Plural Security Insights Security
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
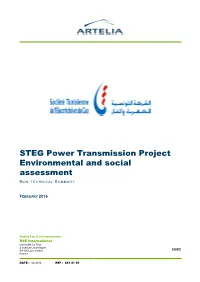
STEG Power Transmission Project Environmental and Social Assessment N ON- TECHNICAL S UMMARY
STEG Power Transmission Project Environmental and social assessment N ON- TECHNICAL S UMMARY FÉBRUARY 2016 ORIGINAL Artelia Eau & Environnement RSE International Immeuble Le First 2 avenue Lacassagne 69 425 Lyon Cedex EBRD France DATE : 02 2016 REF : 851 21 59 EBRD - STEG Power Transmission Project Environmental and social assessment Non- technical Summary FEBRUARY 2016 1. PROJECT DESCRIPTION 1.1. INTRODUCTION The Tunisian national energy company STEG (“Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz”) is currently implementing the Power Transmission Program of its XIIth National Plan (2011-2016). Under this program, the EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) and the EIB (European Investment Bank) are considering contributing to the financing of: a network of high voltage underground power lines in the Tunis-Ariana urban area ; two high-voltage power lines, one in the Nabeul region, the other in the Manouba region; the building or extension of associated electrical substations. The project considered for EBRD/EIB financing consists of 3 sub-components, which are described below. 1.2. SUB-COMPONENT 1: UNDERGROUND POWER LINES IN TUNIS/ARIANA This sub-component comprises a new electrical substation in Chotrana and a series of underground high-voltage power lines: two 225 kV cables, each 10 km in length, from Chotrana to Kram; one 225 kV cable of 12.8 km, from Chotrana to Mnihla; one 90 kV cable of 6.3 km, from “Centre Urbain Nord” substation to Chotrana substation; one 90 kV cable of 8.6 km from « Lac Ouest » substation to Chotrana substation; one 90 kV cable of 2 km from Barthou substation to « Lac Ouest » substation. -

Catalogue Vente Mixte Décembre 2014
MP Catalogue/19-12-2014:MP 10/5/03 19/12/14 14:30 Page 1 REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE La Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline en collaboration avec La Fédération Nationale des Eleveurs de Chevaux et l’Association des Propriétaires et Eleveurs de Pur Sang Organise Une Vente Mixte de Chevaux Pur Sang Arabe et Pur Sang Anglais Le Samedi 27 Décembre 2014 à partir de 10 heures au Haras National de Sidi Thabet MP Catalogue/19-12-2014:MP 10/5/03 19/12/14 14:30 Page 2 SOMMAIRE Pages CONDITIONS DE VENTE 5 REFERENCES DES ETALONS PUR SANG ARABE 8 REFERENCES DES ETALONS PUR SANG ANGLAIS 18 LISTE DES ETALONS DE RACE PUR SANG ARABE 21 LISTE DES PRODUITS DE RACE PUR SANG ARABE 24 LISTE DES PRODUITS DE RACE PUR SANG ANGLAIS 55 LISTE DES POULINIERES DE RACE PUR SANG ARABE 60 LISTE DES POULINIERES DE RACE PUR SANG ANGLAIS 83 LISTE DES CHEVAUX DE RACE PUR SANG ARABE 89 3 MP Catalogue/19-12-2014:MP 10/5/03 19/12/14 14:30 Page 4 SIGNIFICATION DES CARACTERES “GRAS MAJUSCULES” et “GRAS MINUSCULES” CONDITIONS DE VENTE Conformément aux règles établies Les présentes conditions de vente sont réputées connues et acceptées par les vendeurs et les acheteurs. Elles sont applicables à toutes les transactions par l’International Cataloguing Standard Comittee réalisées par la Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (F.N.A.R.C.). Les ventes étant publiques, l’entrée dans l’enceinte de vente est gratuite. -

Entreprise Code Sec Ville Siege Adresse Tel Fax
ENTREPRISE CODE_SEC VILLE_SIEGE ADRESSE TEL FAX 1 BELDI IAA ARIANA Route de Mateur Km 8 71 521 000 71 520 577 2 BISCUITERIE AZAIZ IAA ARIANA 71 545 141 71 501 412 3 COOPERATIVE VITICOLE DE TUNIS IAA ARIANA Sabalet ben Ammar 71 537 120 71 535 318 4 GENERAL FOOD COMPANY IAA ARIANA Rue Metouia BORJ LOUZIR 71 691 036 70 697 104 5 GRANDE FABRIQUE DE CONFISERIE ORIENTALE - GFCO IAA ARIANA 11, Rue des Entrepreneurs Z.I Ariana Aroport 2035 Tunis-Carthage 70837411 70837833 6 HUILERIE BEN AMMAR IAA ARIANA Cebelet Ben Ammar Route de Bizerte Km 15 71 537 324 71 785 916 7 SIROCCO IAA ARIANA Djebel Ammar 71 552 365 71 552 098 8 SOCIETE AMANI IAA ARIANA Route Raoued Km 5 71 705 434 71 707 430 9 SOCIETE BGH IAA ARIANA Z.I Elalia Ben Gaied Hassine 71 321 718/70823945 70823944 10 SOCIETE CARTHAGE AGRO-ALIMENTAIRE IAA ARIANA Bourj Touil 70684001 70684002 11 SOCIETE DE SERVICES AGRICOLES ZAHRA IAA ARIANA Bouhnech - KALAAT EL ANDALUS 25 100 200 12 SOCIETE FROMAGERIE SCANDI IAA ARIANA 23 346 143/706800 70 680 009 13 SOCIETE FRUIT CENTER IAA ARIANA 35 Rue Mokhtar ATTIA 71 334 710 71 857 260 14 SOCIETE GIGA IAA ARIANA 70 308 441 71 308 476 15 SOCIETE GREEN LAND ET CIE IAA ARIANA route el battane jedaida 1124 mannoba 71798987 71784116 16 SOCIETE JASMIN EXPORT IAA ARIANA Rue Mohamed El Habib Route de Raoued Km 7 71 866 817 71 866 826 17 SOCIETE KACEM DE PATISSERIE - KAPCO IAA ARIANA 20 Rue Kalaat Ayoub Riadh El Andalous 71 821 388 71 821 466 18 SOCIETE LABIDI VIANDES IAA ARIANA Borj Touil 71 768 731 71 769 080 19 SOCIETE LE TORREFACTEUR IAA ARIANA Rue de l'argent -

MPLS VPN Service
MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

Section: ARIANA
Section: ARIANA Nom Prénom Adresse Code postal Tél ABDELMOULA AHMED 71,Avenue Habib Bourguiba 2080 ARIANA 71716297 ABDELMOUMEN EP, OUESLATI SOUMAYA Route Principale 7024 IMADA-ZOUAOUINE 72 403 525 ABDENNEBI EP, NAKOURI LILIA 14, Avenue de la Liberté C,C,Tej 1004 EL MENZAH 5 71 237 036 ALOULOU KHEDIJA Cité Commerciale Jamil 2080 ARIANA 71754731 AMARA EP, BEN RHOUMA ZOHRA 19, Rue Taieb M'Hiri 2041 CITE ETTADHAMEN 71 516 453 AMARA EP,MEDDEB CAMELIA Bezina 7012 BAZINA AMMAR EP,KRICHEN ZEINEB 44, Avenue Taieb M'Hiri 2080 ARIANA 71714659 AMRI MOHAMED NEJIB 11,Avenue Habib Bourguiba 1110 MORNAGUIA 71.540.255 ARBI ABDELAZIZ 19, Rue d'Algérie 7030 MATEUR 72485420 ARBI DALENDA 3, Rue d'Algérie 7050 MENZEL BOURGUIBA 72 460 219 AYADI MAHJOUB 15, Rue Musset-Ang rue Algérie 7050 MENZEL BOURGUIBA 72.463.768 AYADI EP, BEN HASSEN FADHILA 112, Avenue HabibBourguiba 2022 KALAAT EL ANDALOUS 71 558 423 AZAIEZ RIDHA Avenue Habib Bourguiba 1124 JEDEIDA 71539110 AZOUZ OLFA Résidence les Orangers- Av, des Orangers 2010 LA MANOUBA 71 603 755 AZOUZ EP, GHORBAL HAGER 1, Avenue de l'Environnement 2021 OUED ELLIL 71535301 AZOUZI EP, FERCHICHI RIM 57, Avenue Taieb M'Hiri 2041 CITE ETTADHAMEN 71 549 230 AZZOUZ ZOUHAIER 19, Avenue Emir Abdelkader- El Bhira 7000 BIZERTE 72 531 136 BACCOUCHE FERID 38, Avenue du 1er Mai 7000 BIZERTE 72 431 113 BAHRI RYM 61, Avenue Habib Bourguiba 7010 SEJNANE 7256114 BAKLOUTI EP, DJEMAL MERIAM Avenue 7 Novembre 7080 MENZEL JEMIL 72 490 600 BAKTACHE OTHMAN 19, Avenue Taieb M'Hiri 7000 BIZERTE 72 431 208 BANANI EP, M'ZAH AMENA 1, Rue de la -

RAISON SOCIALE ADRESSE CP VILLE Tél. Fax RESPONSABLES
Secteur RAISON SOCIALE ADRESSE CP VILLE Tél . Fax RESPONSABLES d’Activité 2MB Ing conseil Cité Andalous Immeuble D Appt. 13 5100 Mahdia 73 694 666 BEN OUADA Mustapha : Ing conseil ABAPLAST Industrie Rue de Entrepreneurs Z.I. 2080 Ariana 71 700 62 71 700 141 BEN AMOR Ahmed : Gérant ABC African Bureau Consult Ing conseil Ag. Gafsa: C-5, Imm. B.N.A. 2100 Gafsa 76 226 265 76 226 265 CHEBBI Anis : Gérant Ag. Kasserine: Av Ali Belhaouène 1200 Kasserine 34, Rue Ali Ben Ghédhahem 1001 Tunis 71 338 434 71 350 957 71 240 901 71 355 063 ACC ALI CHELBI CONSULTING Ing conseil 14, Rue d'Autriche Belvédère 1002 Tunis 71 892 794 71 800 030 CHELBI Ali : Consultant ACCUMULATEUR TUNISIEN (L’) Chimie Z.I. de Ben Arous B.P. N° 7 2013 Ben Arous 71 389 380 71 389 380 Département Administratif & ASSAD Ressources Humaines ACHICH MONGI Av 7 Novembre Imm AIDA 2éme Achich Mongi Ingénieur Conseil Etudes et Assistances Technique Ing conseil Etage bloc A N°205 3000 Sfax 74 400 501 74 401 680 [email protected] ACRYLAINE Textile 4, Rue de l'Artisanat - Z.I. Charguia II 2035 Tunis 71 940 720 71 940 920 [email protected] Carthage Advanced e- Technologies Electronique Z.I. Ariana Aéroport – Imm. Maghrebia - 1080 Tunis Cdx 71 940 094 71 941 194 BEN SLIMANE Anis: Personnel Bloc A Boulevard 7 Novembre – BP www.aetech-solutions.com 290 ADWYA Pharmacie G.P. 9 Km 14 - B.P 658 2070 Marsa 71 742 555 BEN SIDHOM R. -

Evolutions in Times of Democratic Transition
The Middle East Journal Local (r)evolutions in times of democratic transition: Reconstructing political authority in Tunisian municipalities (2011-2014) Frédéric Volpi, Fabio Merone & Chiara Loschi Introduction: contextualizing the Tunisian transition In recent scholarship on democratization in the Arab world, there have been repeated criticisms of the dominance of top-down institutionalist analyses in the period prior to the Arab uprisings.1 This is not to say that bottom-up approaches were not present, as there were indeed very relevant studies produced at the time, even in such unpropitious research settings as Tunisia. Researchers looking at the protests in the mining region of Gafsa in 2008 already highlighted some of the dynamics between local unrest and state authoritarianism that would later impact the Tunisian revolution.2 Similarly, studies had investigated the dynamics of the (crony) neo-liberal reforms of the Tunisian regime at the local level and outlined the many unintended consequences of macro-reforms in the face of local resistance and adaptations.3 Yet in all these cases, 1 Sarah Ben Néfissa, “Révolution Arabes: les Angles Morts de l’Analyse Politique des Sociétés de la Région,” Confluences Méditerranée, Vol. 2, No. 77 (Spring 2011), pp. 75–90; Michelle Pace and Francesco Cavatorta, “The Arab Uprisings in Theoretical Perspective: An Introduction,” Mediterranean Politics, Vol. 17, No. 2 (July 2012), pp. 125–38; and Frédéric Volpi, “Explaining (and re-explaining) Political Change in the Middle East during the Arab Spring: Trajectories of Democratization and of Authoritarianism in the Maghreb,” Democratization, Vol. 20, No. 6 (April 2013), pp. 969–90. 2 Amin Allal, “Réformes Néolibérales, Clientélismes et Protestations en Situation Autoritaire,” Politique Africaine, Vol. -

Journal Officiel De La République Tunisienne — 16 Septembre 2005
Arrêté de ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 12 septembre 2005, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Magcem de la délégation d'El Hamma, au gouvernorat de Gabès. Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16, Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence foncière agricole, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment son article 13, Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, Vu le décret n° 2005-1692 du 6 juin 2005, portant création du périmètre public irrigué de Magcem de la délégation d'El Hamma au gouvernorat de Gabès. Arrête : Article premier. - La procédure de réaménagement foncier est ouverte à compter de la date de publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de Magcem de la délégation d'El Hamma au gouvernorat de Gabès, créé par le décret n° 2005- 1692 du 6 juin 2005 susvisé. Art. 2. - Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. -

A Broadband UHF TAG Antenna for Near-Field and Far-Field RFID Communications
RADIOENGINEERING, VOL. 23, NO.4, DECEMBER 2014 – ERRATA (VERSION OBTAINED AFTER THE DEADLINE) 1 A Broadband UHF TAG Antenna For Near-Field and Far-Field RFID Communications M. MABROUK 1,2, M. DHAOUADI.1,3, T.P. VUONG 4, A.C DE SOUZA4, A. GHAZEL1 1 Laboratoire GRESCOM, SUPCOM de Tunis, Université de Carthage 2 ISETCOM de Tunis, DGET, Route de Raoued Km 3,5, Raoued, 2088, Ariana, Tunisie 3 ISSAT de Mateur, Université de Carthage 4 IMEP-LAHC - UMR 5130, CNRS-INPG-UJF, Minatec-3, Grenoble Cedex 1, France [email protected], [email protected] Abstract. The paper deals with the design of passive It appears today that one of the limitations of RFID broadband Tag antenna for Ultra-High Frequency (UHF) systems is that they do not operate at short distances (near band. The antenna is intended for both near and far fields field). This can be urgently analyzed to invent antennas for Radio Frequency Identification (RFID) applications. The UHF near-field RFID applications. To overcome this meander dipole Tag antenna geometry modification is problem, some work has been reported to address the designed for frequency bandwidth increasing. The design of reader and Tag antennas for near-field RFID measured bandwidth of the proposed broadband Tag applications. Several papers have been published on antenna is more than 140 MHz (820–960MHz), which can near-field reader antennas. In [3], the author proposed a cover the entire UHF RFID band. A comparison between novel RFID reader antenna for simultaneous near-field and chip impedance of datasheet and the measured chip far-field operations at UHF band. -

Updated Checklist and Distribution of Large Branchiopods (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) in Tunisia
Biogeographia – The Journal of Integrative Biogeography 31 (2016): 27–53 Updated checklist and distribution of large branchiopods (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Spinicaudata) in Tunisia FEDERICO MARRONE1,*, MICHAEL KORN2, FABIO STOCH3, LUIGI NASELLI- FLORES1, SOUAD TURKI4 1 Dept. STEBICEF, University of Palermo, via Archirafi, 18, I-90123 Palermo, Italy 2 Limnological Institute, University of Konstanz, Mainaustr. 252, D-78464 Konstanz & DNA-Laboratory, Museum of Zoology, Senckenberg Natural History Collections Dresden, Königsbrücker Landstrasse 159, D- 01109 Dresden, Germany 3 Dept. of Life, Health & Environmental Sciences, University of L’Aquila, Via Vetoio, I-67100 Coppito, L'Aquila, Italy 4 Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Rue du 02 mars 1934, 28, T-2025 Salammbô, Tunisia * e-mail corresponding author: [email protected] Keywords: Branchinectella media, fauna of Maghreb, freshwater crustaceans, Mediterranean temporary ponds, regional biodiversity. SUMMARY Temporary ponds are the most peculiar and representative water bodies in the arid and semi-arid regions of the world, where they often represent diversity hotspots that greatly contribute to the regional biodiversity. Being indissolubly linked to these ecosystems, the so-called “large branchiopods” are unanimously considered flagship taxa of these habitats. Nonetheless, updated and detailed information on large branchiopod faunas is still missing in many countries or regions. Based on an extensive bibliographical review and field samplings, we provide an updated and commented checklist of large branchiopods in Tunisia, one of the less investigated countries of the Maghreb as far as inland water crustaceans are concerned. We carried out a field survey from 2004 to 2012, thereby collecting 262 crustacean samples from a total of 177 temporary water bodies scattered throughout the country. -

Entreprises Agréées
257 02/09/2021 1 CODE POSTAL TÉLÉPHONE EXPIRATION DU N° RAISON SOCIALE ADRESSE FAX LOCALITÉ Mobile Fixe DÉLAI D'AGRÉMENT 1 Abderrazek DERBEL Imm. Derbel, 2ème Etage, Av. 7 Novembre 4081 Zaouiet Sousse 58368100/(101) 73826441 73826441 07/03/2022 B2C2 2 Achraf BECHAH Route de Tunis KM9 Sakiet Ezzit-Rue de la Liberté 3021 Sfax 44141821 10/12/2023 B2C2 3 Alpha Electric Dar El Amen 3111 Kairouan 52304253 77273588 15/02/2023 B2C2 4 Ammar KHLIFI Av. Mohamed Ben Amine - n°6 Bassatine Kasserine 25530317 01/05/2023 B2C2 5 A.M. Industrie 47, Av 4863 Sidi Hassine Sijoumi 1095 Tunis 22585888 71590447 07/11/2021 B2C2 6 A.M.D Services Nouvelle cité Ghazala 7040 Bizerte 26304393 72486356 72485585 07/03/2026 B2C2 7 ARELEC Z.I. Sidi Abdelhamid 4061 Sousse 73322064 / 723 73322137 06/03/2024 B2C2 8 ASE Imp n°001, Rue Sidi Abdeljelil-Berine - Sidi Hassine 1095 Tunis 55273826 31401984 32401984 16/10/2023 B2C2 9 AUTOMELEC Route Taniour KM 6,5 - Diar El Moataz - Residence Omar 3041 Sfax 97475473 74633925 74633951 22/01/2024 B2C2 10 Awatef KHALIFA Omret Ouled Mohamed, Ksar 2111 Gafsa 27865503 16/10/2021 B2C2 11 AZELEC Lot AFH N°508 Mourouj 6 2074 Ben Arous 99454654 97414272 71472820 16/10/2023 B2C4 12 Bargaoui Bâtiment Services 08, Rue Bni Mtir Bardo - BP 212 2010 Manouba 27505858 98329758 79325040 02/10/2022 B2C2 13 Bechir HAMZA Place 14 Janvier 4200 Kebili 98249375 11/11/2024 B2C3 14 BEMAI Route de Mahdia Km4 Merkez Kaâniche 3011 Sfax 74232633 74234000 / 232899 74232542 06/10/2021 B2C5 15 BEN YAHIA Contracting Av. -

Country City Sitename Street Name
Country City SiteName Street name Tunisia Sfax IGL Distribution Rue 13 Aout Zone Industrielle Poudriere I Tunisia Sfax IGL Distribution Rue 13 Aout, Zone industrielle la Poudriere 1 Tunisia Sfax IGL DISTRIBUTION Rue 13 Aout zone industrielle poudriere 1 Tunisia Tunis IGL Distribution 19 , Rue de l'artisanat Charguia 2 Tunisia Sfax IGL Distriution Rue 13 Aout ZI Poudriere I Tunisia Sfax IGL Distribution rue 13 aout, Z I Poudrière 1 Tunisia Tunisie IGL Distribution Rue 13 Aout ZI Pouderier 1 Tunisia Bizerte NeoTech 10 Rue El Banafsej La Corniche Tunisia Bizerte NEOTECH SARL 10 RUE EL BANAFSEJ-LA CORNICHE Tunisia Bizerte NEOTECH 10 rue el banafsej Tunisia City Service Providers street Tunisia Ariana TECHNOPRO duplex FD5 Tunisia Tuis technopro 41 rue ibn rachiq belvedere Tunisia Monastir Info3000 Zone du stade Imm N°1 Tunisia Sousse TOP BUREAU AV HABIB THAMEUR Tunisia Sfax Comptoir d`equipement G route Gremda km 0.5 immeuble phenicia 3002 BP1140 énéral Tunisia Tunis KAL INFORMATIQUE 01 RUE DU ROYAUME DE L`ARABIE SAOUDITE Tunisia Tunis kal informatique 01 rue du royaume de l`arabie saoudite 1002 Tunis Tunisia Sfax PC RETAIL OUTLET Rue 13 AOUT POUDERIERE 1 Tunisia Sousse PC RETAIL OUTLET Wiki Sousse, 2, rue Bechir Sfar Sousse Tunisia Tunis pc retail outlet wiki rue 8609 charguia 1 tunis 2035 Tunisia Ariana pc retail outlet rue 8609 charguia 1 Tunisia Grombalia KENZA Bureautique & AVEUE DE LA PAIX BP57 Informatique Tunisia Tataouine SMSI RUE MOSBAH EL JARBOUA TATAOUINE Tunisia Sousse MEDIAVISION 38 BLD LEOPOLD SENGHOR IMMEUBLE NUIRA Tunisia Tunis