La Pollution Marine Dans La Zone D’Étude
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDF File Generated From
OCCASION This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation. DISCLAIMER This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. FAIR USE POLICY Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO. CONTACT Please contact [email protected] for further information concerning UNIDO publications. For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · [email protected] I~ I L/-0 Situation, evolution et perspect~ves de la Wilaya de Tipasa Rapport par Robert H. -

Rapport Sur Les Priorités Et La Planification Année 2021
République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère des Ressources en Eau Rapport sur les priorités et la planification Année 2021 Volume 2 Octobre/ 2020 Table des matières Contenu Section 1. Message du ministre .......................................................................................4 1.1 Message du ministre ...................................................................................................4 1.2 Déclaration du Secrétaire Général ..............................................................................5 Section 2. Au sujet du portefeuille...................................................................................6 2.1 La mission ...................................................................................................................6 - Production de l’eau domestique, industrielle et agricole, y compris la production et l’utilisation de l’eau de mer dessalée, de l’eau saumâtre et des eaux usées Épurées ;6 2.2 Le ministère ................................................................................................................7 2.3 Fiche Portefeuille ........................................................................................................9 Gestionnaire responsable : Ministre des Ressources en Eau ...............................................9 2.4 Planification des activités pour l’année 2021 ...........................................................11 Section 3. Planification détaillée du programme 01 ......................................................12 -

Étude Originale
Étude originale Les déterminants de l'adoption du système d'irrigation par goutte-à-goutte par les agriculteurs algériens de la plaine de la Mitidja Salima Salhi1 2 Résumé Amar Imache ` ´ ´ ´ 3 Durant la derniere decennie, l’Algerie a encourage l’adoption de techniques d’irrigation Jean-Philippe Tonneau plus e´conomes en eau, comme l’irrigation par goutte-a`-goutte, en subventionnant les 1 Mohamed-Yassine Ferfera agriculteurs graˆce a` un plan national de de´veloppement agricole. Cette initiative n’a connu 1 Cread le succe`s qu’aupre`s d’un nombre restreint d’agriculteurs. L’objectif de l’article est Rue Djamel Eddine-El-Afghani- El-Hammadia d’identifier les de´terminants qui influencent les agriculteurs alge´riens dans leur choix (Bouzareah) d’adopter le syste`me d’irrigation par goutte-a`-goutte. Du point de vue me´thodologique, le BP 197 mode`le ‘‘Logit’’ nous a permis de mettre en e´vidence les variables significatives qui influent Rostomia (Alger) sur la strate´gie des agriculteurs quant a` l’adoption de cette innovation. Les re´sultats Algerie montrent que montant de subvention, type de culture pratique´e, niveau d’instruction <[email protected]> <[email protected]> affectent positivement l’adoption du goutte-a`-goutte. En revanche, le couˆtde 2 l’investissement, les conditions d’acce`sa` la subvention et le manque d’ouvrage Lisode hydraulique semblent avoir un effet ne´gatif sur l’adoption de ce syste`me d’irrigation 361, rue J-F Breton BP 5095 e´conome en eau. 34196 Montpellier cedex 05 Mots cle´s:agriculture ; Alge´rie ; innovation ; irrigation localise´e;me´thodes d’irrigation ; France <[email protected]> Mitidja ; mode`le de simulation ; pe´rime`tre irrigue´. -
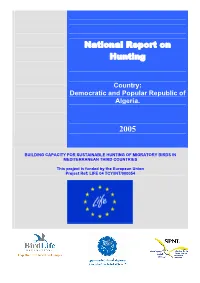
National Report on Hunting 2005
National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria. 2005 BUILDING CAPACITY FOR SUSTAINABLE HUNTING OF MIGRATORY BIRDS IN MEDITERRANEAN THIRD COUNTRIES This project is funded by the European Union Project Ref: LIFE 04 TCY/INT/000054 National Report on Hunting Country: Democratic and Popular Republic of Algeria Prepared by: Dr Mohammed BELHAMRA 2005 SOMMAIRE A/ La chasse et les activités de chasse 1. Noms et coordonnées gèo-rèfèrentielles des principales zones de chasse 2. Liste des espèces d’oiseaux migrateurs chassées 3. Nombre d’oiseaux chassés par espèce et par localité 4. Détails relatifs aux méthodes de chasse utilisées 5. Estimation de la charge en plomb introduite dans l’environnement à travers l’exercice de la chasse. 6. Types de chasseurs et nombres de chasseurs part type 7. Nombre de chasseurs enregistrés en 2004/2005 et estimation du nombre de braconniers 8. Noms et adresses des associations de chasseurs nationales et locales et détails relatifs à leurs membres 9. Appréciation des activités de chasse touristique 10. Détails relatifs aux bagues d’oiseaux retrouvées sur des oiseaux tués dans le cadre de la chasse 11. Appréciations des donnés manquantes et du besoin de recherche en matière de chasse des oiseaux migrateurs. B/ La législation en matière de chasse des oiseaux migrateurs et application de la réglementation en vigueur 1. organisation de la gestion de la chasse (responsabilités des institution gouvernementales, des association de chasseurs et autres organisations de chasseurs et autre organisation, formes de collaboration par exemple en matière de formation et livraison de chasse, etc.). 2. principale législation pertinente en matière de chasse des oiseaux migrateurs et les limitations fixées en ce qui concerne les périodes de chasse, le nombre d’oiseaux par espèce et par période de chasse autorisée, les espèces gibier, les espèces protégées, 2 restriction en ce qui concerne les horaires, les zones, la fréquence et les méthodes de chasse, etc. -

BILAN 2013 Sepulutures Algerie
Ministère des Affaires étrangères BILAN ET PERSPECTIVES SUR LES SEPULTURES CIVILES EN ALGERIE FEVRIER 2013 2 SOMMAIRE I – Synthèse Page 4 II – Etat des lieux du plan d’action et de coopération relatif aux Page 7 sépultures civiles françaises en Algérie 2003-2011 1- Circonscription d’Alger Page 8 2- Circonscription d’Annaba Page 12 3- Circonscription d’Oran Page 16 III – Etat des lieux de la seconde phase du plan d’action et de Page 18 coopération relatif aux sépultures civiles françaises en Algérie 1- Circonscription d’Alger Page 19 2- Circonscription d’Annaba Page 24 3- Circonscription d’Oran Page 27 IV – Travaux prévus 2013-2015 Page 29 1- Circonscription d’Alger Page 30 2- Circonscription d’Annaba Page 31 3- Circonscription d’Oran Page 32 V – Budget Page 33 1- Tableau récapitulatif des dépenses engagées dans la circonscription Page 34 d’Alger – 2005-2012 2- Tableau récapitulatif des dépenses engagées dans la circonscription Page 35 consulaire d’Annaba – 2005-2012 3- Tableau récapitulatif des dépenses engagées dans la circonscription Page 36 consulaire d’Oran – 2008-2012 4- Fonds de Concours Page 37 3 ANNEXES Annexe n° 1 : Plan d’action et de coopération relatif aux sépultures civiles françaises en Algérie (texte) Annexe n° 2 : Arrêté du 7 décembre 2004 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie. Annexe n° 3 : Arrêté du 12 décembre 2005 portant autorisation de regroupement des cimetières chrétiens en Algérie Annexe n° 4 : Arrêté du 9 octobre 2007 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises dans l’ouest de l’Algérie. Annexe n° 5 : Arrêté du 29 juin 2009 portant autorisation de regroupement des cimetières chrétiens en Algérie Annexe n° 6 : Arrêté du 23 juin 2011 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie Annexe n° 7 : Arrêté du 21 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 23 juin 2011 relatif au regroupement de sépultures civiles françaises en Algérie. -

République Algérienne Démocratique Et Populaire Ministère De L
Sciences & Technologie D - N°43, Juin (2016). pp.59-68 DIFFUSION D’URBANISATION ET TENDANCE A LA CONURBATION CAS DE TIPASA ; ALGERIE. N.TOUAT Institut de Gestion et Techniques Urbaines, Université Constantine 3, Algérie Reçu le 21/09/2015– Accepté le 03/04/2016 Résumé Dans le cadre de l’amélioration du niveau de vie des habitants de Tipasa et vu l’état actuel de son réseau urbain, les préoccupations des responsables et des spécialistes du domaine sont multiples notamment celle de : la maîtrise de la croissance urbaine, la lutte contre la dilapidation des espaces agricoles, la promotion d’un habitat équilibré, la réhabilitation des quartiers à handicaps, l’éradication de l’habitat précaire…etc. C’est dans ce contexte qu’il est question de savoir dans quelle mesure peut-on rompre avec la logique de répondre spontanément ; à chaque fois aux besoins d’une population sans cesse croissante et s’inscrire plutôt dans un cadre régional d’un système urbain plus équilibré, hiérarchisé et articulé, capable de structurer un territoire compétitif ? Mots clés: Tipasa, réseau urbain, territoire compétitif, aire métropolitaine, conurbation. Abstract For the sake of improving the life quality of the inhabitants of Tipasa concerning the current conditions of the urban network, the authorities and specialists raise numerous issues and concerns. Indeed, the concerns are mainly related to the control of the urban growth, besides thefight against the urban sprawl toward the agricultural spaces.Moreover, these concerns are associated also to the promotion of a balanced housing, and the rehabilitation of handicapped and weakened neighborhoods.In addition, theinterest is directed toward the eradication of precarious housing and the control of the urban growth as well. -

Projet MPRH-PNUD-FAO Appui À La Formulation De La Stratégie Nationale
Projet MPRH-PNUD-FAO Appui à la formulation de la stratégie nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture 2015.2020 (avec une attention particulière sur la pêche artisanale) Rapport final 2 Appui à l’organisation et au fonctionnement des circuits de commercialisation des produits de la pêche et d’aquaculture. Analyse des programmes de réalisation des halles à marée du MPRH: forces et faiblesse et principaux scenarios Chérif OMARI Expert en commercialisation des produits de la pêche et d’aquaculture [email protected] - Novembre 2014 – 2 1. Introduction Le Ministère de la pêche et des ressources halieutiques (MPRH) a initié des actions pour le développement de la pêche et de l’aquaculture notamment en ce qui concerne la gestion de la ressource halieutique, la commercialisation, la formation, l’organisation de la profession, le programme de développement de l’aquaculture, le projet d’intégration au développement de la pêche artisanale. Appuyé de partenaires au développement, le Ministère de la pêche et des ressources halieutiques entend mettre en cohérence et en synergie l’ensemble de ces résultats qui vont constituer les éléments structurants de la stratégie nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture. Cette assistance préparatoire vise l’Appui à la formulation de la stratégie nationale de développement de la pêche et de l’aquaculture (avec une attention particulière sur la pêche artisanale) 2015.2020. Dans ce cadre, notre mission consiste à fournir « un appui à l’organisation et au fonctionnement des circuits de commercialisation des produits de la pêche et d’aquaculture ». Notamment, l’examen des programmes de construction d’infrastructure au niveau des ports, en particulier la réalisation et la réhabilitation des halles à marées, des structures de distribution et des marchés de commercialisation, en mettant en exergue les points forts et les points faibles par rapport au contexte actuel de l’organisation du circuit de commercialisation. -

La Seaal Supplante L'ade
L’Algérie profonde / Actualités Distribution de l’eau potable à Tipasa La Seaal supplante l’ADE Même les 9 autres localités où l’eau est gérée par les services de l’APC : Attatba, Larhat, Mousselmoun, Gouraya, Damous, Beni Mellek, Aghbal, Sidi Sémiane et Hadjret Ennas, sont concernés par le contrat signé le 19 décembre dernier. La Société de l’eau et de l’assainissement d’Alger (Seaal) gère désormais l’eau à travers la wilaya de Tipasa, et ce, depuis le du 1er Janvier 2012, apprend-on auprès du directeur de l’Algérienne des eaux (ADE) Tipasa, M. Mohcen Dia. “Le contrat a été finalisé le 19 décembre en présence des autorités locales et actuellement nous dressons un état des lieux”, indique notre source qui n’est cependant pas en mesure de nous préciser le montant de l’accord de partenariat signé entre les deux parties. “Pour le moment présent, nous sommes en phase de diagnostic du réseau de distribution de l’eau potable, du fonctionnement de l’ADE ainsi que des carences et des problèmes liés à la gestion”, précise notre source. Revenant sur les moyens humains et matériels, notre interlocuteur que l’aspect a pris en ligne de compte les métiers spécialisés de l’eau, les cadres dirigeants ainsi que les différents métiers comme ceux de la plomberie, la soudure et des agents d’exécution, cite M. Dia à titre d’exemple. Le 2e volet quant à lui concerne la remise à niveau du réseau d’eau et de l’assainissement, les stations de pompage, les forages et les conduites. -

F20060591.Pdf
N° 59 Dimanche Aouel Ramadhan 1427 45ème ANNEE Correspondant au 24 septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION Algérie ETRANGER SECRETARIAT GENERAL Tunisie (Pays autres DU GOUVERNEMENT ABONNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye WWW. JORADP. DZ Mauritanie Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 Edition originale….........….........…… 1070,00 D.A 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 Edition originale et sa traduction....... 2140,00 D.A 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d'expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d'adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 Aouel Ramadhan 1427 2 24 septembre 2006 S O M M A I R E DECRETS Décret exécutif n° 06-326 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 complétant le décret exécutif n° 92-118 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services extérieurs du Trésor........................................................................................................................................................................................ -

Correspondances LNFA
Correspondances F.A.F : Du Secrétaire Général de la Fédération Algérienne de Football, concernant l’indemnité versé au club formateur lors des transferts des joueurs. Pris Note. Du Secrétaire Général de la Fédération Algérienne de Football, concernant le plateau régional U-19. Pris Note et Transmis à la D.T.R. De la commission de la coupe d’Algérie, concernant une demande de commissaire au match lors des rencontres de la coupe d’Algérie (U-19 et U-17). Pris Note et Nécessaire Fait. Correspondances C.F.A : Nénat. Correspondances L.F.P : Néant. Correspondances L.N.F.A : Néant. Correspondances L.I.R.F : Néant. Correspondances L.F.F : Néant. Correspondances D.T.N : Néant. Correspondances L.F.W : Ain Defla : Néant. Blida : Néant. Chlef : Du Secrétaire Général de la Ligue de Football de la Wilaya de Chlef, concernant la liste nominative des stagiaires DEF S1. Pris Note et Transmis à la D.T.R. Médéa : Néant. Tipaza : Du Secrétaire Général de la Ligue de Football de la Wilaya de Tipaza, concernant une demande d’un trio d’arbitres au stade de Fouka le 23 Février 2019. Pris Note et Transmis à la D.T.R.A. Djelfa : Néant. « Standard » Tél : 025.30.76.37 Fax : 025.30.76.17 Site : www.lrf-blida.dz 1 Correspondances Clubs : Régionale I : Du C.S.A // M.C.Khemis, concernant une demande d’un commissaire au match lors de la rencontre C.R.B.Beni Tamou // M.C.Khemis le 22 Février 2019. Pris Note et Transmis et Nécessaire Fait. Du C.S.A // C.R.Zoubiria, concernant le non déroulement des rencontres « Jeunes » au stade de Messaad le 15 Février 2019. -

10 6 Eme Journee 10 11 2017
Fédération Algérienne de Football Ligue Régionale de Football de Blida Programme des rencontres « Seniors » et « Jeunes » Vendredi 10 Novembre 2017 06 ème Journée du championnat RI « SENIORS» ARBITRE 1èr 2éme Lieux Rencontres Horaire DIRECTEUR Assistant Assistant OUED FODDA J.M.Oum Drou / C.R.Zoubiria 15H00 YAHIAOUI ARIOUAT GHELLAB BLIDA BRAKNI I.R.B.Ouled Yaich / M.S.Cherchell 15H00 ABDOUCHE CHIBI GUESSAR Régionale II Groupe « A » 06ème Journée du championnat « Seniors » ARBITRE 1èr 2éme Lieux Rencontres Horaire DIRECTEUR Assistant Assistant MESSAAD N.R.B.Messaad / I.R.Ouled Nail 15H00 MAKHLOUFI BOURAKI DIFALLAH SIDI GHILES I.R.B.Sidi Ghiles / M.C.Hassi Bahbah 15H00 BERKANE BENAICHOUBA OULD ALI BOUFARIK C.B.Beni Mered / J.S.M.Boufarik 15H00 AZZOUZ-R BOUKROUH KHERROUBI MEFTAH W.B.Meftah / H.B.Guerrouaou 15H00 BOUTALEB DECHE CHAAMBY Régionale II Groupe « B » 06ème Journée du championnat « Seniors » ARBITRE 1èr 2éme Lieux Rencontres Horaire DIRECTEUR Assistant Assistant BOUMEDFAA I.R.B.Hammam Righa / S.C.Miliana 15H00 DJELLOULI LAKSAS HADDI CHAIBA C.R.B.Chaiba / F.C.M.Bourkika 15H00 SAKAT LEMOUCHI BOURAHIM HADJOUT E.B.Hadjout / S.C.M.Blida 15H00 LAHOUAL BENMOUFAK HIDJOUL AIN MERANE C.S.A.B.Ain Merane / C.C.Rouina 15H00 HELLALI KHELIFI SOUKHAL ATTATBA N.B.Bou Ismail / O.M.Sidi Lakhdar 15H00 BENOKBA OUARI-Z LARADJI Fédération Algérienne de Football Ligue Régionale de Football de Blida Programme des rencontres « Seniors » et « Jeunes » Samedi 11 Novembre 2017 06ème Journée du championnat RI « SENIORS» ARBITRE 1èr 2éme Lieux Rencontres Horaire -

Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest
COMPETENCE TERRITORIALE DES COURS Cour d’Adrar Cour Tribunaux Communes Adrar Adrar - Bouda - Ouled Ahmed Timmi Tsabit - Sebâa- Fenoughil- Temantit- Temest. Timimoun Timimoun - Ouled Said - Ouled Aissa Aougrout - Deldoul - Charouine - Adrar Metarfa - Tinerkouk - Talmine - Ksar kaddour. Bordj Badji Bordj Badj Mokhtar Timiaouine Mokhtar Reggane Reggane - Sali - Zaouiet Kounta - In Zghmir. Aoulef Aoulef - Timekten Akabli - Tit. Cour de Laghouat Cour Tribunaux Communes Laghouat Laghouat-Ksar El Hirane-Mekhareg-Sidi Makhelouf - Hassi Delâa – Hassi R'Mel - - El Assafia - Kheneg. Aïn Madhi Aïn Madhi – Tadjmout - El Houaita - El Ghicha - Oued M'zi - Tadjrouna Laghouat Aflou Aflou - Gueltat Sidi Saâd - Aïn Sidi Ali - Beidha - Brida –Hadj Mechri - Sebgag - Taouiala - Oued Morra – Sidi Bouzid-. Cour de Ghardaïa Cour Tribunaux Communes Ghardaia Ghardaïa-Dhayet Ben Dhahoua- El Atteuf- Bounoura. El Guerrara El Guerrara - Ghardaia Berriane Sans changement Metlili Sans changement El Meniaa Sans changement Cour de Blida Cour Tribunaux Communes Blida Blida - Ouled Yaïch - Chréa - Bouarfa - Béni Mered. Boufarik Boufarik - Soumaa - Bouinan - Chebli - Bougara - Ben Khellil – Ouled Blida Selama - Guerrouaou – Hammam Melouane. El Affroun El Affroun - Mouzaia - Oued El Alleug - Chiffa - Oued Djer – Beni Tamou - Aïn Romana. Larbaa Larbâa - Meftah - Souhane - Djebabra. Cour de Tipaza Cour Tribunaux Communes Tipaza Tipaza - Nador - Sidi Rached - Aïn Tagourait - Menaceur - Sidi Amar. Kolea Koléa - Douaouda - Fouka – Bou Ismaïl - Khemisti – Bou Haroum - Chaïba – Attatba. Hadjout Hadjout - Meurad - Ahmar EL Aïn - Bourkika. Tipaza Cherchell Cherchell - Gouraya - Damous - Larhat - Aghbal - Sidi Ghilès - Messelmoun - Sidi Semaine – Beni Milleuk - Hadjerat Ennous. Cour de Tamenghasset Cour Tribunaux Communes Tamenghasset Tamenghasset - Abalessa - Idlès - Tazrouk - In Amguel - Tin Zaouatine. Tamenghasset In Salah Sans changement In Guezzam In Guezzam.