Sport Et Mondialisation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Decision Adjudicatory Chamber FIFA Ethics Committee
Decision of the adjudicatory chamber of the FIFA Ethics Committee Mr Vassilios Skouris [GRE], Chairman Ms Margarita Echeverria [CRC], Member Mr Melchior Wathelet [BEL], Member taken on 26 July 2019 in the case of: Mr Ricardo Teixeira [BRA] Adj. ref. no. 14/2019 (Ethics 150972) I. Inferred from the file 1. Mr Ricardo Teixeira (hereinafter “Mr Teixeira” or “the official”), Brazilian national, has been a high-ranking football official since 1989, most notably the president of the Confederação Brasileira de Futebol (CBF) from 1989 until 2012. He was a mem- ber of the FIFA Executive Committee from 1994 until 2012 and a member of the CONMEBOL Executive Committee. Additionally, he was a member of several stand- ing committees of FIFA, such as the Organising Committee for the FIFA Confedera- tions CupTM, Organising Committee for the FIFA World CupTM, Referees Committee, Marketing and TV Committee, Futsal and Beach Soccer Committee, Ethics Commit- tee and Committee for Club Football. 2. On 27 May 2015, the United States Department of Justice (hereinafter “DOJ”) is- sued a press release relating to the Indictment of the United States District Court, Eastern District of New York also dated 27 May 2015 (hereinafter “the Indictment”). In the Indictment, the DOJ charged several international football executives with “racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies, among other of- fenses, in connection with their participation in a twenty-four-year scheme to enrich themselves through the corruption of international soccer”. The Indictment was fol- lowed by arrests of various persons accused therein, executed by state authorities in Europe, South America and the United States of America. -

Análisis De Contenido Del Comercial De Nike De La Campaña “Escribe El Futuro” En El Mundial 2010 Y Su Contextualización En El Discurso De La Postmodernidad
ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL COMERCIAL DE NIKE DE LA CAMPAÑA “ESCRIBE EL FUTURO” EN EL MUNDIAL 2010 Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN EL DISCURSO DE LA POSTMODERNIDAD DIANA MARCELA LOANGO CAVIEDES SARA MARÍA ZAMORA CUELLAR UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLCITARIA SANTIAGO DE CALI 2012 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL COMERCIAL DE NIKE DE LA CAMPAÑA “ESCRIBE EL FUTURO” EN EL MUNDIAL 2010 Y SU CONTEXTUALIZACIÓN EN EL DISCURSO DE LA POSTMODERNIDAD DIANA MARCELA LOANGO CAVIEDES SARA MARÍA ZAMORA CUELLAR Pasantía de Investigación con el grupo GIMPU (Grupo de Investigación de Mercadeo y Publicidad) Para optar al título de Comunicador Publicitario Directora: CARMEN ELISA LERMA Publicista y Psicóloga UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLCITARIA SANTIAGO DE CALI 2012 Nota de aceptación: Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Comunicador Publicitaria. PAOLA GÓMEZ Jurado CARMEN ELISA LERMA Director Santiago de Cali, 13 de Febrero de 2012 3 AGRADECIMIENTOS Principalmente le agradezco a Dios, por haberme permitido emprender mis estudios de Comunicación publicitaria satisfactoriamente, por darme la fortaleza y la motivación de seguir adelante con el proceso y con este proyecto de investigación, el cual fue desarrollado con el mayor esfuerzo. Asimismo a mi madre y mi padre por estar ahí siempre, apoyando, animando, levantando en los momentos de altibajo y alentando en las situaciones de cansancio donde uno creo que el culminar este proceso será totalmente complejo; por estas razones y mucho más, les agradezco con todo mi corazón el verdadero esfuerzo que hacen por mí, por lo que soy y por todo lo que puede llegar a ser. -

Plan Estrategico De Publicidad
El papel del logotipo como elemento evocador de una personalidad de marca Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis Authors Lindo Noriega, Patricia Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) Rights info:eu-repo/semantics/openAccess Download date 27/09/2021 05:32:42 Link to Item http://hdl.handle.net/10757/576106 CAPÍTULO 1 LOS MUNDOS EXISTENTES EN UN LOGOTIPO Si uno no sabe historia, no sabe nada: es como ser una hoja y no saber que forma parte del árbol. Michael Crichton. Los logotipos son elementos que se engranan dentro de un gigantesco sistema que incluye símbolos, signos y significados distintos. Más allá del marketing y las marcas, hoy estos elementos forman parte de la vida diaria y de la cultura. En consecuencia, el entendimiento de su importancia y significado es fundamental para cualquier profesional inmerso en el campo de las comunicaciones. El presente capítulo desarrolla un marco teórico con el fin de establecer un punto de partida que permita la comprensión de las teorías y conceptos generados a través del tiempo sobre el papel del logotipo y su poder en los diferentes ámbitos relacionados con la identidad de una marca, su personalidad y sus consumidores. Como primer punto, se exponen las nociones básicas acerca de la definición del logotipo: concepto, clases, principales funciones y características, el proceso de creación gráfica y sus diferentes aplicaciones prácticas. Luego, se desarrolla un análisis de este elemento a través de la historia: su origen y proceso de evolución, desde los inicios de la humanidad hasta la actualidad. Por último, se describe su inserción dentro del escenario planteado por el marketing; así como su relación con la evocación de la personalidad y la identidad de una marca y de sus consumidores. -

Publicidad Inclusiva: La Nueva Apuesta De Nike
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL MODALIDAD PRESENCIAL DOCUMENTO PROBATORIO DEL EXAMEN COMPLEXIVO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL TEMA: PUBLICIDAD INCLUSIVA: LA NUEVA APUESTA DE NIKE AUTOR: MANJARRES GARCIA KATERINE IVETT TUTOR: MSC. LEMOS BELTRAN DANIEL GUSTAVO BABAHOYO - ECUADOR 2019 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENCIAL DEDICATORIA Dedico el presente trabajo a mi Familia, a mi querido esposo Joe Chocho por brindarme ese apoyo incondicional y confiar en mí, el esfuerzo y sacrificio en ayudarme para terminar mi carrera y ofrecerme siempre ese apoyo, esto nos ayudará en nuestro futuro. Por otra parte, siempre agradecida con Dios por obsequiarnos fuerzas, y ganas cada día para seguir adelante, ya que la vida es un reto y hay que aprender a vivirla. También esté presente proyecto de investigación está dedicado a mis pequeños hijos, que son mi mayor motivación para dejar mis temores y cada día querer superarme más, y así poder ser un ejemplo para ellos. MANJARRES GARCIA KATERINE IVETT II UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL PRESENCIAL AGRADECIMIENTO Agradezco primeramente a Dios por darme salud, sabiduría, y las ganas de superarme, también quiero dar gracias a todos los docentes que impartían sus enseñanzas con tanto empeño y dedicación, dignos de admirar, ellos que son como un ejemplo a seguir para nosotros, gracias por ese tiempo y entusiasmo a la hora de dirigir a todos por un buen camino, ya que ellos aparte de ser nuestros maestros, fueron como amigos, siempre listos y dispuestos a dar un consejo. -

Qatar 2022™ Sustainability Strategy 3
Sustainability Strategy 1 FIFA World Cup Qatar 2022TM Sustainability strategy 2 FIFA World Cup Qatar 2022™ Sustainability Strategy 3 Contents Foreword by the FIFA Secretary General 4 Foreword by the Chairman of the FIFA World Cup Qatar 2022 LLC and Secretary General of the Supreme Committee for Delivery & Legacy 6 Introduction 8 The strategy at a glance 18 Human pillar 24 Social pillar 40 Economic pillar 56 Environmental pillar 64 Governance pillar 78 Alignment with the UN Sustainable Development Goals 88 Annexe 1: Glossary 94 Annexe 2: Material topic definitions and boundaries 98 Annexe 3: Salient human rights issues covered by the strategy 103 Annexe 4: FIFA World Cup Qatar 2022™ Sustainability Policy 106 4 FIFA World Cup Qatar 2022™ Sustainability Strategy 5 Foreword © Getty Images by the FIFA Secretary General Sport, and football in particular, has a unique capacity The implementation of the FIFA World Cup Qatar We are also committed to delivering an inclusive As a former long-serving UN official, I firmly believe to inspire and spark the passion of millions of fans 2022™ Sustainability Strategy will be a central FIFA World Cup 2022™ tournament experience that in the power of sport, and of football in particular, around the globe. As the governing body of element of our work to realise these commitments is welcoming, safe and accessible to all participants, to serve as an enabler for the SDGs, and I am football, we at FIFA have both a responsibility and over the course of the next three years as we attendees and communities in Qatar and around personally committed to seeing FIFA take a leading a unique opportunity to harness the power of the prepare to proudly host the FIFA World Cup™ in the world. -

Finanzas-2020-En.Pdf
ÍNDICETABLE OF DE CONTENTS CONTENIDOS FINANCIAL REPORT 2020 BUDGET 2021 [06] LETTER FROM THE PRESIDENT OF CONMEBOL [46] ESTIMATED 2021 STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES [08] LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE FINANCIAL COMMISSION [48] 2021 BUDGET FOR PLANNED INVESTMENTS [10] SUMMARY OF THE YEAR 2020 [49] DIRECT INVESTMENT IN FOOTBALL 2021 [12] OPINION FROM PWC INDEPENDENT AUDITORS ON THE [49] EVOLUTION OF CLUB TOURNAMENT PRIZES 01 [50] EVOLUTION OF INVESTMENT IN FOOTBALL 2016-2021 FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2020 02 [14] BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2020 [52] CONTRIBUTIONS BY TOURNAMENTS TO CLUBS BY CONMEBOL [15] STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES AS OF LIBERTADORES, COMPARING YEARS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 DECEMBER 31, 2020 AND 2021 [16] STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AS OF DECEMBER 31, 2020 [53] CONTRIBUTIONS BY TOURNAMENTS TO CLUBS BY CONMEBOL [17] CASH FLOW STATEMENT SUDAMERICANA, COMPARING YEARS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 [18] NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS AND 2021 [40] INTERNAL AUDIT REPORT [54] CONTRIBUTIONS BY TOURNAMENTS TO CLUBS BY CONMEBOL [42] CERTIFICATES OF COMPLIANCE RECOPA, COMPARING YEARS 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 AND 2021 [56] COMMISSION OF COMPLIANCE AND AUDITING REPORT [57] FINANCIAL COMMISSION REPORT 2020 2020 l l FINANCIAL REPORT FINANCIAL FINANCIAL REPORT FINANCIAL 2 3 FINANCIAL REPORT 2020 [06] LETTER FROM THE PRESIDENT OF CONMEBOL [08] LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE FINANCIAL COMMISSION [10] SUMMARY OF THE YEAR 2020 [12] OPINION FROM PWC INDEPENDENT AUDITORS ON THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2020 [14] BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31, 2020 [15] STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURES AS OF DECEMBER 31, 2020 [16] STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY AS OF DECEMBER 31, 2020 [17] CASH FLOW STATEMENT 01[18] NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS [40] INTERNAL AUDIT REPORT [42] CERTIFICATES OF COMPLIANCE Dear South American because it speaks for CONMEBOL’s seriousness and football family; responsibility, as well as the very positive image it projects. -
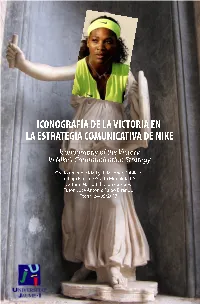
TFG 2017 Taboadacampos M
ICONOGRAFÍA DE LA VICTORIA EN LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE NIKE Iconography of the Victory in Nike’s Communication Strategy Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Trabajo Final de Grado Modalidad A Autora: Marta Taboada Campos Tutor: José Antonio Palao Errando Fecha: 24/05/2017 ICONOGRAFÍA DE LA VICTORIA EN LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DE NIKE RESUMEN Y PALABRAS CLAVE Resumen: Este trabajo propone desvelar la estrategia creativa de Nike, indagando en un aspecto concreto de la misma: la representación visual del mito de la Victoria. A través del análisis iconográfico de sus representaciones visuales durante los últimos 30 años (1985-2015) y de la división cronológica de las etapas clave de su historia publicitaria, hemos llevado a cabo una lectura analítica de su discurso. Dicho análisis ha servido para extrapolar un modelo estratégico válido centrado en el análisis iconográfico. Nike ha mantenido una misma línea estratégica basada en la victoria personal de sus consumidores, instaurando así un estilo y un tono representativos de su identidad corporativa. En primer lugar, Nike fue pionero en el sector de la moda deportiva en utilizar el storytelling como método creativo. La marca entendió la complejidad y la competitividad del mercado y llevó sus productos no sólo al terreno atlético, sino a todo tipo de targets, a través de un discurso social. Este fue el gran logro comunicativo de Nike: transmitir a los consumidores que todo aquel que lo ansíe, puede llegar a ser un gran atleta. En segundo lugar, Nike entendió los comportamientos que se crean alrededor del universo deportivo y de aquellos que lo practican. -

AFC STATUTES Edition 2020
AFC STATUTES Edition 2020 Regulations Governing the Application of the Statutes Standing Orders of the Congress Asian Football Confederation President: Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa General Secretary: Dato’ Windsor John Address: AFC House Jalan 1/155B, Bukit Jalil 57000 Kuala Lumpur Malaysia Telephone: +603 8994 3388 Fax: +603 8994 2689 Internet: the-AFC.com 2 ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION AFC Statutes Edition 2020 the.afc.com 3 TABLE OF CONTENTS Article Contents Page Definitions 8 Chapter 1: The AFC 10 1 Title, Legal Form, Headquarters and Language 10 2 Objectives 10 3 Fundamental Principles 11 4 Promoting Friendly Relations 11 5 Laws of the Game 12 6 Conduct of Persons and Organisations 12 7 Membership 12 8 Application for Membership 14 9 Rights of Member Associations 14 10 Obligations of Member Associations 14 11 Suspension 16 12 Expulsion 16 13 Resignations 17 14 Status and Recognition of Regional Associations 17 15 Status and Recognition of Member Associations 18 16 Status of Clubs, Leagues, Domestic Associations and Other 18 Groups Of Stakeholders Affiliated to a Member Association 17 Honorary Appointments and Awards 19 18 AFC Organisation Regulations 20 19 Bodies 20 Chapter 2: The Congress 21 20 Definition and Composition of the Congress 21 21 Delegates and Voting 21 22 Area of Authority 22 23 Quorum of the Congress 23 24 Decisions of the Congress 23 25 Elections 23 4 ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION AFC Statutes Edition 2020 Article Contents Page 26 Ordinary Congress 24 27 Ordinary Congress Agenda 25 28 Extraordinary Congress -

Origen De La Marca
ORIGEN DE LA MARCA 1950 Nacimiento de la idea El entrenador de la Universidad de Oregon, Estados Unidos, Bill Bowerman, en su afán de darles ventajas a sus deportistas durante las competencias, decide que era necesario hacerle modificaciones al calzado que se usaba diariamente. La Propuesta Junto con un alumno suyo de Oregon, Phil Knight, y pronto colega, decidieron proponer a varias compañías de calzado en Japón que hicieran los cambios pensados a los modelos de calzado para revolucionar esta prenda deportiva en los Estados Unidos y ganar el dominio de dicha industria. 1960 Blue Ribbon Sports Luego de llegar a un acuerdo con la marca japonesa “Tiger”, el profesor y el estudiante forman una alianza para la distribución del calzado extranjero en EEUU creando una sociedad con el nombre de “Blue Ribbons Sports”. Su primera compra fue una orden de 100 pares de zapatillas las cuales se vendieron en el local de Knight en 1964. 1965 Jeff Johnson Gracias al crecimiento de BRS era necesario que los colegas encontraran a otra persona que los ayudara con el manejo de la empresa. Ahí es cuando apareció Jeff Johnson, una ficha clave para la compañía. Generando bajo costo, él fue el que impulsó la publicidad de la marca y que la introdujo a los catálogos de indumentaria. Consecuencias del marketing BRS despegó comercialmente gracias a la movida de Johnson. Fue por esto, que decidieron abrir un local vía correo que fuera al por menor en Santa Mónica, California. Esto generó un crecimiento sustancial de la empresa. 1970 Creación de NIKE El trío toma la decisión de cortar sus lazos con la empresa japonesa y dejar de distribuir sus productos por Estados Unidos. -

Bheki Hlabane
Bheki Hlabane Title: The Political, Economic And Social Impact Of Hosting Mega-Sports Events: The 2010 South Africa World Cup In Comparative Perspective PhD Thesis submitted to: Ritsumeikan Asia Pacific University (APU). Asia Pacific Studies (APS) 2012 Acknowledgements I am deeply thankful to my supervisor, Prof Jeremy Eades, whose support and guidance has served as a pillar of strength and encouragement throughout my studies. His approach and positive attitude had been the key in helping me develop a better understanding of the issues. I would also like to extend my gratitude to Prof Malcolm Cooper for giving direction throughout my fieldwork process. Further acknowledgements are due to the South African Tourism office in Japan and the South African Embassy in Japan. Both have made a significant contribution in my PhD studies in Japan. The chance to have such an exciting and educational research experience would not have been possible without the quality of programs offered at Ritsumeikan Asia Pacific University. In addition, the University helped me with material support, technical support and in participation in student life. They say life is a journey. I guess that is also true with studying towards a PhD degree. The experience I have gained throughout my studies at APU will be significant as my life moves forward. To date, I have managed to publish two papers/articles. The first one has been published with the Ritsumeikan Journal (RJAPS), Volume 28 in 2010 and titled Sociology of Sports mega-events, Tourism Perspective. The second one is published in The International Journal of Sport and Society, volume 1.Issue 4, titled Sociology of Sports Mega –Events: Sports Diplomacy and FIFA World Cup; ‘Global Peace Building Initiative. -

Factsheet FIFA Awards
FACT Sheet FIFA awards The FIFA World Player Gala has been in existence since 1991. In 2010, it was merged with France Football’s Ballon d’Or award to form the new “FIFA Ballon d’Or”. The newly named FIFA Ballon d’Or is a combination of the FIFA World Player of the Year award and France Football’s Ballon d’Or. The 2010 winner was chosen by national team coaches and captains as well as media representatives from all over the world. The FIFA Women’s World Player of the Year award was also decided by the votes of national team coaches and captains as well as media representatives from all over the world. For the first time, Coach of the Year awards were presented at the ceremony to honour the top coaching talent in both the men’s and women’s games. The voting panel had a similar make-up to those involved in selecting the winners of the FIFA Ballon d’Or and the FIFA Women’s World Player of the Year award. Awards presented: FIFA Ballon d’Or FIFA Women’s World Player of the Year FIFA World Coach of the Year for Men’s Football FIFA World Coach of the Year for Women’s Football FIFA Presidential Award FIFA Fair Play Award FIFA Puskás Award FIFA/FIFPro World XI FIFA Ballon d’Or / FIFA World Player of the Year Awards 2010 10.01.2011, Kongresshaus, Zurich men: 1. Lionel Messi (ARG) 2. Andrés Iniesta (ESP) 3. Xavi (ESP) women: 1. Marta (BRA) 2. Birgit Prinz (GER) 3. -

2020 Financial Statements
2020 financial statements Consolidated financial statements 114 Notes 120 Reports to the FIFA Congress 166 112 FIFA Annual Report 2020 2020 financial statements Consolidated financial statements 114 Notes 120 Reports to the FIFA Congress 166 112 FIFA Annual Report 2020 Consolidated financial statements | 2020 financial statements Consolidated financial statements according to IFRS Consolidated financial statements Page Consolidated statement of comprehensive income 116 Consolidated balance sheet 117 Consolidated cash flow statement 118 Consolidated statement of changes in reserves 119 Notes Notes to the consolidated financial statements 120 A General information and statement of compliance 120 B Basis of presentation 120 C Basis of consolidation 121 D Foreign currency 121 E Revenue recognition 121 F Expenses from football activities 122 G Expenses from administrative activities 123 H Other expenses 123 I Leases 123 J Financial income and financial costs 124 K Taxes and duties 124 L Cash and cash equivalents 124 M Derivatives and hedge accounting 124 N Inventories 125 O Property and equipment 125 P Intangible assets 125 Q Non-derivative financial assets 126 R Non-derivative financial liabilities 126 S Impairment 126 T Employee benefit obligations 127 U Provisions 127 V Reserves 127 W Significant accounting judgements, estimates and assumptions 127 114 FIFA Annual Report 2020 Consolidated financial statements | 2020 financial statements Consolidated financial statements | 2020 financial statements Notes to the consolidated statement of comprehensive