Notice Explicative
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions
Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 6 The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions by Philippe Veyrin Translated by Andrew Brown Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 6 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2011 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America Cover and series design © 2011 by Jose Luis Agote Cover illustration: Xiberoko maskaradak (Maskaradak of Zuberoa), drawing by Paul-Adolph Kaufman, 1906 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Veyrin, Philippe, 1900-1962. [Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. English] The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre : their history and their traditions / by Philippe Veyrin ; with an introduction by Sandra Ott ; translated by Andrew Brown. p. cm. Translation of: Les Basques, de Labourd, de Soule et de Basse Navarre Includes bibliographical references and index. Summary: “Classic book on the Basques of Iparralde (French Basque Country) originally published in 1942, treating Basque history and culture in the region”--Provided by publisher. ISBN 978-1-877802-99-7 (hardcover) 1. Pays Basque (France)--Description and travel. 2. Pays Basque (France)-- History. I. Title. DC611.B313V513 2011 944’.716--dc22 2011001810 Contents List of Illustrations..................................................... vii Note on Basque Orthography......................................... -

Zuberoako Herri Izendegia
92 ZUBEROAKO HERRI IZENDEGIA Erabilitako irizpideak Zergatik lan hau 1998an eskatu zitzaion Onomastika batzordeari Zuberoako herri izenak berraztertzea, zenbait udalek euskal izenak bide-seinaletan eta erabiltzeko asmoa agertu baitzuten eta euskaltzaleen artean ez izaki adostasunik izen horien gainean. Kasu batzuetan, izan ere, formak zaharkitu, desegoki edo egungo euskararen kontrakotzat jotzen ziren. Hori dela eta, zenbait herritan, Euskaltzaindiak Euskal Herriko udal izendegia-n (1979) proposatuari muzin eginik, bestelako izenak erabiltzen ari ziren. Bestalde, kontuan hartu behar da azken urteotan burutu lana, eta bereziki Nafarroako herri izendegia (1990) eta geroztik plazaratu “Nafarroako toponimia nagusiaren normalizaziorako irizpideak” Euskera, 1997, 3, 653-666. Guzti hori ezin zitekeen inola ere bazter. Onomastika batzordeak, Zuberoako euskaltzainen laguntza ezezik, hango euskaltzaleena ere (Sü Azia elkartearena, bereziki) eskatu zuen, iritziak hurbiletik ezagutzeko. Hiru bilkura egin ziren: Bilboko egoitzan lehendabizikoa, Iruñeko ordezkaritzan bigarrena eta Maulen hirugarrena. Proposamena Euskaltzaindiaren batzarrean aurkeztu eta 1998ko abenduan erabaki. Aipatu behar da, halaber, Eskiula sartu dugula zerrendan, nahiz herri hori Zuberoatik kanpo dagoen. Eztabaida puntuak eta erabilitako irizpideak Egungo euskara arautua eta leku-izenak Batzuek, hobe beharrez, euskara batuko hiztegi arrunterako onartu irizpide eta moldeak erabili nahi izan dituzte onomastika alorrean, leku-izenak zein bestelako izen bereziak, neurri batean, hizkuntza arruntaren sistematik kanpo daudela ikusi gabe. Toponimian, izan ere, bada maiz aski egungo hizkuntzari ez dagokion zerbait, aurreko egoeraren oihartzuna. Gainera, Euskaltzaindiak aspaldi errana du, Bergaran 1978an egin zuen biltzarraren ondoren, leku-- izenek trataera berezia dutela. Ikus, batez ere, kontsonante busti-palatalen grafiaz erabakia, Euskera 24:1, 1979, 91-92. Ñ letra hiztegi arruntean arras mugatua izan arren, leku-izenetan erabiltzen da: Oñati (G), Abadiño (B), Iruñea (N) eta Añana (A). -

Pyrenees Atlantiques
Observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties 13 ème édition (2019) : période 2008 – 2013 - 2018 L’observatoire UNPI des taxes foncières réalise ses estimations à partir de données issues du portail internet de la Direction générale des finances publiques (https://www.impots.gouv.fr) ou de celui de la Direction générale des Collectivités locales (https://www.collectivites-locales.gouv.fr). En cas d’erreur due à une information erronée ou à un problème dans l’interprétation des données, l’UNPI s’engage à diffuser sur son site internet les données corrigées. IMPORTANT ! : les valeurs locatives des locaux à usage professionnel ayant été réévaluées pour le calcul de l’impôt foncier en 2017, nos chiffres d’augmentation ne sont valables tels quels que pour les immeubles à usage d’habitation. Précautions de lecture : Nos calculs d’évolution tiennent compte : - de la majoration légale des valeurs locatives , assiette de la taxe foncière (même sans augmentation de taux, les propriétaires subissent une augmentation de 4,5 % entre 22013 et 2018, et 14,6 % entre 2008 et 2018) ; - des taxes annexes à la taxe foncière (taxe spéciale d’équipement, TASA, et taxe GEMAPI), à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Précisions concernant les taux départementaux 2008 : En 2011 la part régionale de taxe foncière a été transférée au département. Pour comparer avec 2008, nous additionnons donc le taux départemental et le taux régional de 2008. Par ailleurs, nos calculs d’évolution tiennent compte du fait que, dans le cadre de cette réforme, les frais de gestion de l’Etat sont passés de 8 % à 3 % du montant de la taxe foncière, le produit des 5 % restants ayant été transféré aux départements sous la forme d’une augmentation de taux. -

Liste Des Services D'aide À Domicile
14/04/2015 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.), des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale A Habilitation à l'aide sociale départementale www.cg64.fr TI = Type d'interventions réalisables u AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des P = Prestataire -- M = Mandataire t bénéficiaires de l'aide sociale départementale Pour plus d'information, voir : Choisir un mode d'intervention . C Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention G Postal CCAS Hôtel de ville P Ville d’ANGLET A AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 Centre Communal d'Action Sociale Place Charles de Gaulle M Département des Pyrénées-Atlantiques Uniquement en garde de nuit itinérante Association 12, rue Jean Hausseguy A AS 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, Les Lucioles BP 441 BAYONNE, ANGLET) et périphérie proche Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 41 22 98 Département des Pyrénées-Atlantiques Côte Basque Interservices (ACBI) M Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association 12, rue Jean Hausseguy P 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile BP 441 M Centre -

Liste Des SAAD
15/09/2020 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.) et/ou des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale Habilitation à l'aide sociale départementale www.le64.fr TI = Type d'interventions réalisables AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des bénéficiaires P = Prestataire -- M = Mandataire de l'aide sociale départementale Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention Postal Centre Mercure P AS A.D.M.R. ADOUR ET NIVE 64600 ANGLET 05 59 59 44 75 Département des Pyrénées-Atlantiques 25 avenue Jean Léon Laporte M CCAS 2 avenue Belle Marion AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 P Ville d’ANGLET Centre Communal d'Action Sociale Pôle Solidarité Association Uniquement en garde de nuit itinérante AS Les Lucioles 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, BAYONNE, ANGLET) et périphérie GARDE DE NUIT ITINERANTE proche Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile M Bâtiment l’alliance - 3 rue du pont de AZAE COTE BASQUE 64600 ANGLET 05 59 58 29 50 P Département des Pyrénées-Atlantiques -

Règlement Du Service Public De Prévention Et De Gestion Des
Règlement du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ANNEXE N°1 Liste et coordonnées des Maisons de la Communauté de la Communauté d’Agglomération Pays Basque Version décembre 2019 La Communauté d’Agglomération Pays Basque est née de la fusion des 10 intercommunalités du Pays Basque. Elles deviennent des Maisons de la Communauté. 2 Communauté d'Agglomération Pays Basque Correspondance Maisons de la Communauté / Communes Maisons de la Communauté Communes Aïcirits Camou Suhast Amendeuix Oneix Amorots Succos Arberats Sillègue Arbouet Sussaute Aroue Ithorots Olhaïby Arraute Charritte Beguios Behasque Lapiste Beyrie sur Joyeuse Domezain Berraute Amikuze Etcharry 35 Rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais Gabat Téléphone : 05 59 65 74 73 Garris [email protected] Ilharre Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de Labets Biscay 13h30 à 17h30 Larribar Sorhapuru Lohitzun Oyhercq Luxe Sumberraute Masparraute Méharin Orègue Orsanco Osserain Rivareyte Pagolle Saint Palais Uhart Mixe Pays de Bidache Arancou 1 allée du parc des sports Bardos 64520 Bidache Bergouey Viellenave 05 59 56 05 11 [email protected] Bidache Came Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 Guiche Sames Côte Basque-Adour Bidart Centre Technique de l'Environnement Anglet 17 avenue Adour 64600 Anglet Tél. : 05 59 57 00 00 Bayonne dechets.cotebasqueadour@communaute- Biarritz paysbasque.fr Du lundi au vendredi 8H00 à 12H30 et de 13H30 à Boucau 18H00 3 Arcangues Bassussarry -

From Common Property to Co-Management: Implementing Natura 2000
FROM COMMON PROPERTY TO CO-MANAGEMENT: IMPLEMENTING NATURA 2000 IN SOULE by MEREDITH WELCH-DEVINE (Under the Direction of Theodore Gragson) ABSTRACT The Basque province of Soule (department of Pyrénées-Atlantiques, France) contains more than 14,000 hectares of common-pool land. This land provides numerous resources, most notably summer pasturage, to the animal raisers of the province who, for centuries, have collectively managed that land under a common property regime. Under this system, the animal raisers must operate within boundaries first set by the French state and later added to by the European Union, although as long as their management actions do not violate those boundaries they operate with relative autonomy. Recent years, though, have seen both the French state and the European Union take a more active interest in commons management. At the same time, biodiversity conservation has arisen as a chief concern of the international community and of EU policy-makers. In 1992, the European Commission passed the Habitats Directive, which, together with the Birds Directive, creates a pan-European network of areas to be managed for social, economic, and ecological sustainability. This network, called Natura 2000, is made up of conservation sites on both public and private lands, and the common lands of Soule are covered almost in their entirety by Natura 2000 sites. The implementation of Natura 2000 is pushing the current system toward one of co- management between resource users, state agencies, and other stakeholders yet to be identified. This dissertation research examines the co-management process that is slowly emerging and compares it to the existing management regime. -

Le Car Express
vers Dax 7 vers Dax M/D CHRONOPLUS 7 T1 2 4 5 6 30 32 38 46 48 50 52 Adour 1 Adour 2 LANDES Le Car Express Tarnos Biarrotte CAR EXPRESS 26 3 11 12 13 14 CHRONOPLUS T1 4 5 6 Boucau RÉGIONAL 7 26 M/D 36 38 44 46 52 A63 SNCF / TER HEGOBUS 51 53 54 TGV Sames 12 Puyoo 51 Anglet 12 Guiche CAR EXPRESS 3 BAYONNE HEGOBUS 3 Urcuit 809 39 41 43 45 47 49 51 SNCF / TER A64 51 TGV St-Pierre- Lahonce CAR EXPRESS d’Irube Urt 12 Bardos 11 Bidache Mouguerre Came 3 BIARRITZ Briscous Orthez SNCF / TER 13 51 TGV HEGOBUS Bidart 11 31 33 35 37 39 Villefranque Guéthary Arbonne Arancou M/D CAR EXPRESS Arcangues La Bastide-Clairence 13 3 Bassussarry 14 809 SNCF / TER Bergouey- Ahetze Viellenave 51 TGV SAINT-JEAN- Jatxou DE-LUZ Ustaritz Ayherre Orègue Hasparren 13 15 Arraute- Ilharre Halsou Charritte Masparraute 13 HENDAYE Ciboure 15 Labets- Gabat Urrugne St-Pée- Larressore 3 sur-Nivelle CAMBO- Bonloc Isturits Amorots- Biscay Aïcirits- PYRÉNÉES- Espelette 14 Succos Arbouet- A63 LES-BAINS HEGOBUS Camou- Osserain- Ascain 49 Luxe- Suhast Sussaute ATLANTIQUES Irun Biriatou 49 11 Rivareyte CAR EXPRESS Sumberraute 45 Mendionde St-Martin- Amendeuix- Souraïde 14 15 d'Arberoue Béguios Oneix Sare Itxassou CAR EXPRESS Arbérats- 47 PROXIMITÉ 15 10 11 Garris Sillègue Louhossoa St-Esteben 13 Méharin M/D Ainhoa 57 59 PROXIMITÉ SAINT- Etcharry Beyrie- SNCF / TER Hélette 55 PALAIS 62 sur-Joyeuse Domezain- Macaye RÉGIONAL Berraute Armendarits Béhasque- Aroue- 11 Lichos 809 M/D Lapiste Ithorots- Index et légende Larribar- Olhaïby Sorhapuru Iholdy 15 Orsanco Charritte-de-Bas Arrast- -

Communes Du Perimetre Lead
LISTE DES COMMUNES CONSTITUTIVES DU GAL MONTAGNE BASQUE Le Périmètre LEADER Montagne basque est constitué de 111 communes rassemblant au total 80 228 habitants (données INSEE 2011) : Nombre d'habitants Nom de la commune N° INSEE (INSEE 2011) AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN 64008 286 AINCILLE 64011 135 AINHARP 64012 145 AINHICE-MONGELOS 64013 163 AINHOA 64014 673 ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARET 64015 231 ALDUDES 64016 355 ALOS-SIBAS-ABENSE 64017 293 AMOROTS-SUCCOS 64019 231 ANHAUX 64026 319 ARHANSUS 64045 73 ARMENDARITS 64046 386 ARNEGUY 64047 241 AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY 64049 247 ARRAST-LARREBIEU 64050 96 ARRAUTE-CHARRITTE 64051 381 ASCAIN 64065 4079 ASCARAT 64066 315 AUSSURUCQ 64081 252 AYHERRE 64086 987 BANCA 64092 333 BARCUS 64093 714 BEGUIOS 64105 262 BEHORLEGUY 64107 76 BERROGAIN-LARUNS 64115 126 BEYRIE-SUR-JOYEUSE 64120 511 BIDARRAY 64124 658 BIRIATOU 64130 1114 BONLOC 64134 370 BUNUS 64150 159 BUSSUNARITS-SARRASQUETTE 64154 170 BUSTINCE-IRIBERRY 64155 90 CAMBO LES BAINS 64160 6577 CAMOU-CIHIGUE 64162 102 CARO 64166 183 CHARITTE-DE-BAS 64187 247 CHERAUTE 64188 1106 ESPELETTE 64213 2006 ESPES-UNDUREIN 64214 504 ESTERENCUBY 64218 357 ETCHEBAR 64222 68 GAMARTHE 64229 123 GARINDEIN 64231 516 GOTEIN-LIBARRENX 64247 447 HASPARREN 64256 6139 HAUX 64258 90 HELETTE 64259 709 HOSPITAL-ST-BLAISE (L') 64264 265 HOSTA 64265 75 IBARROLLE 64267 98 IDAUX-MENDY 64268 83 IHOLDY 64271 554 IRISSARRY 64273 866 IROULEGUY 64274 341 ISPOURE 64275 606 ISTURITS 64277 458 ITXASSOU 64279 2018 JAXU 64283 165 JUXUE 64285 219 LABASTIDE-CLAIRENCE 64289 1010 LACARRE 64297 163 -

Prefecture Des Pyrenees-Atlantiques Projet De Fusion De Deux Communautes D'agglomeration Et De Huit Communautes De Communes Po
PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES PROJET DE FUSION DE DEUX COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION ET DE HUIT COMMUNAUTES DE COMMUNES POUR LA CREATION D’UNE ENTITE UNIQUE DU PAYS BASQUE Étude N° III PRESENTATION DE L’ETUDE FINANCIERE SEPTEMBRE 2015 1/57 2/57 A l’occasion de la réforme territoriale et dans le cadre des réflexions et positions exprimées jusqu’alors, les élus du Pays basque ont manifesté le souhait de mettre en place une entité unique, dotée de la personnalité morale et d'une fiscalité propre, à l’échelle du territoire. Dans cette perspective, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le directeur départemental des finances publiques pour établir une étude des impacts budgétaires, financiers et fiscaux de la fusion des 10 EPCI du Pays basque. En préambule, il est rappelé qu'en application du code général des collectivités territoriales, la création d’un nouvel ensemble intercommunal à fiscalité propre relève de deux régimes juridiques distincts : - le régime de droit commun prévu à l'article L. 5211-41-3, qui confie l'initiative d'une évolution de périmètre indifféremment au préfet, à une commune membre, à un EPCI ou à la CDCI et qui obéit à des règles de majorité qualifiée (accord exprimé par les ⅔ au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale des communes ou par la moitié au moins des conseils municipaux représentant les ⅔ de la population. Ces majorités doivent nécessairement comprendre au moins un tiers des conseils municipaux des communes qui sont regroupées dans chacun des EPCI). Dans ce cadre, deux documents succincts doivent être produits à l'appui du projet d'arrêté préfectoral de périmètre, à savoir un rapport explicatif et une étude d'impact budgétaire et fiscal. -

ICB : 25 Ans De Savoir-Faire Au Service De La Culture Basque
INSTITUT CULTUREL BASQUE 25 de ans savoir-faire au service de la culture basque Septembre 2016 INSTITUT CULTUREL BASQUE Château Lota - BP 6 - 64480 Ustaritz 05 59 93 25 25 | [email protected] | www.eke.eus Sommaire Edito 3 La nouvelle réforme territoriale qui engendrera de profonds changements en terme de gouvernance du EDITO 3 Pays Basque nord conduit de nombreux organismes à s’interroger sur la place qu’ils auront dans cette nouvelle configuration. Depuis vingt-cinq ans, l’Institut culturel basque a acquis compétences et savoir-faire dans la maîtrise L’ICB EN 10 DATES 4 d’ouvrage ou d’œuvre de projets structurants, d’expertise et d’ingénierie auprès des acteurs culturels LES MISSIONS DE L’ICB 5 et des institutions publiques, et dans les relations transfrontalières. Il a su créer un véritable réseau de partenaires locaux, nationaux, internationaux, et compte aujourd’hui dans le panorama des entités L’ICB EN CHIFFRES 6 culturelles du Pays Basque et d’ailleurs. Ce document a pour objectif de présenter les principaux champs d’action de l’ICB et d’établir une cartographie montrant leur répartition sur l’ensemble des territoires dans lesquels il intervient ou accompagne des SECTEURS D’ACTIVITES projets. 1 - Patrimoine & création 8 Il va de soi qu’il est aussi le reflet d’une dynamique culturelle et artistique portée et renouvelée depuis tant Un patrimoine hérité, revendiqué et intégré d’années par les associations et les artistes du Pays Basque. 2 - Accompagnement 16 Bien sûr, le Pays Basque a changé depuis 25 ans, et la culture basque également, avec une grande richesse d’acteurs culturels et artistiques, une diversité d’opérateurs, du secteur associatif aux structures labellisées, 2-1 Accompagnement des associations des compétences « culture » prises dans de nombreuses communautés de communes, etc. -
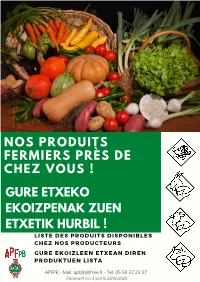
Nos Produits Fermiers Près De Chez Vous ! Gure
NOS PRODUITS FERMIERS PRÈS DE CHEZ VOUS ! GURE ETXEKO EKOIZPENAK ZUEN ETXETIK HURBIL ! LISTE DES PRODUITS DISPONIBLES CHEZ NOS PRODUCTEURS GURE EKOIZLEEN ETXEAN DIREN PRODUKTUEN LISTA APFPB - Mail: [email protected] - Tel. 05 59 37 23 97 Document mis à jour le 25/03/2020 NOS PRODUITS FERMIERS PRES DE CHEZ VOUS ! GURE ETXEKO EKOIZPENAK ZUEN ETXETIK HURBIL ! Ferme Elurti, Ascarat Ferme IDOKI Produits disponibles Prix Crottin de brebis (lait cru) 3,30€ Buchette de brebis 4,30€ Fromage blanc de brebis nature 3,30€ 500g (lait cru) – DLC 15j Breuil 400g – DLC 10j 5,50€ Caillé de brebis 125g – DLC 7j 0,95€ Douceur citronnée au lait de brebis 0,95€ (lait cru) – DLC 15j Yaourt de brebis nature (pasteurisé) 0,95€ 125 g - DLC 20 j Yaourt / mamia / Douceur citronnée 3,60€ par 4 x 125 g Tomme de brebis AOP Ossau Iraty 18,50€/kg (jeune) Soroa / type reblochon au lait de 19,50€ brebis / kg Colis d’agneau Lieu de vente / livraison des produits : Vente à la ferme à Ascarat : tous les matins de 10h à 12h Marché de St-Jean-Pied-de-Port Magasin KAIKU BORDA à Ossès Contact : Nathalie SUZANNE – 06 76 23 97 09 ou [email protected] 1 NOS PRODUITS FERMIERS PRES DE CHEZ VOUS ! GURE ETXEKO EKOIZPENAK ZUEN ETXETIK HURBIL ! Ferme LARRALDEA, St Just Ibarre Ferme IDOKI Produits disponibles Prix Saucisson de mouton 7,00€ pièce Saucisson de porc 8,00€ pièce Fromage de brebis AOP Ossau 19,50€/kg Iraty Crottins de brebis 4,00€ pièce Yaourt au lait de brebis 1,00€ pièce Jus de pomme – 1l 4,00€ Confiture – 250g 3,50€ Confiture – 350g 4,50€ Lieu de vente / livraison des