Le Kelpie, Ou Les Monstres Lacustres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Drinkers Order Whisky Galore Island's Entire Stocks … Five
Drinkers order Whisky Galore island’s entire stocks … five years too early 4th may 2009 shân ross Not a brick has been laid to build the first distillery on the island where Whisky Galore! was filmed—but connoisseurs have already signed up to reserve the entire batch of its first-year casks. Peter Brown will begin building the distillery on Barra in the autumn. The distillery, costing more than £1 million, will make about 5,000 gallons of Isle of Barra Single Malt Whisky a year using water from Loch Uisge, the island’s highest loch. It will use barley grown by crofters on the island before being milled and malted locally and be bottled at the distillery in Borve. Whisky needs to be matured for three years before it can legally be called whisky so the distillery will not have its first consignment until 2014. In the meantime Mr Brown has taken orders for the £1,000 oak casks from individuals and groups of friends from countries including Germany, Japan and Sweden, and the rest of the u.k. More than half the casks will be retained by the distillery but he is already selling his public quota of second-year reserve. Mr Brown said it was impossible to tell at this stage what the whisky would taste like but that it was ‘unlikely to be excessively peaty’. He said it would sell at about £30 a bottle at current prices at the premium end of market. Mr Brown, who ran a courier company in Edinburgh before moving to Barra 12 years ago, said: ‘The whisky will be of the island, from the island. -
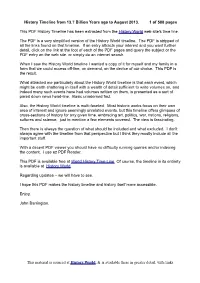
History Timeline from 13.7 Billion Years Ago to August 2013. 1 of 588 Pages This PDF History Timeline Has Been Extracted
History Timeline from 13.7 Billion Years ago to August 2013. 1 of 588 pages This PDF History Timeline has been extracted from the History World web site's time line. The PDF is a very simplified version of the History World timeline. The PDF is stripped of all the links found on that timeline. If an entry attracts your interest and you want further detail, click on the link at the foot of each of the PDF pages and query the subject or the PDF entry on the web site, or simply do an internet search. When I saw the History World timeline I wanted a copy of it for myself and my family in a form that we could access off-line, on demand, on the device of our choice. This PDF is the result. What attracted me particularly about the History World timeline is that each event, which might be earth shattering in itself with a wealth of detail sufficient to write volumes on, and indeed many such events have had volumes written on them, is presented as a sort of pared down news head-line. Basic unadorned fact. Also, the History World timeline is multi-faceted. Most historic works focus on their own area of interest and ignore seemingly unrelated events, but this timeline offers glimpses of cross-sections of history for any given time, embracing art, politics, war, nations, religions, cultures and science, just to mention a few elements covered. The view is fascinating. Then there is always the question of what should be included and what excluded. -

Beautiful, Spacious Beachside Island Home
Beautiful, Spacious Beachside Island Home Suidheachan, Eoligarry, Isle of Barra, HS9 5YD Entrance hallway • Kitchen • Dining room • Utility room Drawing room / games room • Sitting room • Inner hallway • Bathroom Master bedroom with en suite 4 further bedrooms • Butler’s pantry • Shower room Bedroom 5 / study Directions The isle of Barra is often If you are taking the ferry from described as the jewel of the Oban you will arrive at Castle Hebrides with its spectacular Bay – turn right and continue beaches, rugged landscaped north for approximately 8.3 and flower laden machair, while miles; Suidheachan is on the the wildlife rich isles of left hand side adjacent to Vatersay (linked by a causeway Barra Airport. to Barra) and Mingulay (accessed by boat) are equally If flying to Barra Airport – stunning and also boast idyllic Suidheachan is adjacent to beaches. The beaches in Barra the airport. and Vatersay are among the very best in the world with Flights to Barra Airport from fabulously white sands and Glasgow Airport take around 1 crystal clear waters. The hour 10 minutes in normal beaches offer large and empty flying conditions. The ferry stretches of perfect sand and from Oban takes are also popular with sea approximately 4 hours 30 kayakers and surfers. The minutes in normal wildlife on the island is sailing conditions. stunning, with numerous opportunities for wildlife Situation watching including seals, The beautiful isle of Barra is a golden eagles, puffins, 23 square mile island located guillemots and kittiwakes, with approximately 80 miles from oyster catchers and plovers on the mainland reached by either the seashore. -

Wilderness Walking View Trip Dates Outer Hebrides: Book Now the Uists, Barra & Mingulay
Wilderness Walking View Trip Dates Outer Hebrides: Book Now The Uists, Barra & Mingulay Trip Grade: Green 2 Outer Hebrides: The Uists, Barra & Mingulay Join us as we embark on a journey through the southern Outer Hebrides. The curious traveller who ventures here will be rewarded by quiet islands, wonderfully scenic walks and welcoming accommodations, all the time accompanied by wild Atlantic vistas. A trip to Mingulay provides a fitting climax to the trip. Your knowledgeable guide will provide a fascinating insight into the complex tapestry of island life, history and geology. They can also help you spot wildlife, which may include golden eagles, white tailed sea eagles, basking sharks, whales and dolphins, as well helping you identify the rich flora of the islands found in the famous coastal ‘machairs’ or flower meadows. With charming accommodation and delicious food, this special trip provides a memorable insight into these wild and beautiful islands. Highlights • Visit seven islands on a spectacular journey through the southern Outer Hebrides, indulging in the wild scenery and rich history of the islands • Journey to the abandoned island of Mingulay on a privately chartered boat, relishing its wild beauty and abundant wildlife while learning about the hardships of life there • Enjoy exceptional island hospitality at our carefully selected guest houses, set in magnificent coastal locations Book with confidence • We guarantee this trip will run as soon as 2 people have booked • Maximum of 8 places available per departure PLEASE NOTE – The itinerary may be subject to change at the discretion of the Wilderness Scotland Guide with regard to weather conditions and other factors. -

Set in Scotland a Film Fan's Odyssey
Set in Scotland A Film Fan’s Odyssey visitscotland.com Cover Image: Daniel Craig as James Bond 007 in Skyfall, filmed in Glen Coe. Picture: United Archives/TopFoto This page: Eilean Donan Castle Contents 01 * >> Foreword 02-03 A Aberdeen & Aberdeenshire 04-07 B Argyll & The Isles 08-11 C Ayrshire & Arran 12-15 D Dumfries & Galloway 16-19 E Dundee & Angus 20-23 F Edinburgh & The Lothians 24-27 G Glasgow & The Clyde Valley 28-31 H The Highlands & Skye 32-35 I The Kingdom of Fife 36-39 J Orkney 40-43 K The Outer Hebrides 44-47 L Perthshire 48-51 M Scottish Borders 52-55 N Shetland 56-59 O Stirling, Loch Lomond, The Trossachs & Forth Valley 60-63 Hooray for Bollywood 64-65 Licensed to Thrill 66-67 Locations Guide 68-69 Set in Scotland Christopher Lambert in Highlander. Picture: Studiocanal 03 Foreword 03 >> In a 2015 online poll by USA Today, Scotland was voted the world’s Best Cinematic Destination. And it’s easy to see why. Films from all around the world have been shot in Scotland. Its rich array of film locations include ancient mountain ranges, mysterious stone circles, lush green glens, deep lochs, castles, stately homes, and vibrant cities complete with festivals, bustling streets and colourful night life. Little wonder the country has attracted filmmakers and cinemagoers since the movies began. This guide provides an introduction to just some of the many Scottish locations seen on the silver screen. The Inaccessible Pinnacle. Numerous Holy Grail to Stardust, The Dark Knight Scottish stars have twinkled in Hollywood’s Rises, Prometheus, Cloud Atlas, World firmament, from Sean Connery to War Z and Brave, various hidden gems Tilda Swinton and Ewan McGregor. -

Read Ebook {PDF EPUB} the Rival Monster by Compton Mackenzie the Rival Monster by Compton Mackenzie
Read Ebook {PDF EPUB} The Rival Monster by Compton Mackenzie The Rival Monster by Compton Mackenzie. Famous Scots - Sir Compton Mackenzie (1883-1972) Though he had Scottish ancestry, he was born in England, named originally Edward Montague Compton - the earlier family name 'Mackenzie' had been dropped by his father when he became an actor. But Mackenzie was added back by the novelist later as his emotional links with Scotland grew. He began to study law but gave this up to concentrate on writing. Initially he wrote for the theatre and his first novel, Sinister Street, was published in 1913. During the First World War he was the director of the secret service in the Aegean. He moved to Scotland in 1928, settling in Barra which was to be the background for his most famous comedies of Scottish Life, "Whisky Galore" (the film of this was entitled "Tight Little Island" in the US). Other comedies with a Scottish location were "The Monarch of the Glen" and "The Rival Monster" and "Rockets Galore". A staunch nationalist, he was a founder member of the Scottish National Party and was knighted in 1952. The Rival Monster by Compton Mackenzie. The Rival Monster by Compton Mackenzie was first published in 1952. The setting is again the Scottish Highlands and Islands, more particularly the islands of Little Todday and Great Todday, the islands made famous by the sinking of a ship full of whisky in his earlier book Whisky Galore. In fact if you intend to read these books you should start with Keep the Home Guard Turning then read Whisky Galore, then Rockets Galore. -

Now Whisky Galore Isle to Build Its Own £2.5M Distillery
Source: Scottish Daily Mail {Main} Edition: Country: UK Date: Tuesday 29, January 2019 Page: 28 Area: 125 sq. cm Circulation: 90121 Daily Ad data: page rate £5,040.00, scc rate £20.00 Phone: Keyword: Barra Distillery Now Whisky Galore isle to build its own £2.5m distillery Daily Mail Reporter in cases when it ran aground in 1941. The crew were rescued IT was once the island home unharmed. of Whisky Galore author Sir Sir Compton’s 1947 novel inspired the 1949 Ealing comedy Compton Mackenzie. Barra in the Outer Hebrides in which many islanders were used as extras. was also used in making the classic film of his book, which Barra Distillery director Peter was based on the true-life Brown said: ‘You cannot buy the grounding of the SS Politician publicity that the mere hint of with a cargo of the spirit on the Whisky Galore gives.’ neighbouring island of Eriskay. Now it is hoped there really ‘Environmentally will be whisky galore on Barra friendly’ after the launch of a shares offer for a £2.5million distillery project. It is looking for £1.5million of the cash through crowdfunding. The scheme, which already has planning permission for a site above the township of Borve, aims to be the ‘most environmentally friendly whisky distillery’ in the UK. Four wind turbines have already been built. Two hydro turbines as well as solar panels will be added to meet all energy requirements. The distillery will use the peaty water from the island reservoir at Loch Uisge. It is hoped to secure a local supply of barley, grown in Barra or neighbouring Uist. -

Outer Hebrides Outer Hebrides
Scottish Natural Heritage Explore for a day Outer Hebrides Outer Hebrides Itinerary 1 Itinerary 2 Itinerary 3 Itinerary 4 Itinerary 5 Words will not do justice to the spectacular beauty, stunning wildlife and fascinating history of the Outer Hebrides. Explore the land of the machair – the low-lying fertile plain that fringes the west of these islands and is maintained by traditional crofting Symbol Key practices – providing some of the world’s finest flower-rich meadows, busy with wading birds. Parking Information Centre Cliffs covered in noisy seabirds, majestic eagles soaring high overhead and otters along the seaweed-fringed shore make your visit here special and memorable. Add to this mix, the vast peatlands of Lewis, the Paths Disabled Access presence of the sea in all its moods, the rocky coasts, stunning beaches of white sand and scattered crofting settlements strung out through Toilets Wildlife watching these islands and you have an unforgettable place. Find out more about the mysterious monuments of first settlers and the Refreshments Picnic Area traces of early Christianity in these isles. Encounter more modern stories of powerful clans, emigration, land struggles, the emergence of whaling, fishing and tweed industries and ships full of whisky running aground! Admission free unless otherwise stated. This leaflet gives you a flavour of the journey through the whole island chain from Barra to the Butt of Lewis and suggest places to visit along the way that will help you discover a little of what these islands at the very This leaflet was prepared with the assistance edge of Europe have to offer. -

M8 Redux.Pdf
o o o MACKE (AUGUST. - -- See LAXNER (UTA). Stilanalytische Untersuchungen zu den Aquarellen der Tunisreise 1914; M., Klee, Moilliet. McKEACHIE (WILBERT JAMES). - -- Teaching tips; a guide -book for the beginning college teacher. By W.J.M., with the collaboration of G. Kimble. 5th ed. Ann Arbor, 1965. .378122 Mack. -- and DOYT ;! i (CHARLOTT LACKNER) . - -- Psychology. [Addison -Wesley World Student Ser.] Reading, Mass. [1966.] .15 Mack. --- Another copy. Psychol. Lib. - -- 3rd ed. [By] W.J.M., C.L.D. [and] M.M. Moffett. Reading, Mass. [1976.] Psychol. Lib. McKEAG (H.T.A.). - -- See BRASH (J.C.), M. (H.T.A.) and SCOTT (J.H.). McKEAG (R. MICHAEL). - -- See WELSH (JIM ) and M. (R.M.). - -- and WILSON (R.). - -- Studies in operating systems. Ed. by D.H.R. Huxtable. [A.P.I.C. Stud. in Data Processing, No. 13.] Lond., 1976. JCM Lib. McKEAN (ALEXANDER). - -- Exposition of the practical life tables, with digest of the most approved rules and formulae ... for the solution of all cases occurring in the actual daily business of life assurance, annuities, reversions ... Lond., 1837. So.6.32. X c<rel )-1S 3 McKEAN (CHARLES). - -- comp. Edinburgh; an illustrated architectural guide. Comp. by C.McK. with David Walker for the Edinburgh Architectural Association 125th anniversary. Introd. by Colin McWilliam. 2nd ed. Edin., 1982. .72(41)1)15) Mack. -- Another ed. Edin., 1982. Architect. Lib. --- and JESTICO (TOM). - -- eds. Modern buildings in London; a guide. Lond., 1976. .7249(421) Mack. * ** Cover-title reads Guide to modern buildings in London 1965 -75. - -- Two other copies. Architect. Lib. MACKEAN (DONALD GORDON). --- Introduction to biology. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress
INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

Bertram Rota
January 2013 Bertram Rota Ltd 31 LONG ACRE COVENT GARDEN, LONDON WC2E 9LT Telephone: + 44 (0) 20 7836 0723 * Fax: + 44 (0) 20 7497 9058 E-mail: [email protected] www.bertramrota.co.uk IN OUR NINETIETH ANNIVERSARY YEAR From the Gavin H. Fryer Collection a fine selection of works by Joseph Conrad, Compton Mackenzie, V.S. Pritchett and others Catalogue 308 Part II Established 1923 TERMS OF BUSINESS. The items in this catalogue are offered at net sterling prices, for cash upon receipt. Charges for postage and packing will be added. All books are insured in transit. PAYMENT. We accept cheques and debit and credit cards (please quote the card number, start and expiry date and 3 digit security code as well as your name and address). For direct transfers: HSBC, 129 New Bond Street, London, W1A 2JA, sort code 40 05 01, account number 50149489 . VAT is added and charged on autograph letters and manuscripts (unless bound in the form of a book), drawings, prints and photographs WANTS LISTS. We are pleased to receive lists of books especially wanted. They are given careful attention and quotations are submitted without charge. We also provide valuations of books, manuscripts, archives and entire libraries. HOURS OF BUSINESS. We are open from 10.30 to 6.00 from Monday to Friday. Appointment recommended. Unless otherwise described, all the books in this catalogue are published in London, in the original cloth or board bindings, octavo or crown octavo in size. Dust-wrappers should be assumed to be present only when specifically mentioned. Featuring in particular works by Conrad and those two other literary masters of their time, Compton Mackenzie and V.S. -
![Études Écossaises, 19 | 2017, « Scotland and the Sea » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Avril 2017, Consulté Le 23 Septembre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/6118/%C3%A9tudes-%C3%A9cossaises-19-2017-%C2%AB-scotland-and-the-sea-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-01-avril-2017-consult%C3%A9-le-23-septembre-2020-5996118.webp)
Études Écossaises, 19 | 2017, « Scotland and the Sea » [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Avril 2017, Consulté Le 23 Septembre 2020
Études écossaises 19 | 2017 Scotland and the Sea L’Écosse et la mer Cyril Besson (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/etudesecossaises/1151 DOI : 10.4000/etudesecossaises.1151 ISSN : 1969-6337 Éditeur UGA Éditions/Université Grenoble Alpes Édition imprimée ISBN : 978-2-37747-001-3 ISSN : 1240-1439 Référence électronique Cyril Besson (dir.), Études écossaises, 19 | 2017, « Scotland and the Sea » [En ligne], mis en ligne le 01 avril 2017, consulté le 23 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/etudesecossaises/ 1151 ; DOI : https://doi.org/10.4000/etudesecossaises.1151 Ce document a été généré automatiquement le 23 septembre 2020. © Études écossaises 1 Si une grande part de l’identité, de la culture et de la politique écossaises sont informées par la relation qu’entretient l’Écosse avec l’Angleterre, cette polarisation a résulté de leur proximité géographique immédiate, les deux nations partageant une frontière terrestre au sein d’un même territoire. Par conséquent, on trouve, à la base de cette relation comme de bien d’autres domaines en ce qui concerne l’Écosse, la nature maritime d’un territoire partout ailleurs entouré d’eau. Bien sûr, l’insularité de la Grande-Bretagne, qui entraîne en quelque sorte une « péninsularité » de l’Écosse, ne devrait pas être envisagée de manière négative, dans la mesure où elle a permis un tissage de connections multiples, à une époque où la mer offrait un moyen privilégié d’établir des échanges culturels, diplomatiques et commerciaux. Qu’il s’agisse des marchands de tabac de Glasgow avec les États-Unis, des administrateurs écossais aux Indes, ou des brigades écossaises en Suède au cours de la guerre de Trente Ans, tous dépendaient de la mer pour faire avancer leurs projets personnels, qui participaient au rayonnement et au renforcement de l’influence de l’Écosse.