Rapport Du Commissaire Enqueteur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
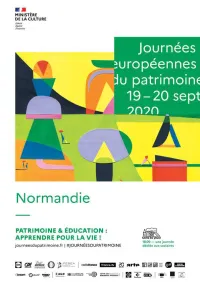
JEP20-Calvados.Pdf
PATRIMOINE & ÉDUCATION APPRENDRE POUR LA VIE ! Journées européennes du patrimoine 2020 Éditorial Je veux déconfiner la culture pour La journée du 18 septembre qu’elle soit l’affaire de tous. « Levez les yeux ! », dédiée aux élèves de la maternelle au lycée, Qui aurait pu penser au printemps, ainsi que le thème de cette que les Journées européennes du patrimoine pourraient se dérouler, édition « Patrimoine et éducation : à la date prévue, les 19 et 20 apprendre pour la vie ! » sont septembre prochain ? autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le Nous ne pouvions pas ne pas goût du patrimoine. renouer avec nos monuments et lieux historiques comme nous Lieux de pouvoir, monuments le faisons depuis 36 ans chaque emblématiques de la nation, troisième week-end du mois châteaux, patrimoines ruraux, de septembre. jardins historiques, édifices religieux ou encore sites Et ce lien étroit qui nous unit industriels… : c’est à nouveau à notre patrimoine va, j’en MCDidier Plowy suis convaincue, se renforcer toute la belle et riche diversité du pendant l’été. patrimoine qui s’offre à vous, aux Roselyne BACHELOT millions de visiteurs passionnés qui Les déplacements de loisirs et les Ministre de la Culture chaque année se mobilisent. vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens envisagent Pour ce grand rendez-vous cette année en France pourront monuments ont besoin d’accueillir festif du mois de septembre, je faire la part belle à ce patrimoine des visiteurs, faites leur ce plaisir, souhaite que ces 37èmes Journées de proximité qui jalonne tout mais surtout faites-vous plaisir en européennes du patrimoine soient notre territoire. -

En Poursuivant Votre Navigation Sur Ce Site, Vous Acceptez L'utilisation De Cookies Pour Mesurer La Fréquentation De Nos Services Afin De Les Améliorer
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau : NOMAD CARS Calvados 06/10/2021 Ligne : 20 Direction : DEAUVILLE: gare routière (Deauville) Arrêt Horaires CAEN: gare routiere, - - - - 07h30 - 09h13 - 10h25 11h25 Caen CAEN: demi lune, Caen - - - - 07h33 - 09h16 - 10h28 11h28 MONDEVILLE: maison - - - - 07h34 - 09h17 - 10h29 11h29 du peuple, Mondeville MONDEVILLE: route de - - - - 07h35 - 09h18 - 10h30 11h30 cabourg, Mondeville MONDEVILLE: grands - - - - 07h37 - 09h20 - 10h32 11h32 bureaux, Colombelles COLOMBELLES: - - - - 07h40 - 09h23 - 10h35 11h35 lazzaro, Colombelles STE HONORINE LA CHARDRONNETTE, - - - - 07h42 - 09h25 - 10h37 11h37 Hérouvillette HEROUVILLETTE: l'aiguillon, - - - - 07h45 - 09h28 - 10h40 11h40 Hérouvillette RANVILLE: albert - - - - - - 09h31 - 10h43 - camus, Ranville BREVILLE LES MONTS: mairie, Bréville-les- - - - - - - 09h34 - 10h46 - Monts AMFREVILLE: les - - - - - - 09h35 - 10h47 - moutiers, Amfreville AMFREVILLE: le plain, - - - - - - 09h36 - 10h48 - Amfreville AMFREVILLE: hameau - - - - - - 09h37 - 10h49 - oger, Amfreville AMFREVILLE: la - - - - - - 09h38 - 10h50 - perruque, Amfreville SALLENELLES: baie de - - - - - - 09h39 - 10h51 - l'orne, Sallenelles MERVILLE- FRANCEVILLE: ancienne gare, - - - - - - 09h42 - 10h54 - Merville-Franceville- Plage MERVILLE- FRANCEVILLE: plage, - - - - - - 09h44 - - - Merville-Franceville- Plage MERVILLE- FRANCEVILLE: route - - -

ESTUAIRE DE L'orne (Identifiant National : 250006473)
Date d'édition : 12/01/2021 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006473 ESTUAIRE DE L'ORNE (Identifiant national : 250006473) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00190001) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250006473, ESTUAIRE DE L'ORNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 46P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250006473.pdf Région en charge de la zone : Basse-Normandie Rédacteur(s) :SAVINI J-R Centroïde calculé : 412686°-2478910° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 01/06/2016 Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020 Date de première diffusion INPN : 26/03/2019 Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 5 7. ESPECES ...................................................................................................................................... -

Mois De JUIN 2018
La Sécurité Routière dans le Calvados Tableau de bord mensuel provisoire Juin 2018 Accidents Tués à 30 dont Bilan du mois Blessés corporels jours hospitalisés Juin 2018 provisoire 37 1 47 20 Juin 2017 définitif 49 2 65 39 Différence 2018/2017 - 12 - 1 - 18 - 19 Evolution 2018/2017 - 24,5% - 50,0% - 27,7% - 48,7% Evolution mois par mois Evolution mensuelle de l’année glissante L'année glissante est le cumul sur les douze derniers mois Accidents 553 2017 2018 545 546 542 539 535 527 56 516 51 49 50 50 45 500 42 44 40 38 483 479 35 37 37 36 32 34 467 29 24 Tués 8 8 47 47 46 46 46 45 2017 2018 44 6 6 40 4 37 3 3 3 34 2 2 2 2 2 2 32 32 1 1 1 0 Blessés 77 705 2017 2018 692 698 697 690 686 676 65 64 663 62 60 642 59 56 627 620 54 55 602 49 47 49 47 44 45 38 35 31 Blessés hospitalisés 351 2017 2018 342 342 342 339 331 320 39 316 306 34 33 300 29 30 295 25 26 27 25 23 23 22 276 18 18 20 14 14 16 Établi à partir des remontées rapides fournies par les forces de l'ordre le 05 juin 2018 Service Système d'Information, de la Circulation Routière et de l'Expertise Territoriale - Sécurité Routière 10, boulevard Général Vanier – CS 75224 - 14052 Caen cedex4 Tél: 02 31 43 16 58 - courriel: [email protected] Observatoire Départemental de Sécurité Routière Pas de Fenêtre Les accidents mortels dans le Calvados HonfleurHonfleurHonfleur JUIN 2018 DDD DDD555 555111 111444 333 555111333 DDD555 DDD DDD666555 D278D278D278 Surrain Saint-Arnoult Isigny-sur-MerIsigny-sur-MerIsigny-sur-Mer Crépon DDD DDD222 222777 777888 BayeuxBayeuxBayeux OuistrehamOuistreham -

Calvados Pays D'auge
Publié au BO AGRI du 12 février 2015 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » homologué par le décret n ° 2 015-134 du 6 février 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge », JORF du 8 février 2015 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « Calvados Pays d’Auge » Partie I : Fiche Technique 1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’Indication Géographique L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » est enregistrée à l’annexe III du Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau de vie de cidre et de poiré », Annexe II, point 10. 2. Description de la boisson spiritueuse L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » désigne des eaux-de-vie ayant été vieillies sous bois au minimum 2 ans à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent être commercialisés sans condition de vieillissement. L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » est réservée aux eaux-de-vie assemblées ou non provenant de la distillation exclusive de cidres ou de poirés, produites conformément au Règlement (CE) n°110/2008 et répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2.1. Caractéristiques organoleptiques Le « Calvados Pays d’Auge » présente une robe allant de jaune paille à ambré foncé. Au nez et en bouche, il développe des notes aromatiques qui rappellent les fruits dont il est issu. -

210X297 Fichescalvadosavelo2021 2.Indd
Véloroute Retrouvez la carte complète du pays d’Auge des itinéraires dans le document Section de Cabourg à Mézidon-Canon Le Calvados à Vélo 2021 D513 Houlgate Auberville Cabourg Baie Merville- Franceville- 3 km 7 D514 2 de l’Orne Le Hôme D D Plage 2 1 4 6 Varaville 1 3 Ouistreham D DSaint-Vaast-2 4en-Auge D35A Gonneville- 1 4 Dives- D5 D 4 sur-Mer 1 Cabourg 8 3 sur-Mer 4 51 D 2 D D 45 A Heuland Saint-Aubin- D400A d'Arquenay Sallenelles 23 2 Branville D Grangues Gonneville- D49 B 4 45 1 0 D 0 Dives-sur- 5 4 en-Auge D 4 D Mer 27 Périers-en- Douville- D D 9 D en-Auge 5 Auge 4 A 5 D400A 6 13 Varaville C 7 7 2 Amfreville D5 D2 s D Danestal 5 e D 9 v 2 D i Brucourt 36 10 km Angerville A Petiville D 13 Pegasus Bréville- a re Bridge L Cricqueville- nc les-Monts L'A D400 en-Auge D Bavent Cresseveuille 2 7 Ranville D in 6 37 D2 rs 2 24 D D u D 0 224 Photo © Calvados Attractivité 4 29 Dozulé 28 D 2 O 5 7 3 67 Hérouvillette 6 D l a D Hameau n Saint-Léger- 3 a 3 7 de Bricqueville C Sites propres 2 Dubosq 2 Beaufour- D Putot- Sites propres Escoville Bois de Goustranville Druval Voies partagées 9 en-Auge D Voies partagées 5 km 4 SitesItinéraires propres en cours 2 D Bavent Saint-Jouin 7 D 6 VoiesItinérairesd’aménagement partagées en cours 3 D228 7 3 D675 l C 1 a d’aménagement A n BoucleItinéraires vélo en cours a Bures sur C Boucled’aménagement vélo A D 4 Basseneville 8 SERVICES Dives 2 5 2 Boucle vélo Cuverville Touréville D d 46 SERVICESOffice de Tourisme n D1 a OfficeSyndicat de d’initiativeTourisme Saint- r 6A SERVICES 2,2 km G D14 Giberville D22 -

20Caen Cabourg Deauville
LIGNE CAEN CABOURG 20 DEAUVILLE HORAIRES VALABLES DU 02 SEPTEMBRE 2021 AU 06 JUILLET 2022 INCLUS* *Horaires susceptibles d’être modifiés au 19 décembre 2021. Car en coordination avec les trains lun au ven en provenance de PARIS sam et dim lun au ven Autres correspondances NOMAD sam et dim Lundi Lundi Lundi Lundi, Lundi Horaires Deauville Lundi Lundi Lundi Lundi Lundi Dimanches et fêtes Lundi au Samedi au au Lundi au Vendredi au au au au Samedi Lundi au vendredi Mardi, au au au vendredi samedi samedi samedi vendredi Jeudi, vendredi (sauf le 1er mai) < > le Havre en page 2 samedi (3) (2) vendredi samedi (1) Vendredi samedi (1) samedi Période de validité TA TA TA TA TA TA TA PS TA TA TA TA TA PS PVS TA PS TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA CAEN / Gare Routière 07:30 07:30 09:13 10:25 11:25 12:30 13:26 13:30 14:30 15:20 17:03 16:53 17:30 17:20 18:08 18:08 18:41 19:30 20:15 07:55 09:25 11:25 14:25 15:30 18:30 20:20 CAEN / Demi-Lune 07:33 07:33 09:16 10:28 11:28 12:33 13:29 13:33 14:33 15:23 17:06 16:56 II 18:11 18:11 18:44 19:33 20:18 07:58 09:28 11:28 14:28 15:33 18:33 20:23 MONDEVILLE / Maison du Peuple 07:34 07:34 09:17 10:29 11:29 12:34 13:30 13:34 14:34 15:24 17:07 16:57 II 18:12 18:12 18:45 19:34 20:19 07:59 09:29 11:29 14:29 15:34 18:34 20:24 MONDEVILLE / Route de Cabourg 07:35 07:35 09:18 10:30 11:30 12:35 13:31 13:35 14:35 15:25 17:08 16:58 II 18:13 18:13 18:46 19:35 20:20 08:00 09:30 11:30 14:30 15:35 18:35 20:25 MONDEVILLE / Grands Bureaux 07:37 07:37 09:20 10:32 11:32 12:37 13:33 13:37 14:37 15:27 17:10 17:00 17:37 17:27 18:15 18:15 -

En Poursuivant Votre Navigation Sur Ce Site, Vous Acceptez L'utilisation De Cookies Pour Mesurer La Fréquentation De Nos Services Afin De Les Améliorer
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau : NOMAD CARS Calvados 26/09/2021 Ligne : 20 Direction : Gare SNCF (Caen) Arrêt Horaires LE HAVRE: gare - - - - - - - 14h00 - - routière, Le Havre HONFLEUR: village - - - - - - - - - - des marques, Honfleur LA RIVIERE-ST SAUVEUR: rue du - - 10h12 (1) - - - - 14h26 - - bourg, La Rivière- Saint-Sauveur LA RIVIERE ST SAUVEUR: saint clair, - - 10h14 (1) - - - - 14h28 - - La Rivière-Saint- Sauveur HONFLEUR: les - - 10h16 (1) - - - - 14h30 - - marronniers, Honfleur HONFLEUR: gare 08h20 (1) - 10h21 (1) - 11h20 (1) 13h20 (1) - 14h35 16h20 (1) - routiere, Honfleur HONFLEUR: place 08h23 (1) - 10h24 (1) - 11h23 (1) 13h23 (1) - 14h38 16h23 (1) - sorel, Honfleur HONFLEUR: vert 08h24 (1) - 10h25 (1) - 11h24 (1) 13h24 (1) - 14h39 16h24 (1) - feuillage, Honfleur EQUEMAUVILLE: la briquerie, 08h27 (1) - 10h28 (1) - - 13h27 (1) - - 16h27 (1) - Équemauville PENNEDEPIE: route de 08h32 (1) - 10h33 (1) - - 13h32 (1) - - 16h32 (1) - trouville, Pennedepie PENNEDEPIE: planche 08h34 (1) - 10h35 (1) - - 13h34 (1) - - 16h34 (1) - pierre, Pennedepie CRICQUEBOEUF: 08h36 (1) - 10h37 (1) - - 13h36 (1) - - 16h36 (1) - manoir, Cricquebœuf VILLERVILLE: parking 08h38 (1) - 10h39 (1) - - 13h38 (1) - - 16h38 (1) - des tennis, Villerville CRICQUEBOEUF: 08h40 (1) - 10h41 (1) - - 13h40 (1) - - 16h40 (1) - manoir, Cricquebœuf EQUEMAUVILLE: château d'eau, - - - - 11h27 (1) - - -

20Le Havre Deauville Caen
LIGNE LE HAVRE DEAUVILLE CAEN 20 ER HORAIRES VALABLES DU 7 JUILLET 2021 AU 1 SEPTEMBRE 2021 INCLUS lun au ven Autres correspondances NOMAD sam Lundi Lundi Navette Honfleur - Deauville en page 3 au Lundi au Lundi au samedi vendredi au samedi vendredi LE HAVRE / Gare Routière 09:00 18:05 20:15 HONFLEUR* / Village des Marques 09:21 I I LA RIVIÈRE ST-SAUVEUR* / Rue du Bourg I 11:21 18:28 20:38 LA RIVIÈRE ST-SAUVEUR* / Saint-Clair I 11:23 18:30 20:40 HONFLEUR* / Gare Routière (Arrivée) 09:26 11:28 18:34 20:45 HONFLEUR* / Gare Routière (Départ) 06:25 08:00 08:40 09:28 11:30 13:20 15:30 16:00 19:01 19:30 I HONFLEUR* / Les Marronniers 06:27 08:03 08:43 I 11:33 13:23 15:33 16:03 19:04 19:33 20:43 ST-GATIEN-DES-BOIS* / Église 06:38 08:14 08:54 I 11:44 13:34 15:44 16:14 19:15 19:44 ST-GATIEN-DES-BOIS* / Aéroport 06:42 08:18 08:58 I 11:48 13:38 15:48 16:18 19:19 19:48 CRICQUEBŒUF* / Pôle de Santé I I 09:02 I 11:52 13:42 I 16:22 19:23 I TOUQUES* / La Croix Sonnet 06:46 08:22 09:04 I 11:54 13:44 15:52 16:24 19:25 19:52 TOUQUES* / Église 06:50 08:26 09:08 I 11:59 13:49 15:57 16:28 19:29 19:56 TOUQUES* / Reine Mathilde 06:51 08:27 09:09 I 12:00 13:50 15:58 16:29 19:30 19:57 DEAUVILLE* / Gare Routière (Arrivée) 06:57 08:33 09:15 09:59 12:09 13:57 16:07 16:35 19:36 20:03 DEAUVILLE* / Gare Routière (Départ) 07:05 07:30 08:35 09:20 10:10 11:15 11:45 12:15 13:00 14:15 15:05 16:10 16:40 17:40 18:10 18:40 19:40 20:35 21:35 DEAUVILLE* / Art Station 07:07 07:32 08:38 09:23 10:13 11:18 I 12:18 13:03 14:19 15:08 16:14 16:43 I 18:13 18:43 19:42 20:37 21:37 DEAUVILLE* -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°14-2020-070 Publié Le 21 Mai 2020
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°14-2020-070 CALVADOS PUBLIÉ LE 21 MAI 2020 1 Sommaire Préfecture du Calvados 14-2020-05-20-015 - Arrêté n° 2020/SIDPC/CR/220 autorisant les activités nautiques et de plaisance sur tous les cours d'eau intérieurs du Calvados (2 pages) Page 3 14-2020-05-20-014 - Arrêté n° 2020/SIDPC/SP/203 autorisant l'activité de plaisance au départ du port de Caen (2 pages) Page 6 14-2020-05-20-016 - Arrêté n° 2020/SIDPC/SP/214 autorisant l'activité de plaisance au départ du port d'Isigny-sur-mer (2 pages) Page 9 14-2020-05-20-019 - Arrêté n° 2020/SIDPC/SV/209 portant autorisation dérogatoire de réouverture d'un musée sur la commune de Saint-Martin des Besaces (2 pages) Page 12 14-2020-05-20-017 - Arrêté n° 2020/SIDPC/SV/210 portant autorisation dérogatoire de réouverture d'un musée sur la commune de Mézidon-Vallée-d'Auge (2 pages) Page 15 14-2020-05-20-018 - Arrêté n° 2020/SIDPC/SV/211 portant autorisation dérogatoire de réouverture d'un musée sur la commune de SALLENELLES (2 pages) Page 18 14-2020-05-19-007 - Arrêté n°202/SIDPC/SP/206 autorisant l'activité de plaisance au départ du port de Port-en-Bessin-Huppain (2 pages) Page 21 14-2020-05-19-008 - Arrêté n°2020/SIDPC/SP/201 autorisant l'activité de plaisance au départ du port de Courseulles sur Mer (2 pages) Page 24 14-2020-05-19-009 - Arrêté n°2020/SIDPC/SP/202 autorisant l'activité de plaisance au départ de l'équipement léger pour la plaisance de Merville-Franceville (2 pages) Page 27 2 Préfecture du Calvados 14-2020-05-20-015 Arrêté n° 2020/SIDPC/CR/220 -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2020
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 14 CALVADOS INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 14 - CALVADOS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 14-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 14-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 14-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 14-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la -

Véloroute Côte Fleurie Du Pays D'auge
Trouville- Deauville sur-mer Bayeux 11 Cabourg Pont- Retrouver Caen l’Évêque la carte Villers- complète Véloroute Côte Fleurie Bocage Lisieux Mézidon- des itinéraires Vallée-d’Auge dans le document Le Hom Livarot- Pays-d’Auge 11 Vire- Falaise Le du pays d’Auge Normandie Condé-en- Calvados Normandie SECTION DE CABOURG À MÉZIDON-CANON à Vélo 2017 3 1 5 D Auberville Houlgate Merville- Cabourg Baie Saint-Vaast- Franceville- 3 km 7 D514 de l’Orne 2 Le Hôme D en-Auge D Plage 2 1 4 6 Varaville 1 3 D514 D D Ouistreham 24 D35A Gonneville- 1 4 Dives- 5 D 4 D sur-Mer 1 8 3 sur-Mer Cabourg4 51 D 2 D D 45 A Heuland Saint-Aubin- D400A d'Arquenay Sallenelles Grangues Branville Gonneville- D49 B D514 4 45 1 0 D 23 0 5 2 en-Auge 4 Dives-sur- D D 4 D27 D Périers-en- Douville-Mer D en-Auge Auge 4 5 D400A 6 3 Varaville C 7 D 1 5 7 2 9 2 Amfreville D D D 5 A s Danestal 5 e D 9 v 2 D i Brucourt 36 10 km Angerville A1 Petiville D 3 Pegasus Bréville- a e L Cricqueville- ncr Bridge 'A les-Monts D400 L Bavent en-Auge Cresseveuille D 27 Ranville D 1 in 6 37 D2 rs 2 24 u D 0 D224 D 2 4 2 29 8 D O 5 Dozulé 7 3 7 6 D6 Hérouvillette l a D Hameau n Saint-Léger- 3 a 3 7 de Bricqueville C 2 Dubosq 2 Beaufour- D Putot- Escoville Bois de Goustranville Druval 9 en-Auge D 5 km 4 2 D Bavent Saint-Jouin 7 D 6 D228 37 D675 C 3 al A1 n a A Basseneville 4 C Bures sur 2 2 D 8 Dives D 5 Repentigny Cuverville Touréville d 46 n D1 a r 6A 2,2 km G D14 Giberville D2 Saint- 8 26 2 Sannerville e Gerrots 2 0 Samson L 8 D D Beuvron- e Doigt 30 Saline L Démouville D675 en-Auge D117 Rumesnil