Calvados Pays D'auge
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Camembert De Normandie »
CAHIER DES CHARGES de L’APPELLATION D’ORIGINE « Camembert de Normandie » Version du 19/07/2012 1/17 SOMMAIRE 1. NOM DU PRODUIT :................................................................................................3 2. DESCRIPTION DU PRODUIT: ................................................................................3 3. DELIMITATION DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.....................................................3 4. ELEMENTS PROUVANT QUE LE PRODUIT EST ORIGINAIRE DE L'AIRE GEOGRAPHIQUE :.........................................................................................................8 4.1. Déclaration d’identification :....................................................................................................................... 8 4.2. Déclaration des installations de sanitation.................................................................................................. 9 4.3. Déclarations nécessaires à la connaissance et au suivi des volumes ......................................................... 9 4.4. Tenue de registres......................................................................................................................................... 9 4.5. Contrôles sur le produit ............................................................................................................................. 10 5. DESCRIPTION DE LA METHODE D'OBTENTION DU PRODUIT : .....................10 5.1. Race............................................................................................................................................................. -
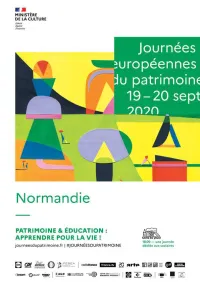
JEP20-Calvados.Pdf
PATRIMOINE & ÉDUCATION APPRENDRE POUR LA VIE ! Journées européennes du patrimoine 2020 Éditorial Je veux déconfiner la culture pour La journée du 18 septembre qu’elle soit l’affaire de tous. « Levez les yeux ! », dédiée aux élèves de la maternelle au lycée, Qui aurait pu penser au printemps, ainsi que le thème de cette que les Journées européennes du patrimoine pourraient se dérouler, édition « Patrimoine et éducation : à la date prévue, les 19 et 20 apprendre pour la vie ! » sont septembre prochain ? autant d’opportunités pour transmettre à tous les jeunes le Nous ne pouvions pas ne pas goût du patrimoine. renouer avec nos monuments et lieux historiques comme nous Lieux de pouvoir, monuments le faisons depuis 36 ans chaque emblématiques de la nation, troisième week-end du mois châteaux, patrimoines ruraux, de septembre. jardins historiques, édifices religieux ou encore sites Et ce lien étroit qui nous unit industriels… : c’est à nouveau à notre patrimoine va, j’en MCDidier Plowy suis convaincue, se renforcer toute la belle et riche diversité du pendant l’été. patrimoine qui s’offre à vous, aux Roselyne BACHELOT millions de visiteurs passionnés qui Les déplacements de loisirs et les Ministre de la Culture chaque année se mobilisent. vacances qu’un grand nombre de nos concitoyens envisagent Pour ce grand rendez-vous cette année en France pourront monuments ont besoin d’accueillir festif du mois de septembre, je faire la part belle à ce patrimoine des visiteurs, faites leur ce plaisir, souhaite que ces 37èmes Journées de proximité qui jalonne tout mais surtout faites-vous plaisir en européennes du patrimoine soient notre territoire. -

Acqueville Bucéels Culey-Le-Patry Grainville-Sur-Odon Agy Cabourg
Communes du ressort du tribunal d'instance de CAEN* Acqueville Bucéels Culey-le-Patry Grainville-sur-Odon Agy Cabourg Cussy Grandcamp-Maisy Amayé-sur-Orne Caen Cuverville Graye-sur-Mer Amayé-sur-Seulles Cagny Damblainville Grentheville Amfreville Cahagnolles Démouville Grimbosq Angoville Cairon Deux-Jumeaux Guéron Anisy Cambes-en-Plaine Donnay Hermanville-sur-Mer Arganchy Campigny Douvres-la-Délivrande Hérouville-Saint-Clair Argences Canchy Ducy-Sainte-Marguerite Hérouvillette Arromanches-les-Bains Canteloup Ellon Hom (Le) Asnelles Carcagny Émiéville Hottot-les-Bagues Asnières-en-Bessin Cardonville Englesqueville-la-Percée Hubert-Folie Aubigny Carpiquet Épaney Ifs Audrieu Cartigny-l'Épinay Épinay-sur-Odon Isigny-sur-Mer Aure sur Mer Castillon Épron Janville Aurseulles Caumont-sur-Aure Eraines Jort Authie Cauvicourt Ernes Juaye-Mondaye Avenay Cauville Escoville Juvigny-sur-Seulles Balleroy-sur-Drôme Cesny-aux-Vignes Espins La Bazoque Banneville-la-Campagne Cesny-Bois-Halbout Esquay-Notre-Dame La Caine Banville Chouain Esquay-sur-Seulles La Cambe Barbery Cintheaux Esson La Folie Barbeville Clécy Estrées-la-Campagne La Hoguette Baron-sur-Odon Cléville Éterville La Pommeraye Barou-en-Auge Colleville-Montgomery Étréham La Villette Basly Colleville-sur-Mer Évrecy Laize-Clinchamps Bavent Colombelles Falaise Landes-sur-Ajon Bayeux Colombières Feuguerolles-Bully Langrune-sur-Mer Bazenville Colombiers-sur-Seulles Fleury-sur-Orne Le Bô Beaumais Colomby-Anguerny Fontaine-Étoupefour Le Breuil-en-Bessin Bellengreville Combray Fontaine-Henry Le Bû-sur-Rouvres -

Dives Sur Mer, Le 23 Juillet 2020 a L'attention Des Conseillers
Le Président Dives sur Mer, le 23 juillet 2020 A l’attention des conseillers communautaires Liste des destinataires in fine Mesdames, Messieurs les Conseillers et chers collègues, La prochaine réunion du conseil communautaire de Normandie-Cabourg-Pays d’Auge se déroulera en présentiel le : Jeudi 30 juillet 2020 à 17h00 Espace Nelson Mandela A Dives sur Mer A NOTER : ➢ Dans ce contexte de crise sanitaire, veuillez-vous munir d’un masque et d’un stylo personnel ➢ En cas d’indisponibilité vous pouvez donner ou recevoir 2 pouvoirs, ces pouvoirs doivent être déposés ou transmis avant la réunion (dans le cas contraire il n’en sera pas pris compte) ➢ La séance ne sera pas ouverte au public L’ordre du jour est le suivant : - Compte rendu conseil communautaire du 16 juillet 2020 ; - Annonce des dernières décisions du Président ; 1- Délégation de pouvoir au Président, vice-présidents, membres du bureau ; 2- Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO) ; 3- Election des membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 4- Modification des statuts de l'EPIC Office de Tourisme Intercommunal ; 5- Election au Comité de direction de l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal ; 6- Election d’un représentant à la Mission Locale Caen la Mer Calvados Centre ; 7- Election des délégués au bureau du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole ; 8- Election de représentants au GAL LEADER ; 9- Election de représentants au Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets ménagers de l'Agglomération Caennaise -

Laissez-Vous Conter Le Pays D'auge
Document en gros caractères Laissez-vous conter le Pays d’Auge Sommaire Les paysages…………………………………. Page 2 Le pays au fil des siècles……………………. Page 6 D’une ville à l’autre…………………………… Page 9 De bourgs en hameaux……………………… Page 12 Formes et matériaux…………………………. Page 16 Saveurs et traditions…………………………. Page 20 Principaux sites du Pays d’art et d’histoire… Page 24 OT Cabourg 1 Les paysages Au contact du bassin parisien et du massif armoricain, le Pays d’Auge forme un long triangle ouvert sur la Manche par la Côte Fleurie. Un ensemble géographique cohérent Le Pays d’Auge est avant tout une entité géographique. Sa frontière avec les plaines de Caen et de Falaise est matérialisée par une vigoureuse cuesta* d’une centaine de mètres de hauteur. Limité au sud par le plateau du Merlerault, le Pays d’Auge se distingue du Lieuvin et du Pays d’Ouche à l’est par ses vallées aux formes molles où coulent les nombreux affluents de ses deux principaux cours d’eau, la Touques et la Dives. *Cuesta : talus en pente raide dans les bassins sédimentaires. Du plateau crayeux qu’est le Pays d’Auge, les cours d’eau ont façonné un ensemble de paysages variés. Au sud de Lisieux, ils ont creusé des vallées encaissées entre des versants dressés. Ces vallées s’élargissent plus au nord laissant serpenter la Touques ou la Calonne. Au sud- ouest, la Vie et ses affluents n’ont laissé du plateau que des lambeaux. « L’ossature » constituée de plateaux, de vallées et de versants, confère pourtant à ces paysages augerons une réelle unité. -

Gare Routiere
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour mesurer la fréquentation de nos services afin de les améliorer. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies Réseau : NOMAD CARS Calvados 27/09/2021 Ligne : 20 Direction : DEAUVILLE: gare routière (Deauville) Arrêt Horaires CAEN: gare routiere, - - - - 07h30 - 09h13 - 10h25 (0) 11h25 Caen CAEN: demi lune, Caen - - - - 07h33 - 09h16 - 10h28 (0) 11h28 MONDEVILLE: maison - - - - 07h34 - 09h17 - 10h29 (0) 11h29 du peuple, Mondeville MONDEVILLE: route de - - - - 07h35 - 09h18 - 10h30 (0) 11h30 cabourg, Mondeville MONDEVILLE: grands - - - - 07h37 - 09h20 - 10h32 (0) 11h32 bureaux, Colombelles COLOMBELLES: - - - - 07h40 - 09h23 - 10h35 (0) 11h35 lazzaro, Colombelles STE HONORINE LA CHARDRONNETTE, - - - - 07h42 - 09h25 - 10h37 (0) 11h37 Hérouvillette HEROUVILLETTE: l'aiguillon, - - - - 07h45 - 09h28 - 10h40 (0) 11h40 Hérouvillette RANVILLE: albert - - - - - - 09h31 - 10h43 (0) - camus, Ranville BREVILLE LES MONTS: mairie, Bréville-les- - - - - - - 09h34 - 10h46 (0) - Monts AMFREVILLE: les - - - - - - 09h35 - 10h47 (0) - moutiers, Amfreville AMFREVILLE: le plain, - - - - - - 09h36 - 10h48 (0) - Amfreville AMFREVILLE: hameau - - - - - - 09h37 - 10h49 (0) - oger, Amfreville AMFREVILLE: la - - - - - - 09h38 - 10h50 (0) - perruque, Amfreville SALLENELLES: baie de - - - - - - 09h39 - 10h51 (0) - l'orne, Sallenelles MERVILLE- FRANCEVILLE: ancienne gare, - - - - - - 09h42 - 10h54 (0) - Merville-Franceville- Plage MERVILLE- FRANCEVILLE: plage, - - - - - - 09h44 - -

Commune 14600 Ablon 14220 Acqueville 14710 Aignerville 14310
Commune 14600 Ablon 14220 Acqueville 14710 Aignerville 14310 Amayé-sur-Seulles 14480 Amblie 14860 Amfreville 14240 Anctoville 14430 Angerville 14220 Angoville 14610 Anguerny 14610 Anisy 14400 Arganchy 14117 Arromanches-les-Bains 14960 Asnelles 14700 Aubigny 14250 Audrieu 14260 Aunay-sur-Odon 14140 Auquainville 14140 Autels-Saint-Bazile 14140 Authieux-Papion 14130 Authieux-sur-Calonne 14340 Auvillars 14940 Banneville-la-Campagne 14260 Banneville-sur-AJon 14480 Banville 14400 Barbeville 14600 Barneville-la-Bertran 14620 Barou-en-Auge 14610 Basly 14670 Basseneville 14260 Bauquay 14860 Bavent 14480 Bazenville 14340 Beaufour-Druval 14950 Beaumont-en-Auge 14370 Bellengreville 14140 Bellou 14910 Benerville-sur-Mer 14350 Bény-Bocage 14440 Bény-sur-Mer 14170 Bernières-d'Ailly 14112 Biéville-Beuville 14270 Biéville-Quétiéville 14260 Bigne 14370 Billy 14370 Bissières 14130 Blangy-le-Château 14400 Blay 14910 Blonville-sur-Mer 14690 Bô 14340 Boissière 14340 Bonnebosq 14260 Bonnemaison 14800 Bonneville-sur-Touques 14700 Bonnœil 14420 Bons-Tassilly 14210 Bougy 14220 Boulon 14430 Bourgeauville 14540 Bourguébus 14430 Branville 14740 Bretteville-l'Orgueilleuse 14190 Bretteville-le-Rabet 14170 Bretteville-sur-Dives 14760 Bretteville-sur-Odon 14130 Breuil-en-Auge 14330 Breuil-en-Bessin 14130 Brévedent 14140 Brévière 14860 Bréville-les-Monts 14250 Brouay 14160 Brucourt 14190 Bû-sur-Rouvres 14250 Bucéels 14350 Bures-les-Monts 14630 Cagny 14240 Cahagnes 14490 Cahagnolles 14210 Caine 14230 Cambe 14610 Cambes-en-Plaine 14500 Campagnolles 14260 Campandré-Valcongrain -

Les Échos Des Marais Juillet
Juillet Les échos des marais 2017 n°20 FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 9 SEPTEMBRE de 14h à 17h • Salle de judo INFORMATIONS • ECHANGES • INSCRIPTIONS www.bavent.fr Venez rencontrer les associations du village ! Le mot du maire Avant tout, je souhaite remercier mon équipe Avec notre partenaire les HLM » Calvados-Habitat », la com- municipale qui m’apporte en permanence son mune engage à partir de cette année un vaste programme soutien. de construction d’une quarantaine de logements sociaux et de Il est l’heure de faire le point sur l’avenir de 6 à 8 commerces de proximité. Il est évident que le commerce Bavent/Robehomme . d’alimentation reste pour moi une priorité qui répondra aux désirs de la population. Les constructions se feront sur deux Deux espaces jeux pour les enfants sont en sites différents, face au terrain de foot à l’entrée du nouveau cours de construction à Robehomme. lotissement et près de la mairie en face de la maison de santé. Toutes les parcelles des deux lotissements de Bavent sont Les travaux devraient commencer en fin d’année. vendues et les dernières maisons verront le jour au cours de l’année 2018. La modification et la révision du plan local d’urbanisme sont en cours, cette modification pourra ouvrir à la construction Le projet le plus proche sera consacré à la maison médicale. de notre nouvelle zone artisanale à l’Arbre Martin et permettra Le permis de construire a été accordé en mai 2017 et les de créer un rond-point en haut de la côte de Bavent. -

Numéro INSEE Nom De La Commune 14001 ABLON 14024 AUBERVILLE
annexe n°1 arrêté préfectoral 14-2017-0003 numéro INSEE Nom de la commune 14001 ABLON 14024 AUBERVILLE 14041 BARNEVILLE-LA-BERTRAN 14055 BEAUMONT-EN-AUGE 14059 BENERVILLE-SUR-MER 14069 BEUVILLERS 14077 BLANGY-LE-CHATEAU 14079 BLONVILLE-SUR-MER 14085 BONNEVILLE-LA-LOUVET 14086 BONNEVILLE-SUR-TOUQUES 14091 BOURGEAUVILLE 14131 CANAPVILLE 14147 CERNAY 14161 CLARBEC 14177 COQUAINVILLIERS 14179 CORDEBUGLE 14185 COUDRAY-RABUT 14193 COURTONNE-LA-MEURDRAC 14194 COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES 14202 CRICQUEBOEUF 14220 DEAUVILLE 14230 DRUBEC 14238 ENGLESQUEVILLE-EN-AUGE 14243 EQUEMAUVILLE 14260 FAUGUERNON 14269 FIERVILLE-LES-PARCS 14270 FIRFOL 14280 FORMENTIN 14286 FOURNEVILLE 14293 FUMICHON 14299 GENNEVILLE 14302 GLANVILLE 14303 GLOS 14304 GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR 14326 HERMIVAL-LES-VAUX 14333 HONFLEUR 14334 L'HOTELLERIE 14273 LA FOLLETIERE-ABENON 14536 LA RIVIERE-SAINT-SAUVEUR 14740 LA VESPIERE-FRIARDEL 14102 LE BREUIL-EN-AUGE Page 1 annexe n°1 arrêté préfectoral 14-2017-0003 14104 LE BREVEDENT 14261 LE FAULQ 14419 LE MESNIL-EUDES 14421 LE MESNIL-GUILLAUME 14426 LE MESNIL-SUR-BLANGY 14504 LE PIN 14520 LE PRE-D'AUGE 14687 LE THEIL-EN-AUGE 14694 LE TORQUESNE 14032 LES AUTHIEUX-SUR-CALONNE 14366 LISIEUX 14368 LISORES 14371 LIVAROT-PAYS-D'AUGE 14398 MANERBE 14399 MANNEVILLE-LA-PIPARD 14403 MAROLLES 14460 MOYAUX 14466 NOROLLES 14478 ORBEC 14484 OUILLY-DU-HOULEY 14487 OUILLY-LE-VICOMTE 14492 PENNEDEPIE 14500 PIERREFITTE-EN-AUGE 14514 PONT-L'EVEQUE 14522 PRETREVILLE 14528 QUETTEVILLE 14534 REUX 14540 ROCQUES 14555 SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT 14557 SAINT-ARNOULT -

Annebault Argences Asnieres Beaufour Druval
PRODUCTEURS, ARTISANS COMMERCANTS PAYS D’AUGE Liste non exhaustive selon vos adresses mise à jour au 9 Avril ANNEBAULT AU POTAGER DE MIMILE, maraîcher – 06 16 48 54 38 – Vente sur place https://www.facebook.com/Maraicher-Au-potager-de-mimile-590786101047807/ LA MARE AU LIÈVRE : 70, route de Lisieux – 02 31 64 85 57 Pendant le confinement, La Mare Au Lièvre a décidé d'ouvrir un service à emporter pour les services du week-end.( On ne pouvait pas ne pas proposer le fameux gigot de 7h cette année!!! ).A suivre pour les week-end suivants avec d'autres menus proposés si vous êtes au rendez vous !!! Commande obligatoire et Attestation 1ère nécessité valable et obligatoire pour circuler... https://www.facebook.com/LaMareAuLievre/ ARGENCES Marché maintenu le jeudi matin AU PARFUM FLORAL – 334, route de Canteloup - Tél : 06 67 04 50 52 Vente sur place de plants potagers et à fleurs https://www.facebook.com/Au-Parfum-Floral-108583674129191 ASNIERES PISCICULTURE DE LA CALONNE – 23, Ham Saint Jean - Tél : 02 32 57 81 38 Vente au détail de truites du lundi au samedi de 8h30 à 12h00. Moyens de paiement sans contact privilégiés. https://www.facebook.com/Pisciculture-de-la-Calonne-et-ses-étangs-de-pêche- 669150036539873 BEAUFOUR DRUVAL FERME CIDRICOLE DESVOYES – Tél : 02 31 65 11 94 - 06 72 50 02 64. Vente sur place de cidres, poirés, jus de pommes, confitures, caramels, vinaigre de cidre et calvados : https://www.facebook.com/profile.php?id=100015340218972 Caroline & Thierry Pic – 06 26 48 22 52 / 06 12 90 67 82 - Bonnebosq BENERVILLE SUR MER NHOMADE (cuisine française et méditerranéenne) 07 68 89 64 13 ou [email protected] Deux anciens chefs du George V ont créé Nhomade, qui propose des menus gastronomiques en livraison à domicile pendant le confinement. -

210X297 Fichescalvadosavelo2021 2.Indd
Véloroute Retrouvez la carte complète du pays d’Auge des itinéraires dans le document Section de Cabourg à Mézidon-Canon Le Calvados à Vélo 2021 D513 Houlgate Auberville Cabourg Baie Merville- Franceville- 3 km 7 D514 2 de l’Orne Le Hôme D D Plage 2 1 4 6 Varaville 1 3 Ouistreham D DSaint-Vaast-2 4en-Auge D35A Gonneville- 1 4 Dives- D5 D 4 sur-Mer 1 Cabourg 8 3 sur-Mer 4 51 D 2 D D 45 A Heuland Saint-Aubin- D400A d'Arquenay Sallenelles 23 2 Branville D Grangues Gonneville- D49 B 4 45 1 0 D 0 Dives-sur- 5 4 en-Auge D 4 D Mer 27 Périers-en- Douville- D D 9 D en-Auge 5 Auge 4 A 5 D400A 6 13 Varaville C 7 7 2 Amfreville D5 D2 s D Danestal 5 e D 9 v 2 D i Brucourt 36 10 km Angerville A Petiville D 13 Pegasus Bréville- a re Bridge L Cricqueville- nc les-Monts L'A D400 en-Auge D Bavent Cresseveuille 2 7 Ranville D in 6 37 D2 rs 2 24 D D u D 0 224 Photo © Calvados Attractivité 4 29 Dozulé 28 D 2 O 5 7 3 67 Hérouvillette 6 D l a D Hameau n Saint-Léger- 3 a 3 7 de Bricqueville C Sites propres 2 Dubosq 2 Beaufour- D Putot- Sites propres Escoville Bois de Goustranville Druval Voies partagées 9 en-Auge D Voies partagées 5 km 4 SitesItinéraires propres en cours 2 D Bavent Saint-Jouin 7 D 6 VoiesItinérairesd’aménagement partagées en cours 3 D228 7 3 D675 l C 1 a d’aménagement A n BoucleItinéraires vélo en cours a Bures sur C Boucled’aménagement vélo A D 4 Basseneville 8 SERVICES Dives 2 5 2 Boucle vélo Cuverville Touréville D d 46 SERVICESOffice de Tourisme n D1 a OfficeSyndicat de d’initiativeTourisme Saint- r 6A SERVICES 2,2 km G D14 Giberville D22 -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°14-2020-094
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°14-2020-094 CALVADOS PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA (1 page) Page 3 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie pour la réalisation des opérations de vidange, transport et élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif (4 pages) Page 5 14-2020-07-16-005 - Arrêté préfectoral prescrivant la restauration de la continuité écologique au point de diffluence de la rivière Orbiquet et du ruisseau Graindin et sur la rivière Orbiquet au droit du vannage du Carmel, commune de LISIEUX (5 pages) Page 10 Préfecture du Calvados 14-2020-07-17-002 - 20200717-ArrêtéGrandsElecteurs (1 page) Page 16 14-2020-07-17-003 - 20200717-GRANDS ELECTEURS (48 pages) Page 18 14-2020-07-17-004 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A13 et A132 (4 pages) Page 67 2 Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 Liste des admis au BNSSA Jury du 13 juin 2020 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 3 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 4 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des