Anteprima Aghion.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Cave of the Nymphs at Pharsalus Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy
The Cave of the Nymphs at Pharsalus Brill Studies in Greek and Roman Epigraphy Editorial Board John Bodel (Brown University) Adele Scafuro (Brown University) VOLUME 6 The titles published in this series are listed at brill.com/bsgre The Cave of the Nymphs at Pharsalus Studies on a Thessalian Country Shrine By Robert S. Wagman LEIDEN | BOSTON Cover illustration: Pharsala. View of the Karapla hill and the cave of the Nymphs from N, 1922 (SAIA, Archivio Fotografico B 326) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Wagman, Robert S. Title: The Cave of the Nymphs at Pharsalus : studies on a Thessalian country shrine / by Robert S. Wagman. Description: Boston : Brill, 2015. | Series: Brill studies in Greek and Roman epigraphy, ISSN 1876-2557 ; volume 6 | Includes bibliographical references and indexes. Identifiers: LCCN 2015032381| ISBN 9789004297616 (hardback : alk. paper) | ISBN 9789004297623 (e-book) Subjects: LCSH: Thessaly (Greece)—Antiquities. | Excavations (Archaeology)—Greece—Thessaly. | Inscriptions—Greece—Thessaly. | Farsala (Greece)—Antiquities. | Excavations (Archaeology)—Greece—Farsala. | Inscriptions—Greece—Farsala. | Nymphs (Greek deities) Classification: LCC DF221.T4 W34 2015 | DDC 938/.2—dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015032381 This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, ipa, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface. issn 1876-2557 isbn 978-90-04-29761-6 (hardback) isbn 978-90-04-29762-3 (e-book) Copyright 2016 by Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Hes & De Graaf, Brill Nijhoff, Brill Rodopi and Hotei Publishing. -
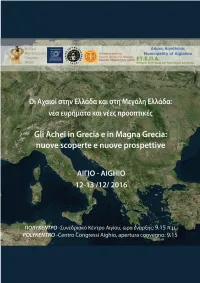
Adobe Photoshop
Gli Achei in Grecia e in Magna Grecia: nuove scoperte e nuove prospettive Οι Αχαιοί στην Ελλάδα και στην Μεγάλη Ελλάδα: νέα ευρήματα και νέες προοπτικές Aighio – Αίγιο 12-13 / 12 /2016 Lunedì 12 dicembre – Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 9.15 Saluti del Sindaco dell’Egialea, dott. A. Panagopoulos Χαιρετισμός του Δημάρχου Αιγιαλείας, κ. Α. Παναγόπουλου Saluti del Direttore della SAIA, prof. E. Papi Χαιρετισμός του Διευθυντή της ΙΑΣΑ, καθ. E. Papi Prof. E. Greco, Prof. A. Rizakis, Introduzione-Εισαγωγή Prima sessione – Dal Tardo Elladico al Geometrico Presiede M. Petropoulos Συνεδρία Α’ – Από την υστεροελλαδική έως την γεωμετρική περίοδο Πρόεδρος Μ. Πετρόπουλος 9.45 E. Borgna - A. G. Vordos, Micenei e Achei. Note preliminari sull’occupazione della Trapezà tra la fine dell’età del bronzo e la prima età storica 10.05 Β. Αργυρόπουλος, Ευρήματα των Μυκηναϊκών και των Μέσων Γεωμετρικών χρόνων σε Μεσοελλαδικό κτιστό θαλαμοειδή τάφο στην περιοχή των Φαρών. Η ερμηνεία των στοιχείων. 10.25 Ι. Μόσχος – Γ. Ζ. Αλεξοπούλου, Η Μυκηναϊκή νεκρόπολη των Πατρών μεταξύ Ανατολής και Δύσης 10.45 Coffee Break 11.00 Ι. Μόσχος, Πολιτικές και Κοινωνικές εξελίξεις κατά την μετάβαση στους Ιστορικούς χρόνους 11.20 Μ. Γκαζής – Κ. Ακτύπη, Η χρήση του Μυκηναϊκού νεκροταφείου της Βούντενης Πατρών κατά την Πρωτογεωμετρική και τη Γεωμετρική περίοδο 11.40 F. Quondam, Strutture sociali in Italia meridionale nel Primo Ferro: l’impatto della colonizzazione greca sul versante ionico della Calabria, da Sibari a Locri 12.00 W. Gauß, New research at Late Bronze Age and Early Iron Age Aigeira 12.20 Δ. Σκιλάρντι, Ενδείξεις ιστορικής συνέχειας στην λατρεία του Ποσειδώνος στην Ελίκη 12.40-13.15 Discussione/Συζήτηση Seconda sessione – Dal periodo geometrico al periodo arcaico I Presiede N. -

Mediterranean Route!
8 EuroVelo 8 Welcome to the Mediterranean Route! FROM ANDALUSIA TO CYPRUS: 7,500 KILOMETRES OF CYCLING THROUGH WORLD FAMOUS DESTINATIONS, WILD NATURE & HIDDEN BEACHES www.eurovelo8.com Welcome to EuroVelo 8 8 Mediterranean Route! AQUILEIA, FRIULI VENEZIA GIULIA, ITALY GACKA RIVER, CROATIA Photo: Giulia Cortesi Photo: Ivan Šardi/CNTB Venice Turin Monaco Béziers Barcelona Elche Cádiz 2 EUROVELO 8 | MEDITERRANEAN ROUTE MAP Dear cyclists, FOREWORD Discovering Europe on a bicycle – the Mediterranean Route makes it possible! It runs from the beaches in Andalusia to the beautiful island of Cyprus, and on its way links Spain, France, Italy, Slovenia, Croatia, Montenegro, Albania, Greece, Turkey and Cyprus. This handy guide will point the way! Within the framework of the EU-funded “MEDCYCLETOUR” project, the Mediterranean Route is being transformed into a top tourism product. By the end of the project, a good portion of the route will be signposted along the Mediterranean Sea. You will be able to cycle most of it simply following the EuroVelo 8 symbol! This guide is also a result of the European cooperation along the Mediterranean Route. We have broken up the 7,500 kilometres into 15 sections and put together cycle-friendly accommodations, bike stations, tourist information and sightseeing attractions – the basic package for an unforgettable cycle touring holiday. All the information you need for your journey can be found via the transnational website – www.eurovelo8.com. You have decided to tackle a section? Or you would like to ride the whole route? Further information and maps, up-to-date event tips along the route and several day packages can also be found on the website. -

Bulletin of the Geological Society of Greece
Bulletin of the Geological Society of Greece Vol. 38, 2005 TEKTONICALLY CONTROLLED DRAINAGE NETWORKS: THE GEOLOGICAL HISTORY OF VOURAIKOS AND LADOPOTAMOS RIVERS (N. PELOPONESSUS ΤΡΙΚΟΛΑΣ Κ. National Technical University of Athens ΑΛΕΞΟΥΛΗ-ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α. National Technical University of Athens http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.18438 Copyright © 2018 Κ. ΤΡΙΚΟΛΑΣ, Α. ΑΛΕΞΟΥΛΗ- ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ To cite this article: ΤΡΙΚΟΛΑΣ, Κ., & ΑΛΕΞΟΥΛΗ-ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ, Α. (2005). TEKTONICALLY CONTROLLED DRAINAGE NETWORKS: THE GEOLOGICAL HISTORY OF VOURAIKOS AND LADOPOTAMOS RIVERS (N. PELOPONESSUS. Bulletin of the Geological Society of Greece, 38, 194-203. doi:http://dx.doi.org/10.12681/bgsg.18438 http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 10/01/2020 21:36:48 | Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVIII, 2005 194 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVIII, 2005 Τεκτονικά ελεγχόμενα υδρογραφικά δίκτυα: η γεωλογι κή ιστορία των ποταμών Βουραϊκού και Λαδοπόταμου (Β. Πελοπόννησος) ΤΡΙΚΟΛΑΣ Κ.1 ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΥΛΗ-ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ Α.1 ABSTRACT The geological research in the greater areas of Aigialia and Kalavryta resulted that neotectonic evolution occurred in two phases; the first one took place from Upper Miocene to Lower-Middle Pleis tocene and the second from Lower-Middle Pleistocene up to now. The deposits and the flow direction of Vouraikos river are controlled by the neotectonic evolution of the region. During the first phase of neotectonic alteration in Lower Pleiocene - Lower Pleistocene, Vouraikos river deposited fluvial sediments of large width and extent, in the areas of M. Spilaio and Ano Diakopto in Kalavryta's ditch, and flowed into the greater area of Ano Diakopto - Akrata in marine or lacustrine environment. -

MORPHOTECTONIC ANALYSIS in the ELIKI FAULT ZONE (GULF of CORINTH, GREECE) Verrios S., Zygouri V., and Kokkalas S
∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Proceedings of the 10th International Congress, Thessaloniki, April 2004 MORPHOTECTONIC ANALYSIS IN THE ELIKI FAULT ZONE (GULF OF CORINTH, GREECE) Verrios S., Zygouri V., and Kokkalas S. Department of Geology, University of Patras, 26500, Patras, Greece, [email protected] ABSTRACT Morphotectonic analysis using geomorphic indices has been developed as a basic reconnais- sance tool in order to identify areas experiencing rapid tectonic deformation or estimate relative variations of tectonic activity in a specific area. We applied this analysis in Eliki fault zone, which is located in the western part of the Gulf of Corinth. Eliki fault zone was selected because it displays a spectacular geomorphic expression and hosts historic and recent seismicity. The intensity of active tectonics is interpreted through a detailed geomorphic study of the fault–generated mountain fronts and fluvial systems. Tectonic geomorphology analysis of the Eliki footwall area includes the applica- tion of the most commonly used geomorphic indices, such as the mountain front sinuosity index (Smf), the valley floor / width ratio index (Vf), the stream gradient index (SL) and the transverse to- pographic symmetry factor (T). These indices were estimated on topographic maps and aerial pho- tographs of the study area in order to correlate active tectonics and erosional processes. Our re- sults imply that the Eliki fault zone can be assigned to a tectonic class of the higher tectonic activity. However, spatial variations of tectonic activity along the segmented studied fronts point to a general trend of increasing activity towards the east, which is gradually decreasing towards the west. -

Business Concept “Fish & Nature”
BUSINESS CONCEPT “FISH & NATURE” Marina Ross - 2014 PRODUCT PLACES FOR RECREATIONAL FISHING BUSINESS PACKAGE MARINE SPORT FISHING LAND SERVICES FRESHWATER EQUIPMENT SPORT FISHING SUPPORT LEGAL SUPPORT FISHING + FACILITIES DEFINITIONS PLACES FOR RECREATIONAL FISHING BUSINESS PACKAGE MARINE SPORT FISHING LAND SERVICES FRESHWATER EQUIPMENT SPORT FISHING SUPPORT LEGAL SUPPORT FISHING + FACILITIES PLACES FOR RECREATIONAL FISHING PRODUCT MARINE SPORT FISHING MARINE BUSINESS SECTION FRESHWATER SPORT FISHING FRESHWATER BUSINESS SECTION BUSINESS PACKAGE PACKAGE OF ASSETS AND SERVICES SERVICES SERVICES PROVIDED FOR CLIENTS RENDERING PROFESSIONAL SUPPORT TO FISHING SUPPORT MAINTAIN SAFE SPORT FISHING RENDERING PROFESSIONAL SUPPORT TO LEGAL SUPPORT MAINTAIN LEGAL SPORT FISHING LAND LAND LEASED FOR ORGANIZING BUSINESS EQUIPMENT AND FACILITIES PROVIDED EQUIPMENT + FACILITIES FOR CLIENTS SUBJECTS TO DEVELOP 1. LAND AND LOCATIONS 2. LEGISLATION AND TAXATION 3. EQUIPMENT AND FACILITIES 4. MANAGEMENT AND FISHING SUPPORT 5. POSSIBLE INVESTOR LAND AND LOCATIONS LAND AND LOCATIONS LAND AND LOCATIONS List of rivers of Greece This is a list of rivers that are at least partially in Greece. The rivers flowing into the sea are sorted along the coast. Rivers flowing into other rivers are listed by the rivers they flow into. The confluence is given in parentheses. Adriatic Sea Aoos/Vjosë (near Novoselë, Albania) Drino (in Tepelenë, Albania) Sarantaporos (near Çarshovë, Albania) Ionian Sea Rivers in this section are sorted north (Albanian border) to south (Cape Malea). -
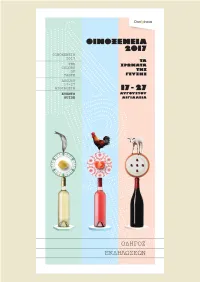
Events Guide
Oinoxeneia - Landscapes and tastes of Aigialeia 17-27 August 2017 “The colors of taste” Aigialeia is dressed up, wearing white, rosé and red colors! It pairs fine local wines with flavors and viands of the local cuisine, offering a joyful and delightful experience in its beautiful landscapes. «The colors of flavor» is the theme of «Oinoxeneia 2017». Our journey is full of beautiful surprises! Flavour balancing guided by wine| Artistic events | Events in wineries | Tours in vineyards | Wine tasting | Explorations | Exhibitions |Concerts This year’s Oinoxeneia will be an opportunity to explore the harmony of tastes in a land which uniquely combines nature with people, tradition with culture, long history with the present day and sea with fir! A land praised by Pausanias (Greek traveller and geographer of the 2nd century AD) for its vineyards and by Alexander Payne (Academy award winner director) “International ambassador of Aigialeia’s wines”, for its wines and hospitality. A land with flavor complexity and long aftertaste! Oinoxeneia is organized for the 5th year by DI.K.EP.A. - Municipal Welfare Business of Aigialeia and is one of the most important wine tourism festivities in the country. Protagonists and conjoiners of all the events are the fine local wines and wineries of the Oinoxeneia network. This year accessing Aigialeia will be quicker and safer via the new Olympia Odos highway. You are all invited to enjoy the journey through the Wine Roads of Aigialeia, living the Oinoxeneia experience! a multidimensional festival organized -

REGION / “ACHAIA” PERFECTURE Rouvalis Cavino Acheon Rira Tetra
LIST & CHARACTERISTICS OF MAIN WINERIES IN “AIGIALIA” REGION / “ACHAIA” PERFECTURE Rouvalis Cavino Acheon Rira Tetramythos Karanikolas Edanos Kanakaris Krokidas Rouvalis Cavino Winery Rira Tetramythos Karanikolas Kanakaris Krokidas TRADE NAME Acheon Winery Edanos Winery Winery & Distillery Vineyards Winery Winery Winery Winery (On the tp of Old National Rira the village) Road Elikis – 150 km. PEO Arravonitsas, 8th km Pountas – Paraskevi Selinous Meganiti Kalamias Diakoptou, PC: Athinon – VINEYARD Korinthou 121, Aigialeias, Kalavryton, Ano village, 25100, Aigio, Bridge, 25100 Aigialeias, N. 25100, Patron, 250 06 LOCATION 25100 Aigio 25100, Aigio Diakopto, Aigialeias, National Road Aigio, Greece Achaia AEGION, Eliki, Akrata Achaea P.O. Box: 25003, Greece 25100 Aigio Aigio – Municipality of Greece 5033 Kalavryta Aigialeia 8 km 40 km 25 km DISTANCE FROM (Aigion west (Aigion east SKOS old 23 km (8 km from (6 km from 5 km 13 km 3 km AIGIO entrance) entrance) warehouse / (=15+8) Platanos Platanos Longos village) village) White, red, White, red, White, red, White, red, White, red, White, red, White, red, White, red, TYPES OF WINES rosé & some White, red, rosé rosé rosé rosé rosé rosé rosé rosé world varieties POSSIBILITY OF Yes, weekdays In the vineyard Monday – Yes, weekdays Yes, after Monday – after VISITING & WINE- 09:00-16:00 & Friday 10:00- 09:00-16:00 & booking, Yes, after Yes, after Yes, after Friday until contacting the TASTING (AT weekends after 14:00 after weekends: afternoon booking booking booking 15:00 person in THEIR PREMISES) phone booking booking 10:00-18:00 hours charge 26910 28062 26910 20123 26910 26883 26960 61370 26910 81255 TELEPHONE & 26910 97500 2691029415 Ms Katerina & 26910 Mr. -

Chronique Archéologique De La Religion Grecque (Chronarg)
Kernos Revue internationale et pluridisciplinaire de religion grecque antique 27 | 2014 Varia Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG) Joannis Mylonopoulos, Despina Chatzivasiliou, Alain Duplouy, Michael Fowler, François Quantin, Emmanuel Voutiras, Kalliopi Chatzinikolaou, Massimo Osanna, Ilaria Battiloro et Alexis D’Hautcourt Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/kernos/2267 DOI : 10.4000/kernos.2267 ISSN : 2034-7871 Éditeur Centre international d'étude de la religion grecque antique Édition imprimée Date de publication : 1 novembre 2014 Pagination : 379-444 ISBN : 978-2-87562-055-2 ISSN : 0776-3824 Référence électronique Joannis Mylonopoulos, Despina Chatzivasiliou, Alain Duplouy, Michael Fowler, François Quantin, Emmanuel Voutiras, Kalliopi Chatzinikolaou, Massimo Osanna, Ilaria Battiloro et Alexis D’Hautcourt, « Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG) », Kernos [En ligne], 27 | 2014, mis en ligne le 01 octobre 2016, consulté le 15 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/kernos/ 2267 Ce document a été généré automatiquement le 15 septembre 2020. Kernos Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG) 1 Chronique archéologique de la religion grecque (ChronARG) Joannis Mylonopoulos, Despina Chatzivasiliou, Alain Duplouy, Michael Fowler, François Quantin, Emmanuel Voutiras, Kalliopi Chatzinikolaou, Massimo Osanna, Ilaria Battiloro et Alexis D’Hautcourt 01. Athènes, Attique, Mégaride (Joannis Mylonopoulos) 1 01.00 – Généralités – Une vue d’ensemble mise à jour des cultes impériaux de Trajan (Athènes), d’Hadrien (Athènes, Éleusis), d’Antonin le Pieux (Athènes) et de Marc Aurèle (Athènes) qui incorpore des informations épigraphiques ainsi que des témoignages archéologiques tels que statues, autels et bâtiments. L’étude traite également des fêtes et des prêtres associés au culte de l’empereur. F. -

Expedition 381 Summary 2 Introduction 2 Background L.C
McNeill, L.C., Shillington, D.J., Carter, G.D.O., and the Expedition 381 Participants Proceedings of the International Ocean Discovery Program Volume 381 publications.iodp.org https://doi.org/10.14379/iodp.proc.381.101.2019 Contents 1 1 Abstract Expedition 381 summary 2 Introduction 2 Background L.C. McNeill, D.J. Shillington, G.D.O. Carter, J.D. Everest, E. Le Ber, R.E.Ll. Collier, 7 Objectives A. Cvetkoska, G. De Gelder, P. Diz, M.-L. Doan, M. Ford, R.L. Gawthorpe, 8 Operational strategy M. Geraga, J. Gillespie, R. Hemelsdaël, E. Herrero-Bervera, M. Ismaiel, L. Janikian, 9 Principal results K. Kouli, S. Li, M.L. Machlus, M. Maffione, C. Mahoney, G. Michas, C. Miller, 20 Preliminary scientific assessment C.W. Nixon, S.A. Oflaz, A.P. Omale, K. Panagiotopoulos, S. Pechlivanidou, 22 References M.P. Phillips, S. Sauer, J. Seguin, S. Sergiou, and N.V. Zakharova2 Keywords: International Ocean Discovery Program, IODP, D/V Fugro Synergy, mission-specific platform, Expedition 381, Site M0078, Site M0079, Site M0080, Corinth rift, Gulf of Corinth, Alkyonides Gulf, Eastern Mediterranean Sea, Aegean Sea, continental rifting, extension, active rift, normal fault, earthquake, horst, fault growth, rift development, synrift stratigraphy, drainage evolution, surface processes, basin paleoenvironment, glacio-eustatic cycles, sea level, semi-isolated basin, marine basin, lacustrine, sediment flux, Quaternary, Pliocene, Miocene, carbon cycling, nutrient preservation, marine isotope stage Abstract These objectives were and will be accomplished as a result of successful drilling, coring, and logging at three sites in the Gulf of The primary objective of International Ocean Discovery Pro- Corinth, which collectively yielded 1645 m of recovered core over a gram Expedition 381 was to retrieve a record of early continental 1905 m cored interval. -

Brussels, 18 September 2012
Directorate-General for Internal Policies of the Union Directorate for Budgetary Affairs Secretariat of the Committee on Budgetary Control Brussels, 3 December 2015 Report on the fact-finding mission of the Budgetary Control Committee to Greece 24/25 September 2015 Control of EU funded priority projects shortlisted by ‘’Task Force for Greece” B-1047 Brussels - Tel +32 2 28 448869 - Fax 0032 2 28 46958 Summary Greece has a long history of ill-managed EU-funded projects which have been prolonged or repaid to the EU budget due to delays in their implementation; The Greek financial crisis aggravated the problem as the weakening economy influenced the projected profitability of the major infrastructural projects (highways, railways, etc.); The capital control introduced by the Greek government became an additional heavy burden for the timely realisation of the projects, as it either limited the possibility of external purchase or prolonged the process of external acquisition of construction elements needed to implement the EU funded projects. The structure of the central administration leads to an unclear division of competency among the various bodies of the central administration; The Committee was surprised to discover that both the regional and local administration - which should be most directly linked to the conducted projects, as they will be the most influenced by the outcome of the project were not at all or only partially involved in many projects; in most cases the projects were decided by the central Greek administration which -

List of Rivers of Greece
Sl. No River Name Location (City / Region ) Draining Into Region Location 1 Aoos/Vjosë Near Novoselë, Albania Adriatic Sea 2 Drino In Tepelenë, Albania Adriatic Sea 3 Sarantaporos Near Çarshovë, Albania Adriatic Sea 4 Voidomatis Near Konitsa Adriatic Sea 5 Pavla/Pavllë Near Vrinë, Albania Ionian Sea Epirus & Central Greece 6 Thyamis Near Igoumenitsa Ionian Sea Epirus & Central Greece 7 Tyria Near Vrosina Ionian Sea Epirus & Central Greece 8 Acheron Near Parga Ionian Sea Epirus & Central Greece 9 Louros Near Preveza Ionian Sea Epirus & Central Greece 10 Arachthos In Kommeno Ionian Sea Epirus & Central Greece 11 Acheloos Near Astakos Ionian Sea Epirus & Central Greece 12 Megdovas Near Fragkista Ionian Sea Epirus & Central Greece 13 Agrafiotis Near Fragkista Ionian Sea Epirus & Central Greece 14 Granitsiotis Near Granitsa Ionian Sea Epirus & Central Greece 15 Evinos Near Missolonghi Ionian Sea Epirus & Central Greece 16 Mornos Near Nafpaktos Ionian Sea Epirus & Central Greece 17 Pleistos Near Kirra Ionian Sea Epirus & Central Greece 18 Elissonas In Dimini Ionian Sea Peloponnese 19 Fonissa Near Xylokastro Ionian Sea Peloponnese 20 Zacholitikos In Derveni Ionian Sea Peloponnese 21 Krios In Aigeira Ionian Sea Peloponnese 22 Krathis Near Akrata Ionian Sea Peloponnese 23 Vouraikos Near Diakopto Ionian Sea Peloponnese 24 Selinountas Near Aigio Ionian Sea Peloponnese 25 Volinaios In Psathopyrgos Ionian Sea Peloponnese 26 Charadros In Patras Ionian Sea Peloponnese 27 Glafkos In Patras Ionian Sea Peloponnese 28 Peiros In Dymi Ionian Sea Peloponnese