Bach, Maître Spirituel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Xvii. Tempo En Fermates Bij De Uitvoering Van Koralen in Bachs Cantates En Passies
XVII. TEMPO EN FERMATES BIJ DE UITVOERING VAN KORALEN IN BACHS CANTATES EN PASSIES In dit hoofdstuk staan het tempo van de koralen en de wijze waarop de fermates werden uitgevoerd centraal. Zoals bekend zijn koralen door de gemeente gezongen gezangen tijdens erediensten. In Bachs tijd stonden de tekst en soms ook de melodie hiervan in de gebruikte gezangboeken. De gezangen waren over het algemeen bij de gemeente bekend. Onder kora- len zullen tevens verstaan worden de – meestal vierstemmig homofoon gezette – gezangen, zoals die in Bachs cantates en passies veel voorkomen: zij hadden immers dezelfde tekst en melodie als de gemeentegezangen. Ook wanneer instrumenten een zelfstandige rol hadden, in de vorm van tussenspelen (bijvoorbeeld in het slotkoraal ‘Jesus bleibet meine Freude‘ BWV 147/10) of extra partijen (‘Weil du vom Tod erstanden bist' BWV 95/7), worden ze hier gerekend tot Bachs koralen. Deze studie richt zich niet primair op koraalmelodieën die – meestal éénstemmig – als cantus firmus gezongen of gespeeld worden tijdens een aria of reci- tatief, maar het ligt voor de hand dat de beschreven conclusies hierbij ook van toepassing zijn. In de eerste paragraaf wordt gekeken naar de ontwikkeling van de gemeentezang in Duits- land, en hoe die op orgel begeleid werd. Vervolgens wordt onderzocht hoe er in traktaten over het tempo van de gemeentezang werd gesproken. Daarna worden de resultaten geëx- trapoleerd naar de hoofdkerken in Leipzig onder Johann Sebastian Bach. Het moge zo zijn dat de koralen als gemeentezang langzaam werden uitgevoerd, maar gold dat ook voor de koralen in Bachs cantates? In deze paragraaf wordt getracht een antwoord te vinden op deze vraag. -

Os Seis Solos De Johann Sebastian Bach Ao Violão: Partitas BWV 1002, 1004 E 1006
Gustavo Silveira Costa Os seis solos de Johann Sebastian Bach ao violão: partitas BWV 1002, 1004 e 1006 Volume VI Coleção USP de Música do NAP-CIPEM da FFCLRP-USP Livro VI - novo lay-out 28-03-2016.indd 1 02/04/2016 05:07:38 Editor Marco Antônio Geraldini Coordenação e organização editorial Rubens Russomanno Ricciardi Realização NAP-CIPEM da FFCLRP-USP Capa Gabriella Graf Imagens de miolo FFCLRP-USP Copyright © 2015 by Gustavo Silveira Costa Editora Pharos. Projeto gráfico e editoração Rua Panorama, 870, Palmas do Tremembé, São Eduardo Profeta Paulo, SP - CEP 02347-050 Telefone: (11) 3798-8101 Apoio Técnico Site: www.editorapharos.com.br Luis Alberto Garcia Cipriano E-mail: [email protected] Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Costa, Gustavo Silveira Os seis solos de Johann Sebastian Bach ao violão : partitas BWV 1002, 1004 e 1006 / Gustavo Silveira Costa. -- São Paulo : Editora Pharos : NAP-CIPEM da FFCLRP-USP, 2015. -- Bibliografia ISBN 978-85-63908-22-3 1. Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 2. Compositores - Brasil - Biografia 3. Música - Apreciação 4. Música - Brasil 5. Música brasileira 6. Músicos - Brasil - Biografia I. Título. II. Série. 15-07132 CDD-780.092 Índices para catálogo sistemático: 1. Brasil : Compositores : Biografia e obra 780.092 2 Livro VI - novo lay-out 28-03-2016.indd 2 02/04/2016 05:07:38 Sumário Introdução...................................................................................................7 1. Johann Sebastian Bach e as obras para violino solo.............................14 1.2. Os Sei Solo: características gerais......................................................15 1.2.1 Transcrições......................................................................................17 1.3. Considerações sobre as relações entre a música e a retórica...............21 1.3.1. -

Beyond Bach• Music and Everyday Life in the Eighteenth Century
Beyond Bach• Music and Everyday Life in the Eighteenth Century Andrew Talle Beyond Bach• Beyond Bach• Music and Everyday Life in the Eighteenth Century andrew talle Publication is supported by a grant from the AMS 75 PAYS Endowment of the American Musicological Society, funded in part by the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation. © 2017 by the Board of Trustees of the University of Illinois All rights reserved Manufactured in the United States of America c 5 4 3 2 1 ∞ This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Talle, Andrew. Title: Beyond Bach : music and everyday life in the eighteenth century / Andrew Talle. Description: Urbana : University of Illinois Press, 2017. | Includes bibliographical references. Identifiers: LCCN 2016041694 (print) | LCCN 2016043348 (ebook) | ISBN 9780252040849 (cloth : alk. paper) | ISBN 9780252099342 (e-book) | ISBN 9780252099342 (E-book) Subjects: LCSH: Music—Social aspects—Germany— History—18th century. | Keyboard players— Germany—Social conditions—18th century. | Germany—Social life and customs—18th century. Classification: LCC ML3917.G3 T35 2017 (print) | LCC ML3917.G3 (ebook) | DDC 786.0943/09032—dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2016041694 Jacket illustration: Barthold Fritz: Clavichord for Johann Heinrich Heyne (1751). Copyright Victoria and Albert Museum For J. E. Contents Illustrations .................................... ix Acknowledgments .............................. xiii A Note on Currency ............................. xv Introduction ....................................1 1. Civilizing Instruments ............................11 2. The Mechanic and the Tax Collector ...............32 3. A Silver Merchant’s Daughter......................43 4. A Dark-Haired Dame and Her Scottish Admirer ............................66 5. Two Teenage Countesses..........................84 6. -

A Bach Manuscript Recovered: Berlin, Bibliothek Der Hochschule Der Künste, Spitta Ms
A Bach Manuscript Recovered: Berlin, Bibliothek der Hochschule der Künste, Spitta Ms. 1491 David Schulenberg The musical manuscript Berlin, Bibliothek der Hochschule der Künste, Spitta Ms. 1491 is one of a number of items listed by Christoph Wolff as missing from this library since World War II.1 Part of the estate of the nineteenth-century musicologist and Bach biographer Johann Philipp Spitta (1841–94), the manuscript is the principal source for the organ chorale preludes of Johann Christoph Bach (1642– 1703), the most distinguished of Sebastian's ancestors. It was, moreover, the sole known source of Sebastian's early chorale prelude Der Tag der ist so freudenreich BWV 719, prior to the identification of the Neumeister Codex, which contains a concordance.2 The manuscript also contained organ chorales by Pachelbel, Buttstedt, and others, as well as additional material relevant to the study of composition and improvisation during the eighteenth or early nineteenth century.3 In fact, the manuscript was in private hands since at least 1954 and has recently been returned to the Berlin library that is its legitimate owner. The return was made possible by Roderick A. Manson of Montréal, who introduced himself to the present author after the latter had given a public lecture as part of the Bach International Harpsichord Festival in that city in May 1997. Manson, a retired social worker, Bach enthusiast, and accomplished organist, presented photographs of a manuscript for which he was seeking an appropriate depository. Identifying marks within the manuscript, such as library stamps and a bookplate, had been removed or defaced, and thus it is understandable that its possessor was unaware that the manuscript had disappeared, presumably during the war, from the Berlin Hochschule für Musik and that it remained of great interest to scholars.4 When the present author traveled to Montréal in March 1998 to retrieve the manuscript, he found the latter being kept unprepossessingly in a locked metal box, a prized possession in a modest, austerely furnished flat. -

St Paul's Church, Knightsbridge the Diocese of London the Solemn
St Paul’s Church, Knightsbridge The Diocese of London The Solemn Eucharist Epiphany Sunday 5th January 2014 at 11 a.m. Welcome to St Paul’s Knightsbridge, part of the Diocese of London and a church of the worldwide Anglican Communion. If you are visiting us from another church, please make yourself known to the sidesmen or to one of the clergy after the service. Members of all Christian churches are welcome to share with us in this Eucharist – and those who do not wish to receive the Sacrament are invited to approach the altar at the time of Communion, to receive a blessing. There is a loop system in the lower parts of the church for the benefit of the hearing- impaired. Hearing aid users should switch their devices to ‘T’. During the service a collection will be taken for the work of the church in this parish, throughout the Diocese of London and further afield. Please use the special envelopes at the end of each pew to maximise your giving through the ‘Giftaid’ scheme. Members of the congregation are asked to ensure that mobile phones are switched off (or to silent) and are reminded that the taking of photographs or the making of audio or video recordings during services is prohibited. Cover image: The Three Kings Joseph Christian Leyendecker (1874-1951) 2 ORDER OF SERVICE The Introductory Rite At 11 a.m. a bell is rung. All stand to sing: THE ENTRANCE HYMN O worship the Lord in the beauty of holiness! Bow down before him, his glory proclaim; with gold of obedience, and incense of lowliness, kneel and adore him: the Lord is his name! Low at his feet lay thy burden of carefulness, high on his heart he will bear it for thee, comfort thy sorrows, and answer thy prayerfulness, guiding thy steps as may best for thee be. -

FASCH-REPERTORIUM (FR) - Vokalmusik Von Johann Friedrich Fasch
FASCH-REPERTORIUM (FR) - Vokalmusik von Johann Friedrich Fasch - von Gottfried Gille Bad Langensalza, Deutschland Stand: September 2016 (Dateiversion: FaschRepertorium_092016.odt) Fasch-Repertorium (FR): Vokalmusik von Johann Friedrich Fasch Stand: September 2016 Verfasser: Gottfried Gille, Bad Langensalza (Deutschland) Das FR versucht den gegenwärtigen Stand der Forschung zur Vokalmusik Johann Friedrich Faschs (1688 – 1758) zusammenzufassen und in komprimierter Form darzustellen. Es erlaubt zugleich, den Umfang seines Schaffens zu überblicken. Sowohl Wissenschaftler als auch Praktiker können sich auf Grundlage der mitgeteilten Daten über seine Werke informieren. Einige anonym überlieferte Stücke konnten Fasch zugeordnet, andererseits mussten wenige ihm bis- her zugeschriebene Manuskripte als Incerta ausgesondert werden. Beigegeben sind dazu jeweils Be- gründungen. In einigen Fällen lassen sich Beziehungen zwischen einzelnen Stücken (Parodien) aufzeigen. Manche der Daten und Wertungen sind vorläufig und bedürfen der Überprüfung bzw. Ergän- zung. Deshalb soll das FR laufend aktualisiert und erweitert werden. Darüber hinaus wäre ein Austausch von Beobachtungen und Bewertungen zu Faschs Vokal- werk wünschenswert: [email protected] Veränderungen gegenüber der ersten Version des FR vom September 2013: •Neu aufgenommen wurden: FR Nr. Bereich FR 1183 B.2.2. Geburtstagskantate für Fürst Friedrich August (Grundlage: Direktionsstimme) FR 1220-1222 B.2.2. Kantaten für den Köthener Hof FR 1225 (Grundlage: Textdrucke) •FR 1232 wurde aus dem Bereich B.3. in den Bereich E.1. (Incerta) verschoben und wird nunmehr unter FR 1405 geführt. •Die in der FR-Version vom Sept. 2013, Seite 284 im Bereich E. (Incerta) ohne FR-Nummer unter „Verschollene Stücke in Engelkes Thematischem Verzeichnis“ aufgeführte Kantate „Ich bin der Erste und der Letzte“ (Kantate zum 1. -

50. Regionalwettbewerb
Solowertung: Violine AG I-II 09:00 – 17:00 Violine AG III-VI 13:15 – 19:30 Viola 10:00 – 10:30 Violoncello 09:00 – 12:00 Kontrabass 09:00 – 10:30 Gesang (Pop) 14:30 – 17:00 Akkordeon 17:30 – 19:30 Percussion/Mallett 15:00 - 17:30 Ensemblewertung: Duo: Klavier und ein Blasinstrument 09:00-14:00 Zeitplan 2013 Klavier- Kammermusik 12:00 – 13:00 Zupf-Ensemble 09:00 – 12:30 Vokalensemble 14:00 – 14:30 Wir möchten darauf hinweisen, dass die private und kommerzielle Aufzeichnung von Wettbewerbsveranstaltungen (Wertungsspiele und Konzerte) auf Bild- und Tonträgern aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt ist. 50. Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, sehr geehrte Gäste, auch in diesem Jahr bietet unser Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ ein umfassendes Programm mit ca. 150 Solo- und Ensemblewertungen. Es erfordert viel Engagement, Ausdauer und auch Mut, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Neben dem persönlichen Ehrgeiz, ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, sollte die Freude am Musizieren die Motivation zur Teilnahme sein. Die Belastung durch lange Unterrichtszeiten in den Schulen macht die umfangreiche Vorbereitung des Musikprogramms immer schwieriger. Umso höher sind das Engagement und das musikalische Interesse jedes einzelnen Musikers anzusehen. Den Teilnehmern wünschen wir viel Erfolg und Spaß beim Musizieren. Vor, während und nach dem Wettbewerb steht unser Team für Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung. Den Juroren danken wir für Ihre Arbeit und wünsche Ihnen ein gutes Maß bei der Vergabe der Punkte. Unser besonderer Dank gilt der Sparkasse Westmünsterland, dem Kreis Borken sowie dem Kreis Coesfeld für die finanzielle Unterstützung des Wettbewerbs. Ebenso gilt unser Dank der Leitung und den Mitarbeitern der Landesmusikakademie NRW für die gute Zusammenarbeit. -

Berichte Von Den 21. Clavichordtagen Der DCS in Eisenach, Bachhaus, 31
Berichte von den 21. Clavichordtagen der DCS in Eisenach, Bachhaus, 31. Oktober – 02. November 2003 Eisenacher Komponisten des Barock · von Dorothea Demel Gleich zu Beginn der Clavichordtage erzählte die Leiterin das Bachhauses, Frau Dr. Nentwig, der die DCS für die herzliche Einladung dankt, von der Geschichte und der Zukunftsperspektive des Bachhauses, das seit 1908 als Bachgedenkstätte dient. Johann Sebastian Bach wurde zwar möglicher- weise nicht im Gebäude des Bachhauses geboren, sondern in einem Gebäude in der Nähe, dennoch spiegelt das Gebäude die Wohnkultur zur Bachzeit wieder und Angehörige der Bachfamilie haben in dem Gebäude gewohnt. In einem zukünftigen Anbau werden endlich alle Muskinstrumente des Bachhauses (ca. 400) gezeigt werden können und es werden Plätze für die Forschung in den umfang reichen Dokumentbeständen vorhanden sein. Im Bachhaus Eisenach wird für die Besucher regelmässig auch ein Clavichord als Klangbeispiel vorgestellt. Leider können zur Zeit nicht alle Clavichorde im Bachhaus ausgestellt werden, für die 21. Clavichordtage des DCS wurden aber alle vier Clavichorde des Bachhauses von Uwe Fischer, Bachhaus Eisenach vorgestellt, darunter auch ein Pedalclavichord. Das Motto der Clavichordtage war „Eisenacher Komponisten des Barock” und so hörten wir im 1. Konzert von Robert Hill Werke von Christian Friedrich Witt, Johann Christoph Bach, Johann Bernhard Bach und Johann Sebastian Bach. Robert Hill trug die die Werke sehr gefühlvoll und wunderschön singend vor, seine Erläuterungen zu den Werken vertieften noch den wunderbaren Hö- reindruck. Es war ihm anzumerken, dass ihm die Musik am Herzen lag. So hörten wir am nächsten Morgen auch einen Vortrag von ihm über den jungen Bach, die Möllersche Handschrift und das Andreas Bach Buch (zu diesem Thema hatte Robert Hill seine Dissertation verfaßt). -
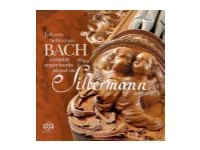
Kooiman-E-R03-B1c[Aeulus-15CD
Recordings / Aufnahmen / Enregistrements: April 2008 (Ewald Kooiman – Ebersmunster, Bouxwiller), June 2008 (Ewald Kooiman – Marmoutier), October 2008 (Ewald Kooiman – Wasselonne, Marmoutier), March 2010 (Gerhard Gnann – Wasselonne), September 2010 (Ute Gremmel-Geuchen – Strasbourg), October 2010 (Bernhard Klapprott – Arlesheim, Ute Gremmel-Geuchen – Marmoutier), November 2010 (Gerhard Gnann – Strasbourg), March 2011 (Ute Gremmel-Geuchen – Villingen), July 2011 (Gerhard Gnann – Soultz Haut-Rhin) Producer / Aufnahmeleitung / Direction artistique: Christoph Martin Frommen Engineering, editing & mastering / Technik, Schnitt & Mastering / Prise de son, montage & mastering: Christoph Martin Frommen Mikrofone / Microphones: 9 x DPA 4006 omnidirectional Photos: Christoph Martin Frommen, Jean-Philippe Grille (cover photo SACD vol.17) Organ maintenance: Gaston Kern, Manufacture d’orgues Daniel Kern, Quentin Blumenroeder, Bernhard Fleig Registranten / Assistants: Anne den Hartigh, Victoria Siegert (Strasbourg, November 2010) Dank an / Acknowledgements / Remerciements: Jean-Philippe Grille (Wasselonne), Père Florent & Hubert Sigrist (Marmoutier), Daniel Maurer, Daniel Leininger, René Gerber (Strasbourg), Anne-Laure Thallinger (Bouxwiller), Bernard Chalté & Henri Keller (Ebersmunster), Ulrich Kolberg (Villingen), Jean-Claude Zehnder & Peter Koller (Arlesheim), Monique Leimbach-Weinzäpfel (Soultz-Haut-Rhin), Quentin Blumenroeder. Greatest thanks to Anne den Hartigh. +© 2012 Postfach 300 226, 41343 Korschenbroich, Germany mail@aeolus–music.com www.aeolus–music.com -
Seventh Johann Sebastian Bach Dialogue Meeting
Seventh Johann Sebastian Bach Dialogue Meeting Programme and Dialogue Topics 8–10 July 2015 Madingley Hall, Cambridge Sponsors Bach Network UK Co-convenors Matthew Laube (University of Cambridge) Ruth Tatlow (Musik- och teaterbibliotek, Statens Musikverk, Stockholm) Yo Tomita (Queen’s University Belfast) Peter Smaill (Edinburgh) Scientific Committee Ruth Tatlow (Musik- och teaterbibliotek, Statens Musikverk, Stockholm) Yo Tomita (Queen’s University Belfast) Stephen Rose (Royal Holloway, University of London) Szymon Paczkowski (University of Warsaw) Bettina Varwig (King’s College London) Council members and Trustees of Bach Network UK John Butt Richard D. P. Jones Szymon Paczkowski Katharine Pardee Stephen Rose Peter Smaill (Chair of trustees) Reinhard Strohm Ruth Tatlow (Chair of council) Yo Tomita Bettina Varwig 2 Bach Network UK Programme at a Glance WEDNESDAY 8 JULY 12 noon Reception opens. Room check-in from 14.00. 14–16.00 Afternoon tea. Registration. 16.00 Welcome. 16.30–17.30 Session 1: Global Bach Research Reinhard Strohm—‘Balzan project and Bach’ Tobias Robert Klein—‘Bach to Africa and Forward towards a global aesthetics of music’ 17.30–18.15 Lecture-Recital Chiara Bertoglio—‘Enhancing the Spectacular: Busoni on Bach’s Goldberg Variations’ 18.30 Barbeque for all delegates in the grounds of Madingley Hall THURSDAY 9 JULY 7.00-9.00 Breakfast Time to explore the grounds, catch up with friends, continue discussions etc. 9.30–11.00 Session 2: Principles of Performance Lost and Gained John Butt on Bach-related subjects in conversation with Yo Tomita, Michael Marissen and Bettina Varwig 11.00–11.30 Coffee break 11.30–12.45 Session 3: Young Scholars’ Forum Thomas Cressy— ‘バッハ: Bach and Japan’ Kaoru Matsubara—‘Recognition of Counterpoint by the contemporaries of J. -

J.E. Gardiner (SDG
Cantatas for the Twenty-second Sunday after Trinity All Saints, Tooting Bach’s three cantatas for the Twenty-second Sunday after Trinity – BWV 89, 115 and 55 – all take their lead from the parable of the unjust steward as recounted in the Gospel of the day (Matthew 18:23-35). The earliest of the three, BWV 89 Was soll ich aus dir machen, Ephraim?, was first performed in Leipzig in 1723 and may possibly have been based on older material from Bach’s Weimar years. God’s anger – more wistful than explosive – is a major factor in the opening aria for bass, two oboes, strings and hunting horn (‘Corne du Chaße’). The text here comes from Hosea 11:8, in which God’s wrath is directed against Ephraim and his fellow worshippers of false gods in Israel. It is evoked in the turbulent semiquaver movement of the continuo, while above this the plaintive cries of God’s chosen targets emerge in the parallel thirds of the oboes. In effect, God is weighing up whether Israel is worth preserving – perhaps for now, but in the future if they re- offend? Should they be destroyed like Admah and Zeboim, the wicked cities of the plain along with Sodom and Gomorrah? The violins convey this lingering question in the way their five-note upward arpeggio ends with a drooping downward fifth, ninth or seventh. The three instrumental motifs, so central to the overall mood-painting, combine, collide and swap over, but without resolution. Meanwhile the music comes to a temporary halt at the end of each anguished question posed by the bass singer, representing God’s divided mind. -

Mittwoch, 09.03.2016 Holzbläser – Pförtnerhaus OG
Holzbläser – Pförtnerhaus OG Mittwoch, 09.03.2016 09:30 fagotto frizzante Altersgruppe A Julia Gallez - Fagott Linnea Lamprecht - Fagott Lorenz Ullmann - Fagott Giovanni Giacomo Gastoldi: Renaissance Tänze Gilbert Hirtz: Krähenwalzer Gilbert Hirtz: Detektiv OhGottFagott 09:40 Bläserzwerge Altersgruppe A Daniela Ackerl - Klarinette Johanna Ackerl - Horn Nina Bischofberger - Klarinette Rudolf Mauz: aus Urlaubserinnerungen, 1. Jetzt geht`s los Siegfried Moll: aus Drei Freunde, Ein Tänzchen Pierre Max Dubois: Dédidé Sylvia Ackerl: aus Bambi, 2. Treibjagd Helga Warner -Buhlmann: aus Lisa und Jan im Zoo, Der alte Bär Jean -Baptiste Loeillet: Tanz 09:50 Freaky Flutes Altersgruppe A Valerie Bertschler - Querflöte Katherina Matt - Querflöte Sarah Vester - Querflöte Colin Cowles: All Change - Rhythmically Hans P. Keuning: Song for a young lady - moderato J. Hook: Sonata G -Major, Op.83 No.4 - Allegro vivace I. Shekov: Mosaiken für 3 Querflöten: 3. Nachdenken - Ruhig, aber mit Bewegung I. Shekov: Trio für 3 Querflöten: 5. Ferienreise - Lustig 10:00 Pause 10:10 Clarigirlies Altersgruppe B Tamara Bommer - Klarinette Rebecca Kaufmann - Klarinette Stefanie Fink - Klarinette Eva Lenz - Klarinette Erasmus Widmann: aus Tänze und Galliarden No.1 Tanz Johann No.2 Galliarde Helena No.7 Tanz Christina Alessandro Scarlatti: Minuet Leon Lester: Sailing Terence J. Thompson: aus Suite Chalumeau Swing Harry's Blues Boeykens Walter: aus Easy Clarinet Ensemble Album Ambience Dixie 10:20 fagotto animato Altersgruppe B Pia Rüscher - Fagott Antonia Muxel - Fagott Valentina Schedler - Fagott Locse: Intrada Kodex Vietorisz: Air/Courante Oliver Hasenzahl: The Flying Bassoons 10:30 "The Amazing Flutes" Altersgruppe B Katharina Kathan - Querflöte Katrin Keckeis - Querflöte Caroline Summer - Querflöte Ida Nenning - Querflöte Clara Wehinger - Querflöte Joseph Bodin de Boismortier: Konzert für 5 Flöten Op.