87-SGN-667-LRO.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
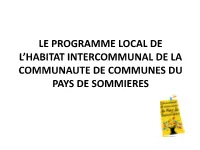
Le Programme Local De L'habitat INTERCOMMUNAL DE LA
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC - juillet 2008 QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Le dynamisme démographique de la Communauté de communes – 18 675 habitants en 2007 (18 981 habitants au 1er janvier 2010) – Près de 500 habitants supplémentaires par an depuis 1999 – Un taux de croissance annuel de l’ordre de + 2,9% sur la période 1999-2007 – 250 logements construits en moyenne entre 2000 et 2007 (soit le double de la période précédente) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • La faiblesse et la concentration du parc locatif social – Un taux d’équipement global inférieur à 6% – Un parc social essentiellement concentré sur Sommières (83% du parc hors foyers) – 5 communes ne disposent à ce jour d’aucun logement social – 290 demandeurs enregistrés en 2005 (taux de satisfaction très faible et délai d’attente pour une attribution d’environ 8 mois) QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Quelques chiffres/indicateurs de précarité – 42% des ménages ont des revenus inférieurs à 60% du plafond HLM (55% à Sommières) – 10,4% de la population est couverte par des minimas sociaux (20,3% à Sommières) – Le parc de logements potentiellement indignes est estimé à 13% des résidences principales de la Communauté de communes (25% à Sommières), soit environ 1 000 logements – 72 % de la population gardoise sont éligibles à un logement social QUELQUES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC juillet 2008 • Des valeurs foncières et immobilières en forte hausse -

Administration Generale : Personnel : Tourisme : Affaires Scolaires Et Periscolaires
Sommières, le 17 septembre 2020 Le Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières Objet : Convocation conseil communautaire Aux membres du conseil communautaire Affaire suivie par : Pierre LERASLE Direction Générale des Services Madame, Monsieur, J’ai le plaisir de vous convier à la réunion du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sommières, le : JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 A 18H30 A LA SALLE POLYVALENTE DE SOMMIERES ADMINISTRATION GENERALE : 1- Approbation du procès-verbal du Conseil du 23 juillet 2020 2- Création et constitution des Commissions Thématiques 3- Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et du plan d’action 4- Désignation d’un référent « Egalité entre les femmes et les hommes » 5- Désignation des délégués au Comité de Programmation LEADER 6- Election du membre titulaire à la Commission Locale de l’Eau Sage Vistre Vistrenque Costières 7- Délibération modificative de la délibération n°10 du 23 juillet 2020 concernant la désignation des délégués pour le SIVOM Leins Gardonnenque 8- Délibération modificative de la délibération n°11 du 23 juillet 2020 concernant la désignation des délégués pour le SIEM 9- Délibération modificative de la délibération n°16 du 23 juillet 2020 relative à la composition de la CAO 10- Délibération modificative de la délibération n°22 du 23 juillet 2020 relative à l’élection des délégués pour l’Office de Tourisme PERSONNEL : 11- Indemnités aux instituteurs et professeurs des écoles pour les études surveillées 12- Ajustement de postes dans les services communautaires 13- Réflexion sur la mise en place du télétravail TOURISME : 14- Tarifs 2021 de la taxe de séjour AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES : 15- Renouvellement de la convention annuelle de mise à disposition des locaux scolaires entre la C.C.P.S. -

Liste Des Points De Tri
LISTE DES POINTS DE TRI Commune Adresse Colonne Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Aigaliers La mairie Emballages Aigaliers La mairie Papier Aigaliers La mairie Verre Argilliers Place du jeu de boule Emballages Argilliers Place du jeu de boule Papier Argilliers Place du jeu de boule Verre Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Emballages Arpaillargues Salle polyvalente Papier Arpaillargues Salle polyvalente Verre Aureilhac Gabarit Emballages Aureilhac Gabarit Papier Aureilhac Gabarit Verre Bastide (la) Place de l'horloge Emballages Bastide (la) Place de l'horloge Papier Bastide (la) Place de l'horloge Verre Belvezet Cimetière Emballages Belvezet Cimetière Papier Belvezet Cimetière Verre Belvezet Place de l'église Emballages Belvezet Place de l'église Papier Belvezet Place de l'église Verre Bruguière (la) Parking cave coopérative Emballages Bruguière (la) Parking cave coopérative Papier Bruguière (la) Parking cave coopérative Verre Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Emballages Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Papier Capelle (la) & Masmolène La Capelle-Rte uzès côté étang Verre Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Emballages stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Papier stade Masmolène Gabarit-Rte Flaux côté Capelle (la) & Masmolène Verre stade Castillon Che des oliviers - près du cimetière Emballages Castillon Che des oliviers - près du cimetière Papier Castillon -

24 Septembre 2020
PROCES VERBAL EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays de Sommières Du Jeudi 24 Septembre 2020 L’an deux mille vingt, le 24 Septembre, le Conseil Communautaire, dûment convoqué, s’est réuni à 18h30, en session ordinaire, à la Salle Polyvalente de Sommières, sous la présidence de Monsieur Pierre MARTINEZ, Président de la Communauté de Communes du Pays de Sommières. - Date de convocation : 18 Septembre 2020 - Date d’affichage de la convocation : 18 Septembre 2020 - Nombre de conseillers : 36 (et 13 suppléants) - En exercice : 36 titulaires (et 13 suppléants) - Présents : 26 titulaires 1 suppléant (avec voix délibérative) Votants : 27 Etaient présents : - Membres titulaires : Bernard CHLUDA ; André SAUZEDE ; Véronique MARTIN ; Alex DUMAS ; Christiane EXBRAYAT ; Alain HERAUD ; Julie JOUVE ; Sonia AUBRY ; Michel DEBOUVERIE ; Fabienne DHUISME ; Loïc LEPHAY, Pascale CAVALIER ; Alain THEROND ; Marie-José PELLET ; Bernadette POHER ; François GRANIER ; Jean-Michel ANDRIUZZI ; Sylvain RENNER ; Marc LARROQUE ; Pierre MARTINEZ ; Sandrine GUY ; Patrick CAMPABADAL ; Josette COMPAN-PASQUET ; Sylvie ROYO ; Catherine LECERF, Cécile MARQUIER - Membres suppléants : Jean-Louis NICOLAS (avec voix délibérative) - Etaient excusés : Jean-Louis RIVIERE, Jean-Pierre BONDOR, Ombeline MERCEREAU, Bétrice LECCIA, Carole NARDINI Présidente de Séance : André SAUZEDE Procès Verbal du Conseil Communautaire du Jeudi 24 septembre 2020 Page 2 sur 44 ADMINISTRATION GENERALE : 1- Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 23 juillet 2020 Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la Communauté de Communes du Pays de Sommières que : Les délibérations du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020 ont été transmises et rendues exécutoires par visa de la Préfecture du 29 juillet 2020. -

Magazine Offert Novembre 2018
38 exclusivités C i e c m s Magazine i Novembre o o i 106 s m biens c offert e 2018 i C 19 agences Beau terrain plat 89 000e Plat - Clôturé et tout à l’égout 99 000e Exclusivités Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Au nord d’Uzès, secteur St Laurent la Vernède, Terrain orienté Sud 1164 m² à 10 min. d’Uzès, en beau terrain plat et clôturé de 966 m². Viabilités bordure de village. Déjà clos sur 3 côtés, il dispose en bordure. Assainissement individuel. Etude d’un portail et de quelques beaux arbres. Vue sur de sol réalisée. Ref MIU 1196 le vieux village. Voir notre site. Ref MIU 1831 Présenté par Isabelle Brughera 06 18 21 92 85 Présenté par Eric et Véronique Roux 04 66 22 36 66 Au cœur du village de Collorgues 99 000e Résidence sécurisée avec piscine 112 800e Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie NO Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie D Maison de village de 200 m² utiles environ, à l’étage : séjour Uzès, appart. P3 ancien rénové de 43 m², 1er étage, cuisine + 4 chambres , en rdc : 80 m² de caves, joli terrasse très belle vue vers le Sud, parking, cave, et accès environ 20 m² + courette d’environ 25 m². Travaux à prévoir, piscine. Cuisine équipée, clim. Copropriété de 27 aucune nuisance, bonne exposition. Ref MIU 2501 lots, charges 80 €/mois. Voir site. Ref MIU 1849 Présenté par Johan Crave 06 27 12 90 45 Présenté par Eric et Véronique Roux 04 66 22 36 66 Uzès tous commerces 113 000e Un pied à terre à Lussan… 139 000e Made in Uzès Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie D Exclusivité Honoraires à la charge du vendeur Classe énergie E Résidence avec ascenseur et parking privatif. -

Prefecture Du Gard
Nîmes, Vendredi 21 novembre 2014 Viticulture Dépôt des dossiers de demandes d’aides avant le 16 janvier 2015 pour les viticulteurs gardois touchés par les orages de grêle du 20 juillet 2014 Le Ministère de l’agriculture a mis en place deux mesures d’allégement des charges financières en faveur des viticulteurs des communes(1) listées dans l’arrêté préfectoral régional du 2 septembre 2014 autorisant l’achat de vendange fraîche. Ces allègements de charges prennent la forme de : prêts de trésorerie de 10 000 à 50 000 € avec prise en charge d’une partie des intérêts d’emprunts ; prise en charge partielle d’intérêts d’emprunts de l’annuité 2014 des prêts professionnels à long et moyen terme ; Le cofinancement de ces deux mesures est assuré par l’État, le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon et le Conseil Général du Gard. Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, les viticulteurs concernés doivent notamment : l Être spécialisés dans la production viticole à hauteur de 70 % de leur chiffre d’affaires ; l Avoir subi suite à la grêle au moins 30 % de perte de récolte par rapport à la moyenne des 5 dernières années ; l Et s’engager à souscrire un contrat d’assurance multirisques climatiques en 2015. Où et quand déposer les dossiers de demandes d’aides ? Avant le 9 janvier 2015 : réalisation des prêts de trésorerie Avant le 16 janvier 2015 : dépôts des dossiers de demande d’aide à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard (DDTM 30) Toutes les infos, les formulaires de demandes d’aides, les modalités et les critères d’éligibilités -

Cours Du Vidourle De Salinelles À Gallargues (Identifiant National : 910030361)
Date d'édition : 06/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues (Identifiant national : 910030361) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 30142097) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon, .- 910030361, Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/910030361.pdf Région en charge de la zone : Languedoc-Roussillon Rédacteur(s) :Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon Centroïde calculé : 746617°-1858660° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 21/09/2009 Date actuelle d'avis CSRPN : 21/09/2009 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 06/04/2011 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 3 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 3 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Elaboration Du Plan De Prévention Du Risque Inondation Sur Les 19 Communes Du Bassin Versant « Rhône-Cèze-Tave » Dossier De
Direction départementale des territoires et de la mer du Gard Elaboration du Plan de Prévention du Risque Inondation sur les 19 communes du bassin versant « Rhône-Cèze-Tave » Dossier de demande d’examen au cas par cas sur la nécessité d’une évaluation environnementale RAPPORT DDTM du Gard Service Eau et Inondation Unité Risque Inondation 89, rue Wéber 30907 NIMES CEDEX Date : MARS 2017 1. Contexte Le projet de PPRI porte sur un ensemble de 19 communes dont la délimitation figure sur le plan ci- dessous : - 4 communes Laudun l’Ardoise, Orsan, Codolet et Chusclan sont intégrées au PPRI Rhône-Cèze- Tave prescrit en 1995 et approuvé en 2000. Il s’agit donc d’une procédure de révision pour ces quatre collectivités. - 15 communes n’ont pas de PPRI et feront donc l’objet d’une procédure d’élaboration : La Bastide d’Engras, La Bruguière, Cavillargues, Connaux, Fons sur Lussan, Fontareches, Gaujac, Lussan, Le Pin, Pougnadoresse, Saint Laurent la Vernède, Saint Paul les Fons, Saint Pons La Calm, Tresques, Vallerargues. L’ensemble des communes se situe sur le bassin versant de la Tave, sur la partie amont du bassin versant de l’Aiguillon, du Merderis et sur l’extrémité aval du bassin versant de la Cèze. Ce secteur présente un relief marqué par de nombreuses collines, vallons encaissés et plaines alluviales. Les villages sont développés en pied de collines, et soumis aux débordements des cours d’eau principaux, aux écoulements descendant des collines dans les talwegs. La problématique des inondations est particulièrement forte dans le département du Gard du fait de l’ampleur et de la soudaineté des inondations, mais également du fait de la pression foncière et d’une occupation diffuse sur certaines zones. -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon
ZNIEFF de type I n° 3014-2097 Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues Identifiant national : 910030361 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Hérault et Gard Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues n° 3014-2097 Identifiant national : 910030361 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département du Gard Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 30321 SOMMIERES 35 ha 23 % 30019 AUBAIS 20 ha 13 % 30123 GALLARGUES-LE-MONTUEUX 16 ha 11 % 30352 VILLEVIEILLE 10 ha 7 % 30136 JUNAS 8 ha 5 % 30306 SALINELLES 5 ha 3 % Département de l'Hérault Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 34340 VILLETELLE 25 ha 16 % 34033 BOISSERON 15 ha 9 % 34288 SAINT-SERIES 11 ha 7 % 34145 LUNEL 8 ha 5 % La ZNIEFF « Cours du Vidourle de Salinelles à Gallargues » est située sur la frontière entre les départements du Gard et de l'Hérault. Elle englobe la rivière du Vidourle sur un linéaire de plus de 16 kilomètres. Elle couvre une superficie de presque 154 hectares, pour une altitude variant peu, entre 10 et 30 mètres. -

Société LES CALCAIRES DU GARD SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE
DEPARTEMENT DU GARD TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES Société LES CALCAIRES DU GARD SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE ENQUÊTE PUBLIQUE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE DE CALCAIRE, DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE MATERIAUX, ET UNE STATION DE TRANSIT DE PRODUITS MINERAUX ET DE DECHETS NON DANGEREUX INERTES. LIVRET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE N° E16000114 / 30 DU 24/10/2016 AU 25/11/2016 I - RAPPORT D’ENQUÊTE II - CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Fait à Saint-Laurent-des-Arbres, le 16 décembre 2016 Le commissaire enquêteur, Michel ANASTASY E16000114 / 30 SOMMAIRE Nota bene : Les deux parties du présent Livret émis par le commissaire enquêteur, - Rapport (Partie 1ère) - Conclusions et Avis (Partie 2nde), doivent être considérées comme indépendantes l’une de l’autre, et constituant chacune un document particulier. Elles sont reliées dans un souci de présentation et de cohérence. PARTIE 1ère – RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR CHAPITRE I – OBJET DE L’ENQUÊTE Généralités I-1 Origine du projet 4 I-2 Objectif de l’enquête publique 4 I-3 Description du projet d’intérêt général 4 CHAPITRE II – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE II-1 Désignation du commissaire enquêteur 5 II-2 Modalités de la procédure 5 II-3 Prise de connaissance du dossier 6 II-4 Cadre juridique 6 II-5 Visites et organisations préalables 7 II-6 Information du public 8 II-7 Information du commissaire enquêteur 9 II-8 Permanences 9 II-9 Registre et dossier d’enquête 9 II-10 Observations du public – procédé utilisé 10 II-11 Mémoire en réponse 11 CHAPITRE III – OBSERVATIONS III-1 Observations exprimées 11 III-2 Examen des observations par thème 11 III-3 Commentaires du commissaire enquêteur sur le mémoire 14 Enquête publique – Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire, des installations de traitement de matériaux, et de déchets non dangereux inertes, présentée par la Société Les Calcaires du Gard, sur la commune de Saint-Laurent-la-Vernède, au lieu-dit « Bois de Saint-Laurent ». -

Arrêté Préfectoral Du 26 Juin 2017- Annexe 3 – Liste Des Communes Sur Lesquelles Sont Instaurées Des Mesures De Limitation Provisoire Des Usages De L’Eau
Arrêté préfectoral du 26 juin 2017- Annexe 3 – Liste des communes sur lesquelles sont instaurées des mesures de limitation provisoire des usages de l’eau Liste des communes concernées par l’alerte de Niveau 1 sécheresse à compter du 26 juin 2017 AIGUEZE BAGNOLS-SUR-CEZE BARJAC LA BASTIDE-D'ENGRAS BELVEZET BOUQUET LA BRUGUIERE LA CAPELLE-ET-MASMOLENE CARSAN CAVILLARGUES CHUSCLAN CODOLET CONNAUX CORNILLON FONS-SUR-LUSSAN FONTARECHES LE GARN GAUJAC GOUDARGUES ISSIRAC LAUDUN-L'ARDOISE LAVAL-SAINT-ROMAN LUSSAN MALONS-ET-ELZE MEJANNES-LE-CLAP MONTCLUS ORSAN LE PIN PONT-SAINT-ESPRIT POUGNADORESSE POUZILHAC LA ROQUE-SUR-CEZE SABRAN SAINT-ANDRE-DE-ROQUEPERTUIS SAINT-ANDRE-D'OLERARGUES SAINT-BRES SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES SAINT-GERVAIS SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET SAINT-MICHEL-D'EUZET SAINT-NAZAIRE SAINT-PAULET-DE-CAISSON SAINT-PAUL-LES-FONTS SAINT-PONS-LA-CALM SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE SAINT-VICTOR-LA-COSTE SALAZAC THARAUX TRESQUES VALLERARGUES VENEJAN VERFEUIL Seuls les prélèvements sur le réseau d’eau potable sont concernés par les restrictions sur les communes MONTCLUS et SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS de : BELVEZET, BOUQUET, LA BRUGUIERE, LA CAPELLE-ET-MASMOLENE, CARSAN, CODOLET, CORNILLON, FONS-SUR-LUSSAN, FONTARECHES, LE GARN, ISSIRAC, LUSSAN, MALONS-ET-ELZE, Les prélèvements sur le réseau d’eau potable ne sont pas concernés sur les communes de: POUGNADORESSE, POUZILHAC, SAINT-ANDRE-D'OLERARGUES, SAINT-CHRISTOL-DE-RODIERES, SAINT-LAURENT-DE-CARNOLS, SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE, SAINT-MICHEL-D'EUZET, SAINT- QUENTIN-LA-POTERIE, SALAZAC, THARAUX, VALLERARGUES et VENEJAN Liste des communes concernées par la Vigilance sécheresse à compter du 26 juin 2017 Le reste des communes du département* *Hors prélèvement BRL. -

Balade Au Fil Du Temps
BERNADETTE VOISIN-ESCOFFIER MICHEL VOISIN VALLABRIX BALADE AU FIL DU TEMPS Guide pour promeneur COURADOU Décembre 2018 1 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 LE REBOUSSIER, (LE NÎMOIS) MARQUÉ PAR LE POIDS DES INVASIONS ET LES INTERMINABLES GUERRES DE RELIGION, TIRE DU GREC SA SUBTILITÉ, DE L’ORIENTAL SA LANGUEUR, DU LATIN SON ÉQUILIBRE… » ( – Gazette de Nîmes 836) Sommaire : Avant-propos - P 13 Origine probable du nom de « Vallabrix » - P 17 Charles Martel, les Sarrasins et Vallabrix - P 20 Les Carrières - P 26 La citadelle et le château - P 39 La Tranchée - P 42 La Guerre de Cent Ans - P 48 Mathieu de Bargeton - P 53 L’Eglise - P 66 Le Presbytère - P 75 La Maison Ronde ou la première école et mairie - P 81 La Mairie actuelle et l’école de la République - P 87 La Façade Renaissance - P 102 La Fontaine- le Lavoir- la Canalette - P 110 Le Brigand de Valabris - P 115 Une école bien particulière - P 117 Un bien fâcheux évènement - P 118 quelques photos escalier du clocher, horloge 2 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 Page blanche, passer à la suivante 3 Bernadette Voisin-Escoffier 2018 AVANT-PROPOS Les textes qui vont suivre sont une somme d’informations glanées depuis une dizaine d’années au cours des travaux historiques des auteurs. Ces écrits serviront à faire un voyage à pied au cœur de Vallabrix, pour le visiteur ou pour les guides occasionnels. Ceux-ci pourront picorer de ci de là dans ces pages, selon la durée de la promenade et des centres d’intérêt(s) des visiteurs. Dans chaque chapitre, des annexes, des informations pour répondre aux questions éventuelles qui ne manquent pas d’être posées par les visiteurs (chronologie, personnages du moment évoqués etc…).