L a G a Z E T
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
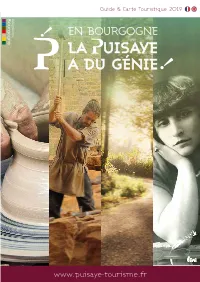
Puisaye-Web.Pdf
ar ICI, Je localise La Puisaye EN VOITURE EN BUS Paris Paris : 1h45 Des liaisons quotidiennes assurent Beaune : 1h40 des trajets Paris-Saint-Fargeau / Orléans Dijon Dijon : 2h00 Saint-Sauveur en Puisaye. Orléans : 1h30 BOURGOGNE Des liaisons régulières assurent Lyon : 3h00 des trajets depuis la gare routière Lyon Possibilité de covoiturage avec d’Auxerre et la gare ferroviaire blablacar.fr et viamobigo.fr de Joigny. Plus d’informations auprès Les VTC « la bonne route » de l’Office de Tourisme. et « Grapes and Corks », vous transportent où vous le souhaitez, sur des courtes ou longues EN TRAIN distances (journée touristique, Sens Paris / Auxerre gare SNCF, aéroports, etc.). ou Cosne sur Loire : 1h45 Plus d’infos : vtc-la-bonne-route. Paris / Joigny : 1h15 Auxerre business.site / grapesandcorks.com Lyon/Auxerre : 4h00 Genève/Auxerre : 5h30 PUISAYE-FORTERRE EN AVION Bruxelles / Auxerre : 4h00 Avallon Aéroport de Paris-Orly (153km) Informations : Aéroport de Paris-Charles www.voyages-sncf.com -de-Gaulle (188km) www.aeroportsdeparis.fr 2 La Puisaye, un des secrets les mieux gardés de la Bourgogne Puisaye, one of the best kept secrets in Bourgogne. LE WIFI EN PUISAYE-FORTERRE SOMMAIRE Gratuit, illimité et sécurisé. Connectez-vous dans nos sept points d’accueil. Avec le wifi territorial Bourgogne, nous, Office de Tourisme, Patrimoine 4 facilitons la connexion à nos visiteurs Balades et loisirs 14 MONUMENT HISTORIQUE FAMIL’YONNE Carte touristique 18 Sites et hébergements labellisés Famil’Yonne. Les sites Famil’Yonne proposent différentes Sport -

Diapositive 1
IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques Décembre 2018 n° 13 Bulletin de l’association « Les Vieilles Pierres » Mot du président Suite aux décisions prises lors de notre dernière assemblée générale, le programme d’activité de l’association au niveau des animations s’est réduit en 2018 à deux manifestations : une fin avril et l’autre mi-septembre lors des Journées Européennes du Patrimoine. En contrepartie, notre calendrier des sorties, des contacts et collaborations n’a pas désempli pour faire connaitre notre patrimoine et accroître l’aura qui l’entoure auprès des organismes touristiques et titulaires. Grâce à nos efforts nous pouvons nous honorer, dès maintenant, de pouvoir afficher sur tous nos documents le logo Médiéval Normandy rappelant qu’Ivry fait indéniablement partie de cette période historique. Un retour sur un temps pas aussi lointain Cette première reconnaissance Aujourd’hui où il ne reste presque plus nous implique des devoirs en rien de notre patrimoine industriel matière de prestations, de traditionnel, l’association Les Vieilles services et de communication Pierres a souhaité initier ses sorties (animations, publications, visites, culturelles 2018 en allant visiter un etc.) Certains d’entre vous y témoin remarquable de ce passé : La participent déjà activement et je les en remercie vivement mais Corderie Vallois et de poursuivre ce cela ne suffit pas. voyage dans le temps en allant contempler les chefs-d’œuvre Il nous faut être plus nombreux rassemblés au musée Le Secq des notamment afin d’être réactif et pouvoir assurer les visites futures Tournelles à Rouen. de groupes (adultes ou scolaires) Une fois n’est pas coutume, cette qui nécessairement deviendront escapade commence à midi par un plus nombreuses. -

De Loire En Seine Et De Loire En Saône
DE LOIRE EN SEINE ET DE LOIRE EN SAÔNE COMPTE RENDU DU VOYAGE ORGANISE PAR L’ALLIANCE DES RHODANIENS ET PROMOFLUVIA DU 3 AU 7 JUIN 2015 1er jour, mercredi 3 juin : LYON, ROANNE, BRIENNON, DIGOIN, PARAY-LE-MONIAL. Le 3 juin2015, sous un soleil rayonnant, dès 7 heures, nous voici tous réunis, adhérents ADR et Promofluvia devant notre siège au port Édouard Herriot pour un voyage au plus près des canaux du Centre. Dès le départ, les horaires sont tenus et le car prend la route pour Roanne. À cette heure- là, les embarras de Lyon pas encore commencés, rapidement l’autoroute A89 nous ouvre les bras. À Balbigny (42) nous retrouvons vite la voie express Neulise-Roanne et à 8h30 nous avons rejoint la maison du barragiste au port de Roanne entre Loire et canal. Roland MIGNARD, adjoint à l’urbanisme du maire de Roanne, nous souhaite la bienvenue. René FESSY invite à découvrir la Loire : le barrage dit « de la navigation » permet l’alimentation du canal latéral, jusqu’au Bec d’Allier par Le Linquet (3m3/s) ; il offre aussi un plan d’eau pour le canoë-cayak et l’aviron. Le second robinet est assuré par le barrage des Lorrains sur l’Allier. Roanne se situe à 5 km en aval du barrage de Villeret, dernier contrefort du Massif Central. Roanne est le 1er port de la « Loire haute » aux XVIIème et XVIIIème siècles pour le transport du charbon du bassin stéphanois et aussi du vin de la Côte Roannaise. Les rambertes (ou sapines), bateaux à fond plat de 30 mètres (30 tonnes) naviguaient en période de crue soit une soixantaine de jours par an seulement. -

Chambres D'hôtes - La Bichonnière - Lindry
CHAMBRES D'HÔTES - LA BICHONNIÈRE - LINDRY LA BICHONNIÈRE Chambres d'hôtes à Lindry https://labichonnierebnb.com www.la-bichonniere.com Julia et Stéphane de Wellenstein 03 86 47 19 85 06 77 64 48 46 A La Bichonnière - chambres d''hôtes : 37- 39, rue de Charbuy, Les Houches 89240 LINDRY La Bichonnière - chambres d'hôtes Le Grand Duc La Chouette Les Ecureuils Le Chevreuil La Tourtourelle La Bichonnière, ancienne ferme bâtie vers 1820 est notre maison familiale depuis 1958. Nous l’avons transformée en chambres d’hôtes en 2006 et depuis nous vous y accueillons avec chaleur et simplicité. Idéalement située dans le centre du département de l’Yonne en Bourgogne, à 12 km d’ Auxerre et 1h30 de Paris, proche de nombreux sites touristiques, la Bichonnière est à la croisée des routes traversant la France ce qui en fait aussi une étape de choix sur la route de vos vacances. Que vous soyez adeptes de campagne, patrimoine culturel, activités sport et nature, œnologie, gastronomie, préhistoire ou encore d’humeur à vous relaxer à l’ombre, vous trouverez ici votre bonheur. Invisible de la route et entourée d’un parc de 2 hectares, c'est l’endroit rêvé pour venir vous ressourcer, seul, en couple, en famille ou entre amis. En même temps que votre séjour dans nos 5 chambres d’hôtes, vous pouvez envisager d’organiser dans notre grange des stages, séminaires ou formations pour 15 personnes. L'entrée dans la propriété se fait au niveau du 49 rue de Charbuy, 89240 Lindry Infos sur l'établissement A proximité propriétaire Entrée indépendante Communs Jardin commun Activités Accès Internet Internet Parking P Parking Nettoyage / ménage Services Terrain de pétanque Parc Extérieurs Table de ping pong Le Grand Duc Chambre 3 1 18 personnes chambre m2 Chambre de 2 à 3 couchages: 1 lit de 160 et 1 de 90. -
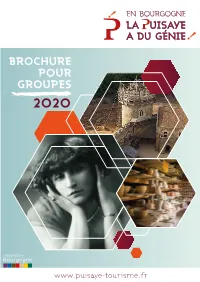
Guide Groupe 2020 Lowdef
BROCHURE POUR GROUPES 2020 PUISAYE-FORTERRE • Carte d’identité Paris Orléans Dijon Sens BOURGOGNE Lyon Auxerre PUISAYE-FORTERRE Avallon EN VOITURE EN TRAIN EN BUS Paris : 1h45 Paris / Auxerre Des liaisons quotidiennes assurent Beaune : 1h40 ou Cosne sur Loire : 1h45 des trajets Paris-Saint-Fargeau / Dijon : 2h00 Paris / Joigny : 1h15 Saint-Sauveur-en-Puisaye. Lyon/Auxerre : 4h00 Orléans : 1h30 Des liaisons régulières assurent Genève/Auxerre : 5h30 Lyon : 3h00 des trajets depuis la gare routière Bruxelles / Auxerre : 4h00 d’Auxerre et la gare ferroviaire Informations : de Joigny. www.voyages-sncf.com COMMUNAUTÉ DE COMMUNES OFFICE DE TOURISME DE DE PUISAYE-FORTERRE DE PUISAYE-FORTERRE 7 BUREAUX D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 58 COMMUNES 9 SALARIÉS + 4 SAISONNIERS 36.000 HABITANTS SUPERFICIE DE 1700KM² 30.000 VISITEURS/AN 2 SOMMAIRE NOS IDÉES VISITE DE GROUPES © Yvan Archenault La voie de ses maîtres p.4 La Puisaye met les petits plats dans les grands p.5 Les Seigneurs Bâtisseurs p.6 Les Délices du Transpoyaudin p.7 Chevaliers ou pierreux : une épopée féodale p.8 Beauté & Luxe p.9 La Nature vous veut du bien p.10 JOURNÉE COMPLÈTE Écrin d’histoire p.11 Entre Giennois et Puisaye p.12 Terres de Puisaye p.13 Folle rêverie p.14 Visite commentée de Toucy p.15 Visite commentée de Rogny p.16 DEMI-JOURNÉE - CIRCUIT - à la journée à partir de 70 € 42, /pers. © A. Laurent LA VOIE DE SES MAÎTRES SENS Qu’ils soient artistes, poètes, inventeurs ou hommes de lettre, JOIGNY ils ont marqué la Puisaye-Forterre de leur trait de génie. AUXERRE PARLY MEZILLES 10H PARLY Mi-cuit au chocolat et caramel beurre salé SAINT-FARGEAU Visite guidée du Centre d’Art graphique de ou crème brûlée Irish Coffee la Métairie Bruyère. -

Chambre D'hôtes - La Petite Pâture - Tannerre-En-Puisaye
CHAMBRE D'HÔTES - LA PETITE PÂTURE - TANNERRE-EN-PUISAYE LA PETITE PÂTURE Chambre d'hôtes à Tannerre-En-Puisaye https://lapetitepature.fr Marie-Paule et Sébastien 06 81 79 03 69 0681790369 A La petite Pâture - Puisaye : Les Béatrix 89350 TANNERRE-EN-PUISAYE La petite Pâture - Puisaye La suite familiale Marie-Paule et Sébastien reçoivent leurs hôtes dans l'extension de leur maison qui comprend une suite parentale (grande chambre à l'étage sous les combles, séjour confortable avec coin tv et coin repas, grande salle de bain avec douche à l'italienne, wc suspendu et meuble vasque). Le parking accueille sans difficulté véhicules légers, véhicules attelés et poids lourds.L'hébergement a un accès indépendant et le terrain de 11000m2 offre un espace idéal pour profiter d'un séjour au calme ... en toute sérénité. Infos sur l'établissement A proximité propriétaire Entrée indépendante Communs Mitoyen propriétaire Activités Accès Internet Internet Parking P Parking Nettoyage / ménage Services Piscine partagée Piscine plein air Extérieurs La suite familiale Chambre 0 1 55 personne chambre m2 Chambres Chambre(s): 1 dont Suite: 1 Lit(s): 2 dont lit(s) 1 pers.: 1 dont lit(s) 2 pers.: 1 Salle de bains / Salle Salle de bains avec douche Salle de bains privée d'eau Sèche cheveux Sèche serviettes Salle(s) d'eau (avec douche): 1 WC WC: 1 WC privés Cuisine Coin cuisine à disposition (chambre d'hôtes) Four à micro ondes Réfrigérateur Autres pièces Salon Séjour Media Câble / satellite Télévision Wifi Autres équipements Chauffage / AC Chauffage Bien être Spa / Jacuzzi Exterieur Abri couvert Cour Cour commune Jardin Salon de jardin Terrain clos Terrain clos commun Divers A savoir : conditions de la location Arrivée Départ L'heure de départ par défaut est midi. -

Une Sortie Pleine D'enseignements Pour Conclure L
IVRY PATRIMOINE Nouvelles et chroniques Une sortie pleine d’enseignements pour conclure l’année Comme toujours nous clôturons la saison par une sortie alliant l’évasion et l’exploration d’un domaine culturel en rapport avec nos préoccupations patrimoniales. Pour 2018 en raison du choix de la destination assez éloignée nous ne pouvions pas bloquer cette sortie sur une seule journée aussi nous nous sommes enquis de trouver à proximité un autre pôle d’intérêt qui puisse répondre aux attentes de chacun. D’un simple regard sur la carte une évidence nous est apparue : Briare, petite ville située juste à côté, nous offrait l’opportunité d’associer à notre première thématique la construction des châteaux forts et un second thème l’évolution de la navigation et de la batellerie sur les rivières intérieures au fil des siècles. C’est ainsi qu’un matin de septembre, nous nous sommes retrouvés, pour une première journée à Briare. Une cité connue pour sa céramique mais aussi et surtout pour son canal et son pont canal mais n’anticipons pas. Dès notre arrivée nous plongeons dans l’atmosphère de la navigation en nous rendant au musée des deux marines. Certes, il est essentiellement consacré à la marine fluviale de la Loire et de ses canaux, d’où son nom, mais, bien que ce soit à une échelle différente de celle de l’Eure, c’est pour nous une façon d’approcher et de comprendre comment les hommes ont su maîtriser et utiliser les rivières depuis le moyen-âge pour favoriser les échanges et le développement économique. -

Depliant Rogny 2020
Le Port De Plaisance Animations 2020 Les accès TOURISME FLUVIAL Concours hippiques : DU CENTRE 22 mars 140 km de Paris Location de 3, 4 et 5 avril - 26 avril par l’A77 er vedettes Nicols. 30 et 31 mai - 1 juin (sortie à 20 km Accueil 7 juin - 21 juin de ROGNY LES er des plaisanciers, 31 juillet - 1 et 2 août SEPT ECLUSES). hivernage. 25, 26 et 27 septembre 4 octobre - 8 novembre 03 86 74 56 34 34 km au sud-est [email protected] Braderies : 9 et 10 mars de Montargis www.bateaux2bourgogne.com 9 et 10 mai - 13 et 14 juin par la RD2007 ogny-les-S 11 et 12 juillet - 8 et 9 août et le RD 90. R ept-Ecluses 12 et 13 septembre 24 et 25 octobre Activités et Loisirs Marché aux fleurs : 10 mai Expositions :9 et 10 mai Moyens de transport Un court de tennis 8 et 9 août Randonnées. en libre-service sur l’île. 19 et 20 septembre éLes Taxis Hurié : Hiking trails. Tennis for free service. ( 03 86 45 13 08 ou [email protected] Vide-greniers : 10 mai 8 et 9 août CARS ( 03 86 74 07 51 Concours de pétanque : Aller-retour en car Paris / Rogny les Sept Ecluses. facebook.com/rognyles7ecluses/ Terrain multisports. 26 avril - 19 septembre Sports ground. Fête de la pêche : 7 juin t GARE SNCF ( Un terrain de pétanque Fête de la Musique : 20 juin 89 000 AUXERRE (60 km de Rogny) au 36 35 Quai Sully. Ground of 45 290 NOGENT SUR VERNISSSON petanque. -

L'ouvrage Est Ici Depuis Près De Quatre Siècles. C'est La Partie
L'ouvrage est ici depuis près de quatre Le projet était ambitieux puisqu'il s'agissait siècles. C'est la partie ingénieuse du canal. Au point d'unir la Méditerranée à l'Océan Atlantique et de partage des eaux entre la Loire et la Seine. la Manche. Ces travaux furent commencés en 1604 sous la C'est le premier ouvrage de ce type construit direction de l'Architecte Hugues COSNIER qui en France. Les constructeurs qui l'ont imaginé ont dû obtint l'entreprise. résoudre un immense problème : celui de joindre deux cours d'eau, coulant dans deux bassins A l'origine six écluses alimentées en eau par les différents et séparés par un seuil important. étangs de la Puisaye. Elles permettaient aux bateaux de franchir une dénivellation de 25 C'est Henri IV et son premier mètres. ministre Sully qui en 1597 Les premières ébauches d'écluses à sas furent fondèrent le projet de dessinées par Léonard DE VINCI. développer sur une grande échelle les voies de navigation alors inexistantes. Le principe de l’écluse consiste à faire entrer le bateau dans le sas, puis amener celui-ci au même niveau que le bief par lequel le bateau doit continuer sa route. Dimensions du Monument des 7 écluses : 24 m Dimensions des sas après leur allongement suite à de hauteur et 250 m de longueur la mise au Gabarit Becquey : 31,00 m de longueur, 5,20 m de largeur et 1,20 m d’enfoncement. Dimensions initiales des sas en 1609 (6 écluses) : 28, 00 m de longueur, 4,80 m de largeur et 0,80 m En 1882, la mise en place du gabarit Freycinet d’enfoncement (écluses de 39 m de long et 5,20 m de large) rend trop complexe une nouvelle transformation. -

Treigny- Perreuse-Sainte-Colombe
GÎTE D'ÉTAPE ET DE GROUPES DE L'AMBRE DU FORT BOIS - TREIGNY- PERREUSE-SAINTE-COLOMBE L'AMBRE DU FORT BOIS, GÎTE D'ÉTAPE ET DE GROUPES À PERREUSE Notre gîte de 9 chambres pour une capacité de 18 personnes est situé en Puisaye-Forterre dans l'Yonne en Bourgogne. A seulement 5 minutes du château de Guédelon et de sites touristiques majeurs. Commerces à proximité. Nombreux circuits de randonnée aux alentours ainsi qu'au départ du gite. http://lambredufortbois.fr Gîte de l'Ambre du Fort Bois 0698648139 A Gîte d'étape et de groupes de l'Ambre du Fort Bois : 17 Rue de la Chaume (perreuse) 89520 TREIGNY-PERREUSE-SAINTE-COLOMBE Gîte d'étape et de groupes de l'Ambre du Fort Bois Chambre pour deux personnes, avec salle d'eau et wc privatifs, à l’étage 1 chambre pour personnes à mobilité réduite, au rez-de- chaussée Le Gîte complet - 9 chambres, 18 personnes Nous sommes idéalement situé à proximité des villages de Saint- Sauveur-en-Puisaye et Saint-Fargeau. Entre Briare-le-canal et Vézelay. Le gite est composé de 9 chambres pour deux personnes dont une chambre aménagée pour les personnes à mobilité réduite en rez-de- chaussée. Draps fournis, linge fournis, ménage compris (Lit non fait et à faire et lit à défaire en partant). Toutes les chambres ont leurs sanitaires privatifs. Possibilité de prêt de lit d'appoint supplémentaire ou lit parapluie pour les enfants. Notre gite d'une capacité de 300m² dispose d'une cuisine commune aménagée PMR, d'une grande salle à manger d'une capacité de 48 personnes mais aussi une très belle salle de vie avec parquet de danse et acoustique musique ou théâtre de 100m². -

La Rando Du Samedi : Rogny Les 7 Ecluses (2)
La Rando du Samedi : Rogny les 7 Ecluses (2) Rogny: • Rogny Les 7 Ecluses, village de 740 habitants aux portes de la Puisaye,, doit son nom aux "Sept-Ecluses", ouvrage d'art placé sur le canal de Briare et réalisé au début 17 ème sur un projet de Henri IV et de Sully.. • A l'actuelle commune de Rogny a été rattachée à la Révolution l'ancienne paroisse de Saint-Eusoge devenue simple hameau. • La terre de Rogny appartenait au 14 ème à une famille qui en portait le nom. • Elle fut annexée plus tard à la seigneurie de Châtillon-sur-Loing. • A côté de la seigneurie principale existaient, dans les deux anciennes paroisses de Rogny et de Saint-Eusoge, de nombreux fiefs, dont plusieurs avec manoirs. • Les sept écluses en escalier fonctionnèrent jusqu'en 1880 , elles furent alors remplacées par 6 écluses séparées. • Architecture : o Château de Saint-Eusoge milieu 19 ème . o Sites fossoyés de 2 mai sons fortes aux lieux dits le Pré et Cotard. o Ancien manoir de La Brênellerie : portail 1587 . o Eglise Saint-Loup, autrefois Saint-Martin 12 ème , restaurée en 1740 : portail partiellement 11 ème (voussures et gable), nef unique 12 ème , choeur voûté sur ogives en boudins, clocher 12 ème (un seul chapiteau ancien), toile des pèlerins d'Emmaüs 1757 , dalle funéraire 13 ème . o Chapelle de Saint-Eusoge (dédiée à saint Eusèbe) 12 ème rénovée 19 ème (ancienne église de la paroisse de Saint-Eusoge) : pierres tumulaires 14 ème , statues en bois d'art populaire. o Calvaires. les 7 Ecluses : • Construites dans le but d'unir la Loire (navigable au XVIIème siècle, époque de la construction des écluses) à la Seine par le Canal de Briare, les 7 écluses de Rogny devaient permettre d'améliorer l'approvisionnement de Paris. -

Annales Du Gâtinais, Volume 13
ANNALES i DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE GATINAISDU TOME TREIZIÈME FONTAINEBLEAU MAURICE BOURGES, IMPRIMEUR BREVETÉ Rue de l'Arbre-Sec, 32 i8o5 ANNALES DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE & ARCHÉOLOGIQUE DU GATINAIS SÉANCE DE LA SOCIÉTÉ TENUE A BELLEGARDE (LOIRET), LE 14 MAI 1894. Quelques-uns de nos confrères s'étaient rendus à l'invitation qui comportaitun ordre du jour intéressant la lecture d'un tra- vail de M. J. Devaux, La Dislocation dit comté de Gâtinais (1209-1404); d'un document trouvé dans les archives par M. Eug. Thoison, Les Statuts des drapiers de Nemours; – et d'une note de M. H. Stein, sur Deux peintres inconnus du Gâtinais. La séance a été suivie d'une visite très complète de l'ancien château de Bellegarde, démembré aujourd'hui entre plusieurs propriétaires; M. le Dr Tartarin a très gracieusement fait parcourir aux membres de la Société, donjon, pavillon d'Antin, pavillon des écuries, etc., ensemble de constructions remarquables à la Mansart qui donne une idée de ce qu'était le château au temps de sa splendeur, bien conservé et renfer- mant encore quelques tableaux et objets d'art remarquables. On s'est séparé vers 5 heures, en se donnant rendez-vous pour l'an prochain, à Lorrez-le-Bocage. 4 – CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE SENS (Yonne) LES 19-21 JUIN 1894. La Société archéologique de Sens, pour le cinquantenaire de sa fondation, avait convié nos membres aux fêtes destinées à rappeler ces heureux souvenirs et une lettre d'invitation de notre président en avait informé tous nos confrères. M. Paul Quesvers représentait la Société du Gâtinais aux séances qui ont été fort intéressantes, à l'une d'elles il a lu un mémoire qui a été fort applaudi, et au banquet levé son verre en l'honneur des hôtes sénonais en un toast élégamment tourné.