Siège De Québec
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Military Reputation of Major-General James Wolfe
THE MILITARY REPUTATION OF MAJOR-GENERAL JAMES WOLFE Presidential Address Delivered by E. R. Adair 1936 This is an age when heroes are viewed with a somewhat sceptical eye, when it is felt that mere blind veneration for the reputations of the past should not turn aside the chilly wind of historical criticism, that the legends devised to charm worshippers must be tested by the acid of facts. So far General Wolfe has survived any serious attacks upon his reputation, very largely because he was fortunate enough to die in the moment of victory, a victory moreover that came like a blessed thunderbolt to an England that thought that all hope of it had departed, for, as Horace Walpole aptly says, Wolfe's final despatch couched "in the most artful terms that could be framed" had "left the nation uncertain whether he meant to prepare an excuse for desisting, or to claim the melancholy merit of having sacrificed himself without a prospect of success."(1) But if his reputation has so far survived practically untarnished, it is not because he has been wholly exempt from all the dangers to which dead heroes are exposed. On the one hand he has been rendered at times a little ridiculous, by the praises of his more eulogistic biographers, of whom Beckles Willson is one of the worst,(2) and who have found it necessary to discover even in his earlier years those splendid qualities which they thought it proper for a Hero to possess; that there was no particular authority to justify their views seemed quite immaterial. -

Historical Notes on the Environs of Quebec Are, by Permission
Less RUSSELL'S QUEBEC, Patronized by their Excellencies the Governor* General of Canada and Countess of Duffernu This Hotel, which is unrivalled for size, style and locality in Quebec, is open through the year for pleasure and business travel, having accommodation for 500 guests. It is eligibly situated in the immediate vicinity of the most delightful and fashionable promenades, the Governor's Garden, the Citadel, the Esplanade, the Place d'Armes, and Durham and Dufferin Terraces (1400 feet long and 200 feet above the Eiver St. Lawrence), which furnish the splendid views and magnificent scenery for which Quebec is s:> justly celebrated, and which is unsurpassed in any part of the world. WILLIS RUSSELL, President. : ISTORICAL NOTES dnbinns of ($wk(. DRIVE TO INDIAN LORETTE. INDIAN LORETTE. TAHOURENCHE, THE HURON CHIEF. THE ST. LOUIS AND THE ST. FOY ROADS. THE CHAUDIERE FALLS. These Historical jottings are intended to supply the omissions in the Guide Books. By J. M. LeMOINE, Author of " Quebec Past and Present /" Album du Touriste "Maple Leaves ;" and "Chronicles of the St. Lawrence ." MONTREAL PRINTED BY THE BURLAND-DESBARATS LlTH. CO. 1879. HER ROYAL HIGHNESS THE PRINCESS LOUISE These historical notes on the Environs of Quebec are, by permission, MOST RESPECTFULLY INSCRIBED J. M. LeMOINE. Spencer Grange, near Quebec, 4th June, 1879. *&*m ^-^HKtt WljMk SSEr""^ ^g#%*j ^^S^S^M ill I! — A VISIT TO THE INDIAN LORETTE, Of the many attractive sites in the environs of the city, few contain in a greater degree than the Huron village of Lorette during the leafy months of June, July and September, pic- turesque scenery, combined with a wealth of historical asso- ciations. -

British Garrison at Quebec
THE BRITISH GARRISON AT QUEBEC Christian Rioux Canadian Heritage Patrimoine canadien Parks Canada Pares Canada The British Garrison at Québec 1759-1871 Christian Rioux Translated from the original French Studies in Archaeology, Architecture and History National Historic Sites Parks Canada Department of Canadian Heritage ©Minister of Supply and Services Canada, 1996 Available in Canada through local bookstores or by mail from the Canada Communication Group — Publishing, Supply and Services Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0S9. Published under the authorization of the Minister of the Department of Canadian Heritage, Ottawa, 1996. Editing: Sheila Ascroft Design: Suzanne Adam-Filion and Suzanne H. Rochette Production: Suzanne H. Rochette Cover Design: Suzanne H. Rochette Translation: Quebec Region, Parks Canada Parks Canada publishes the results of its research in archaeology, ar chitecture and history. A list of reports is available from Publications, National Historic Sites Directorate, Parks Canada, 1600 Liverpool Court, Ottawa, Ontario, K1A 0M5. Canadian Cataloguing in Publication Data Rioux, Christian The British garrison at Québec, 1759-1 871 (Studies in archaeology, architecture and history, ISSN 0821-1027) Translation of: La garnison britannique à Québec 1759 à 1871 Includes bibliographical references. ISBN 0-660-16482-5 Cat. no. R61-2/9-63E 1. Garrisons, British — Quebec (Province) — Quebec — History — 18th century. 2. Garrisons, British — Quebec (Province) — Quebec — History — 19th century. 3. Soldiers — Quebec (Province) — Quebec — Social life and customs. 4. Quebec (Quebec) — History. I. Parks Canada. National Historic Sites. II. Title. III.Series. U375.C3R56 1996 355.3'0941'0971 C96-980212-9 2 Table of Contents Introduction 5 Organization and Strength 7 Military Properties 17 Military Activities 21 Living Conditions 29 Relations with the Civilian Population 45 Conclusion 51 Bibliography 53 3 1 James Wolfe, leader of the British army to which the city of Québec fell, was killed in the battle of the Plains of Abraham. -

Blockade of Quebec in 1775-1776 by the American Revolutionists
: — JOURINAU of THB PRIIVCIPAU OCCUREINCES during THE SIEGE OF QUEBEC by THE AMERICAN REVOLUTIONISTS under GENERALS MONTGOflERY and ARNOLD IN 1775=76 Containing many anecdotes of interest never yet published Collected from the Old Manuscripts originally written by an officer during the period of the gallant defence made by Sir Guy Carleton. EDITED BY "W. T. F. SHORT LONDON Sold by Simpkin and Co. Stationer's Court 1824 JovirnaLl of the PrirvcipaLl Occxirervces during the Siege of Quebec by the Ame- ricatn R^evolvitionists \ir\der GerveraLls Montgomery aLnd Arnold in 1775-76 . Dec. 1775. From the 1st to the 8th of this month our redoubted foe, General Montgomery, in conjunction with his col- league in arms, Colonel Arnold, and other officers in the rebel army, (who have lately figured as the prin- cipal chieftains of the insurgent forces, leagued to- gether for our destruction,) prepared to besiege us in form; and after taking possession of the principal houses in the neighborhood of the town, employed all the inhabitants in the laborious task of cutting fas- cines, and opening lines of circumvallation ; which ac- count we learn from numerous deserters. On the 5th. of this month Montgomerj^ who it appears had taken possession of the parish of St. Croix, two miles from this City, at first posted himself there with some field artillery, having landed his heavy cannon at Cap Eouge, beyond the Heights of Abraham—Arnold's de- tachment taking possession in the interim of the Grande Allee from St. Louis' Gate, and the other principal avenues, so as to cut off all communication with the country. -

Siege of Quebec in 1759
KXTRACT FRO~t A MANUSCRIPT .JOUHNAij 1 iUlL.o\'i'lNO TO 'l'TIP.. SIEGE OF QUEBEC IN 1759. tŒPT BY COLONEL MALCOLM FRASER.1. Then Lieutena11t of the 78th (Fraset''s llighlandere,) u4 ~Jeniog in that ()au1paigu. nlLlr,.;J,_,J ~meler l],~ ttu-spic~~ "' th~ LiftrO'l!J Ctli.d OhJfOt·ù·a-i Soct~I!J, Qtll'btt:.. t .....,. <&>' lro ('( EXT.RACT FROM A MANUSCRIPT JOURNAL ' RELATING TO THE OPERATIONS BEFORE QUEBEC IN 1759, KEPT BY COLONEL MALCOLM FRASER, Then Lieutenant of .the 78th (Fraser's Highlanders,) and servmg in that Campaign. [Col. .M:. Fraser died in 1815, at the age of 82. 'l'he original of this manuscript is in the possession of the family of the late Hon. J. M. Fraser, who kindly allowed this copy to be made from it for the use of the Literary and Historical Society.] Tuesday, 8th. 1\fay, 1759. Set sail from Sandy Hook for Louis burg with a fair wind, un der con voy of the Nightingale, Captain Campbell, the fl.eet consisting of about twenty eigbt Sail ; the greatest part of whicb is to take in the Troops from Nova Scotia, and the rest having Colonel Fraser's Regiment on board. Thursday, 17th. May. W e came into the harbour of Louis bourg, having had a very agreable and quick passage. W e are ordered ashore every day while here, to exorcise along with the rest of the Army. On the 29th. 1\lay, and sorne days bcfore and after, the Harbour of Louisbourg was so full of sho!lls of lee tbat no boats could go from the Ships to Shore. -

Turcotte History of the Ile D'orleans English Translation
Salem State University Digital Commons at Salem State University French-Canadian Heritage Collection Archives and Special Collections 2019 History of the Ile d'Orleans L. P. Turcotte Elizabeth Blood Salem State University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.salemstate.edu/fchc Part of the History Commons Recommended Citation Turcotte, L. P. and Blood, Elizabeth, "History of the Ile d'Orleans" (2019). French-Canadian Heritage Collection. 2. https://digitalcommons.salemstate.edu/fchc/2 This Book is brought to you for free and open access by the Archives and Special Collections at Digital Commons at Salem State University. It has been accepted for inclusion in French-Canadian Heritage Collection by an authorized administrator of Digital Commons at Salem State University. History of the Ile d’Orléans by L.P. Turcotte Originally published in Québec: Atelier Typographique du “Canadien,” 21 rue de la Montagne, Basse-Ville, Québec City 1867 Translated into English by Dr. Elizabeth Blood, Salem State University, Salem, Massachusetts 2019 1 | © 2019 Elizabeth Blood TRANSLATOR’S PREFACE It is estimated that, today, there are about 20 million North American descendants of the relatively small number of French immigrants who braved the voyage across the Atlantic to settle the colony of New France in the 17th and early 18th centuries. In fact, Louis-Philippe Turcotte tells us that there were fewer than 5,000 inhabitants in all of New France in 1667, but that number increased exponentially with new arrivals and with each new generation of French Canadiens. By the mid-19th century, the land could no longer support the population, and the push and pull of political and economic forces led to a massive emigration of French-Canadians into the United States in the late 19th and early 20th centuries. -

Quebec City's Literary Heritage
QUEBEC CITY’S LITERARY HERITAGE A BIBLIOGRAPHY Volume I: Fiction, Journals, Memoirs, Travel Writing, Childrens’ Literature BY PATRICK DONOVAN QUEBEC CITY’S LITERARY HERITAGE A BIBLIOGRAPHY Volume I: Fiction, Journals, Memoirs, Travel Writing, Childrens’ Literature BY PATRICK DONOVAN Literary & Historical Society of Quebec Quebec (Quebec) Literary & Historical Society of Quebec 44, chaussée des Écossais Quebec, Quebec G1R 4H3 © Literary & Historical Society of Quebec, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publisher. FIRST EDITION Printed in Canada Donovan, Patrick Quebec City’s Literary Heritage: A Bibliography Volume I: Fiction, Journals, Memoirs, Travel Writing, Childrens’ Literature ISBN 978-0-919282-00-1 Published with the financial assistance of the Department of Canadian Heritage QUEBEC CITY’S LITERARY HERITAGE: A BIBLIOGRAPHY Volume I: Fiction, Journals, Memoirs, Travel Writing, Childrens’ Literature Table of contents 1. Introduction.............................................................................................................1 1.1. Context..........................................................................................................1 1.2. Definition of the Problem .............................................................................1 1.3. Objectives.....................................................................................................1 -

The Fight for Canada
CLASH OF EMPIRES: THE BRITISH, FRENCH & INDIAN WAR 1754 - 1763 CHAPTER 6 The Fight for Canada )M 1755 To 1760, British, French, and American Indians engaged in some of rgest and most dramatic military operations of the American war. Campaigns ic Canada and the St. Lawrence Valley involved joint operations between and forces, as well as large-scale European-style sieges employing heavy dl tll l y llLL tlplX exenginleering earthworKs. I ie contrast between tnese operations and f the campaigns in the American interior reveal both the remarkable military power that 18th-century empires could project far from Europe and also the limits of that power. The dominance of regular European troops and fleets in these campaigns reinforced the contempt shared by most Europeans toward native and colonial fighters. This perspective shaped profoundly the fate of Britain's American empire after the fall of Canada. DEFENDING NEW FRANCE French settlement in Acadia (now western Nova Scotia, eastern New Brunswick, and northeastern Maine) began in the early 1600s. France ceded Acadian territory to the British in 1713, but by 1750, more than 13,000 French-speaking inhabitants were living along the region's extensive coastline. The boundaries were still in dispute when conflict broke out in the Ohio Country in 1754. Most Acadians living in British territory had remained neutral during previous conflicts, but in 1755, fear of insurgency and desire for the Acadians' lands and fishing grounds led New England and British forces to ruthlessly expel the inhabitants. This ethnic displacement scattered Acadians across the British colonies and the larger Atlantic world. -

Battle of Quebec (1775) - Wikipedia
Battle of Quebec (1775) - Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Quebec_(1775) Coordinates: 46°48′54″N 71°12′8″W The Battle of Quebec (French: Bataille de Québec) was Battle of Quebec fought on December 31, 1775, between American Continental Army forces and the British defenders of Part of the American Revolutionary War Quebec City early in the American Revolutionary War. The battle was the first major defeat of the war for the Americans, and it came with heavy losses. General Richard Montgomery was killed, Benedict Arnold was wounded, and Daniel Morgan and more than 400 men were taken prisoner. The city's garrison, a motley assortment of regular troops and militia led by Quebec's provincial governor, General Guy Carleton, suffered a small number of casualties. Montgomery's army had captured Montreal on November British and Canadian forces attacking 13, and early in December they became one force that was Arnold's column in the Sault-au-Matelot led by Arnold, whose men had made an arduous trek painting by C. W. Jefferys through the wilderness of northern New England. Governor Carleton had escaped from Montreal to Quebec, Date December 31, 1775 the Americans' next objective, and last-minute Location Quebec City, Province of Quebec reinforcements arrived to bolster the city's limited (present-day Canada) defenses before the attacking force's arrival. Concerned that expiring enlistments would reduce his force, Result British victory[1] Montgomery made the end-of-year attack in a blinding snowstorm to conceal his army's movements. The plan End of American offensive was for separate forces led by Montgomery and Arnold to operations in Canada. -
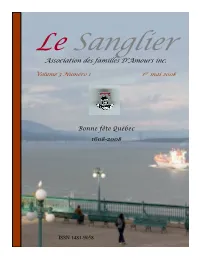
Le Sanglier 2008
Le Sanglier Association des familles D'Amours inc. Volume 3 Numéro 1 1er mai 2008 Bonne fête Québec 1608-2008 ISSN 1481-9058 Le SanglierSanglier,,,, votre fidèle compagnon Site Web http://familles-damours.org À votre service La ville de Québec fête son 400 e anniversaire de fondation Après avoir été la capitale des colonies françaises d’Amérique, puis celle du Bas-Canada, la ville de Québec est devenue la capitale du Québec en 1867, au moment où la Confédération canadienne a été créée. La région administrative de Québec est d’ailleurs connue sous le nom officiel de région de la Capitale-Nationale et regroupe plus de 650 000 habitants, dont plusieurs sont à l’emploi de la fonction publique québécoise. Ce rôle privilégié de capitale a fortement contribué à façonner son paysage et à lui donner le cachet particulier qu’on lui connaît. Le secteur de la colline parlementaire en est un bon exemple. Dans l’optique d’une vaste opération de revalorisation, on cherche à lui conférer le prestige et la prestance continuellement dignes de son statut à la fois historique et moderne. Le Québec compte 7,4 millions d’habitants, principalement concentrés au sud de son vaste territoire de 1,7 million de kilomètres carrés. C’est une population équivalente à la Suisse ou à la Suède, sur un territoire trois fois plus grand que la France et cinq fois plus grand que le Japon. Le Québec est nord-américain par sa situation géographique, français par ses origines et britannique par son système parlementaire. La société québécoise se définit comme pluraliste, moderne, dynamique et ouverte sur le monde. -

A Quick History Lesson the Battle of the Plains of Abraham Background on the Epic Poem Touring Canada, April-May 2005
A Quick History Lesson The Battle of the Plains of Abraham background on the epic poem touring Canada, April-May 2005 www.plainsofabraham.ca The Siege of Quebec (1758-1759) In June 1759, Wolfe arrived at Quebec with his army of English line regiments, Highland regiments, and American irregular troops. Yet the natural defensive advantages of the city – tall cliffs on the north shore of the St. Lawrence River – made it difficult to assault directly. After the first such assault was beaten back at the Battle of Montmorency (31 July), Wolfe fell back on “scorched earth” tactics, hoping to force the French to surrender from hunger. When he himself fell ill, however, it seemed inevitable that the British would be forced to abandon the siege. Unexpectedly, on the 12th of September, Wolfe learned that a supply convoy was expected by the French, a convoy which would land at a small cove near the citadel, L’Anse-au-Foulon. Impersonating the supply convoy, his leading soldiers – Scottish officers of the 78th Fraser Highlanders, fluent in French – fooled the defenders and opened the way for the rest of the British army to climb the steep cliffs of the north shore and prepare for battle on the fields in front of Quebec: the Plains of Abraham. The Battle of the Plains of Abraham On the morning of the 13th of September, Montcalm got word that the British had appeared on the north shore, and he led his forces to battle. Perhaps rashly, he decided to attack them directly, without waiting for reinforcements. His mixed force of French line regiments, the local Compagnies franches de la Marine, First Nations allies, and Canadian militia charged the British line in some confusion. -
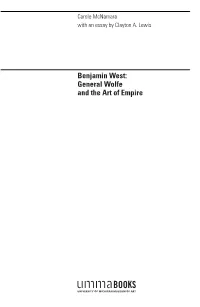
Benjamin West: General Wolfe and the Art of Empire Contents
Carole McNamara with an essay by Clayton A. Lewis Benjamin West: General Wolfe and the Art of Empire Contents This publication is presented in conjunction with the exhibition 5 Director’s Foreword %HQMDPLQ:HVW*HQHUDO:ROIHDQGWKH$UWRI(PSLUH at the Joseph Rosa University of Michigan Museum of Art, September 22, 2012– January 13, 2013, in the A. Alfred Taubman Gallery I. 6 Acknowledgments This exhibition is generously supported by the Joseph F. McCrindle Foundation, the University of Michigan Health System, the Carole McNamara University of Michigan Office of the Provost and Office of the Vice President for Research, the Richard and Rosann Noel Endowment 8 Benjamin West Fund, and THE MOSAIC FOUNDATION (of R. & P. Heydon). and the Art of Empire Carole McNamara 26 William L. Clements Copyright © 2012 The Regents of the University of Michigan and 6JG&GCVJQH)GPGTCN9QNHG All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, Clayton A. Lewis stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic or mechanical, including photocopying, 34 Plates recording, or otherwise, without the prior permission in writing of the publisher. 56 Checklist of Works in the Exhibition ISBN: 978-1-930561-16-8 Library of Congress Control Number: 2012941765 58 Selected Bibliography Published by the University of Michigan Museum of Art 525 South State Street Ann Arbor, Michigan 48109-1354 www.umma.umich.edu Regents of the University of Michigan Julia Donovan Darlow, Ann Arbor Laurence B. Deitch, Bloomfield Hills Denise Ilitch, Bingham Farms Olivia P. Maynard, Goodrich Andrea Fischer Newman, Ann Arbor Andrew C.