TS Hopper 4C.Qxp
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
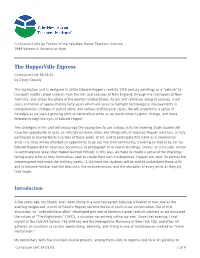
The Hopperville Express
Curriculum Units by Fellows of the Yale-New Haven Teachers Institute 1989 Volume V: America as Myth The HopperVille Express Curriculum Unit 89.05.01 by Casey Cassidy This curriculum unit is designed to utilize Edward Hopper’s realistic 20th century paintings as a “vehicle” to transport middle school children from the hills and seasides of New England, through the metropolis of New York City, and across the plains of the western United States. As our unit continues along its journey, it will cross a timeline of approximately forty years which will serve to highlight technological improvements in transportation, changes in period attire, and various architectural styles. We will experience a sense of nostalgia as we view a growing spirit of nationalistic pride as we watch America grow, change, and move forward through the eyes of Edward Hopper. The strategies in this unit will encourage the youngsters to use various skills for learning. Each student will have the opportunity to read, to critically examine slides and lithographs of selected Hopper creations, to fully participate in teacherled discussions of these works of art, and to participate first hand as a commercial artist—i.e. they will be afforded an opportunity to go out into their community, traveling on foot or by car (as Edward Hopper did on countless occasions), to photograph or to sketch buildings, scenes, or structures similar to commonplace areas that Hopper painted himself. In this way, we hope to create a sense of the challenge facing every artist as they themselves seek to create their own masterpieces. Hopper was able “to portray the commonplace and make the ordinary poetic.”1 We hope our students will be able to understand these skills and to become familiar with the decisions, the inconveniences, and the obstacles of every artist as they ply their trade. -

Edward Hopper___Book Design
1882-1967 Coverafbeelding: Hotel Lobby, 1943 Olieverf op linnen, 81,9 x 103,5 cm The Indianapolis Museum of Art, herdenkingscollectie William Ray Adams Self-portrait, 1925-1930 Self-portrait by Edward Hopper, 1906 Olieverf op linnen, 63,8x51,4cm Olieverf op linnen New York, Collection of Whitney Museum of American Art New York, Collection of Whitney Museum of American Art 2 3 De tweede voorbode van latere ontwikkelingspatronen Soir Blue uit 1914 laat het late werk vanuit een derde is te zien in Hoppers landschapschilderijen, die vooral perspectief zien. Aan de ene kant kan dit schilderij al EEN VOORZICHTIG BEGIN kenmerkend zijn voor de overgang van de impressionis- terugblik van de schilder op zijn Franse en impressionis- tische (Franse) naar de vroege Amerikaanse periode. tische periode opgevat worden, maar bovendien verwijst Al heel vroeg verschijnen er naast de zuivere landschap- het door zijn psychologische laag naar toekomstige doe- schilderijen composities waarin natuur en beschaving in ken. Er kan gesteld worden dat Hopper vanaf dit mo- elkaar overlopen en tegelijk haarscherp van elkaar zijn ment niet allen zijn identiteit als Amerikaans kunstenaar, Edward Hopper wordt op 22 juli 1882 geboren in New afgegrensd. Steeds weer schildert Hopper bruggen, ka- maar ook de psychogrammatische laag in zijn schilde- York. Hij studeerde er aan de Newyorkse kunstacade- nalen, aanlegplaatsen voor boten en vuurtorens. rijen gaat benadrukken. mie als illustrator maar gaat na een jaar over naar The New York School of Art. Eerst volgt hij hier reclame, la- ter leert hij de schilderkunst van docenten Robert Henri en Keneth Hayes Miller. Afgezien van twee korte bezoeken aan Europa leeft Edward Hopper vanaf 1908 in New York. -
Whitney Museum Loans Two Edward Hopper Paintings to the White House
President Barack Obama looks at the Edward Hopper paintings now displayed in the Oval Office, February 7, 2014. The paintings are Cobb's Barns, South Truro, top, and Burly Cobb’s House, South Truro. (Official White House Photo by Chuck Kennedy) Whitney Museum Loans Two Edward Hopper Paintings to The White House NEW YORK, February 11, 2014—The Whitney Museum of American Art is delighted to announce the loan of two Edward Hopper paintings to The White House. The two paintings, Burly Cobb’s House, South Truro and Cobb’s Barns, South Truro, both dated 1930–1933, were installed in the Oval Office last week. “We are pleased and honored to lend two paintings by Edward Hopper—the artist with whom the Whitney Museum of American Art is most closely identified—to The White House for display in the Oval Office,” said Adam D. Weinberg, the Alice Pratt Brown Director of the Whitney. “Edward Hopper’s history with the Whitney goes back to our roots in 1920, when he was given his first one-person exhibition at the Whitney Studio Club, forerunner to the Whitney Museum. Since the founding of the Museum in 1930, we have exhibited Hopper’s work more than any other artist and are proud to house the greatest collection of Hoppers in the world. We hope these beautiful Cape Cod landscapes will give great pleasure to President Obama and to all who see them.” Edward Hopper (1882–1967) is universally recognized as one of the most significant artists of the twentieth century. Known primarily for the oil paintings of urban life and the American landscape that he created from the 1920s to the 1960s, Hopper subtly intertwined observations of the real with his imagination to create an aesthetic that has influenced not only painting but also popular culture, photography, and film. -

The Lonely City: Adventures in the Art of Being Alone
Also by Olivia Laing To the River The Trip to Echo Spring OLIVIA LAING The Lonely City Adventures in the Art of Being Alone Published in Great Britain in 2016 by Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh EH1 1TE www.canongate.tv This digital edition first published in 2016 by Canongate Books Copyright © Olivia Laing, 2016 The moral right of the author has been asserted For permissions acknowledgements, please see the Notes beginning on page 285 Every effort has been made to trace copyright holders and obtain their permission for the use of copyright material. The publisher apologises for any errors or omissions and would be grateful if notified of any corrections that should be incorporated in future reprints or editions of this book. British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available on request from the British Library ISBN 978 1 78211 123 8 eISBN 978 1 78211 124 5 Typeset in Bembo by Palimpsest Book Production Ltd, Falkirk, Stirlingshire If you’re lonely, this one’s for you and every one members one of another Romans 12:5 CONTENTS 1 The Lonely City 2 Walls of Glass 3 My Heart Opens to Your Voice 4 In Loving Him 5 The Realms of the Unreal 6 At the Beginning of the End of the World 7 Render Ghosts 8 Strange Fruit Notes Bibliography Acknowledgements List of Illustrations 1 THE LONELY CITY IMAGINE STANDING BY A WINDOW at night, on the sixth or seventeenth or forty-third floor of a building. The city reveals itself as a set of cells, a hundred thousand windows, some darkened and some flooded with green or white or golden light. -

Edward Hopper 26 January – 26 July 2020
Media release Edward Hopper 26 January – 26 July 2020 Edward Hopper (1882–1967) is widely acknowledged as one of the most significant artists of the 20th century. In Europe, he is known mainly for his oil paintings of urban life scenes dating from the 1920s to 1960s, some of which have become highly popular images. Less attention has so far been paid to his landscapes. Surprisingly, no exhibition to date has dealt comprehensively with Hopper’s approach to American landscape. Initially until 17 May 2020, the Fondation Beyeler presents an extensive exhibition of iconic landscape paintings in oil as well as a selection of watercolors and drawings. This will also be the first time Hopper’s works are shown in an exhibition in German-speaking Switzerland. Hopper was born in Nyack, New York. After training as an illustrator, he studied painting at the New York School of Art until 1906. Next to German, French and Russian literature, the young artist found key reference points in painters such as Diego Velázquez, Francisco de Goya, Gustave Courbet and Édouard Manet. Although Hopper long worked mainly as an illustrator, his fame rests primarily on his oil paintings, which attest to his deep interest in color and his virtuosity in representing light and shadow. Moreover, on the basis of his observations Hopper was able to establish a personal aesthetics that has influenced not only painting but also popular culture, photography and film. The idea for this exhibition arose when Cape Ann Granite, a landscape painted by Edward Hopper in 1928, joined the collection of the Fondation Beyeler as a permanent loan. -

European Journal of American Studies, 16-1 | 2021 the Empty Stage in Edward Hopper’S Early Sunday Morning, Girlie Show, and Two
European journal of American studies 16-1 | 2021 Spring 2021 The Empty Stage in Edward Hopper’s Early Sunday Morning, Girlie Show, and Two Comedians Philip Smith Electronic version URL: https://journals.openedition.org/ejas/16694 DOI: 10.4000/ejas.16694 ISSN: 1991-9336 Publisher European Association for American Studies Electronic reference Philip Smith, “The Empty Stage in Edward Hopper’s Early Sunday Morning, Girlie Show, and Two Comedians”, European journal of American studies [Online], 16-1 | 2021, Online since 12 August 2021, connection on 12 August 2021. URL: http://journals.openedition.org/ejas/16694 ; DOI: https://doi.org/ 10.4000/ejas.16694 This text was automatically generated on 12 August 2021. Creative Commons License The Empty Stage in Edward Hopper’s Early Sunday Morning, Girlie Show, and Two... 1 The Empty Stage in Edward Hopper’s Early Sunday Morning, Girlie Show, and Two Comedians Philip Smith 1. Hopper and the Stage 1 An empty stage typically signals a moment of transition between the reality the audience occupies outside of the performance and their emersion into the representation of reality presented on the stage. An empty stage at the start of the performance is an invitation for the audience to examine the objects before them and anticipate the action to follow. An empty stage at the end of a performance is an invitation for the audience to reflect upon what they have just seen. This latter moment is captured in one of the most famous passages from The Tempest: Our revels now are ended. These our actors As I foretold you, were all spirits, and Are melted into air, into thin air; And like the baseless fabric of this vision, The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, The solemn temples, the great globe itself, Yea all which it inherit, shall dissolve; And, like this insubstantial pageant faded, Leave not a rack behind. -

REPETITION: a Study in Visual Form Using Selected Artworks by Edward Hopper
City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 2-2016 REPETITION: A Study in Visual Form Using Selected Artworks by Edward Hopper Lauren Irwin The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/1212 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] REPETITION: A Study in Visual Form using Selected Artworks by Edward Hopper by LAUREN IRWIN A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Clinical Psychology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The City University of New York 2016 ii © 2016 LAUREN IRWIN All Rights Reserved iii This manuscript has been read and accepted by the Graduate Faculty in Clinical Psychology in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ___________________ ________________________________ Date Lissa Weinstein, Ph.D. Chair of Examining Committee ___________________ ________________________________ Date Maureen O’Connor, Ph.D. Executive Officer in Psychology Diana Diamond, Ph.D. Steven Tuber, Ph.D. Diana Puñales, Ph.D. Benjamin Harris, Ph.D. Supervision Committee THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iv Abstract REPETITION: A Study in Visual Form using Selected Artworks by Edward Hopper by Lauren Irwin Adviser: Professor Lissa Weinstein An attempt was made to study the form, function and patterns of repetition as expressed in visual form. -

Pre- & Post-Visit Materials for Teachers
Pre- & Post-visit Materials for Teachers Modern Life: Edward Hopper and His Time October 28, 2010-April 10, 2011 Education whitney.org/K-12 2010 WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART 1 About these Materials How can these materials be used? These materials provide a framework for preparing you and your students for a visit to the exhibition and offer suggestions for follow up classroom reflection and lessons. The discussions and activities introduce some of the exhibition’s key themes and concepts. p. 5 About the Exhibition pp. 6-9 Pre- & Post-visit Activities pp. 10-16 Images and Related Information pp. 17-19 About the Artists pp. 20-21 Glossary p. 22 Bibliography & Links Which grade levels are these pre- and post-visit materials intended for? These lessons and activities have been written for Elementary, Middle, or High School students. We encourage you to adapt and build upon them in order to meet your teaching objectives and students’ needs. Learning standards The projects and activities in these curriculum materials address national and state learning standards for the arts, English language arts, social studies, and technology. Links to National Learning Standards. http://www.mcrel.org/compendium/browse.asp Comprehensive guide to National Learning Standards by content area. http://www.education-world.com/standards/national/index.shtml New York State Learning Standards. http://www.nysatl.nysed.gov/standards.html http://www.emsc.nysed.gov/ciai/standards.html New York City Department of Education’s Blueprint for Teaching and Learning in the Arts, grades K-12. http://schools.nyc.gov/offices/teachlearn/arts/blueprint.html Feedback Please let us know what you think of these materials. -

Post-War American Art the NOVAK/O’DOHERTY COLLECTION
Post-War American Art THE NOVAK/O’DOHERTY COLLECTION Contents Foreword 7 Enrique Juncosa Director In Dreams Begin Responsibilities 13 Brian O’Doherty The Novak/O’Doherty Collection 15 Christina Kennedy Senior Curator, Head of Collections Works 25 Artists’ Biographies 168 Endnotes 190 Image Credits/Colophon 192 Foreword Enrique Juncosa It is my pleasure as Director of IMMA to accept the magnificent gift to the nation of the Novak/O’Doherty collection of post-war American art. These 6 works cover a significant period, mainly the 1960s and 0s, which is not fully represented in our collection. Last year, thanks to The American Ireland Fund, IMMA acquired works by Edward Hopper, Marcel Duchamp, George Segal and Jasper Johns. Some works from the collection were included in the recent IMMA exhibition Vertical Thoughts: Morton Feldman and the Visual Arts – appropriately, since Morton Feldman was a close friend of the two donors. The works included in this book and the accompanying exhibition were the result of friendships with outstanding artists in the New York milieu. We can imagine the lives of Barbara Novak and Brian O’Doherty over forty years – they married in 1960 – through these paintings, photographs, drawings, sculptures and prints. Most of the pieces were exchanged for works of their own, others were gifts, some were purchased. Through them we see that Barbara and Brian were central figures in the art community of the 1960s and 0s and beyond. Among artists in their circle and in their collection we find figures as celebrated as Eva Hesse, Ruth Vollmer, Peter Hutchinson, John Coplans, Dan Graham, George Segal, Sol LeWitt, Robert Rauschenberg and Mel Bochner. -

Summer 2020 Luxury Magazine
LUX URY MA GAZINE SUMMER 2020 Early Sunday Morning, 1930, oil on canvas, 35 3/16” x 60” An American Life One of the most celebrated artists of the 20th century, EDWARD HOPPER painted melancholic cityscapes and rural scenes imbued with loneliness and uncertainty—now eerily prescient. Digital image © Whitney Museum of American ArtDigital image © Whitney Scala / Art / Licensed by NY Resource, BY JASON EDWARD KAUFMAN 190 LM SUMMER 2020 LM SUMMER 2020 191 Self-Portrait, 1925–1930, oil on canvas, 25 3/8” x 20 3/8” Opposite, from top: South Carolina Morning, 1955, oil on canvas, 30 3/8” x 40 1/4” Lighthouse Hill, 1927, oil on canvas, 28 1/4” x 39 1/2” dward Hopper’s reputation is neither awe-inspiring nor picturesque, and Consider the psychological dimensions somewhat paradoxical. He emerged their occasional inhabitants tend to be bored of America, and the appeal of Hopper’s at a time when critics condemned cyphers rather than dynamic individuals. As work deepens. He is known as the painter Erepresentational painting and physical objects, the canvases are as modest of loneliness, representing the somber life promoted the innovations of abstraction, yet as their subject matter. Never monumental in of individuals absorbed in their own worlds. he remained a die-hard realist. scale, often subdued in tone, they are painted Even his unpopulated scenes are enshrouded Hopper’s life (1882–1967) spanned World in a sort of bland, straightforward manner, in an enigmatic stillness, as if time has paused War I, the Roaring Twenties, the Great devoid of overt virtuosity. -

Pardo Garcia2020.Pdf (13.56Mb)
This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Hopper beyond the commonplace EDWARD HOPPER BEYOND THE COMMONPLACE. A review of his work under the light of Walter Benjamin´s concept of poverty of experience. Ana Pardo García 1 Hopper beyond the commonplace Abstract The title of this dissertation —Edward Hopper beyond the commonplace— alludes to the fact that, although the work of Edward Hopper is widely acknowledged in the history of the twentieth century art, critical literature focused on it has resorted to a number of labels (Americanness, alienation, loneliness and the like) which, over time, have become clichés with very little critical insight and with very weak theoretical and visual foundations. My first aim is, therefore, to develop a different critical framework which is up to the task of analysing the indisputable visual relevance of Hopper’s work. -

Edward Hopper 26 January – 17 May 2020
Media release, 24 January 2020 Edward Hopper 26 January – 17 May 2020 Edward Hopper (1882–1967) is widely acknowledged as one of the most significant artists of the 20th century. In Europe, he is known mainly for his oil paintings of urban life scenes dating from the 1920s to 1960s, some of which have become highly popular images. Less attention has so far been paid to his landscapes. Surprisingly, no exhibition to date has dealt comprehensively with Hopper’s approach to American landscape. From 26 January to 17 May 2020, the Fondation Beyeler is presenting an extensive exhibition of iconic landscape paintings in oil as well as a selection of watercolors and drawings. This will also be the first time Hopper’s works are shown in an exhibition in German-speaking Switzerland. Hopper was born in Nyack, New York. After training as an illustrator, he studied painting at the New York School of Art until 1906. Next to German, French and Russian literature, the young artist found key reference points in painters such as Diego Velázquez, Francisco de Goya, Gustave Courbet and Édouard Manet. Although Hopper long worked mainly as an illustrator, his fame rests primarily on his oil paintings, which attest to his deep interest in color and his virtuosity in representing light and shadow. Moreover, on the basis of his observations Hopper was able to establish a personal aesthetics that has influenced not only painting but also popular culture, photography and film. The idea for this exhibition arose when Cape Ann Granite, a landscape painted by Edward Hopper in 1928, joined the collection of the Fondation Beyeler as a permanent loan.