DOC 1 Dossier De Présentation SIMAL VF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PDPG 64 Planq48-0400 Départemental Pour La Protection Des Milieux
PDPG 64 PlanQ48-0400 Départemental pour la Protection des Milieux Aquatiques et la Gestion des Ressources Piscicoles des Pyrénées-Atlantiques Etat des lieux et Plan des actions nécessaires 2012-2016 Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 12, Boulevard Hauterive Tél : 05 59 84 98 50 64000 PAU Fax : 05 59 84 98 54 : [email protected] Avec le soutien Sommaire Etat des lieux général Le PDPG : qu’est-ce que c’est ? ................................................................................................................ 2 Méthodologie et hypothèses de calcul ................................................................................................... 5 Aperçu global ........................................................................................................................................ 12 Fiches contextes .................................................................................................................................... 19 Fiches contextes : diagnostic et programmation COTIERS ................................................................................................................................................... 24 NIVELLE ................................................................................................................................................... 31 ARAN ...................................................................................................................................................... 39 ARDANAVY.............................................................................................................................................. -

Schéma Départemental De Coopération Intercommunale Des Landes Arrêté Le 21 Mars 2016 Schéma Départemental De Coopération Intercommunale Des Landes – Mars 2016
PREFET DES LANDES Schéma départemental de coopération intercommunale des Landes arrêté le 21 mars 2016 Schéma départemental de coopération intercommunale des Landes – mars 2016 Sommaire Introduction................................................................................................3 1. Rappels des objectifs de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République...3 2. Objectifs et enjeux du SDCI dans les Landes............................................................................3 3. Contenu du projet de schéma ....................................................................................................3 1. Éléments d’analyse territoriale............................................................4 1.1 L’intercommunalité dans les Landes ......................................................................................4 1.2. Éléments d’analyse et de documentation................................................................................5 2. Élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale........................................................................................14 2.1 Calendrier...............................................................................................................................14 2.1.1 Procédure d’adoption du SDCI......................................................................................................14 2.1.2 Mise en œuvre du SDCI ................................................................................................................14 -

Landes Randonnée® (Itinéraires Pédestres, VTT Et Équestres)
Les types de balisage ® Landes Randonnée (itinéraires pédestres, VTT et équestres) Les circuits de randonnée sont tous balisés sur le Offices de Tourisme terrain avec un code différent selon les pratiques Promenades de randonnée : à pied, à vélo ou à cheval. Aire-sur-l’Adour - 40800 et randonnées Tél : 05 58 71 64 70 - tourisme-aire-eugenie.fr Type de sentier Amou - 40330 dans les Landes Tél : 05 58 89 02 25 - amoutourisme.com Site Nature 40 Bonne Biscarrosse - 40600 direction Tél : 05 58 78 20 96 - biscarrosse.com À PIED, À CHEVAL OU À VÉLO : ou rappel À CHACUN SA RANDO ! Capbreton - 40130 Tél : 05 58 72 12 11 - capbreton-tourisme.com Tournez à Edition gauche Castets - 40260 2019 Tél : 05 58 89 44 79 - cotelandesnaturetourisme.com Tournez à Dax - 40100 droite Tél : 05 58 56 86 86 - dax-tourisme.com Eugénie-les-Bains - 40320 Mauvaise Tél : 05 58 51 13 16 - tourisme-aire-eugenie.fr direction Gabarret - 40310 Tél : 05 58 44 34 95 - tourisme-landesdarmagnac.fr Geaune - 40320 Tél : 05 58 44 42 00 - landes-chalosse.com Grenade-sur-l’Adour - 40270 Tél : 05 58 45 45 98 - cc-paysgrenadois.fr/tourisme Hagetmau - 40700 Tél : 05 58 79 38 26 - tourisme-hagetmau.com Hossegor - 40150 Tél : 05 58 41 79 00 - hossegor.fr Département Labastide-d’Armagnac - 40240 des Landes Tél : 05 58 44 67 56 - tourisme-landesdarmagnac.fr Les Actions Environnementales Labenne - 40530 Tél : 05 59 45 40 99 - landesatlantiquesud.com Département des Landes Comité départemental du tourisme Léon - 40550 Direction de l’Environnement équestre Tél : 05 58 48 76 03 - cotelandesnaturetourisme.com 23 rue Victor Hugo 40025 Mont-de-Marsan cedex 40090 BOUGUE Lit-et-Mixe - 40170 Tél : 05 58 06 09 70 Tél : 05 58 42 72 47 - cotelandesnaturetourisme.com Tél. -

Candidatures Dpt 40 Moins De 1000 Hab-1
Code du départementLibellé du départementCode communeLibellé communeSexe Nom Prénom Date de NaissanceSortant Nationalité 40 LANDES 3 Angoumé F AUDOUY Véronique 14/12/1960 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F BORDES Catherine 10/09/1964 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F CAYET Laëtitia 24/12/1972 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F DE BARROS Catherine 05/03/1968 S Française 40 LANDES 3 Angoumé F DELMAS Isabelle 07/03/1966 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M MAUGEAIS Didier 20/07/1957 Française 40 LANDES 3 Angoumé M NAVARRO Thierry 07/06/1971 Française 40 LANDES 3 Angoumé F PAYSAN Hélène 15/06/1956 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M PICARD Vincent 06/10/1971 S Française 40 LANDES 3 Angoumé M PIERRE Maurice 27/05/1948 Française 40 LANDES 3 Angoumé M VERGERON Thierry 21/02/1968 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M BIDOT Benjamin 02/06/1983 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M BIDOT Mathieu 01/12/1987 Française 40 LANDES 5 Arboucave M BOULIN Baptiste 21/09/1988 Française 40 LANDES 5 Arboucave F DARNAUDERYSylvie 26/05/1968 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M DARRIEUTORTDidier 21/02/1961 S Française 40 LANDES 5 Arboucave M DEPOMPS Denis 11/11/1969 Française 40 LANDES 5 Arboucave M FALCOU Dominique 02/08/1966 S Française 40 LANDES 5 Arboucave F KOCHER Leila 19/08/1951 Française 40 LANDES 5 Arboucave M LAFFITTE Jean 10/04/1953 S Française 40 LANDES 5 Arboucave F LAFFITTE Nathalie 28/08/1975 Française 40 LANDES 5 Arboucave F TASTET Marie-Claude 25/11/1955 S Française 40 LANDES 6 Arengosse M DARENGOSSEMichel 11/05/1947 S Française 40 LANDES 6 Arengosse M DESTRUHAUT -
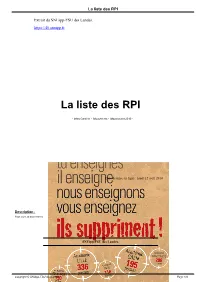
La Liste Des RPI
La liste des RPI Extrait du SNUipp-FSU des Landes. https://40.snuipp.fr La liste des RPI - Infos Carrière - Mouvement - Mouvement 2010 - Date de mise en ligne : lundi 12 avril 2010 Description : Pour aider au mouvement. SNUipp-FSU des Landes. Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 1/4 La liste des RPI DAX CENTRE LANDES AZUR, MESSANGES, MOLIETS LEVIGNACQ, UZA BEYLONGUE, CARCEN PONSON LESGOR, LALUQUE, TALLER ARENGOSSE,OUSSE SUZAN, ST YAGUEN,VILLENAVE RPC CARCARES, AUDON, GOUTS DAX SUD ADOUR ESTIBEAUX,MOUSCARDES,OSSAGES,TILH MIMBASTE, MISSON ORTHEVIELLE, PORT DE LANNE ORIST, PEY BELUS, ST ETIENNE D'ORTHE ST CRICQ DU GAVE, SORDE L'ABBAYE HASTINGUES, SAMES (64) CANDRESSE, NARROSSE ST VINCENT DE PAUL, TETHIEU HEUGAS, ST PANDELON MONT DE MARSAN HAUTE LANDE BOSTENS,POUYDESSEAUX, STE FOY,GAILLERES BELIS,BROCAS,CANENX,CERE, MAILLERES LUCBARDEZ, SAINT AVIT ARUE, CACHEN, LENCOUACQ BOURRIOT,LOSSE,RETJONS,VIELLE, SOUBIRAN,ST GOR GAREIN,LABRIT,LE SEN,VERT CREON, LABASTIDE LE FRECHE, ST JUSTIN LUXEY, SORE MONT DE MARSAN SUD ARMAGNAC ARTASSENX, BASCONS, BRETAGNE Copyright © SNUipp-FSU des Landes. Page 2/4 La liste des RPI BORDERES, CASTANDET, MAURRIN FARGUES, MONTGAILLARD BOURDALAT,HONTANX,ST GEIN PUJO, SAINT CRICQ VILLENEUVE BOUGUE, LAGLORIEUSE, MAZEROLLES MONT DE MARSAN SUD CHALOSSE AUBAGNAN, BATS, VIELLE TURSAN BRASSEMPOUY, SAINT CRICQ CHALOSSE HORSARRIEU, Ste COLOMBE, SERRES GASTON LACRABE,MANT,MORGANX,PEYRE,MONSEGUR, POUDENX ARSAGUE, BONNEGARDE, CASTEL SARRAZIN CASTAIGNOS, MOMUY, NASSIET BASTENNES,CASTELNAU,DONZACQ,GAUJACQ GAMARDE,GOOS,PRECHACQ GARREY, SORT EN CHALOSSE CASSEN,GOUSSE,LOUER,ONARD,ST GEOURS D'AURIBAT, ST JEAN DE LIER,VICQ D'AURIBAT LAUREDE, POYANNE CAUPENNE,LARBEY,MAYLIS,ST AUBIN HAURIET,MONTAUT,TOULOUZETTE AURICE, CAUNA, LAMOTHE, LE LEUY COUDURES,MONTSOUE,SARRAZIET AUDIGNON,BANOS,DUMES,EYRES MONCUBE MONT DE MARSAN TURSAN ASH PHILONDENX, URGONS PIMBO, SORBETS, MIRAMONT CAZERES, LE VIGNAU LARRIVIERE, RENUNG MIMIZAN PAYS DE BORN BIAS, MEZOS Copyright © SNUipp-FSU des Landes. -

EVS Admin Site
N° CIRCONSCRIPTION ECOLES 1 Mont de Marsan Sud-Chalosse St Pierre du Mont Jules Ferry - Elémentaire 2 Mont de Marsan Sud-Chalosse St Pierre du Mont - Biarnès Maternelle 3 Mont de Marsan Haute Landes Jean Moulin - Mont de Marsan 4 Mimizan Pays de Born Biscarrosse Petit Prince 5 Tyrosse Côte Sud Capbreton 6 Dax Sud-Adour Dax Berre 7 Dax Sud-Adour Dax Les Pins 8 Mimizan Pays de Born Labouheyre (Groupe Scolaire) 9 Mimizan Pays de Born Mimizan Bourg 10 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan Argenté 11 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan Carboué (Groupe scolaire) 12 Mont de Marsan Haute Landes Mont de Marsan St Jean d'Août (groupe scolaire) 13 Mont de Marsan Sud-Chalosse Montfort Chalosse 14 Mimizan Pays de Born Morcenx Gare 15 Mimizan Pays de Born Parentis Arènes 16 Mont de Marsan Haute Landes Roquefort 17 Tyrosse Côte Sud St Jean de Marsacq 18 Dax Centre Landes St Paul les Dax H. Lavielle 19 Tyrosse Côte Sud Tarnos Poueymidou + Durroty 20 Mont de Marsan Sud-Chalosse Cassen, Gousse,Louer, Onard, St Geours d'Auribat 21 Dax Centre Landes Azur, Messanges, Moliets 22 Dax Centre Landes Laluque, Lesgor, Taller 23 Mont de Marsan Haute-Landes Belis, Brocas, Canenx, Cere, Mailleres 24 Dax Sud-Adour Estibeaux, Mouscardes, Ossages, Tilh 25 Mont de Marsan Haute-Landes Garein, Labrit, Le sen, Vert 26 Mont de Marsan Sud-Chalosse Horsarrieu ,Ste Colombe, Serres Gaston 27 Mont de Marsan Sud-Chalosse Lacrabe, Mant, Monsegur,Morganx, Peyre, Poudenx 28 Tyrosse Cote-Sud Biarrotte, Biaudos, St Laurent de Gosse 29 Dax Sud-Adour Hastingues 30 Mont de Marsan -

LES HÉBERGEMENTS Pour Un Séjour En Immersion Nature Accommodations
LES HÉBERGEMENTS Pour un séjour en immersion nature Accommodations Office de Tourisme 2021 TERRES DE CHALOSSE SOMMAIRE Summary Bienvenue p.2 Welcome Informations p.4 Informations Oui, oui et encore Thermalisme p.6 Thermal cures oui Carte p.7 Map Résidences de tourisme p.8 Tourism residences Hébergement de groupe, hôtels- restaurants p.9 Collective accomodation, hotels and restaurants Camping, aires de camping-car, cabane dans les arbres p.10 Campsite, motorhome areas, tree Bienvenue en Terres de Chalosse house Chambres d'hôtes p.11 Bed and breakfast Welcome in Terres de Chalosse Meublés p.13 Holiday rentals Partenaires p.26 Sponsors OÙ TROUVER TON INFORMATION TOURISTIQUE ? Where to find your tourist information ? Office de Tourisme Bureau d’information touristique L’Office de Tourisme aux thermes Tourism office Tourism office Tourism office at the thermal 55 place Foch 8 rue Vincent Depaul establishment 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 40250 MUGRON 1515 avenue des sources 05 58 98 58 50 07 68 06 47 87 40465 PRECHACQ-LES-BAINS D’avril à juin De septembre à De septembre à Juillet-août* octobre** Juillet-août* De mars à novembre*** juin July-August April to june July-August March to november September to june September to october Lundi Fermé 10h-12h30 Fermé Fermé Pot d’accueil à 16h Monday Closed 14h-17h30 Closed Closed (pastis landais et vin) Mardi 10h-12h30 10h-12h30 Point info de 9h à 12h 15h-17h30 14h-17h30 Tuesday 15h-17h30 14h-17h30 (semaine impaire) Mercredi 10h-12h30 10h-12h30 Fermé Fermé * Du 6 juillet au 24 août 2020 Wednesday 15h-17h30 -

Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110
Commune 40990 Angoumé 40150 Angresse 40320 Arboucave 40110 Arengosse 40700 Argelos 40430 Argelouse 40110 Arjuzanx 40330 Arsague 40190 Arthez-d'Armagnac 40120 Arue 40700 Aubagnan 40400 Audon 40320 Bahus-Soubiran 40700 Bassercles 40360 Bastennes 40320 Bats 40400 Bégaar 40410 Belhade 40120 Bélis 40300 Bélus 40180 Bénesse-lès-Dax 40230 Bénesse-Maremne 40250 Bergouey 40240 Betbezer-d'Armagnac 40370 Beylongue 40700 Beyries 40390 Biarrotte 40170 Bias 40390 Biaudos 40600 Biscarrosse 40330 Bonnegarde 40370 Boos 40270 Bordères-et-Lamensans 40190 Bourdalat 40330 Brassempouy 40320 Buanes 40120 Cachen 40300 Cagnotte 40430 Callen 40090 Campagne 40090 Canenx-et-Réaut 40400 Carcarès-Sainte-Croix 40400 Carcen-Ponson 40380 Cassen 40330 Castel-Sarrazin 40360 Castelnau-Chalosse 40320 Castelnau-Tursan 40700 Castelner 40500 Cauna 40300 Cauneille 40250 Caupenne 40700 Cazalis 40090 Cère 40320 Classun 40320 Clèdes 40210 Commensacq 40360 Donzacq 40500 Dumes 40210 Escource 40290 Estibeaux 40240 Estigarde 40320 Eugénie-les-Bains 40500 Eyres-Moncube 40500 Fargues 40190 Frêche 40350 Gaas 40090 Gaillères 40420 Garein 40180 Garrey 40110 Garrosse 40160 Gastes 40330 Gaujacq 40320 Geaune 40090 Geloux 40380 Gibret 40180 Goos 40990 Gourbera 40465 Gousse 40400 Gouts 40290 Habas 40700 Hagetmau 40300 Hastingues 40190 Hontanx 40700 Horsarrieu 40230 Josse 40700 Labastide-Chalosse 40300 Labatut 40210 Labouheyre 40320 Lacajunte 40700 Lacrabe 40090 Laglorieuse 40240 Lagrange 40250 Lahosse 40465 Laluque 40250 Lamothe 40270 Larrivière-Saint-Savin 40800 Latrille 40320 Lauret 40550 Léon -

Rythmes Scolaires Des Écoles Du Département Des Landes, Rentrée
Rentrée scolaire 2021/2022 Rythmes scolaires des écoles du Département des Landes Libellé RNE Dénomination Rythmes scolaires Commune AIRE-SUR-L'ADOUR 0400442N ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE CLAUDE NOUGARO 4 jours et demi AIRE-SUR-L'ADOUR 0400937B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE F. GIROUD 4 jours et demi AMOU 0400754C ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AMOU 0400761K ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ANGRESSE 0400290Y ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARENGOSSE 0400168R ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARJUZANX 0400170T ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours ARSAGUE 0400294C ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi ARTASSENX 0401008D ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours ARUE 0400533M ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUBAGNAN 0400504F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi AUDIGNON 0400377T ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours et demi AUREILHAN 0400223A ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AURICE 0400378U ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours AZUR 0400346J ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BANOS 0400379V ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BASCONS 0400491S ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BASTENNES 0400297F ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BATS 0400474Y ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE MATERNELLE 4 jours et demi BEGAAR 0400735G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours et demi BELIS 0400523B ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE 4 jours BELUS 0400328P ECOLE PRIMAIRE 4 jours BENESSE-MAREMNE 0400733E ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE M. GENEVOIX 4 jours BENQUET 0400413G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 4 jours BEYLONGUE 0400232K ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 4 jours BIARROTTE -

(EU) 2021/335 of 23 February 2021 Amending the Annex To
25.2.2021 EN Offi cial Jour nal of the European Uni on L 66/5 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2021/335 of 23 February 2021 amending the Annex to Implementing Decision (EU) 2020/1809 concerning certain protective measures in relation to outbreaks of highly pathogenic avian influenza in certain Member States (notified under document C(2021) 1386) (Text with EEA relevance) THE EUROPEAN COMMISSION, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, Having regard to Council Directive 89/662/EEC of 11 December 1989 concerning veterinary checks in intra-Community trade with a view to the completion of the internal market (1), and in particular Article 9(4) thereof, Having regard to Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary checks applicable in intra-Union trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (2), and in particular Article 10(4) thereof, Having regard to Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC (3), and in particular Article 63(4) thereof, Whereas: (1) Commission Implementing Decision (EU) 2020/1809 (4) was adopted following outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in holdings where poultry or other captive birds were kept in certain Member States and the establishment of protection and surveillance zones by those Member States in accordance with Council Directive 2005/94/EC. (2) Implementing Decision (EU) 2020/1809 provides that the protection and surveillance zones established by the Member States listed in the Annex to that Implementing Decision, in accordance with Directive 2005/94/EC, are to comprise at least the areas listed as protection and surveillance zones in that Annex. -

Expédition Gabas
DOSSIER DE PRÉSENTATION Février 2021 Lac du Gabas Lourenties Eslourenties- Daban Expédition Gabas Arrien La première descente en kayak de la rivière pour la dépolluer par Augustin Fabre, Nicolas Hossard, Samuel Lafargue Sedzère Gabaston Association des Riverains du Gabas 2768 route du Cap de Gascogne • 40500 Audignon Contact : [email protected] / 06 82 36 57 87 — Présentation de l’Association des Riverains du Gabas — Saint-Laurent- Bretagne L’Association des Riverains du Gabas est une association de loi 1901 (W402008916, préfecture des Landes) qui a pour objectif de : • Défendre les droits et rappeler les devoirs des propriétaires riverains du Gabas ; • Veiller à la protection de la qualité de l’eau du Gabas et à la biodiversité de la rivière ; Riupeyrous • Prendre ou s’associer à toute initiative visant à valoriser, protéger et défendre le patrimoine fluvial du Gabas (chaussées, moulins, ponts, gués, lavoirs, etc.) ; • Représenter ses membres auprès des pouvoirs publics, institutions et utilisateurs du Gabas. Basée au Moulin Neuf (à Audignon, dans le département des Landes), elle soutient structurellement l’expédition, fournit le matériel et assure la logistique. Escoubès — Présentation des membres de l’équipe — Augustin Fabre Augustin a 17 ans et est en terminale STI2D au lycée Victor Duruy (Mont de Marsan). Il est aussi sapeur-pompier volontaire au centre de Saint-Sever. Passionné de grand air, il fait régulièrement des voyages à vélo ainsi que des randonnées dans les Pyrénées et les Alpes où il passe des heures à contempler la faune et la flore sauvage. Il pratique le paddle ainsi que l’escalade. Il parcourt régulièrement les rives du Gabas où il pêche et promène son chien ! Sévignacq Nicolas Hossard Nicolas a 44 ans. -

Cassen Sous L'ancien Régime
Seconde partie : Cassen sous l’Ancien Régime (1180-1789) 1. Une paroisse millénaire Dans un premier temps, Cassen fut une paroisse qui se constitua probablement à la fin du I er millénaire. Sa voisine, Saint Geours d’Auribat, est citée dès 988, dans l’acte de fondation de l’abbaye de Saint Sever. Cependant, la concentration démographique autour du tertre du cimetière actuel est sans doute beaucoup plus ancienne. La découverte de nombreux tessons de poterie, près de la fontaine du Rousseou, pourrait attester une occupation du sol antique voire protohistorique. Les églises L’église Saint Paul de Cassen apparaît dans la liste des églises du diocèse de Dax établie vers 1180, par l’auteur du Liber Rubeus (le cartulaire de la Cathédrale de Dax). En 1312, dans son testament, Arnaud-Raymond, vicomte de Tartas et seigneur d’Auribat, lègue 30 sols morlans, pour le repos de son âme, à la fabrique de Sent Pau de Cassen . Le premier sanctuaire est incendié par les compagnies huguenotes de Montgomery en août 1569, ainsi que le rapporte Mathieu de Cassiède, marchand natif de Clermont, lors de l’enquête commanditée par l’abbé de Divielle en 1642. L’église reconstruite est consacrée à Saint Pierre bien que la paroisse soit également placée sous le patronage de Saint Clair, dont la source éponyme, qui coulait en contrebas de l’église, derrière la maison du benoît, le Bergeré, accueillait une procession annuelle, le 1 er juin, jour du saint patron, jusqu’aux années 1960. Les pèlerins venaient s’y laver les yeux et demander au saint la guérison des maladies affectant la vue.