Guinee Paaeg Nies Lola-Cch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
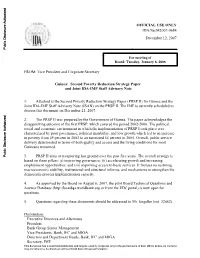
PRSP II) for Guinea and the Public Disclosure Authorized Joint IDA-IMF Staff Advisory Note (JSAN) on the PRSP II
OFFICIAL USE ONLY IDA/SecM2007-0684 December 12, 2007 Public Disclosure Authorized For meeting of Board: Tuesday, January 8, 2008 FROM: Vice President and Corporate Secretary Guinea: Second Poverty Reduction Strategy Paper and Joint IDA-IMF Staff Advisory Note 1. Attached is the Second Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP II) for Guinea and the Public Disclosure Authorized Joint IDA-IMF Staff Advisory Note (JSAN) on the PRSP II. The IMF is currently scheduled to discuss this document on December 21, 2007. 2. The PRSP II was prepared by the Government of Guinea. The paper acknowledges the disappointing outcome of the first PRSP, which covered the period 2002-2006. The political, social and economic environment in which the implementation of PRSP I took place was characterized by poor governance, political instability, and low growth which led to an increase in poverty from 49 percent in 2002 to an estimated 54 percent in 2005. Overall, public service delivery deteriorated in terms of both quality and access and the living conditions for most Guineans worsened. Public Disclosure Authorized 3. PRSP II aims at recapturing lost ground over the past five years. The overall strategy is based on three pillars: (i) improving governance; (ii) accelerating growth and increasing employment opportunities; and (iii) improving access to basic services. It focuses on restoring macroeconomic stability, institutional and structural reforms, and mechanisms to strengthen the democratic process implementation capacity. 4. As approved by the Board on August 6, 2007, the pilot Board Technical Questions and Answer Database (http://boardqa.worldbank.org or from the EDs' portal) is now open for questions. -

Guinea Ebola Response International Organization for Migration
GUINEA EBOLA RESPONSE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION SITUATION REPORT From 9 to 31 May, 2016 First simulation exercise to manage EVD cases at the Point of Entry of Madina Oula, at the border with Sierra Leone. News © IOM Guinea 2016 Between May 9 and 13, IOM, in partnership with On the 12 May, IOM organized a On the 14 May, in partnership with CDC, launched the first simulation exercise to manage groundbreaking ceremony at the Tamaransy International Medical Corps (IMC), IOM EVD cases at the Madina Oula Point of Entry (PoE), at market, a village in Boké Prefecture that was officially launched Community Event-Based the border with Sierra Leone. Between May 22 and heavily affected by EVD. This activity is part of Surveillance (CEBS) in the prefecture of 26, it launched the second simulation exercise at the IOM’s support to the Guinean Government in Kindia. Many prefectural health and PoE of Baala, near Liberia. The main objective of these the socio-economic recovery of Ebola administrative authorities participated in the exercises is to prepare the authorities in charge of the Survivors. ceremony, during which bicycles and two points of entry in detecting, notifying and managing motorcycles were distributed to community any suspected case of potential epidemic disease, health agents and their supervisors. especially EVD cases at their various borders. Epidemiological situation On 29 March 2016, the World Health Organization (WHO) declared the end of EVD in West Africa as a Public Health Emergency of International Concern. In its situation report of 26 May 2016, WHO underlined that the latest notified case in Guinea during the resurgence of Ebola in mid-March was declared Ebola negative for the second time in a row after final testing on 19 April, 2016. -

Interim Report Government of Japan COUNTERING EPIDEMIC-PRONE
Government of Japan COUNTERING EPIDEMIC-PRONE DISEASES ALONG BORDERS AND MIGRATION ROUTE IN GUINEA Interim Report Project Period: 30 March 2016 – 29 March 2017 Reporting Period: 30 March 2016-31 August 2016 Funds: 2.000.000 USD Executing Organization: International Organization for Migration (IOM) Guinea October 2016 Interim Report to Government of Japan COUNTERING EPIDEMIC-PRONE DISEASES ALONG BORDERS AND MIGRATION ROUTES IN GUINEA Project Data Table Executing Organization: International Organization for Migration (IOM) Project Identification and IOM Project Code: MP.0281 Contract Numbers: Contract number: NI/IOM/120 Project Management Site Management Site: Conakry, CO, GUINEA and Relevant Regional Regional Office: Dakar, RO, SENEGAL Office: Project Period: 30 March 2016 – 29 March 2017 Geographical Coverage: Guinea Communal / Sub Prefectural / Prefectural / Regional Health authorities and Project Beneficiaries: Community members in Guinea Ministry of Health, National Health Security Agency, US Agency for international development (USAID), U.S. Office of Foreign Disaster Assistance Project Partner(s): (OFDA), Centre for Disease Control and Prevention (CDC), World Health Organization (WHO), International Medical Corps (IMC), Research triangle institute (RTI), Premieres Urgences (PU) Reporting Period: 30 March 2016 – 31 August 2017 Date of Submission: 30 October 2016 Total Confirmed 2,000,000 USD Funding: Total Funds Received to 2,000,000 USD Date: Total Expenditures: 439,761 USD Headquarters 17 route des Morillons • C.P. 71 • CH-1211 -

Key Considerations: 2021 Outbreak of Ebola in Guinea, the Context of N’Zérékoré
KEY CONSIDERATIONS: 2021 OUTBREAK OF EBOLA IN GUINEA, THE CONTEXT OF N’ZÉRÉKORÉ This brief summarises key considerations about the social, political and economic context shaping the outbreak of Ebola in the N’Zérékoré prefecture, Guinea, as of March 2021. The outbreak was declared on 14 February 2021, two weeks after the death of the first known case, a health agent (Agent Technique de Santé) from Gouécké. Gouécké is located 40km north of N’Zérékoré via the paved Route Nationale 2. The nurse sought care at a health centre in Gouécké, a clinic and then a traditional healer in N’Zérékoré. She died in N’Zérékoré on 28 January.1 When they became sick, the relatives of the first known case referred themselves to N’Zérékoré regional hospital, where the disease was transmitted to healthcare workers. Although the potential for transmission in rural areas of the Gouécké subprefecture was high, to date, most cases have been reported in the urban setting of N’Zérékoré, which is the focus of this brief. At the time of writing (22 March), the total number of cases was 18 (14 confirmed, four probable), with nine deaths and six recoveries. The last new case was reported on 4 March. N’Zérékoré city is the administrative capital of N’Zérékoré prefecture and N’Zérékoré region, and the largest urban centre of the Guinée Forestière area of south-east Guinea. It has an estimated population of 250,000, and is an important commercial, economic and transportation hub connecting Guinée Forestière to neighbouring Sierra Leone, Liberia and Côte d’Ivoire. -

Climate Change Analysis for Guinea Conakry with Homogenized Daily Dataset
CLIMATE CHANGE ANALYSIS FOR GUINEA CONAKRY WITH HOMOGENIZED DAILY DATASET. Abdoul Aziz Barry Dipòsit Legal: T 262-2015 ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs. ADVERTENCIA. El acceso a los contenidos de esta tesis doctoral y su utilización debe respetar los derechos de la persona autora. Puede ser utilizada para consulta o estudio personal, así como en actividades o materiales de investigación y docencia en los términos establecidos en el art. 32 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (RDL 1/1996). Para otros usos se requiere la autorización previa y expresa de la persona autora. En cualquier caso, en la utilización de sus contenidos se deberá indicar de forma clara el nombre y apellidos de la persona autora y el título de la tesis doctoral. -

Ecologically Sensitive Sites in Africa. Volume 1
Ecologically Sites in Africa Volume I: Occidental and Central Africa Benin Cameroon Central African Republic Congo Cdte d'lvoire Eq uatorlil^lllpvea aSon Guinea Complled'by the World Conservation Monitoring Centre For TK^^o^d Bdnk Ecologically Sensitive Sites in Africa Volume I: Occidental and Central Africa WORLD CONSERVATION! MONITORING CENTRE 2 4 MAY 1995 Compiled by PROTECTED AREAS | World Conservation Monitoring Centre Cambridge, UK for The World Bank Washington DC, USA The World Bank 1993 Published by The World Bank, Washington, DC, USA. Prepared by the World Conservation Monitoring Centre (WCMC), 219 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 ODL, UK. WCMC is a joint venture between the three partners who developed The World Conservation Strategy and its successor Caring for the Earth: lUCN-World Conservation Union, UNEP-United Nations Environment Programme, and WWF- World Wide Fund for Nature. Its mission is to provide an information, research and assessment service on the status, security and management of the Earth's biological diversity as the basis for its conservation and sustainable use. Copyright: 1993 The World Bank Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorised without prior permission from the copyright holder. Reproduction for resale or other commercial purposes is prohibited without the prior written permission of the copyright holder. Citation: World Bank (1993). Ecologically Sensitive Sites in Africa. Volume I: Occidental and Central Africa. Compiled by the World Conservation Monitoring Centre for The World Bank, Washington, DC, USA. Printed by: The Burlington Press, Cambridge, UK. Cover illustration: Nairobi City Skyline with Kongoni and Grant's Gazelles, RIM Campbell. -

Page 1 GE.18-20123 (E) 100119 Committee on the Rights of The
United Nations CRC/C/GIN/Q/3-6/Add.1 Convention on the Distr.: General 23 November 2018 Rights of the Child English Original: French English, French and Spanish only Committee on the Rights of the Child Eightieth session 14 January–1 February 2019 Item 4 of the provisional agenda Consideration of reports of States parties List of issues in relation to the combined third to sixth periodic reports of Guinea Addendum Replies of Guinea to the list of issues* [Date received: 16 November 2018] * The present document is being issued without formal editing. GE.18-20123 (E) 100119 CRC/C/GIN/Q/3-6/Add.1 Part One 1. Please indicate whether the necessary steps have been taken to expedite the revision of national legislation, particularly the Children’s Code and the Civil Code, with a view to making it fully compliant with the principles and provisions of the Convention. 1. Necessary measures have been taken in the context of the revision of national legislation, including in relation to the Children’s Code. It has already been considered once by the Council of Ministers; subsequently, an interministerial committee was established to address the concerns of the other departments concerned and the amendments suggested by the Council of Ministers. It was transmitted to the General Secretariat of the Government for consideration, adoption and submission to the National Assembly by the end of 2018. 2. As for the Civil Code, it is already before the National Assembly and its consideration has begun; it is due to be voted on and adopted shortly. -

Invest in Guinea Dear Readers, I Have the Great Honour of Presenting This Guide for International Investors
Invest in Guinea Dear readers, I have the great honour of presenting this guide for international investors. I am convinced that good-quality investors, whether they come from the UK or elsewhere, can play a key role in the future development and prosperity of Guinea and its people. This guide is part of ongoing efforts made by the British Embassy in Guinea to support the Government of Guinea in its objective of attracting quality international investment into the country. Written in close collaboration with the Government of Guinea and stakeholders from the various sectors covered, this guide aims not only to demonstrate the incredible economic opportunities present in Guinea but also to share the country’s commitment to building a stable and prosperous future. While Guinea is considered one of the most important growth areas on the continent due to its geographical diversity and mineral endowment, improvements still need to be made to the investment climate. Several measures have been adopted by President Alpha Condé and his Government to create an attractive environment for investors looking to manage their businesses in a climate of trust and stability. The British Government is encouraging continued efforts in this vein in order to improve Guinea’s business environment. I would like to thank, in particular, all the members of the editorial committee for their valuable contributions and constant availability. HE Graham Styles, Ambassador of the United Kingdom in Guinea 2 Invest in Guinea Table of contents 04 Introduction to Guinea 06 Political and social context 08 Guinean economy 10 Business climate 12 Agriculture 14 Energy 16 Mines 20 Fishing 22 Tourism and Handicrafts 24 Doing business 3 Introduction to Guinea History 7th - 9th century The Baga, Nalu and Landoma people live in the area that is now Guinea. -

Guinea Ebola Response International Organization for Migration
GUINEA EBOLA RESPONSE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION SITUATION REPORT From 9 to 31 May, 2016 First simulation exercise to manage EVD cases at the Point of Entry of Madina Oula, at the border with Sierra Leone. News © IOM Guinea 2016 Between May 9 and 13, IOM, in partnership with On the 12 May, IOM organized a On the 14 May, in partnership with CDC, launched the first simulation exercise to manage groundbreaking ceremony at the Tamaransy International Medical Corps (IMC), IOM EVD cases at the Madina Oula Point of Entry (PoE), at market, a village in Boké Prefecture that was officially launched Community Event-Based the border with Sierra Leone. Between May 22 and heavily affected by EVD. This activity is part of Surveillance (CEBS) in the prefecture of 26, it launched the second simulation exercise at the IOM’s support to the Guinean Government in Kindia. Many prefectural health and PoE of Baala, near Liberia. The main objective of these the socio-economic recovery of Ebola administrative authorities participated in the exercises is to prepare the authorities in charge of the Survivors. ceremony, during which bicycles and two points of entry in detecting, notifying and managing motorcycles were distributed to community any suspected case of potential epidemic disease, health agents and their supervisors. especially EVD cases at their various borders. Epidemiological situation On 29 March 2016, the World Health Organization (WHO) declared the end of EVD in West Africa as a Public Health Emergency of International Concern. In its situation report of 26 May 2016, WHO underlined that the latest notified case in Guinea during the resurgence of Ebola in mid-March was declared Ebola negative for the second time in a row after final testing on 19 April, 2016. -

Guinea, and Liberia
AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP PROJECT: ROAD DEVELOPMENT AND TRANSPORT FACILITATION PROGRAMME WITHIN THE MANO RIVER UNION COUNTRY: COTE D’IVOIRE, GUINEA, AND LIBERIA SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (ESIA) Team Leader J. N. ILBOUDO, Transport Engineer OITC.1 5012 J.B. AGUMA, Transport Economist OITC.1 1956 J. P.M. KALALA , Chief Socio-Economist OITC.1 3561 N. KULEMEKA, Chief Socio-Economist SARC/ONEC.3 8452 L. M. KINANE, Environmentalist ONEC.3 2933 E. NDINYA, Environmentalist SARC/ONEC.3 1541 LRFO/OITC.1 7072 P. TAMBAH, Infrastructure Engineer Team Members Project Malick Soumare, Procurement Specialist ORPF.1/ LRFO Team M. H . SANON , Socio-Economist ONEC-3 Mose Mabe-Koofhethile, Procurement Specialist ORPF.1/ SNFO Sector Division Jean Kizito KABANGUKA OITC1 2143 Manager Sector Director Amadou OUMAROU OITC 3075 Regional Director Franck Joseph PERRAULT ORWA 4046 Director, Regional Janvier K. LITSE ONRI 4047 Integration and Trade 2 SUMMARY ENVIRONMENTAL AND SOCIAL IMPACT ASSESSMENT Project Name : Road Development and Transport Project No.: P-Z1-DB0-103 Facilitation Programme Within the Mano River Union Countries: Côte d’Ivoire, Guinea and Liberia Depart ment : OITC Division: OITC-1 Introduction This document is a Summary of the Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) of the Ivorian section of the Road Development and Transport Facilitation Programme within the Mano River Union. The summary has been prepared in accordance with the guidelines and procedures for environmental and social assessment of the African Development Bank (AfDB) for Category 1 projects, as well as with the policies in force in Guinea. The project description and rationale are presented first, followed by the applicable legal and institutional framework in Guinea. -

“Initiative on Capitalising on Endogenous Capacities for Conflict Prevention and Governance”
“Initiative on capitalising on endogenous capacities for conflict prevention and governance” Volume 2 Compilation of working documents Presented at the Initiative’s launching workshop SAH/D(2005)554 October 2005 1 2 “INITIATIVE ON CAPITALISING ON ENDOGENOUS CAPACITIES FOR CONFLICT PREVENTION AND GOVERNANCE” LAUNCHING WORKSHOP Hôtel Mariador Palace Conakry (Guinea) 9 – 11 March, 2005 Volume 2 Working documents October 2005 The working documents represent the views and analyses of the authors alone. It does not reflect the positions of the SWAC Secretariat or the OECD. "The translations do not replace the original texts. They have been prepared for the sole purpose of facilitating subsequent exchange of views between the English and French-speaking participants of the workshop. 3 4 Table of Contents SESSION 1. « A METHOD OF PREVENTION AND REGULATION IN WEST AFRICA: KINSHIP OF PLEASANTRY » .......................................................................................................................................................... 7 1.1 « Kinship of pleasantry: historical origin, preventative and regulatory role in West Africa » (Djibril Tamsir Niane) ............................................................................................................................... 7 1.2. The "Maat" kinship of pleasantry or the reign of the original model for social harmony (Babacar Sedikh Diouf) ........................................................................................................................... 17 SESSION 2. -

Download Resource
Ignacio Oliver Cruz/WFP/Kinsardou -Sangardo, Kissidougou/2005 Consolidated Appeals Process (CAP) The CAP is much more than an appeal for money. It is an inclusive and coordinated programme cycle of: • strategic planning leading to a Common Humanitarian Action Plan (CHAP); • resource mobilisation (leading to a Consolidated Appeal or a Flash Appeal); • coordinated programme implementation; • joint monitoring and evaluation; • revision, if necessary; and • reporting on results. The CHAP is a strategic plan for humanitarian response in a given country or region and includes the following elements: • a common analysis of the context in which humanitarian action takes place; • an assessment of needs; • best, worst, and most likely scenarios; • stakeholder analysis, i.e. who does what and where; • a clear statement of longer-term objectives and goals; • prioritised response plans; and • a framework for monitoring the strategy and revising it if necessary. The CHAP is the foundation for developing a Consolidated Appeal or, when crises break or natural disasters strike, a Flash Appeal. Under the leadership of the Humanitarian Coordinator, the CHAP is developed at the field level by the Inter-Agency Standing Committee (IASC) Country Team. This team mirrors the IASC structure at headquarters and includes UN agencies and standing invitees, i.e. the International Organization for Migration, the Red Cross and Red Crescent Movement, and NGOs tha t belong to ICVA, Interaction, or SCHR. Non-IASC members, such as national NGOs, can be included, and other key stakeholders in humanitarian action, in particular host governments and donors, should be consulted. The Humanitarian Coordinator is responsible for the annual preparation of the consolidated appeal document .