Informations Et Documents
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
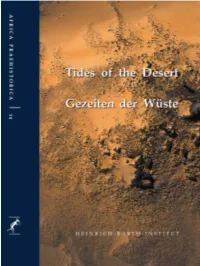
Tides-Of-The-Desert.Pdf
UNIVERSITÄT ZU KÖLN Heinrich -Barth -Institut für Archäologie und Geschichte Afrikas 14 A F R I C A P R A E H I S T O R I C A Monographien zur Archäologie und Umwelt Afrikas Monographs on African Archaeology and Environment Monographies sur l'Archéologie et l'Environnement d'Afrique Herausgegeben von Rudolph Kuper KÖLN 2002 Tides of the Desert – Gezeiten der Wüste Contributions to the Archaeology and Environmental History of Africa in Honour of Rudolph Kuper Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper Edited by Jennerstrasse 8 Jennerstrasse 8 comprises Tilman Lenssen-Erz, Ursula Tegtmeier and Stefan Kröpelin as well as Hubert Berke, Barbara Eichhorn, Michael Herb, Friederike Jesse, Birgit Keding, Karin Kindermann, Jörg Linstädter, Stefanie Nußbaum, Heiko Riemer, Werner Schuck and Ralf Vogelsang HEINRICH-BARTH-INSTITUT © HEINRICH-BARTH - INSTITUT e.V., Köln 2001 Jennerstraße 8, D – 50823 Köln http://www.uni-koeln.de/hbi/ Alle Rechte vorbehalten. Reproduktionen jeglicher Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung. CIP – Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek Tides of the desert : contributions to the archaeolo- gy and environmental history of Africa in honour of Rudolph Kuper = Gezeiten der Wüste : Beiträge zu Archäologie und Umweltgeschichte Afrikas zu Ehren von Rudolph Kuper / Heinrich-Barth-In- stitut. Ed. by Jennerstrasse 8. - Köln : Heinrich- Barth-Inst., 2002 (Africa praehistorica ; 14) ISBN 3-927688-00-2 Printed in Germany Druck: Hans Kock GmbH, Bielefeld Typographisches Konzept: Klaus Kodalle Digitale Bildbearbeitung: Jörg Lindenbeck Satz und Layout: Ursula Tegtmeier Titelgestaltung: Marie-Theres Erz Redaktion: Jennerstrasse 8 Gesetzt in Palatino ISSN 0947-2673 Contents Prolog Jennerstrasse 8 – The Editors Eine Festschrift für Rudolph Kuper.......................... -

Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond
“Long-range desert travel by donkey or camel was a daring venture in the ancient world, and losing your way could prove just as fatal as losing your waterskin ...” Recent exploration has revealed an amazing network of ancient roads and paths crossing the forbidding Saharan desert. This evidence broadens scientific horizons and launches a fascinating new field of archaeological research. Frank Förster & Heiko Riemer (eds.) Desert Road Archaeology in Ancient Egypt and Beyond AFRICA PRAEHISTORICA 27 Köln: Heinrich-Barth-Institut, 2013 584 pages, hardcover and half-linen-bound ISBN 978-3-927688-41-4 Price 78.- Euro, plus package and postage order from our www.hbi-ev.uni-koeln.debookshop Foreword by Steven E. Sidebotham Introduction Heiko Riemer & Frank Förster Ancient desert roads: Towards establishing Stan Hendrickx, Frank Förster & Merel Eyckerman The Pharaonic potery of a new field of archaeological research the Abu Ballas Trail: ‘Filling stations’ along a desert highway Methods, approaches, and historical perspectives András Zboray Prehistoric trails in the environs of Karkur Talh, Jebel Uweinat Olaf Bubenzer & Andreas Bolten Top down: New satellite data and ground- truth data as base for a reconstruction of ancient caravan routes. Exam- Heinz-Josef Thissen Donkeys and water: Demotic ostraca in Cologne as ples from the Western Desert of Egypt evidence of desert travel between Oxyrhynchos and Bahariya Oasis Heiko Riemer Lessons in landscape learning: The dawn of long-distance Per Storemyr, Elizabeth Bloxam, Tom Heldal & Adel Kelany Ancient desert travel and navigation in Egypt’s Western Desert from prehistoric to Old and quarry roads on the west bank of the Nile in the First Cataract region Kingdom times Angelika Lohwasser Tracks in the Bayuda desert. -

Flag 60 Report Libyan Desert Expedition April 25, 2012
THE EXPLORERS CLUB FLAG 60 REPORT Archaeological Exploration of the Libyan Desert, Egypt nd th April 2 2012 –April 25 , 2012 Site QMM14 “Gara Marai Watchtower” Photo Credit: Sam Watson FRGS Robert J. Atwater, FRGS, LF’05 and Jason Paterniti, FRGS, MN’10 Contents: Contents: .......................................................................................................................................................................................... 2 Summary: .......................................................................................................................................................................................... 2 Introduction & Background .............................................................................................................................................................. 3 Habitation, Climate Change and Migration ...................................................................................................................................... 4 Expedition Objectives: ...................................................................................................................................................................... 7 Expedition Members & Areas of Responsibility: ............................................................................................................................... 7 Methods: ......................................................................................................................................................................................... -

WADI SURA Field Report Season 2010
WADI SURA Field Report 3 Season 2010 “Wadi Sura” is a joint archaeological project of University of Cologne (UoC), Institute of Prehistoric Archaeology and Heinrich-Barth-Institut e.V. (HBI) Cologne University of Applied Sciences (CUAS) Cologne Institute for Conservation Sciences (CICS) Deutsches Archäologisches Institut (DAI), Cairo Department Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Cooperation and support: Egyptian Supreme Council of Antiquities (SCA) Egyptian Environmental Affairs Agency (EEAA) Nature Conservation Sector (NCS) Z+F | 3D Laserscanning Zoller+Fröhlich GmbH onefile database + internet application development Reinhold Goss, Cologne www.onefile.de Claudia Gornik Kommunikationsdesign, Cologne www.fun-k.de Kunstwerkfotograf, Jürgen Seidel, Bonn, www.kunstwerkfotograf.de Report on the third field season of the Wadi Sura Project (Gilf Kebir, SW Egypt) in spring 2010 Rudolph Kuper, Hans Leisen, Heiko Riemer, Frank Förster, Sabine Krause & Jürgen Seidel 1. Introduction With the third field campaign in spring 2010, the “Wadi Sura Project” continued the archaeological and conservation studies at Wadi Sura in Egypt’s Southwest (Fig. 1). The project which started in 2009 is a joint archaeological mission of the University of Cologne, the Cologne University of Applied Sciences, and the German Archaeological Institute in Cairo, financed by the German Research Council (DFG). The third field campaign of the Wadi Sura Project took place from March 18 until April 28, 2010. Except for a short break for provisioning, the expedition camp was based at Wadi Sura II (“Cave of beasts”). Field work was continued in the Wadi Sura II shelter by the rock art recording and conservation teams, while the survey team explored the eastern part of the survey area under investigation. -

The Nubia Sandstone Nubia Group , Western Desert, Egypt An
International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Volume 5 Issue 3, March-April 2021 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 The Nubia Sandstone (Nubia Group), Western Desert, Egypt: An Overview Khaled Abdel-Kader Ouda Professor Emeritus of Geology, Geology Department, Faculty of Science, Assiut University, Assiut, Egypt ABSTRACT How to cite this paper : Khaled Abdel- No information was given about the outcropping of the Nubia sandstone in the Kader Ouda "The Nubia Sandstone (Nubia Great Sand Sea in the Western Desert of Egypt and actually very scarce and Group), Western Desert, Egypt: An insufficient information has been written on the geology of the Great Sand Sea. Overview" Published Since 1931 the Great Sand Sea has been described as being formed of many in International parallel longitudinal sand dunes which cover ~72000 km² and are bounded in Journal of Trend in the south by the Gilf El Kebir Nubia Sandstone Plateau and in the north by Scientific Research Siwa Oasis. However, recently it has been found by the author and his and Development collaborators that the rock units exposed on surface in the Great Sand Sea are (ijtsrd), ISSN: 2456- belonging to the younger members of the fluviatile Cretaceous Nubia 6470, Volume-5 | IJTSRD38760 Sandstone Group. They are not covered by younger marine consolidated Issue-3, April 2021, deposits but only with a thin veneer of accumulations of free sands originating pp.274-292, URL: from the disintegration and breakdown of the Nubia Sandstone bedrock, thus www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd38760.pdf obscuring the original bedrock. -

Print This Article
Journal of Ancient Egyptian Interconnections Egypt and the Chad: Some Additional Remarks omas Schneider University of British Columbia A !! This article is an addendum to the contribution published by the author in JAEI 2:4 (2010). It draws attention to the importance of research on the connection between Egypt and the Chad region with regard to observations made on shared linguistic features, and the recent hypothesis that rock drawings at Gilf Kebir display possible precursors to Egyptian religious concepts. Also published here is a way marker discovered in the 1990s on the proposed trajectory of the prolonged Abu Ballas trail into the Chad Basin. ince the publication, in the 2010 volume of this journal, 1 sors of Ancient Egyptian concepts, 4 an argument similar to the of “The West beyond the West: The Mysterious one advocated by Toby Wilkinson concerning the rock draw - ‘Wernes’ of the Egyptian Underworld and the Chad ings of the Eastern Desert. 5 The latter hypothesis has been met S 6 Palaeolakes,” additional evidence has been brought to my with much skepticism. The scene reproduced here is from the attention that may further contribute to our understanding of Foggini- Mestekawi Cave (or Cave of the Beasts, discovered in the interconnections between the two regions. 2002 at the Gilf Kebir) and would, according to Barta, prefig - ure the Classical Egyptian concept of the separation of Geb A" # and Nut, Earth and the Sky. While it is likely that the deserts of Egypt and the prehistoric populations that lived there con - The German desert traveler Carlo Bergmann (who has tributed to what much later became Ancient Egypt, projecting pioneered the exploration of Egypt’s Western Desert and dis - later concepts back over the millennia to drawings whose date, covered, in 1999 and 2000, the Abu Ballas trail and several of authors, and significance are otherwise unclear seems to call its way stations 2) has kindly informed me of the existence of a for much further debate. -

Humanities Through the Ages
Edition 18 | Number 1 | August 2016 E ras Humanities Through the Ages Editorial London Under Danish Rule: Cnut’s Politics and Policies as a Demonstration of Power Matthew Firth Marx’s Concept of Class and the Athenian Polis Michael Lazarus Ned Kelly’s Last Words: “Ah, Well, I Suppose” Stuart E. Dawson Ideological Cynicism in the Modern Information Age with Sloterdijk and Z3i45e1 Liyan Gao Reviews Table of Contents Edition 18 Number 1 Editorial i London Under Danish Rule: Cnut’s Politics and Policies as a 1-20 Demonstration of Power Matthew Firth Marx’s Concept of Class and the Athenian Polis 21-37 Michael Lazarus Ned Kelly’s Last Words: “Ah, Well, I Suppose” 38-50 Stuart Dawson Ideological Cynicism in the Modern Information Age with Sloterdijk and 51-65 Žižek Liyan Gao Reviews 66-78 Editorial Eras was founded in 2001 with the intention of facilitating interdisciplinary dialogue between postgraduate and early career researchers working across all areas of history, archaeology, theology and Jewish Civilisation. In 2010 our scope further expanded to include the disciplines of international studies and philosophy, particularly when such work also contains significant historical content. In 2014, the layout underwent significant redesign under the editorial auspices of Julian Koplin. The redesign is reflected in this current edition, and has helped to transform Eras into a more accessible publication. Matthew Firth’s contribution offers a consideration and reflection of Cnut the Great’s siege of London during the millennial year of this event. Firth discusses the initial unsuccessful outcome of the siege by a defiant London population, and how Cnut had to shape a unique policy towards this important city as part of his Anglo- Scandinavian Empire. -

On the Origins and Dissemination of Domesticated Sorghum and Pearl Millet Across Africa and Into India: a View from the Butana Group of the Far Eastern Sahel
Afr Archaeol Rev (2018) 35:483–505 https://doi.org/10.1007/s10437-018-9314-2 REVIEW ARTICLE On the Origins and Dissemination of Domesticated Sorghum and Pearl Millet across Africa and into India: a View from the Butana Group of the Far Eastern Sahel Frank Winchell & Michael Brass & Andrea Manzo & Alemseged Beldados & Valentina Perna & Charlene Murphy & Chris Stevens & Dorian Q. Fuller Published online: 10 November 2018 # The Author(s) 2018 Abstract Four decades have passed since Harlan and than 1000 years according to present data. Here, we Stemler (1976) proposed the eastern Sahelian zone as review the middle Holocene Sudanese archaeological the most likely center of Sorghum bicolor domestica- data for the first time, to situate the origins and spread of tion. Recently, new data on seed impressions on Butana these two native summer rainfall cereals in what is Group pottery, from the fourth millennium BC in the proposed to be their eastern Sahelian Sudan gateway southern Atbai region of the far eastern Sahelian Belt in to the Red Sea and the Indian Ocean trade. Africa, show evidence for cultivation activities of sor- ghum displaying some domestication traits. Pennisetum Résumé Quatre décennies se sont écoulées depuis que glaucum may have been undergoing domestication Harlan et Stemler ont proposé la zone sahélienne shortly thereafter in the western Sahel, as finds of fully orientale comme le centre le plus probable de la domes- domesticated pearl millet are present in southeastern tication du sorgho bicolore. Récemment, de nouvelles Mali by the second half of the third millennium BC, données sur les impressions de semences sur les poteries and present in eastern Sudan by the early second mil- du groupe Butana du IVe millénaire avant JC dans la lennium BC. -
Book Reviews
Book Reviews Der Abu Ballas-Weg. Eine pharaonische Karawanenroute durch die Libysche Wüste Frank Förster Africa Praehistorica 28, Köln 2015; Hardcover; 620 pages; 376 figures; 23 tables; RRP €78; ISBN 978-3-927688-42-1. This book is the culmination of extensive research into the Pharaonic caravan route through the Egyptian Western Desert, the so-called Abu Ballas Trail. The resulting monograph stems from Förster‘s PhD thesis completed at the University of Cologne in 2011. The analysis of material in this well-written tome is based on archaeological investigations carried out under the auspices of the Cooperative Research Centre 389 ACACIA project at the University of Cologne. After an introduction that covers the research history of the Abu Ballas Trail and the notable contributions Carlo Bergmann, the book delves into a lengthy tripartite discussion and analysis of the finds, use and purpose, and historical considerations of the trail. The first part presents an analysis and interpretation of the findings from the archaeological investigations. The dominant chapter of this part involves an excellent outline of the ceramics, rock-cut engravings, and unique finds from the archaeological investigations. The evaluation of this material has led to the notion that the caravan route was used episodically, covering a distance of about 400 km from Dakhleh Oasis to the Gilf Kebir Plateau. It has been suggested that it may also extend towards Djebel Ouenat, the nearest water source to the end of the trail. While the trail may have originated out of Dakhleh Oasis, the location of its final destination is not certain, with Förster suggesting a terminus in the sub-Saharan region of the north-west Sudan. -

More Corridors to Africa
More Corridors to Africa STEFAN KRÖPELIN AND RUDOLPH KUPER1 1After the end of the early and mid-Holocene governors of Aswan such as Harkhuf “the first wet phase, which had turned the Eastern Sahara Africa explorers”.4 into a savannah-like environment until about Only during the last six years new archaeo- 5 000 BC,2 the region has been regarded as logical evidence from desert sites has allowed to deserted as it is today. This situation, which Ralph sketch a new picture of Ancient Egypt’s relation Bagnold accurately described as “By Egyptian to the vast western regions. In contrast to the standards there was no water west of the oases Eastern Desert, the role of which is documen- and the world ended”,3 applies to Egypt’s atti- ted in many records of the Nile valley as well as tude towards her “Western Desert” since ancient from the spot, the Western Desert can hardly be times. It also highlights the little attention that traced in hieroglyphic texts. Except for the expe- Egyptology has paid to the region until recently ditions by Harkhuf who during the 6th dynasty and James Breasted’s notion calling Old Kingdom took the “oases way” to reach “Yam”, most likely through Kharga and Dakhla oases, the only proof 1. S. K. acknowledges the company of Abdel Rahman of Egypt’s presence in the deeper desert was the El Sheikh of the Geological Research Authority of Sudan (GRAS), Bernd and Antje Meissner and Markus Richter pottery dump of Abu Ballas.5 Discovered by John (Remote Sensing Department, Technische Fachhochschule Ball as early as 1918,6 it has been acknowledged Berlin), geographer Sven Oehm (SFB 389 / ACACIA), geologist Robert Bussert and botanist Reinhard Bornkamm by Egyptologists not more than marginally. -

Non-Impact Origin of the Crater Field in the Gilf Kebir Region (Sw Egypt)
NON-IMPACT ORIGIN OF THE CRATER FIELD IN THE GILF KEBIR REGION (SW EGYPT) M. Di Martino(1), L. Orti (2,3), L. Matassoni (2,3), M. Morelli (2,3), R. Serra (4), A. Buzzigoli (5) (1) INAF – Osservatorio Astronomico di Torino, 10025 Pino Torinese (Italy) (2) Museo di Scienze Planetarie, via Galcianese 20/H, 59100 Prato (Italy) (3) Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, via La Pira 4, 50121 Firenze (Italy) (4) Dipartimento di Fisica, Università di Bologna, via Irnerio 46, 40126 Bologna, (Italy) (5) Laboratorio di Geofisica Applicata–Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Firenze, Via S. Marta 3, 50139 Firenze, (Italy) ABSTRACT The present study is the result of the fieldwork carried out during a geologic expedition in the Gilf Kebir region (SW Egypt), where a large number of crater-like forms are present. It has been suggested that they could be the result of a meteoritic impact (impact breccia, shatter cones and planar fractures in quartz has been identified) or, as alternative hypothesis, a hydrothermal vent complex. From the data collected in the field and the results of the preliminary geological, petrographical and geophysical investigations, we can state that there are no evidences supporting the impact origin of the circular structures in Gilf Kebir region. As alternative hypothesis, an hydrothermal origin is suggested. 1. INTRODUCTION Fig. 1. Satellite image of the South-Western desert of In the South-Western Egyptian desert an impressive Egypt and Gilf Kebir Crater Field area number of roughly circular, subordinately elliptical, 2 structures is present, covering more than 30.000 km , East of Gilf Kebir plateau. -

Control Posts and Navigation System of the Pharaonic Abu Ballas Trail
Cooperative Research Centre 389 University of Cologne Control posts and navigation system of the Pharaonic Abu Ballas Trail Control posts and navigation system of the Pharaonic Abu Ballas Trail Heiko Riemer (Cologne, 2006) 1. FOCUS OF RESEARCH The so-called Abu Ballas Trail is the 400 km long pharaonic road through the Western Desert of Egypt which starts at Balat in Dakhla Oasis (the former Old Kingdom town of Ayn Aseel) and continues to the Gilf Kebir Plateau (Kuper 2001; 2003; Förster in press). It is named after the pottery hill of Abu Ballas that had already been discovered in 1918 half way to the Gilf Kebir. Since 1999 a large number of new road stations and pottery dumps have been discovered by the modern camel nomad C. Bergmann along the trail. Consequently, the Trail was the subject of a number of ACACIA cam- paigns during the following years, and the examination of the pottery indicated that the trail was installed and used dur- ing the Old Kingdom (6th Dynasty / First Intermediate Period), and re-used during the New Kingdom, while traces of the Roman period are very rare. By far the largest number of sites along the trail date back to the Old Kingdom. The field activities during the last years mainly focussed on the excavation of the large pottery dumps, such as Abu Ballas (site 85/55), Jaqub (99/30), and others which yielded several dozens of large Old Kingdom storage jars that were most likely used as water dumps for the donkeys. The main objectives of the recent field campaign were: the survey and excavation of a number of smaller Old Kingdom stations placed between the large pottery dumps, and the survey and documentation of the road signs (Alamat) and donkey paths which connect the individual stations (Riemer in press).