Document Dtobjectifs Du Site Natura 2000 Fr2410002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Commune Du Bassin Loire-Bretagne
Commune du bassin Loire-Bretagne n° Région département Département Nom commune Code INSEE AUVERGNE 03 ALLIER ABREST 03001 AUVERGNE 03 ALLIER AGONGES 03002 AUVERGNE 03 ALLIER AINAY-LE-CHATEAU 03003 AUVERGNE 03 ALLIER ANDELAROCHE 03004 AUVERGNE 03 ALLIER ARCHIGNAT 03005 AUVERGNE 03 ALLIER ARFEUILLES 03006 AUVERGNE 03 ALLIER ARPHEUILLES-SAINT-PRIEST 03007 AUVERGNE 03 ALLIER ARRONNES 03008 AUVERGNE 03 ALLIER AUBIGNY 03009 AUVERGNE 03 ALLIER AUDES 03010 AUVERGNE 03 ALLIER AUROUER 03011 AUVERGNE 03 ALLIER AUTRY-ISSARDS 03012 AUVERGNE 03 ALLIER AVERMES 03013 AUVERGNE 03 ALLIER AVRILLY 03014 AUVERGNE 03 ALLIER BAGNEUX 03015 AUVERGNE 03 ALLIER BARBERIER 03016 AUVERGNE 03 ALLIER BARRAIS-BUSSOLLES 03017 AUVERGNE 03 ALLIER BAYET 03018 AUVERGNE 03 ALLIER BEAULON 03019 AUVERGNE 03 ALLIER BEAUNE-D'ALLIER 03020 AUVERGNE 03 ALLIER BEGUES 03021 AUVERGNE 03 ALLIER BELLENAVES 03022 AUVERGNE 03 ALLIER BELLERIVE-SUR-ALLIER 03023 AUVERGNE 03 ALLIER BERT 03024 AUVERGNE 03 ALLIER BESSAY-SUR-ALLIER 03025 AUVERGNE 03 ALLIER BESSON 03026 AUVERGNE 03 ALLIER BEZENET 03027 AUVERGNE 03 ALLIER BILLEZOIS 03028 AUVERGNE 03 ALLIER BILLY 03029 AUVERGNE 03 ALLIER BIOZAT 03030 AUVERGNE 03 ALLIER BIZENEUILLE 03031 AUVERGNE 03 ALLIER BLOMARD 03032 AUVERGNE 03 ALLIER BOST 03033 AUVERGNE 03 ALLIER BOUCE 03034 AUVERGNE 03 ALLIER LE BOUCHAUD 03035 AUVERGNE 03 ALLIER BOURBON-L'ARCHAMBAULT 03036 AUVERGNE 03 ALLIER BRAIZE 03037 AUVERGNE 03 ALLIER BRANSAT 03038 AUVERGNE 03 ALLIER BRESNAY 03039 AUVERGNE 03 ALLIER BRESSOLLES 03040 AUVERGNE 03 ALLIER LE BRETHON 03041 AUVERGNE 03 ALLIER -
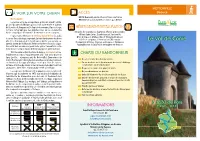
Le Val De Conie
NOTTONVILLE À VOIR SUR VOTRE CHEMIN ACCÈS Beauce RN 10 Bonneval, puis D 27 vers Villiers-Saint-Orien Nottonville RN 10 Châteaudun, D 927 vers Varize, puis D 123 Le secteur est riche en sépultures, polissoirs et petit outilla- ge de l’époque néolithique : polissoir de Saint-Pierre et dolmen dit le palais de Gargantua. De la période romaine, il ne reste que HÉBERGEMENT/RESTAURATION la trace cartographique des grandes voies qui se croisaient à Varize et quelques découvertes de monnaies en or et argent. Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à Nottonville, Villiers-Saint-Orien, Courbehaye et Sancheville L’église Sainte-Christine de Villiers-Saint-Orien fut, jadis, Gîtes d’étapes à Châteaudun et Trizay-lès-Bonneval le centre d’un pèlerinage important. La baie flamboyante du chevet Hôtels et campings à Bonneval et Châteaudun Le val de Conie plat et les deux portails de la façade ouest, abrités sous un large ca- Restaurants à Varize, Orgères-en-Beauce et Terminiers quetoir, datent de l’édifice des XVème et XVIème siècles. Le caque- Ravitaillement à Sancheville et Orgères-en-Beauce toir sert d’abri aux réunions paroissiales qui se tiennent à la sortie de la messe. Il servira ensuite d’abri pour papoter après la messe. Trait de verdure dans la plaine de Beauce, la Conie n’est vé- CHARTE DU RANDONNEUR ritablement un cours d’eau permanent qu’à l’aval de la Goure de Spoy (gouffre – résurgence près de Nottonville). L’importance du marais fluctue selon des règles non élucidées sur plusieurs années, Ne pas s’écarter des chemins balisés en fonction de la nappe phréatique et très peu selon les saisons. -

Bulletin Municipal Guillonville 2021
Commune de Guillonville Bulletin Municipal 2021 1 Sommaire Le mot du maire .................................................. page 3 L’équipe municipale ............................................... page 4 Informations communales et état civil ............................... page 5 Informations utiles ................................................ page 8 Budget et compte administratif .................................... page 11 Flash-back sur l’année 2020 ..................................... page 13 Travaux réalisés et à venir ........................................ page 15 A la rencontre de nos producteurs locaux ........................... page 16 Les associations de la commune ................................... page 19 Calendrier prévisionnel des manifestations 2021 ................... page 23 Informations pratiques ............................................ page 24 Du côté de la Communauté de Communes Cœur de Beauce ..........page 27 2 Le mot du Maire Voici que 2020 se termine, année qui restera dans nos mémoires étant donné les conditions particulières que nous avons vécues : les 2 confinements, les manifestations festives annulées et tant d’autres… En ce début d’année 2021 je tiens, par ce tout premier « mot du maire » et avec l’ensemble du conseil, particulièrement à vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée lors des élections municipales du printemps dernier. Nous mettrons tout en œuvre pour vous satisfaire et faire que notre commune de Guillonville continue de vivre sereinement avec ses projets. Je -

LISTE DES DEMANDES SOUMISES a PUBLICITÉ Du 16 Février Au 14 Mai 2018
PRÉFET D’EURE-ET-LOIR Contact : BRAULT Christelle Direction Départementale des Territoires Tél : 02.37.20.40.45 Service Économie Agricole Ou 02.37.20.50.05 17 place de la République – CS 40517 Courriel : [email protected] 28008 CHARTRES cedex [email protected] LISTE DES DEMANDES SOUMISES A PUBLICITÉ du 16 février au 14 mai 2018 En application de l’article R331-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la DDT est chargée de faire procéder à la publicité des demandes soumises à autorisation préalable d’exploiter au titre du contrôle des structures. Date limite de dépôt des Date accusé N° dossier Demandeur dossiers Commune Superficie Propriétaire réception concurrents en DDT GAEC BOULLET 18.28.059 16/02/18 16/05/18 COMBRES 0 ha 65 M. et Mme PERCHE (BOULLET Mickaël et Brigitte) 17.28.378 SARL FERME DU MESNIL 20/02/18 20/05/18 BOISSY LES PERCHE 03 ha 06 a 08 Consorts TRAISNEL LA BOURDINIERE 17 ha 01 a 90 MARCHAND Guy SAINT-LOUP 11 ha 17 a 60 GEFFROY Philippe 11 ha 12 a 20 GEFFROY Paulette 11 ha 47 PERCHERON Bénédicte FAINS LA FOLIE 14 ha 80 MARCHON Thierry 26 ha 54 a 30 MARCHON Louis 13 ha 74 a 80 MAROTTE Françoise 18.28.060 BOULLAY Gwendoline 21/02/18 21/05/18 23 ha 25 a 70 Indivision JACQUEMIN / POPOT 01 ha 21 a 80 Commune de BOUVILLE 0 ha 68 a 44 Commune de MESLAY LE VIDAME MESLAY LE VIDAME 18 ha 99 a 70 MARCHAND Jacqueline 01 ha 76 a 58 LOISEKAY Ghislaine 63 ha 27 a 80 MARCHAND Guy 0 ha 72 a 03 MARCHAND Jacqueline VITRAY EN BEAUCE 0 ha 91 a 01 HURAULT Alain 38 ha 39 a 30 MARCHAND Guy Page 1 Date limite de -

DIMANCHE 11 Octobre 2020 46Ème Sortie RETROCHAP Rallye Des Châtaignes
DIMANCHE 11 octobre 2020 46ème sortie RETROCHAP Rallye des Châtaignes RETROCHAP organise sa 46ème sortie promenade le dimanche 11 octobre. Nous vous donnons RDV dès 7H45 Parking de l’Espace Béraire à La Chapelle Saint Mesmin pour l'accueil café viennoiseries, remise du carnet de route. Au total nous ferons environ 180 km lors de cette sortie - 90 km le matin et 90 km l'après midi. A 8H15 précises, nous prendrons la direction de VILLEBON dans l'Eure et Loir par Chaingy, Huisseau, Rozières en Beauce, St Péravy, Patay, Cormainville, Sancheville, Guignonville, Mignières, Chauffours. Nous ferons un Arrêt au village fantôme d’ORROUER. Nous nous dirigerons ensuite vers ILLIERS-COMBRAY, village d'enfance de l'écrivain Marcel PROUST où nous visiterons l'église St Jacques, située face au restaurant "La Madeleine d' Illiers " où nous prendrons notre déjeuner. Nous rejoindrons ensuite le château de VILLEBON où nous serons accueillis par M. et Mme Jean de La RAUDIERE qui nous feront visiter leur demeure. Le chemin du retour nous permettra d’emprunter des petites routes entre Loir et Ozanne. Nous ferons (si possible) un arrêt à la Chèvrerie de l'Abbaye de NOTTONVILLE sur la commune de LE BOIS avant de revenir à La Chapelle pour le pot de l'amitié. Nous sommes persuadés que vous passerez une excellente journée dans une ambiance très conviviale à l’occasion de notre 46ème sortie. Le parcours est remarquable. Inscription jusqu’au mercredi 30 septembre Chèque à l’ordre de RETROCHAP à faire parvenir avec votre bulletin à l'adresse ci après : ADAMCZYK Raymond/RETROCHAP -

Teneurs En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées En 2017
LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES en Eure-et-Loir en 2017 La représentation cartographique ! Atrazine déséthyl est basée sur les unités de Guainville Gilles ! Atrazine déséthyl déisopropyl distribution (UDI). Une UDI Le Mesnil Simon correspond à un secteur où La Chaussée d'Ivry l’eau est de qualité homogène, Oulins Anet Saint-Ouen Boncourt géré par un même exploitant Saussay Marchefroy Berchères et appartenant à une même Sorel Rouvres sur-Vesgre Moussel Saint Lubin-de-la entité administrative, ce qui peut Haye amener à partager une commune Abondant Bû ! Atrazine déséthyl Havelu Guainville en plusieurs UDI. Marchezais Gilles Montreuil Serville Goussainville ! Atrazine déséthyl déisopropyl Saint Ver t- en Cherisy Le Mesnil Dampierre Lubin-des Saint-Rémy Drouais Broué Bérou-la sur-Avre Dreu x Simon sur Joncherets Sainte Germainville Mulotière Boissy La Chaussée Avre Louvilliers Gemme La Chapelle Boutigny en-Drouais d'Ivry Prudemanche en-Drouais Moronval Mézières Forainvilliers Prouais Montigny Revercourt Oulins Escorpain Allainville Luray en-Drouais Rueil sur-Avre Vernouillet Anet Saint-Ouen Saint-Lubin Garancières Boncourt Marchefroy la-Gadelière Fessanvilliers ÉcluzellesSaussayOuerre Les Pinthières Mattanvilliers de-Cravant Laons en-Drouais Berchères Garnay Charpont Saint Brezolles Châtaincourt Sorel RouvresLaurent-la sur-Vesgre Boissy-lès Crécy Croisilles MarvilleMoussel Gâtine FaverollesSaint Perche Beauche Couvé Tréon Crucey Moutiers Villemeux Lubin-de-la Rohaire Villages sur-Eure Bréchamps Haye Les Châtelets -

Eure-Et-Loir
Dernier rafraichissement le 02/10/21 Liste des entreprises de transport routier de MARCHANDISES immatriculées au registre national Pour effectuer une recherche d'entreprise (ou de commune), pressez et maintenez la touche "Ctrl" tout en appuyant sur la touche "F". Saisissez alors tout ou partie du mot recherché. *LTI : Licence Transport Intérieur **LC : Licence Communautaire EURE ET LOIR Date de Date de Nombre Date de Date de Nombre Code Siège Gestionnaire Numéro début de fin de de copies Numéro début de fin de de copies SIRET Raison sociale Catégorie juridique Commune Postal (O/N) de transport LTI* validité validité LTI LC** validité validité LC LTI LTI valides LC LC valides GARY 2021 24 84860209000021 2D TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) 28630 SOURS O 18/06/2021 31/07/2022 11 0 DIAFARA 0000361 49063239500011 3 T TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée 28630 MORANCEZ O TESSON TEDDY 2016 24 0 23/06/2016 22/06/2026 3 MICHEL JEAN- 0000285 JACQUES 49063239500029 3 T TRANSPORTS Autre société à responsabilité limitée 28360 MESLAY-LE-VIDAME N ARAIBI EPSE AHMED 2020 24 82798429500010 A2C TRANSPORT Société par actions simplifiée (SAS) 28300 SAINT-PREST O 01/03/2020 28/02/2025 29 0 CHAOUCH 0000057 ZAHRA CHANDOUL 2021 24 79460648300020 AAD28 SARL unipersonnelle 28000 CHARTRES O 01/08/2021 31/07/2022 4 0 ABDERRAOUF 0000439 SAUNIER PATRICK 2016 24 51203542900012 A C D T Société par actions simplifiée (SAS) 28310 SANTILLY O 0 28/06/2016 27/06/2026 7 JEAN 0000338 CHRISTIAN HENRI CHARLOTTE 2021 24 87857866500019 ACTION TRANSPORTS -

CHAMP D'application DU VERSEMENT TRANSPORT (Art
CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) SMCTCEL IDENTIFIANT N° 9312801 CODE CODE DATE URSSAF COMMUNE(S) CONCERNEE(S) TAUX INSEE POSTAL D’EFFET - ARDELU 28009 28700 - AUNAY-SOUS-AUNEAU 28013 28700 - AUNEAU 28015 28708 - BAIGNEAUX 28019 28140 - BAILLEAU-ARMENONVILLE 28023 28320 - BAILLEAU-LE-PIN 28021 28120 - BARMAINVILLE 28025 28310 - BAUDREVILLE 28026 28310 - BAZOCHES-EN-DUNOIS 28028 28140 - BAZOCHES-LES-HAUTES 28029 28140 - BEAUVILLIERS 28032 28150 - BEVILLE-LE-COMTE 28039 28700 - BILLANCELLES 28040 28190 - BOISGASSON 28044 28220 - BOUTIGNY-PROUAIS 28056 28410 - BOUVILLE 28057 28800 - BRECHAMPS 28058 28210 0,50 % 01/01/2014 CENTRE - CERNAY 28067 28120 - CHAMPAGNE 28069 28410 - CHARONVILLE 28081 28120 - CHATENAY 28092 28700 - CHAUDON 28094 28210 - CHUISNES 28099 28190 - CORMAINVILLE 28108 28140 - COULOMBS 28113 28210 - COURVILLE-SUR-EURE 28116 28190 - CROISILLES 28118 28210 - DAMBRON 28121 28140 - DROUE-SUR-DROUETTE 28135 28230 - ECROSNES 28137 28320 - EPEAUTROLLES 28139 28120 - EPERNON 28140 28237 - ERMENONVILLE-LA-PETITE 28142 28120 - FAVEROLLES 28146 28210 - FONTAINE-LA-GUYON 28154 28190 - FRESNAY-L’EVEQUE 28164 28310 - FRIAIZE 28166 28240 - FRUNCE 28167 28190 - GALLARDON 28168 28320 - GARANCIERES-EN-BEAUCE 28169 28700 - GAS 28172 28320 - GOMMERVILLE 28183 28310 - GOUILLONS 28184 28310 - GOUSSAINVILLE 28185 28410 - GUILLEVILLE 28189 28310 - GUILLONVILLE 28190 28140 - HANCHES 28191 28130 -- HAVELU 28193 28410 - INTREVILLE 28197 28310 - LA CHAPELLE-D AUNAINVILLE -

La Synthèse De Llétat Initial De Llenvironnement
La synthèse de L’état initiaL de L’environnement ANALYSE DES SENSIBILITÉS DE L’ENVIRONNEMENT CHAVIGNY-BAILLEUL TILLY TILLY MULCENT SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS GOUPILLIERES MONTAINVILLE CHAVIGNY-BAILLEUL EZY-SUR-EURE DAMVILLE BOIS-LE-ROI OULINS BOISSETS COUDRES CHAMPIGNY-LA-FUTELAYE SAINT-OUEN-MARCHEFROY OSMOY THOIRY CIVRY-LA-FORET MARCQ PRUNAY-LE-TEMPLE MOISVILLE Secteur NONANCOURT - CROTHDREUX SAUSSAY ORVILLIERS FLEXANVILLE VILLIERS-LE-MAHIEU ANET BEYNES LIGNEROLLES SAINT-LAURENT-DES-BOIS BONCOURT ROMAN BUIS - SUR - DAMVILLE Contournement de Dreux BERCHERES-SUR-VESGRE AUTOUILLET SAULX-MARCHAIS ORGERUS AUTEUIL MARCILLY - LA - CAMPAGNE ROUVRES SOREL-MOUSSEL GRESSEY TACOIGNIERES BEHOUST ILLIERS - L'EVEQUE HELLENVILLIERS N MARCILLY - SUR - EURE RICHEBOURG GARANCIERES Nonancourt SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE BOISSY-SANS-AVOIR VICQ NEAUPHLE-LE-VIEUX RD928 COURDEMANCHE BAZAINVILLE MILLEMONT DROISY BU LOUYE ABONDANT LA QUEUE-LES-YVELINES HOUDAN LA MADELEINE - DE - NONANCOURT GALLUIS SAINT - GEORGES - MOTEL MERE HAVELU MAREIL-LE-GUYON GOUSSAINVILLE MAULETTE MUZY NONANCOURT GAMBAIS GROSROUVRE SAINT - GERMAIN - SUR - AVRE ACON MARCHEZAIS MESNIL - SUR - L'ESTREE MONTREUIL SERVILLE MONTFORT-L'AMAURY BREUX - SUR - AVRE DAMPIERRE - SUR - AVRE CHAMPAGNE DANNEMARIE SAINT - LUBIN - DES - JONCHERETS CHERISY RN12 VERT - EN - DROUAIS GAMBAISEUIL SAINT - REMY - SUR - AVRE BROUE BOURDONNE DREUX LES MESNULS GERMAINVILLE BEROU - LA - MULOTIERE RN12 Dreux SAINT-REMY-L'HONORE LOUVILLIERS - EN - DROUAIS BOUTIGNY-PROUAIS BOISSY - EN - DROUAIS REVERCOURT SAINTE - GEMME - MORONVAL -

Le Dossier Est Valable Pour Les 3 Accueils Et Pour Une Année Scolaire
ACCUEILS DE LOISIRS : LE DOSSIER D’INSCRIPTION 2015/2016 se Le dossier est La Communauté de Communes de la Beauce compose : d’Orgères (CCBO) met à votre disposition des - 1 fiche sanitaire et renseignements signée des valable accueils de loisirs pendant les temps périscolaires 2 côtés (avant et après l’école), les mercredis et les pour les 3 accueils petites vacances (automne, hiver et printemps). - La copie du carnet de vaccination de l’enfant et pour une année Ils sont ouverts en priorité aux enfants des - 1 autorisation d’utilisation d’image signée communes suivantes : - 1 exemplaire du règlement intérieur signé par scolaire Baigneaux, Bazoches-en-Dunois, Bazoches-les-Hautes, le responsable légal de l’enfant et à conserver Cormainville, Courbehaye, Dambron, Fontenay-sur-Conie, Guillonville, Loigny-la-Bataille, Lumeau, Nottonville, Orgères- - La copie recto-verso de votre avis d’imposition en-Beauce, Péronville, Poupry, Terminiers, Tillay-le-Péneux, 2015 (revenus 2014) Varize. (Germignonville bénéficie des mêmes tarifs que les communes de la CCBO). - Attention pour les mercredis et petites vacances 1 fiche d’inscription par enfant Accueil Périscolaire (sur les 3 sites) spécifiant les jours ou semaines choisis est à Horaires : Le matin, de 7h jusqu’à l’entrée en renouveler à chaque période avec le classe et le soir, de la sortie de la classe jusqu’à 19h. règlement correspondant. Mercredis (Terminiers et Bazoches en Dunois) PARTICIPATION: Horaires : de la sortie des classes jusqu’à 19h. Activités pédagogiques de 13h30 à 17h Tarifs : « accueil périscolaire matin -soir » Pour toute (découvertes, jeux extérieurs / intérieurs, activités - Forfait mensuel (« matin », « soir » ou « matin inscription, merci manuelles, artistiques…). -

Communautés De Communes Et D'agglomérations
Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

Rapport D'activité 2020AVRIL 2021
Assainissement Urbanisme Assistance administrative et juridique Conseil financier ( Voirie ( Rapport d’activité 2020 AVRIL 2021 03 EDITOÉDITO FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT Assemblée générale 04 Assemblée générale 04Conseil Conseil d’administration d’administration Les05 adhérentsLes adhérents L’équipe MISSIONS06 L’équipe 07BILAN MISSIONSDE L’ACTIVITE 2019 Assainissement non collectif Assainissement BILAN DE L’ACTIVITÉ collectif 2020 Instruction09 Assainissement des autorisations non collectif d’urbanisme 14Voirie Assainissement collectif Assistance administrative et juridique/ Conseil16 Instruction financier des autorisations d’urbanisme 18BUDGET Voirie INFORMATION ET COMMUNICATION 21 Assistance administrative et juridique/ PERSPECTIVES 2020 Conseil financier 22 BUDGET 24 INFORMATION ET COMMUNICATION 26 PERSPECTIVES 2021 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIEINGENIÉRIE #03#01 RAPPORT RAPPORT D’ACTIVITÉ D’ACTIVITÉ 2020 | DIRECTEUR2019 - DIRECTEUR DE PUBLICATION DE PUBLICATIONClaude TÉROUINARD CLAUDE | RÉDACTEUR TÉROUINARD EN CHEFRÉDACTEUR Adeline EN OLLIVIER CHEF ADELINE | CRÉDIT OLLIVIER PHOTOS - ConseilPHOTOGRAPHIE départemental CONSEIL d’Eure-et-Loir DÉPARTEMENTAL - Eure-et-Loir D’EURE-ET-LOIR Ingénierie |ET MISE FRÉDÉRIC EN PAGE GRAUPNER- Direction MISEde la ENcommunication PAGE DIRECTION Hélène DE COUPÉ LA COMMUNICATION | IMPRESSION ImprimerieHÉLÈNE COUPÉ départementale - IMPRESSION | ONT IMPRIMERIEÉGALEMENT DÉPARTEMENTALE PARTICIPÉ À CE NUMÉRO - ONT ÉGALEMENT Karima BENYAHIA PARTI-, CIPÉAude ÀBRANKA CE NUMÉRO, Sébastien SÉBASTIEN DAVID, Laurence DAVID, JULIE PHILIPPON VIALLE, -Julie MME VIALLE LEMAIRE, - Jean M. BASSOULET, LE BALC’H, Nicole MME HUBERMINARD, DIGER, M. MARIE. Martial LECOMTE, Sylvie DAGUET. 2 EURE-ET-LOIR INGÉNIERIE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 ÉDITO L’année 2020 aura résolument été marquée par le contexte inédit de lutte contre la propagation de l’épidémie de COVID-19. Elle nous aura cependant rappelé toute la pertinence et la nécessité d’un service public de proximité, au plus proche des besoins des euréliens.