Annexes Informatives
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Voie Verte Louvigny-Grimbosq Promenade Familiale Du 15 Septembre 2013
La voie verte Louvigny-Grimbosq Promenade familiale du 15 septembre 2013 1er arrêt : entrée de l’ancien camping de Caen Les inondations de Caen et des environs Le développement urbain de Caen au XIXè siècle a contribué à réduire les zones d’écoulement de l’Orne en cas de crue. A partir de 1820, l’aménagement du port entraîne la suppression des prairies inondables et les dépôts successifs des industries amènent un rehaussement des terrains empêchant leur rôle de réservoir naturel. Le déplacement et la régulation du lit de l’Orne puis le creusement du canal en 1837 achèvent de supprimer les méandres de l’Orne et rendent ainsi beaucoup plus vulnérables les terrains riverains. Il peut exister également des inondations dites par remontée de nappe en cas de forte pluviosité mais qui concernent des surfaces plus limitées. La prairie joue le rôle de champ d’expansion de crue : la vanne Yves Guillou est abaissée lors des fortes montées de l’Odon et de l’Orne (par la grande Noé). Dès que le niveau de l’Orne atteint 1,80m à Thury-Harcourt, l’alerte est donnée. Des inondations supérieures à 4m ont eu lieu en 1925, 1990, 1993, 1995, 1999 et 2001. Des mesures ont été prises pour lutter contre les inondations, en particulier, en 2002, la création d’un canal de jonction entre l’Orne et le canal de Caen à la mer. Le débit est ensuite restitué dans l’estuaire de l’Orne par un déversoir situé sur le site du Maresquier à Ouistreham. Un chenal à sec a été réalisé dans la plaine d’inondation de Louvigny pour faciliter l’écoulement et abaisser le niveau d’eau à l’amont et une digue a été érigée le long de l’Orne. -

Décret Du 17 Février 2014
21 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 111 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR Décret no 2014-160 du 17 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département du Calvados NOR : INTA1326779D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3113-2 ; Vu le code électoral, notamment son article L. 191-1 ; Vu le décret no 2012-1479 du 27 décembre 2012 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, de Saint- Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ensemble le I de l’article 71 du décret no 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi no 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; Vu la délibération du conseil général du Calvados en date du 18 octobre 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Décrète : Art. 1er.−Le département du Calvados comprend vingt-cinq cantons : – canton no 1 (Aunay-sur-Odon) ; – canton no 2 (Bayeux) ; – canton no 3 (Bretteville-l’Orgueilleuse) ; – canton no 4 (Cabourg) ; – canton no 5 (Caen-1) ; – canton no 6 (Caen-2) ; – canton no 7 (Caen-3) ; – canton no 8 (Caen-4) ; – canton no 9 (Caen-5) ; – canton no 10 (Condé-sur-Noireau) ; – canton no 11 (Courseulles-sur-Mer) ; – canton no 12 (Evrecy) ; – canton no 13 (Falaise) ; – canton no 14 (Hérouville-Saint-Clair) ; – canton no 15 (Honfleur-Deauville) ; – canton no 16 (Ifs) ; – canton no 17 (Lisieux) ; – canton no 18 (Livarot) ; – canton no 19 (Mézidon-Canon) ; – canton no 20 (Ouistreham) ; – canton no 21 (Pont-l’Evêque) ; – canton no 22 (Thury-Harcourt) ; – canton no 23 (Trévières) ; – canton no 24 (Troarn) ; . -

The Free Radical Scavenging Activities of Biochemical Compounds of Dicranum Scoparium and Porella Platyphylla
Aydın S. 2020. Anatolian Bryol……………………………………………………………..……………19 Anatolian Bryology http://dergipark.org.tr/tr/pub/anatolianbryology Anadolu Briyoloji Dergisi Research Article DOI: 10.26672/anatolianbryology.701466 e-ISSN:2458-8474 Online The free radical scavenging activities of biochemical compounds of Dicranum scoparium and Porella platyphylla Sevinç AYDIN1* 1Çemişgezek Vocational School, Munzur University, Tunceli, TURKEY Received: 10.03.2020 Revised: 28.03.2020 Accepted: 17.04.2020 Abstract The bryophytes studies carried out in our country are mainly for bryofloristic purposes and the studies on biochemical contents are very limited. Dicranum scoparium and Porella platyphylla taxa of bryophytes were used in the present study carried out to determine the free radical scavenging activities, fatty acid, and vitamin contents. In this study, it was aimed to underline the importance of bryophytes for scientific literature and to provide a basis for further studies on this subject. The data obtained in this study indicate that the DPPH radical scavenging effect of D. scoparium taxon is significantly higher than that of P. platyphylla taxon. It is known that there is a strong relationship between the phenolic compound content of methanol extracts of the plants and the DPPH radical scavenging efficiency. When the fatty acid contents were examined, it was observed that levels of all unsaturated fatty acids were higher in the P. platyphylla taxon than the D. scoparium taxon, except for α-Linolenic acid. When the vitamin contents of species were compared, it was determined that D-3, α -tocopherol, stigmasterol, betasterol amount was higher in Dicranum taxon. Keywords: DPPH, Fatty Acid, Vitamin, Dicranaceae, Porellaceae Dicranum scoparium ve Porella platyphylla taxonlarının biyokimyasal bileşiklerinin serbest radikal temizleme faaliyetleri Öz Ülkemizde briyofitler ile ilgili olan çalışmalar genellikle briyofloristik amaçlı olup serbest radikal temizleme aktiviteleri ve yağ asidi içerikleri gibi diğer amaçlı çalışmalar yok denecek kadar azdır. -

Villers-Bocage À 1/50 000
NOTICE EXPLICATIVE DE LA FEUILLE VILLERS-BOCAGE À 1/50 000 par Y. VERNHET, P. MAURIZOT, J. LE GALL, P. GIGOT, L. DUPRET, G. LEROUGE, J.C. BESOMBES, G. BARBIER, T. PAY avec la collaboration de J. PELLERIN, O. DUGUÉ, G. FILY 2002 Éditions du BRGM Service géologique national Références bibliographiques. Toute référence en bibliographie à ce document doit être faite de la façon suivante : – pour la carte : VERNHET Y., MAURIZOT P., LE GALL J., GIGOT P., DUPRET L., BARBIER G., LEROUGE G., BESOMBES J.C., PELLERIN J. (2002) – Carte géol. France (1/50 000), feuille Villers-Bocage (145). Orléans : BRGM. Notice explicative par Y. VERNHET et al. (2002), 229 p. – pour la notice : VERNHET Y., MAURIZOT P., LE GALL J., GIGOT P., DUPRET L., LEROUGE G., BESOMBES J.C., BARBIER G., PAY T., avec la collaboration de PELLERIN J., DUGUÉ O., FILY G. (2002) – Notice explicative, Carte géol. France (1/50 000), feuille Villers- Bocage (145). Orléans : BRGM, 229 p. Carte géologique par Y. VERNHET et al. (2002). © BRGM, 2002. Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Aucun extrait de ce document ne peut être reproduit, sous quelque forme ou par quelque procédé que ce soit (machine électronique, mécanique, à photocopier, à enregistrer ou tout autre) sans l’autorisation préalable de l’éditeur. ISBN : 2-7159-1145-9 SOMMAIRE INTRODUCTION 7 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 7 CADRE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL – PRÉSENTATION DE LA CARTE 9 Formations protérozoïques 11 Formations paléozoïques 12 Formations mésozoïques et cénozoïques 13 TRAVAUX ANTÉRIEURS – CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT -

1 LAGALLE Philippe LE HOM MOREL Patrick URVILLE BERNARD Chantal LE BO BRETEAU Jean-Claude BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 1 2 SURIRAY Mari
COMMISSION 1 COMMISSION 2 COMMISSION 3 COMMISSION 4 Attractivité globale du territoire, Développement économique Finances & Administration générale Scolaire, Périscolaire, et Enfance-Jeunesse Transition écologique et Mobilité et Développement touristique 1 LAGALLE Philippe LE HOM MOREL Patrick URVILLE BERNARD Chantal LE BO BRETEAU Jean-Claude BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 1 2 SURIRAY Marie-Thérèse BOULON ALIAMUS Florence BOULON BRUNET Ludovic BARBERY ERTLEN Tanguy BOULON 2 3 LEBOULANGER Christine BRETTEVILLE-SUR-LAIZE FRANÇOIS Bruno BRETTEVILLE-SUR-LAIZE LESUEUR Ludovic BOULON BOUJRAD Abderrahman BRETTEVILLE-SUR-LAIZE 3 4 BRARD Robert BRETTEVILLE-LE-RABET BOCIANOWSKI Virginie CAUVICOURT COSSERON Véronique BRETTEVILLE-SUR-LAIZE LAROSE Xavier CAUVICOURT 4 5 BRUNET Pascal CAUVICOURT HUBERT-BENDZYK Christine CESNY-LES-SOURCES CHESNEL Élodie CAUVICOURT MARTIN Lionel CAUVILLE 5 6 VANRYCKEGHEM Jean CESNY-LES-SOURCES D'HOINE Sophie CINTHEAUX TASTEYRE Delphine CAUVILLE MARIE Jean-Charles CESNY-LES-SOURCES 6 7 PIEDOUE Sophie CINTHEAUX LEBAS Didier CLÉCY PERRIN Renny CESNY-LES-SOURCES GUILLOUX Valérie CINTHEAUX 7 8 LE CORRE Astride CLÉCY BISCHOFF Clara COMBRAY MARTIN Audrey CINTHEAUX MORAND François CLÉCY 8 9 CAPRETTI Sandrine COMBRAY DELARUE Francis CROISILLES LÉVEILLÉ Sylvie CLÉCY HAVAS Roger COMBRAY 9 10 BOUQUEREL Sophie CROISILLES BELLEMBERT Jérémy CULEY-LE-PATRY BRÉARD Alain COMBRAY LEGENDRE Serge DONNAY 10 11 PARADELA Mike CULEY-LE-PATRY LECERF Théophile DONNAY GOMIS Vincent CROISILLES PAUCTON Sébastien ESSON 11 12 LEGENDRE Serge DONNAY BAILLIEUL -
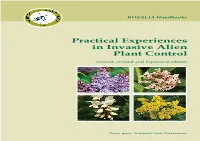
Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control
ROSALIA Handbooks ROSALIA Handbooks Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control Second, revised and expanded edition Invasive plant species pose major agricultural, silvicultural, human health and ecological problems worldwide, and are considered the most signifi cant threat for nature conservation. Species invading natural areas in Hungary have been described by a number of books published in the Practical Experiences in Invasive Alien Plant Control last few years. A great amount of experience has been gathered about the control of these species in some areas, which we can read about in an increasing number of articles; however, no book has been published with regards to the whole country. Invasions affecting larger areas require high energy and cost input, and the effectiveness and successfulness of control can be infl uenced by a number of factors. The development of effective, widely applicable control and eradication technologies is preceded by experiments and examinations which are based on a lot of practical experience and often loaded with negative experiences. National park directorates, forest and agricultural managers and NGOs in many parts of Hungary are combatting the spread of invasive species; however, the exchange of information and conclusion of experiences among the managing bodies is indispensable. The aim of the present volume is to facilitate this by summarizing experiences and the methods applied in practice; which, we hope, will enable us to successfully stop the further spread of invasive plant species and effectively protect our natural values. Magyarország-Szlovákia Partnerséget építünk Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Duna-Ipoly National Park Directorate rrosaliaosalia kkezikonyvezikonyv 3 aangng jjav.inddav.indd 1 22017.12.15.017.12.15. -

Appendix 2: Plant Lists
Appendix 2: Plant Lists Master List and Section Lists Mahlon Dickerson Reservation Botanical Survey and Stewardship Assessment Wild Ridge Plants, LLC 2015 2015 MASTER PLANT LIST MAHLON DICKERSON RESERVATION SCIENTIFIC NAME NATIVENESS S-RANK CC PLANT HABIT # OF SECTIONS Acalypha rhomboidea Native 1 Forb 9 Acer palmatum Invasive 0 Tree 1 Acer pensylvanicum Native 7 Tree 2 Acer platanoides Invasive 0 Tree 4 Acer rubrum Native 3 Tree 27 Acer saccharum Native 5 Tree 24 Achillea millefolium Native 0 Forb 18 Acorus calamus Alien 0 Forb 1 Actaea pachypoda Native 5 Forb 10 Adiantum pedatum Native 7 Fern 7 Ageratina altissima v. altissima Native 3 Forb 23 Agrimonia gryposepala Native 4 Forb 4 Agrostis canina Alien 0 Graminoid 2 Agrostis gigantea Alien 0 Graminoid 8 Agrostis hyemalis Native 2 Graminoid 3 Agrostis perennans Native 5 Graminoid 18 Agrostis stolonifera Invasive 0 Graminoid 3 Ailanthus altissima Invasive 0 Tree 8 Ajuga reptans Invasive 0 Forb 3 Alisma subcordatum Native 3 Forb 3 Alliaria petiolata Invasive 0 Forb 17 Allium tricoccum Native 8 Forb 3 Allium vineale Alien 0 Forb 2 Alnus incana ssp rugosa Native 6 Shrub 5 Alnus serrulata Native 4 Shrub 3 Ambrosia artemisiifolia Native 0 Forb 14 Amelanchier arborea Native 7 Tree 26 Amphicarpaea bracteata Native 4 Vine, herbaceous 18 2015 MASTER PLANT LIST MAHLON DICKERSON RESERVATION SCIENTIFIC NAME NATIVENESS S-RANK CC PLANT HABIT # OF SECTIONS Anagallis arvensis Alien 0 Forb 4 Anaphalis margaritacea Native 2 Forb 3 Andropogon gerardii Native 4 Graminoid 1 Andropogon virginicus Native 2 Graminoid 1 Anemone americana Native 9 Forb 6 Anemone quinquefolia Native 7 Forb 13 Anemone virginiana Native 4 Forb 5 Antennaria neglecta Native 2 Forb 2 Antennaria neodioica ssp. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°14-2020-094
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°14-2020-094 CALVADOS PUBLIÉ LE 17 JUILLET 2020 1 Sommaire Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA (1 page) Page 3 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 - Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des Eaux de Trouville Deauville et Normandie pour la réalisation des opérations de vidange, transport et élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif (4 pages) Page 5 14-2020-07-16-005 - Arrêté préfectoral prescrivant la restauration de la continuité écologique au point de diffluence de la rivière Orbiquet et du ruisseau Graindin et sur la rivière Orbiquet au droit du vannage du Carmel, commune de LISIEUX (5 pages) Page 10 Préfecture du Calvados 14-2020-07-17-002 - 20200717-ArrêtéGrandsElecteurs (1 page) Page 16 14-2020-07-17-003 - 20200717-GRANDS ELECTEURS (48 pages) Page 18 14-2020-07-17-004 - Arrêté préfectoral du 17 juillet 2020 portant réglementation de la circulation sur les autoroutes A13 et A132 (4 pages) Page 67 2 Direction départementale de la cohésion sociale 14-2020-06-13-001 Liste des admis au BNSSA Jury du 13 juin 2020 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 3 Direction départementale de la cohésion sociale - 14-2020-06-13-001 - Liste des admis au BNSSA 4 Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados 14-2020-07-17-001 Arrêté préfectoral portant agrément de la Société des -
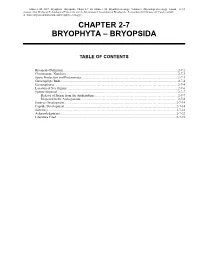
Volume 1, Chapter 2-7: Bryophyta
Glime, J. M. 2017. Bryophyta – Bryopsida. Chapt. 2-7. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 1. Physiological Ecology. Ebook 2-7-1 sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 10 January 2019 and available at <http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology/>. CHAPTER 2-7 BRYOPHYTA – BRYOPSIDA TABLE OF CONTENTS Bryopsida Definition........................................................................................................................................... 2-7-2 Chromosome Numbers........................................................................................................................................ 2-7-3 Spore Production and Protonemata ..................................................................................................................... 2-7-3 Gametophyte Buds.............................................................................................................................................. 2-7-4 Gametophores ..................................................................................................................................................... 2-7-4 Location of Sex Organs....................................................................................................................................... 2-7-6 Sperm Dispersal .................................................................................................................................................. 2-7-7 Release of Sperm from the Antheridium..................................................................................................... -

Tardigrade Reproduction and Food
Glime, J. M. 2017. Tardigrade Reproduction and Food. Chapt. 5-2. In: Glime, J. M. Bryophyte Ecology. Volume 2. Bryological 5-2-1 Interaction. Ebook sponsored by Michigan Technological University and the International Association of Bryologists. Last updated 18 July 2020 and available at <http://digitalcommons.mtu.edu/bryophyte-ecology2/>. CHAPTER 5-2 TARDIGRADE REPRODUCTION AND FOOD TABLE OF CONTENTS Life Cycle and Reproductive Strategies .............................................................................................................. 5-2-2 Reproductive Strategies and Habitat ............................................................................................................ 5-2-3 Eggs ............................................................................................................................................................. 5-2-3 Molting ......................................................................................................................................................... 5-2-7 Cyclomorphosis ........................................................................................................................................... 5-2-7 Bryophytes as Food Reservoirs ........................................................................................................................... 5-2-8 Role in Food Web ...................................................................................................................................... 5-2-12 Summary .......................................................................................................................................................... -

Species List For: Labarque Creek CA 750 Species Jefferson County Date Participants Location 4/19/2006 Nels Holmberg Plant Survey
Species List for: LaBarque Creek CA 750 Species Jefferson County Date Participants Location 4/19/2006 Nels Holmberg Plant Survey 5/15/2006 Nels Holmberg Plant Survey 5/16/2006 Nels Holmberg, George Yatskievych, and Rex Plant Survey Hill 5/22/2006 Nels Holmberg and WGNSS Botany Group Plant Survey 5/6/2006 Nels Holmberg Plant Survey Multiple Visits Nels Holmberg, John Atwood and Others LaBarque Creek Watershed - Bryophytes Bryophte List compiled by Nels Holmberg Multiple Visits Nels Holmberg and Many WGNSS and MONPS LaBarque Creek Watershed - Vascular Plants visits from 2005 to 2016 Vascular Plant List compiled by Nels Holmberg Species Name (Synonym) Common Name Family COFC COFW Acalypha monococca (A. gracilescens var. monococca) one-seeded mercury Euphorbiaceae 3 5 Acalypha rhomboidea rhombic copperleaf Euphorbiaceae 1 3 Acalypha virginica Virginia copperleaf Euphorbiaceae 2 3 Acer negundo var. undetermined box elder Sapindaceae 1 0 Acer rubrum var. undetermined red maple Sapindaceae 5 0 Acer saccharinum silver maple Sapindaceae 2 -3 Acer saccharum var. undetermined sugar maple Sapindaceae 5 3 Achillea millefolium yarrow Asteraceae/Anthemideae 1 3 Actaea pachypoda white baneberry Ranunculaceae 8 5 Adiantum pedatum var. pedatum northern maidenhair fern Pteridaceae Fern/Ally 6 1 Agalinis gattingeri (Gerardia) rough-stemmed gerardia Orobanchaceae 7 5 Agalinis tenuifolia (Gerardia, A. tenuifolia var. common gerardia Orobanchaceae 4 -3 macrophylla) Ageratina altissima var. altissima (Eupatorium rugosum) white snakeroot Asteraceae/Eupatorieae 2 3 Agrimonia parviflora swamp agrimony Rosaceae 5 -1 Agrimonia pubescens downy agrimony Rosaceae 4 5 Agrimonia rostellata woodland agrimony Rosaceae 4 3 Agrostis elliottiana awned bent grass Poaceae/Aveneae 3 5 * Agrostis gigantea redtop Poaceae/Aveneae 0 -3 Agrostis perennans upland bent Poaceae/Aveneae 3 1 Allium canadense var. -
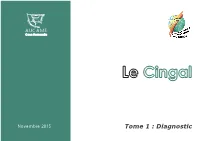
Tome 1 : Diagnostic
AUCAME Caen Normandie Novembre 2015 Tome 1 : Diagnostic Préambule ..............................................................................................................................................................................4 Un territoire construit autour de ses richesses naturelles ....................................................................................................9 Un territoire en voie de périurbanisation ............................................................................................................................27 Un territoire sous influence caennaise mais qui bénéficie d’une véritable vie locale ...................................................45 Les contraintes et potentiels d’urbanisation pour la construction d’un projet de territoire ............................................65 Table des matières ...............................................................................................................................................................78 AUCAME 2015 Étude territoriale du Cingal - Tome 1 : Diagnostic 3 Préambule En date du 15 décembre 2014, la Communauté de communes du Cingal a sollicité l’Aucame afin de réaliser un diagnostic territorial. Ce travail vient en préalable à une éventuelle démarche de PLUI et vise à approfondir la connaissance du territoire de l’intercommunalité afin d’esquisser un projet de territoire et appréhender la refonte des périmètres des intercommuna- lités dans le cadre de la loi NOTRE. La participation de l’Aucame Forte de ses expériences