PLU Avant La Modification 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Arve Faucigny Genevois Albanais Pays Du Rhône » a Été Scindé
Crédit : BlancRibotSavoiephotoMont / ARVE FAUCIGNY GENEVOIS Edition 2021 Dans l’économie touristique de Savoie Mont Blanc, le secteur Arve - Faucigny - Genevois - Albanais - Pays du Rhône, représente : • 4% des lits touristiques • 7% des emplois liés au tourisme • 4% de la fréquentation ski nordique en journées skieurs CAPACITE D’ACCUEIL Source : Observatoire SMBT 2020 nombre de lits CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE • Superficie : 1 316 km² • 130 communes • 337 738 habitants (source : INSEE 2018) • Soit 27% de la population de Savoie Mont Blanc et 41% de la population du département de Haute-Savoie • Taux d’évolution annuel : +2,5% pour la période 1999-2018 Evolution de la population résidente • 58 800 lits touristiques (9 705 structures) • 4% de la capacité d’accueil de Savoie Mont Blanc • 8% de la capacité d’accueil de la Haute-Savoie • 20% sont des lits marchands (12 000 lits) • L’hôtellerie représente 43% de l’offre marchande • Les campings constituent le second type d’’établissements avec 2 200 lits (18% des lits marchands) Le mode de comptage des lits touristiques (en particulier non marchands) ayant été modifié, la comparaison avec les données des années antérieures n’est pas réalisable. Chiffres disponibles au 30/06/2021 1/7 FREQUENTATION DES HEBERGEMENTS MARCHANDS : L’HOTELLERIE Source : INSEE - DGE NB1 : en 2019, l’INSEE a modifié les modalités de l’enquête hôtellerie entraînant une rupture de série statistique. Les données ont été recalculées depuis 2012. Les séries publiées antérieurement ne doivent pas être comparées à cette nouvelle série. NB2 : en 2020, la crise sanitaire a impacté l’ouverture des établissements et suspendu le déroulement des enquêtes de fréquentation de l’INSEE. -

Bassin Albanais – Annecien
TABLEAU I : BASSIN ALBANAIS – ANNECIEN COLLEGES COMMUNES ET ECOLES René Long ALBY -SUR -CHERAN ; ALLEVES ; CHAINAZ -LES -FRASSES ; CHAPEIRY ; CUSY ; GRUFFY ; HERY -SUR -ALBY ; MURES ; SAINT - ALBY-SUR-CHERAN SYLVESTRE ; VIUZ-LA-CHIESAZ Les Balmettes ANNECY - Annecy : groupes scolaires Vaugelas, La Prairie, Quai Jules Philippe (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY Départemental ou collège) ANNECY- Annecy : groupes scolaires Carnot, La Plaine (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) , Le Raoul Blanchard Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Les Romains, Quai Jules Philippe (selon un ANNECY- ANNECY listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) Les Barattes ANNECY- Annecy : groupes scolaires Le Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège); ANNECY- Annecy-le-Vieux (selon un listing de rues ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX précis – cf. Conseil Départemental ou collège); BLUFFY ; MENTHON-SAINT-BERNARD ; TALLOIRES-MONTMIN ; VEYRIER-DU-LAC ANNECY-Annecy : groupes scolaires Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), La Plaine Evire (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX Départemental ou -

PROJET DE REPRISE DU JOURNAL « LE FAUCIGNY » Janvier 2014 Noël Communod
PROJET DE REPRISE DU JOURNAL « LE FAUCIGNY » Janvier 2014 Noël Communod CHRONIQUES DES PAYS DE SAVOIE Histoire du Faucigny (Wikipedia) Le Faucigny est un hebdomadaire savoyard édité à Bonneville (capitale de l'ancienne province du Faucigny). Né à la Libération, en 1944, il est le successeur du journal L’Allobroge, créé en 1864, au lendemain de l’Annexion de la Savoie (à ne pas confondre avec Les Allobroges, quotidien régional de gauche, publiées à Grenoble de la Libération jusqu’au milieu des années 1950). L’Allobroge fusionna dans les années 1920 avec Le Mont-Blanc républicain, de même sensibilité politique (républicain, laïc et anticlérical). Après la Seconde Guerre mondiale, le journal change de nom comme pour signifier un renouveau. Le Faucigny est né. Adoptant dans les années 1980 un ton satirique, qui fera son succès, il est souvent comparé avec Le Canard enchaîné. On y retrouve Les Indiscrétions de Charles-Félix, une rubrique particulièrement lue par les décolleteurs de la vallée de l’Arve et les élus locaux de Haute-Savoie. Principalement centré autour de la vie politique locale, le journal aborde également des sujets plus généralistes (politique, justice, aménagement du territoire...). LA SITUATION Le propriétaire, Pierre Plancher, est décédé il y a quelques mois. Le Faucigny est aujourd’hui dirigé par son frère qui ne souhaite pas le garder et qui voudrait que l’esprit insufflé par son frère se poursuive. Hebdomadaire de 8 à 12 pages vendu 1,10 € au numéro et 47 € l’abonnement annuel. Trois journalistes : Messieurs Bertoni et Coste et madame Varvier Une personne chargée de l’administration : Madame Cousin Le journal est hébergé dans les locaux de la société Plancher (au coût minimal) et imprimé dans l’imprimerie Plancher. -

Cahiers Savoyards De Généalogie
Cahiers Savoyards de Généalogie Tome 1 (1982) (à rééditer) Histoire généalogique de la famille BRUNIER 1. Origine supposée. - 2. Les nobles. - 3. La dispersion, l’émigration. - 4. Les bourgeois. - 5. Quelques biographies. - 6. Étude sociologique. I. Une famille des gentilshommes en Albanais (Genevois). IL. Les nobles BRUNIER de LARNAGE, issus des nobles BRUNIER d’Alby. III. Les BRUNIER d’Avignon et du Bas-Languedoc. IV. Les BRUNIER-FONTANEL du Bas-Faucigny. V. Les BRUNIER, notaires, magistrats et bourgeois d’Annecy. VI. Les BURNIER de MINJOD à Quintal et Annecy (Genevois). VII. D’autres nobles BRUNIER, rameaux qui n’ont pu être rattachés. VIII. Les BURNIER bourgeois de Lutry (Pays de Vaud, Suisse). IX. Les BRUNIER-RUYDOZ à Queige, Albertville et Monthion (Tarentaise). X Les BRUNIER à Moûtiers et Séez, châtelains de La Val d’Isère (Tarentaise). Index Cahiers Savoyards de Généalogie Tome 2 (1983) 7. Les BRUNIER au recensement de 1561 pour la gabelle du sel. XI. Les BURNIER bourgeois de Rumilly (Albanais - Genevois). XII. Les BRUNIER bourgeois d’Aiguebelle (Maurienne). XIII. Les BRUNIER-COLLET des Bauges (Savoie propre). XIV. Les BURNIER du Bourget (Savoie propre). XV. Les BRUNIER de Basse-Maurienne (1). XVI. Les BRUNIER de Sévrier (Genevois). XVII Les BRUNIER de Tarentaise. Index 8. Les nobles de CHARANSONNAY, ancêtres des familles actuelles CHARANSONNET, CHALANSONNET, CHALANSONNEX & SALLANSONNET. Cahiers Savoyards de Généalogie Tome 3 (1984) (à rééditer) XVIII. Les BRUNIER de Cusy (Albanais-genevois). XIX. Les BRUNIER-COPPET des Bauges (Savoie propre). XX. Les BRUNIER-COULIN à Queige (Beaufortain). XXI. Les BRUNIER des Urtières (Maurienne). XXII. Les BRUNIER de Basse-Maurienne (11). -

RUMILLY COUV DCC.Indd
Ma Ville Rumilly l Guide Pratique l 2017 1 Le mot du maire ..................................................................................... 03 MA VILLE ................................................................. 05 Découvrir la ville .............................................................................. 06 Vie pratique Cadre de vie Plan de ville ..................................................................................... 11 L’équipe municipale ......................................................................... 18 La mairie .......................................................................................... 20 Vos démarches administratives ........................................................ 22 Vous informer .................................................................................. 26 A vos agendas .................................................................................. 28 VIE PRATIQUE ........................................................... 33 Numéros utiles ................................................................................. 34 Information sur les risques majeurs ................................................. 39 Social et Famille Santé - Professionnels de santé ....................................................... 58 CADRE DE VIE ........................................................... 63 Les déplacements............................................................................. 64 Le stationnement ............................................................................. -
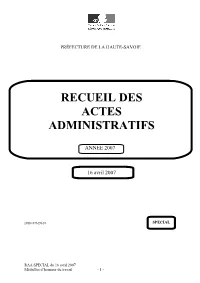
S O M M a I R E
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNEE 2007 16 avril 2007 ISSN 07619618 SPECIAL RAA SPECIAL du 16 avril 2007 Médailles d’honneur du travail - 1 - S O M M A I R E CABINET • Arrêté n° 2007.779 du 14 mars 2007 portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail – Promotion du 1er janvier 2007............................................................................ p 3 RAA SPECIAL du 16 avril 2007 Médailles d’honneur du travail - 2 - CABINET Arrêté n° 2007.779 du 14 mars 2007 portant attribution de la Médaille d'Honneur du Travail – Promotion du 1er janvier 2007 Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à : - Madame ABATE Martine née VIARD-CRETAT Opérateur Montage, TEFAL SAS, RUMILLY. demeurant 4, rue Marcoz D'Ecle à RUMILLY - Monsieur ACHOUIANTZ Denis Perceur, SNR ROULEMENTS, ANNECY. demeurant 5 avenue de vert bois à CRAN-GEVRIER - Monsieur ADAMCZYK Laurent Employé de banque , BANQUE DE FRANCE , MARNE LA VALLEE . demeurant 92, chemin de la Tournette à SEVRIER - Monsieur ALLARD François Vendeur , REXEL FRANCE SAS, VILLEURBANNE . demeurant 1125, route de Lady Les Granges à MEGEVE - Madame ALLEMAND Jocelyne née FOURNIER-BIDOZ Employée de banque , BANQUE LAYDERNIER , ANNECY. demeurant La vacherie à THONES - Madame AMIR Anne-Marie née CLARET-TOURNIER Agent de fabrication , AUTOCAM / BOUVERAT INDUSTRIES, MARNAZ. demeurant Le Clos des Charmes à SCIEZ - Madame AMRI Soufia née SAIDI Opératrice, G. CARTIER TECHNOLOGIES, CLUSES. demeurant 308, rue des Iles à BONNEVILLE - Madame ANOTHAI Christine née LOUARD Opératrice, G. CARTIER TECHNOLOGIES, CLUSES. demeurant Chez M.et Mme RIN Christophe - 76, impasse des Ederlweiss à SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY - Monsieur ANSELME Georges Chauffeur-livreur, BRAKE FRANCE SERVICE , PRINGY. -

01 Diss Cover Page
UC Berkeley UC Berkeley Electronic Theses and Dissertations Title The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860-1880 Permalink https://escholarship.org/uc/item/8dj2f20d Author Sawchuk, Mark Publication Date 2011 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in Charge Professor Carla Hesse, Chair Professor James P. Daughton Professor John Connelly Professor Jonah Levy Spring 2011 The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 Copyright 2011 Mark Alexander Sawchuk Abstract The Daily Plebiscite: Political Culture and National Identity in Nice and Savoy, 1860–1880 by Mark Alexander Sawchuk Doctor of Philosophy in History University of California, Berkeley Professor Carla Hesse, Chair Using the French philosopher Ernest Renan’s dictum that the “nation’s existence is ... a daily plebiscite” as an ironic point of departure, this dissertation examines the contours of oppositional political culture to the French annexation of the County of Nice and the Duchy of Savoy in 1860. Ceded by treaty to France by the northern Italian kingdom of Piedmont-Sardinia, these two mountainous border territories had long been culturally and geo-strategically in the French orbit. Unlike their counterparts in any other province of France, the inhabitants of the two territories were asked to approve or reject the annexation treaty, and thus their incorporation into France, in a plebiscite employing universal male suffrage. -

Portage Des Repas : Genevois/Arve Faucigny Mont Blanc/Chablais/Bassin Annecien
PORTAGE DES REPAS : GENEVOIS/ARVE FAUCIGNY MONT BLANC/CHABLAIS/BASSIN ANNECIEN TERRITOIRE DU GENEVOIS STRUCTURES/ORGANISMES/S ADRESSE TEL MAIL COMMUNES D'INTERVENTION ERVICES AMBILLY, ANNEMASSE, ARBUSIGNY, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE? CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA MURAZ, LA TOUR, 9 RUE MARC COURRIARD 74100 LUCINGES, MACHILLY, MONNETIER RESTAURATION 74 04-50-87-16-64 [email protected] ANNEMASSE MORNEX, NANGY, PERS JUSSY, REIGNIER ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ- MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ AMBILLY, ANNEMASSE, ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, CRANVES SALES, ETREMBIERES, FILLINGES, GAILLARD, JUVIGNY, LA TOUR, LUCINGES, MACHILLY, 90 ROUTE DES ALLUAZ 74380 BONNE GLOBE TRAITEUR 04-50-31-35-67 MONNETIER MORNEX, NANGY, REIGNIER SUR MENOGE ESERY, ST CERGUES, ST JEAN DE THOLOME, ST JEOIRE, SCIENTRIER, VETRAZ MONTHOUX, VILLE EN SALLAZ, VILLE LA GRAND, VIUZ EN SALLAZ ARCHAMPS, BEAUMONT, CHENEX, CHEVRIER, COLLONGES SOUS SALEVE, 101 ROUTE DE FARAMAZ 74520 DINGY EN VUACHE, FEIGERES, JONZIER LA CHAROLAISE 04-50-49-00-40 [email protected] VULBENS EPAGNY, NEYDENS, PRESILLY, ST JULIEN EN GENEVOIS, SAVIGNY, VALLEIRY, VERS, VIRY, VULBENS 2360 ROUTE DE BELLEGARDE LA FROMAGERIE 04-50-35-49-68 VALLEIRY, VIRY, VULBENS GERMANY 74580 VIRY ADMR DE COLLONGES SOUS ROUTE DE BOSSEY 74160 COLLONGES 04-50-43-21-29 [email protected] SALEVE SOUS SALEVE ARTHAZ PONT NOTRE DAME, BONNE, 833 ROUTE DU CHEF LIEU 74250 JULIEN DALLOZ 06-49-41-60-83 -
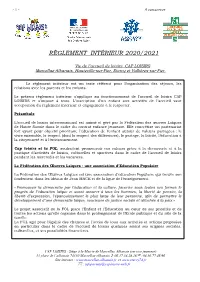
Règlement Intérieur 2020/2021
- 1 - A conserver RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2020/2021 Vie de l’accueil de loisirs CAP LOISIRS Marcellaz-Albanais, Hauteville-sur-Fier, Etercy et Vallières-sur-Fier. Le règlement intérieur est un texte référent pour l’organisation des séjours, les relations avec les parents et les enfants. Le présent règlement intérieur s’applique au fonctionnement de l’accueil de loisirs CAP LOISIRS et s’impose à tous. L’inscription d’un enfant aux activités de l’accueil vaut acceptation du règlement intérieur et engagement à le respecter. Préambule L’accueil de loisirs intercommunal est animé et géré par la Fédération des œuvres Laïques de Haute Savoie dans le cadre du contrat enfance jeunesse. Elle concrétise un partenariat fort ayant pour objectif prioritaire l’éducation de l’enfant autour de valeurs partagées : le vivre ensemble, le respect (dont le respect des différences), le partage, la laïcité, l’éducation à la citoyenneté et à l’environnement. Cap loisirs et la FOL, souhaitent promouvoir ces valeurs grâce à la découverte et à la pratique d’activités de loisirs, culturelles et sportives dans le cadre de l’accueil de loisirs pendant les mercredis et les vacances. La Fédération des Œuvres Laïques : une association d’Education Populaire La Fédération des Œuvres Laïques est une association d’éducation Populaire qui trouve son fondement dans les idéaux de Jean MACE et de la ligue de l’enseignement. « Promouvoir la démocratie par l’éducation et la culture, favorise sous toutes ses formes le progrès de l’éducation laïque et aussi assurer à tous les hommes, la liberté de pensée, la liberté d’expression, l’épanouissement le plus large de leur personne, afin de permettre le développement d’une démocratie laïque, soucieuse de justice sociale et attachée à la paix » Le projet associatif de la FOL place l’Enfant et l’Education au cœur de ses priorités et de toutes les actions qu’elle organise dans le prolongement de l’Ecole publique et du rôle de la famille. -

Plan Local D'urbanisme Intercommunal
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL Tenant lieu de Programme Local de l’Habitat Date d’arrêt RAPPORT DE PRÉSENTATION 03/06/2019 DIAGNOSTIC SOCIO-ÉCONOMIQUE Date d’approbation Pièce du PLUiH 1b Cittànova PREAMBULE Le présent document constitue une des parties du rapport de présentation du PLUi. Le diagnostic a été actualisé et complété au fur-et-à mesure de l’élaboration du PLUi. Ce document s’appuie sur un travail de terrain et sur l’analyse des données issues des sources citées dans le document. Les communes de Vallières et de Val-de-Fier ont fusionné au 1er janvier 2019 et constituent désormais la commune de Vallières-sur-Fier. Le projet tient compte des caractéristiques antérieures des anciennes communes, le diagnostic présente donc les éléments pour chacune d’entre elles. 1. Montee en puissance periurbaine .............................................................. 1.1. Fin des années 1960 : les prémices du développement périurbaiain 1.2. De 1990 à aujourd’hui : une périurbanisation touchant les communes limitrophes du territoire 1.3. La structure de la population induite par ces dynamiques démographiques 1.4. Un territoire historiquement industriel, aujourd’hui pôle d’emplois secondaire à l’échelle départementale 2. Incidences environnementales ................................................................ 2.1. Consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 2.2. Insertion paysagère et architecturale 2.3. Équipements et besoins induits par la croissance démographique 3. Un projet de territoire en construction................................................ 3.1. Orientation du SCOT : positionner l’Albanais au sein de l’espace métropolitain 3.2. Triangle Alby, Albens, Rumilly 3.3. Rumilly, ville structurante de l’Albanais 3.4. Les Communes Bourgs, des pôles relais dans l’organisation territoriale 3.5. -
Horaires Lignes Régulières
Horaires Lignes régulières Rumilly Vallières-sur-Fier 32 Hauteville-sur-Fier Vaulx Annecy Rumilly Sales 33 Marcellaz-Albanais Etercy Annecy Horaires valables du 7 juillet 2021 au 31 août 2022 32 Rumilly>Hauteville-sur-Fier>Annecy JOURS DE FONCTIONNEMENT L M Me J V L M Me J V RUMILLY Gare SNCF 6:30 7:00* RUMILLY Pont Neuf 6:34 7:04* VALLIÈRES-SUR-FIER Vers Coppet 6:39 7:09* VALLIÈRES-SUR-FIER Église 6:41 7:11* VALLIÈRES-SUR-FIER Les Quatre Chemins 6:45 7:15* HAUTEVILLE-SUR-FIER La Croix 6:47 7:17* HAUTEVILLE-SUR-FIER Chef-Lieu 6:49 7:19* HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Onges 6:52 7:22* HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Grands Prés 6:53 7:23* VAULX La Croix 6:56 7:26* NONGLARD Chez Pochat 7:00 7:30* LOVAGNY Mairie 7:05 7:35* LOVAGNY Ancien Lavoir 7:06 7:36* POISY Collège Simone Veil - 7:40* POISY Chef-Lieu 7:11 7:44* ANNECY Le Rabelais - 7:55* ANNECY Lycée Baudelaire 7:20 8:05* ANNECY Église des Bressis 7:21 8:09* ANNECY Lycée Gabriel Fauré 7:29 - ANNECY Gare Routière 7:34 8:15* JOURS DE FONCTIONNEMENT Me L M Me J V L M Me J V ANNECY Lycée Gabriel Fauré 12:06* - - ANNECY Gare Routière 12:12* 16:50* 18:05 ANNECY Lycée Baudelaire 12:19* 16:58* 18:13 ANNECY Le Rabelais 12:27* 17:10* - POISY Chef-Lieu 12:36* 17:20* 18:25 LOVAGNY Ancien Lavoir 12:41* 17:25* 18:30 LOVAGNY Mairie 12:42* 17:27* 18:32 NONGLARD Chez Pochat 12:47* 17:32* 18:37 VAULX La Croix 12:50* 17:35* 18:40 HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Grands Prés 12:51* 17:37* 18:42 HAUTEVILLE-SUR-FIER Les Onges 12:52* 17:38* 18:43 HAUTEVILLE-SUR-FIER Chef-Lieu 12:54* 17:40* 18:45 HAUTEVILLE-SUR-FIER La Croix 12:56* -

A74-939EU171-PHASE 4.1-NOTICE DE ZONAGE.DOCX 1/50 Communauté De Communes Rumilly Terre De Savoie Schéma Directeur D’Assainissement – Phase 4 : Notice De Zonage
Maître(s) d’Ouvrage(s) ETUDE DEPARTEMENT DE LA HAUTE -SAVOIE COMMUNAUTE DE COMMUNE ASSAINISSEMENT RUMILLY TERRE DE SAVOIE 3 Place de la manufacture 74152 RUMILLY Cedex Tél. 04 50 01 87 00 [email protected] Financeurs SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES HAUTE SAVOIE AGENCE DE L’EAU LE DEPARTEMENT RHONE MEDITERRANEE 1 Avenue d’Albigny CORSE CS 32444 2-4 Allée de Lodz F-74041 Annecy Cedex 69 363 LYON CEDEX 07 Tél. 04 50 33 50 00 Tél. 04 72 71 26 00 Prestataire(s) Désignation de la pièce PHASE 4.1 NOTICE DE ZONAGE D ’ASSAINISSEMENT Référence de pièce A74-939EU171-Notice de zonage Révision(s) SIEGE - ANNECY 129 avenue de Genève Ind.a – 15/04/2020 – ACD/CRO – Version initiale 74000 ANNECY Tél. 04 50 67 93 33 siè[email protected] www.profilsetudes.fr A74-939EU171-PHASE_4.1-NOTICE DE ZONAGE.DOCX 1/50 Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie Schéma directeur d’assainissement – Phase 4 : Notice de zonage SOMMAIRE 1. ASPECTS REGLEMENTAIRES ................................................................................................ 5 1.1. PRESENTATION DE L’ETUDE ............................................................................................. 5 1.2. CADRE JURIDIQUE ............................................................................................................ 5 1.2.1. DIRECTIVE EUROPEENNE – 1991 ................................................................................ 5 1.2.2. LOI SUR L’EAU ............................................................................................................