Le Peintre Barbare.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
TEL AVIV PANTONE 425U Gris PANTONE 653C Bleu Bleu PANTONE 653 C
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN TRIPLEX PARIS - NEW YORK TEL AVIV Bleu PANTONE 653 C Gris PANTONE 425 U Bleu PANTONE 653 C Gris PANTONE 425 U ART MODERNE et CONTEMPORAIN Ecole de Paris Tableaux, dessins et sculptures Le Mardi 19 Juin 2012 à 19h. 5, Avenue d’Eylau 75116 Paris Expositions privées: Lundi 18 juin de 10 h. à 18h. Mardi 19 juin de 10h. à 15h. 5, Avenue d’ Eylau 75116 Paris Expert pour les tableaux: Cécile RITZENTHALER Tel: +33 (0) 6 85 07 00 36 [email protected] Assistée d’Alix PIGNON-HERIARD Tel: +33 (0) 1 47 27 76 72 Fax: 33 (0) 1 47 27 70 89 [email protected] EXPERTISES SUR RDV ESTIMATIONS CONDITIONS REPORTS ORDRES D’ACHAt RESERVATION DE PLACES Catalogue en ligne sur notre site www.millon-associes.com בס’’ד MODERN AND CONTEMPORARY FINE ART NEW YORK : Tuesday, June 19, 2012 1 pm TEL AV IV : Tuesday, 19 June 2012 20:00 PARIS : Mardi, 19 Juin 2012 19h AUCTION MATSART USA 444 W. 55th St. New York, NY 10019 PREVIEW IN NEW YORK 444 W. 55th St. New York, NY. 10019 tel. +1-347-705-9820 Thursday June 14 6-8 pm opening reception Friday June 15 11 am – 5 pm Saturday June 16 closed Sunday June 17 11 am – 5 pm Monday June 18 11 am – 5 pm Other times by appointment: 1 347 705 9820 PREVIEW AND SALES ROOM IN TEL AVIV 15 Frishman St., Tel Aviv +972-2-6251049 Thursday June 14 6-10 pm opening reception Friday June 15 11 am – 3 pm Saturday June 16 closed Sunday June 17 11 am – 6 pm Monday June 18 11 am – 6 pm tuesday June 19 (auction day) 11 am – 2 pm Bleu PREVIEW ANDPANTONE 653 C SALES ROOM IN PARIS Gris 5, avenuePANTONE d’Eylau, 425 U 75016 Paris Monday 18 June 10 am – 6 pm tuesday 19 June 10 am – 3 pm live Auction 123 will be held simultaneously bid worldwide and selected items will be exhibited www.artonline.com at each of three locations as noted in the catalog. -

ACCADEMIA FINE ART Monaco Auction
ACCADEMIA FINE ART Monaco Auction Par le Ministère de Organisation & Direction générale Me M.-Th. Escaut-Marquet, Huissier à Monaco Joël GIRARDI Vente aux enchères publiques à l’Hôtel de Paris, Monte-Carlo Gestion et organisation générale Salons Bosio - Beaumarchais François Xavier VANDERBORGHT Vente menée par Serge HUTRY Directeur du département Bijoux Fethia EL MAY Diplômée de l’Institut National de Gemmologie Relation publique Samedi 22 Juin 2013 à 16h30 Alessandra TESTA Exposition publique Photographe Jeudi 20 et Vendredi 21 Juin de 10h à 20h Marcel LOLI Samedi 22 Juin de 10h à 14h Retrait des lots à l’Hôtel de Paris Dimanche 23 Juin 2013 Accademia Fine Art ouvre l’ère des enchères virtuelles : grace à Artfact Live, vous avez la possibilité de suivre en direct la vente et d’enchérir en direct sur internet pendant nos ventes. 2 3 ACCADEMIA FINE ART Monaco Auction Par le Ministère de Organisation & Direction générale Me M.-Th. Escaut-Marquet, Huissier à Monaco Joël GIRARDI Vente aux enchères publiques à l’Hôtel de Paris, Monte-Carlo Gestion et organisation générale Salons Bosio - Beaumarchais François Xavier VANDERBORGHT Vente menée par Serge HUTRY Directeur du département Bijoux Fethia EL MAY Diplômée de l’Institut National de Gemmologie Relation publique Samedi 22 Juin 2013 à 16h30 Alessandra TESTA Exposition publique Photographe Jeudi 20 et Vendredi 21 Juin de 10h à 20h Marcel LOLI Samedi 22 Juin de 10h à 14h Retrait des lots à l’Hôtel de Paris Dimanche 23 Juin 2013 Accademia Fine Art ouvre l’ère des enchères virtuelles : grace à Artfact Live, vous avez la possibilité de suivre en direct la vente et d’enchérir en direct sur internet pendant nos ventes. -

Les Ornements De La Femme : L'éventail, L'ombrelle, Le Gant, Le Manchon (Ed
Les ornements de la femme : l'éventail, l'ombrelle, le gant, le manchon (Ed. complète et définitive) / par Octave Uzanne Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Uzanne, Octave (1851-1931). Auteur du texte. Les ornements de la femme : l'éventail, l'ombrelle, le gant, le manchon (Ed. complète et définitive) / par Octave Uzanne. 1892. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ». - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc. CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. -

NEO-Orientalisms UGLY WOMEN and the PARISIAN
NEO-ORIENTALISMs UGLY WOMEN AND THE PARISIAN AVANT-GARDE, 1905 - 1908 By ELIZABETH GAIL KIRK B.F.A., University of Manitoba, 1982 B.A., University of Manitoba, 1983 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES (Department of Fine Arts) We accept this thesis as conforming to the required standard THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA . October 1988 <£> Elizabeth Gail Kirk, 1988 In presenting this thesis in partial fulfilment of the requirements for an advanced degree at the University of British Columbia, I agree that the Library shall make it freely available for reference and study. I further agree that permission for extensive copying of this thesis for scholarly purposes may be granted by the head of my department or by his or her representatives. It is understood that copying or publication of this thesis for financial gain shall not be allowed without my written permission. Department of Fine Arts The University of British Columbia 1956 Main Mall Vancouver, Canada V6T 1Y3 Date October, 1988 DE-6(3/81) ABSTRACT The Neo-Orientalism of Matisse's The Blue Nude (Souvenir of Biskra), and Picasso's Les Demoiselles d'Avignon, both of 1907, exists in the similarity of the extreme distortion of the female form and defines the different meanings attached to these "ugly" women relative to distinctive notions of erotic and exotic imagery. To understand Neo-Orientalism, that is, 19th century Orientalist concepts which were filtered through Primitivism in the 20th century, the racial, sexual and class antagonisms of the period, which not only influenced attitudes towards erotic and exotic imagery, but also defined and categorized humanity, must be considered in their historical context. -
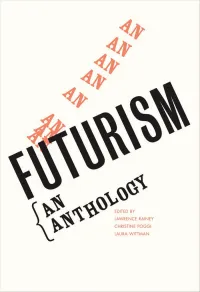
Futurism-Anthology.Pdf
FUTURISM FUTURISM AN ANTHOLOGY Edited by Lawrence Rainey Christine Poggi Laura Wittman Yale University Press New Haven & London Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Published with assistance from the Kingsley Trust Association Publication Fund established by the Scroll and Key Society of Yale College. Frontispiece on page ii is a detail of fig. 35. Copyright © 2009 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Designed by Nancy Ovedovitz and set in Scala type by Tseng Information Systems, Inc. Printed in the United States of America by Sheridan Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Futurism : an anthology / edited by Lawrence Rainey, Christine Poggi, and Laura Wittman. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-08875-5 (cloth : alk. paper) 1. Futurism (Art) 2. Futurism (Literary movement) 3. Arts, Modern—20th century. I. Rainey, Lawrence S. II. Poggi, Christine, 1953– III. Wittman, Laura. NX456.5.F8F87 2009 700'.4114—dc22 2009007811 A catalogue record for this book is available from the British Library. This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48–1992 (Permanence of Paper). 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CONTENTS Acknowledgments xiii Introduction: F. T. Marinetti and the Development of Futurism Lawrence Rainey 1 Part One Manifestos and Theoretical Writings Introduction to Part One Lawrence Rainey 43 The Founding and Manifesto of Futurism (1909) F. -

Edgar Degas: a Strange New Beauty, Cited on P
Degas A Strange New Beauty Jodi Hauptman With essays by Carol Armstrong, Jonas Beyer, Kathryn Brown, Karl Buchberg and Laura Neufeld, Hollis Clayson, Jill DeVonyar, Samantha Friedman, Richard Kendall, Stephanie O’Rourke, Raisa Rexer, and Kimberly Schenck The Museum of Modern Art, New York Contents Published in conjunction with the exhibition Copyright credits for certain illustrations are 6 Foreword Edgar Degas: A Strange New Beauty, cited on p. 239. All rights reserved at The Museum of Modern Art, New York, 7 Acknowledgments March 26–July 24, 2016, Library of Congress Control Number: organized by Jodi Hauptman, Senior Curator, 2015960601 Department of Drawings and Prints, with ISBN: 978-1-63345-005-9 12 Introduction Richard Kendall Jodi Hauptman Published by The Museum of Modern Art Lead sponsor of the exhibition is 11 West 53 Street 20 An Anarchist in Art: Degas and the Monotype The Philip and Janice Levin Foundation. New York, New York 10019 www.moma.org Richard Kendall Major support is provided by the Robert Lehman Foundation and by Distributed in the United States and Canada 36 Degas in the Dark Sue and Edgar Wachenheim III. by ARTBOOK | D.A.P., New York 155 Sixth Avenue, 2nd floor, New York, NY Carol Armstrong Generous funding is provided by 10013 Dian Woodner. www.artbook.com 46 Indelible Ink: Degas’s Methods and Materials This exhibition is supported by an indemnity Distributed outside the United States and Karl Buchberg and Laura Neufeld from the Federal Council on the Arts and the Canada by Thames & Hudson ltd Humanities. 181A High Holborn, London WC1V 7QX 54 Plates www.thamesandhudson.com Additional support is provided by the MoMA Annual Exhibition Fund. -

Artcurial | Livres Et Manuscrits | 15.12.2010 | Hôtel Marcel Dassault
1886 14 & 15 DÉCEMBRE 2010 – PARIS LIVRES ET MANUSCRITS LIVRES ET MANUSCRITS MARDI 14 DÉCEMBRE 2010 MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010 PARIS — HÔTEL MARCEL DASSAULT 14H30 Détail du lot n° 108 maquette livres artcurial 5.indd 1 16/11/10 22:58:40 ARTCURIAL BRIEST – P O U LAIN – F.TAJAN Hôtel Marcel Dassault 7, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris LIVRES ET MANUSCRITS ASSOCIÉS VENTE 1886 EXPOSITIONS PUBLIQUES : Francis Briest, Co-Président Téléphone pendant l’exposition Vendredi 10 décembre Hervé Poulain +33 (0)1 42 99 16 49 de 11h à 19h François Tajan, Co-Président Commisaire priseur Samedi 11 décembre François Tajan de 11h à 19h DIRECTEURS ASSOCIÉS Dimanche 12 décembre Spécialiste junior de 11h à 19h Violaine de La Brosse-Ferrand Benoît Puttemans Martin Guesnet +33 (0)1 42 99 16 49 Lundi 13 décembre Fabien Naudan [email protected] de 11h à 17h VENTE I Experts 14 DÉCEMBRE À 14H30, Olivier Devers LOTS 1 À 420 +33 (0)1 42 99 16 12 [email protected] VENTE II 15 DÉCEMBRE À 14H30, Thierry Bodin LOTS 421 À 717 Pour les lots 4, 6, 13, 14, 19, 20, 22, 30, 32, 43, 48, 51, 52, 54, 60, 70, 75, Catalogue visible sur internet 77, 78, 79, 85, 95, 96, 105, 116. www.artcurial.com +33 (0)1 45 48 25 31 [email protected] Comptabilité vendeurs et acheteurs Marion Carteirac +33 (0)1 42 99 20 44 [email protected] Ordres d’achat, enchères par téléphone Anne-Sophie Masson +33 (0)1 42 99 20 51 [email protected] Détail du lot n° 256 illustration de couverture : détail du lot n° 290 2 Livres et manuscrits — 14–15 DÉCEMBRE 2010, 14H30. -

La Petite Danseuse : Dossier Pédagogique
DOSSIER PÉDAGOGIQUE la petite PONT DES ARTS danseuse CYCLES 2 ET 3 Edgar Degas CLAIRE BÉZAGU AGIR En arrivant à Paris, face à l’Opéra Garnier, Jeanne serre très fort la main de sa mère. Depuis toujours, la petite fille ne rêve que de danse et de musique sautillant de note en note sur des pianos imaginaires. Elle danse la musique, la vit de tout son corps. À travers le récit de Géraldine Elschner et les illustrations d’Olivier Desvaux, réalisées en résidence à l’Opéra, les jeunes lecteurs découvrent l’univers de La Petite Danseuse de quatorze ans. La sculpture de Degas inspire ici un personnage fictionnel qui ressemble à Marie van Goethem, la petite danseuse qui a vraiment existé, dont le rêve absolu est de mêler la danse et la musique, de créer des ballets, de devenir une chorégraphe. Ce dossier pédagogique, destiné aux élèves de cycles 2 et 3, permet d’approcher l’œuvre de Degas et, à travers Directeur de publication Jean-Marie Panazol elle, l’univers de l’Opéra dans le contexte social Directrice de l’édition transmédia et artistique du Paris de la fin du XIXe siècle. Stéphanie Laforge Directeur artistique Samuel Baluret Référentes pédagogiques Sophie Leclercq Patricia Roux Coordination éditoriale Stéphanie Béjian Cheffe de projet Hélène Audard Mise en pages Stéphane Guerzeder Conception graphique DES SIGNES studio Muchir et Desclouds ISSN : 2425-9861 ISBN : 978-2-240-04853-0 © Réseau Canopé, 2019 (établissement public à caractère administratif) Téléport 1 Bât. @ 4 1, avenue du Futuroscope CS 80158 86961 Futuroscope Cedex Tous droits de traduction, de reproduction et d’adap- tation réservés pour tous pays. -

ENGLISH Year 10 a Textbook for the Tenth Form of Secondary Schools
ксана арпюк (10-й рік навчання, рівень стандарту) Підручник для 10го класу закладів загальної середньої освіти Oksana Karpyuk ENGLISH Year 10 A textbook for the tenth form of secondary schools Standard level Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Тернопіль Видавництво Астон” 2018 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua УД 811.111(075.3) 26 наказ МОН України від Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено. — символ, що позначає вправи, які мають аудіосупровід, котрий можна завантажити за посиланням https//www.libra-terra.com.ua/userfi les/audio/ karpiuk-audio-10-klas-ag-2018.ip 26 арюк . Англійська мова (10-й рік навчання) (nglish (the 10th year of studies)) підручник для 10-го класу закладів загальної середньої освіти. Рівень стандарту. — Тернопіль Видавництво Астон”, 2018. — 256 с. іл. IN 978-966-308-710-8 Підручник розпочинає серію навчальних видань рівня стандарту, створених для старшої школи. Видання реалізовує компетентісний потенціал галузі іноземні мови, передбачений програмою, чинною з 2018 року. нтегровані змістові лінії кологічна безпека та сталий розвиток, Громадянська відповідальність, доров’я та безпека та Підприємливість та фінансова грамотність знаходять свою реалізацію в тематиці навчального матеріалу та характері завдань. О. Д. арпюк, 2018 IN 978-966-308-710-8 ТзОВ Видавництво Астон”, 2018 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua Contents pp. 4-5 Scope and Sequence Unit pp. 6-16 Starter Unit 1 pp. -

Mcnay ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors Enjoy a Free Family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the Day at the Mcnay
McNAY ART MUSEUM 2013 | 2015 Annual Report Visitors enjoy a free family John and Peg Emley with Bill Chiego at the Margaritaville at the day at the McNay. McNay Spring Party. Lesley Dill and René Paul Barilleaux, Chief Curator/Curator of Contemporary Art, at the Opening of Lesley Dill: Performance as Art. McNay Second Thursday band plays indie tunes on the Brown Sculpture Terrace. Visitors enjoy a free family day at the McNay. Emma and Toby Calvert at the 60th Sarah E. Harte and John Gutzler at the 60th Anniversary Celebration Anniversary Celebration Visitor enjoys field day activities during a free A local food truck serves up delicious dishes at McNay Second Suhail Arastu at the McNay Gala Hollywood Visions: Dressing the Part. family day at the McNay. Thursdays. Table of Contents Board of Trustees As of December 31, 2015 Letter from the President ................................................................................4 Tom Frost, Chairman Sarah E. Harte, President Letter from the Director ...................................................................................5 Connie McCombs McNab, Vice President Museum Highlights ...........................................................................................6 Lucille Oppenheimer Travis, Secretary Barbie O’Connor, Treasurer Notable Staff Accomplishments ...................................................................10 Toby Calvert Acquisitions ..........................................................................................................13 John W. Feik -

WALLY FINDLAY GALLERIES Dear Friends and Collectors
WALLY FINDLAY GALLERIES Dear Friends and Collectors, Wally Findlay Galleries is pleased to present our most recent e-catalogue, Unbound: Palm Beach, featuring a collection of lithographs, etchings and linocuts celebrating Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan Miro, Alexander Calder, Henry Moore, Alberto Giacometti and Salvador Dali For further information in regards to these works and the current collection, please contact the Palm Beach gallery. We look forward to hearing from you. WALLY FINDLAY GALLERIES 165 Worth Avenue, Palm Beach, FL 33480 (561) 655 2090 [email protected] Henri MATISSE (1869–1954) Matisse considered his drawing to be a very intimate means of expression. The method of artistic execution — whether it was charcoal, pencil, crayon, etcher’s burin, lithographic tusche or paper cut — varied according to the subject and personal circumstance. His favorite subjects were evocative or erotic — the female form, the nude figure or a beautiful head of a favorite model. Other themes relate to the real or imagined world of both Oceania and the Caribbean — the lagoons, the coral and the faces of beautiful women from these far off lands. Matisse worked in various mediums simultaneously—sometimes setting one aside for years, taking it up again when a particular technique offered the possibility of a desired result. Matisse’s etchings and drypoints were executed on a small scale with linear fluidity, giving them a sense of immediacy and spontaneity, like pages in a sketchbook. Alternately, his lithographs were on a larger scale and made grander statements. These lithographs exploited the tonal possibilities of the medium that allowed Matisse to achieve effects of volume and depth. -

NANDALAL BOSE the Doyen of Indian Art DINKAR KOWSHIK
NANDALAL BOSE The doyen of Indian art DINKAR KOWSHIK Contents Forebears and Parents School and College Education Nandalal enters the Magic Circle Early Laurels Discovery of Indian Art At Ajanta Okakura The Poet and the Painter Nandalal and Coomaraswamy Interim Ethical Moorings Far Eastern Voyage Wall Paintings Architecture & Museum Notes on His Paintings Art for the Community Depression Artist of the Indian National Congress A Humane and Kindly Being Nandalal and His Students Nandalal’s Views on Art Gandhiji’s Visit —1945 Admirers and Critics Evening Years I am indebted to the following scholars, authors, colleagues and relatives of Acharya Nandalal Bose for their assistance in assembling material for this book. Their writings and information given during personal interviews have been most helpful: Sri Banabehari Gosh, Sri Biswarup Bose, Sm. Gouri Bhanja, Sm. Jamuna Sen, Sri Kanai Samanta, Sri K.G. Subramanyan, Sri Panchanan Mandal, Sri Rabi Paul, Sri Sanat Bagchi, Sm. Uma Das Gupta, Sm. Arnita Sen. I am grateful to Sri Sumitendranath Tagore for his permission to reproduce Acharya Nandalal’s portrait by Abanindranath Tagore on the cover. I thank Dr. L.P. Sihare, Director, National Gallery of Modern Art, for allowing me to use photographs of Acharya Nandalal’s paintings from the collections in the National Gallery. I record my special gratitude to Sm. Jaya Appasamy, who went through the script, edited it and brought it to its present shape. Santiniketan 28 November 1983 DINKAR KOWSHIK Forebears and Parents Madho, Basavan, Govardhan, Bishandas, Mansur, Mukund and Manohar are some of the artists who worked in the imperial ateliers of Akbar and Jehangir.