VALMONT Rapport Presentation Dernier 7Fev
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Inventaire Des Cavités Souterraines De Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2
Inventaire des cavités souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2 Rapport final BRGM/RP-54790-FR Juin 2006 Inventaire des cavités souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2 Rapport final BRGM/RP-54790-FR Juin 2006 Etude réalisée dans le cadre des opérations de Service public du BRGM 05-RIS-B08 et dans le cadre de la convention CV05000044 R. Couëffé, E. Legris, V. Hugot et J.-F. Pasquet Vérificateur : Approbateur : Nom : Nedellec J.-L. Nom : Pasquet J.-F. Date : 30 juin 2006 Date : 30 juin 2006 Signature : p/o Pasquet J.-F. Signature : Inventaire des Cavités Souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2. Rapport final Mots clés : inventaire, cavité souterraine, carrière souterraine, marnière, cavité naturelle, karst, ouvrage civil, tunnel, effondrement, affaissement, Eure, Seine-Maritime, Haute-Normandie. En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Couëffé R., Legris E., Hugot V., Pasquet J.-F. – Inventaire des Cavités Souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2. Rapport final. Rapport BRGM/RP-54790-FR, 125 p., 9 fig., 7 tabl., 6 ann. © BRGM, 2006, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. Inventaire des Cavités Souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2. Rapport final Synthèse Ce rapport présente les résultats obtenus à la fin juin 2006 dans le cadre de l’« Inventaire des cavités souterraines de Haute-Normandie – Phase 1, Tranche 2 » cofinancé par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) et le BRGM. La région Haute-Normandie est l’une des régions métropolitaines les plus soumises à l’aléa « cavité souterraine ». -

Épreville Nord / Saint-Léonard Sud
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ( ! ! ( ! ! ( ! ! ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ( ! ( ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ! ( ! ( ( ! ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ! ( ( ! ( ( ( ( ! ( ( ! ( ( ( ! 169 168 207 167 165 164 163 60 333 625 348 625 363 249 251 11 113 47 479 97 114 109 170 15 137 160 331 139 ( 175 186 122 352 464 98 117 138 49 506 59 334 364 362 584 104 ! 13 101 349 462 97 372 14 233 176 363 ( 365 480 98 234 177 162 366 250 9 121 51 187 ! 15 97 168 346 124 370 186 344 585 374 ( 13 174 159 505 492 96 472 187 14 503 345 367 140 49 ! 12 ( 510 11 185 161 8 33 48 44 127 5 235 178 125 466 7 ( 117 169 343 365 95 513 ! 7 8 173 493 ( 209 211 158 ( 502 329 94 10 368 ( 9 6 157 342 475 511 367 210 212 184 557 461 364 ( 188 ! ( 2 7 171 179 309 308 430 198 171 504 463 143 AC 1 : Servitude de protection des monuments historiques classés ou inscrits : 5 172 170 494 328 268 190 52 144 ( 156 341 369 191 ! 116 180 ( 183 501 338 ( 179 214 ( 65 ! 213 495 124 339 89 431 91 90 81 ( 340 93 ( ! 182 155 479 189 7 6 2 88 # AC1 ( ( * 181 483 261 4 178 105 102 ! 500 371 172 476 370 76 75 199 1 87 ( ( 154 499 480 556 374 Monu -

N° 012688-01
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE RAPPORT A LA COMMISSION SUPERIEURE DES SITES, PERSPECTIVES ET PAYSAGES Séance du 23 mai 2019 Opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre » Programme d’actions Rapport CGEDD n° 012688-01 établi par Jean-Luc Cabrit Inspecteur de l’Administration du Développement Durable P U B L I É m a i 2019 Courbet - La falaise d'Étretat après l'orage - 1870 – source Wikipédia - Musée d’Orsay Page 2 / 10 Rapport à la commission supérieure des sites, perspectives et paysages du 23 mai 2019 Rapport CGEDD n°012688-01 Opération Grand Site « Falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre » Programme d’actions PUBLIÉ 1. Une falaise emblématique menacée par la fréquentation et l’érosion Le projet d’opération Grand Site (OGS) qui est soumis à l’avis de votre commission 1 porte sur un lieu emblématique de la Normandie et de la Seine-Maritime, qui, de simple village de pêcheurs, est devenu, à partir des années 1840, et avec la construction du chemin de fer, un lieu de villégiature recherché de renommée internationale. On y rencontrait la société mondaine, littéraire, musicale et artistique de l’époque, attirée par l’originalité du site et de ses falaises monumentales de craie blanche, ainsi que par la mode naissante des bains de mer. Les peintres impressionnistes et de nombreuses personnalités y séjournèrent et firent connaître le site, comme Maupassant, Flaubert, Offenbach, et plus récemment, Braque, Picasso, Miró, Cocteau. Le mythe de l’aiguille creuse 2 attire encore les curieux, et les tableaux de Courbet, Boudin, Monet, et bien d’autres, ont forgé notre regard actuel sur la mer, les falaises, et la lu- mière particulière de la Côte d’Albâtre. -

Eletot Epreville Froberville Colleville
Propose le service livraison ou commande à emporter Ne propose pas le service livraison ou commande à emporter COLLEVILLE ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Crèmerie et panier de légumes LA FERME Ouvert le vendredi Commande préférable 06 31 26 84 60 de 15h à 19h et le D’HOUGERVILLE par téléphone ou samedi de 10h à 17h (viande cochon bio) sur www.cochon- lafermehougerville.com ELETOT ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Lundi 8h - 12h30 CROQ'BAR Mardi, mercredi, 06 63 90 82 02 vendredi et samedi : Bar fermé EPICERIE 8h - 18h / Dimanche : 8h30 - 12h30 ETALS Jeudi après-midi Poissonnier et primeur EPREVILLE ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Mardi au dimanche : 02 35 29 06 81 BOULANGERIE 7h - 13h EPICERIE Lundi au dimanche : 02 35 10 05 81 TABAC 7h30 - 12h FROBERVILLE ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Mardi au samedi : 7h30 - 13h / 15h - 19h 02 35 27 32 38 BOULANGERIE Dimanche : 7h30 - 13h EPICERIE Lundi au dimanche : 02 35 28 01 19 TABAC 7h - 19h commandes sur https:// SERRES DE Lundi au samedi : 02 35 28 01 19 www.etsaubry.com. 10h - 12h FROBERVILLE Livraison sous condition GERPONVILLE ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Mardi, mercredi, jeudi : 7h30 - 13h30 / Livraisons dans les 15h30 - 19h30 BOULANGERIE communes à proximité. 02 35 29 83 37 Vendredi et samedi : Epicerie, charcuterie, 7h30 - 19h30 fruits et légumes, gaz Dimanche : 7h30 - 13h30 LES LOGES ENSEIGNE CONTACT HORAIRES COMMANDES LIVRAISONS COMPLÉMENTS Lundi : 14h - 19 h15 Mardi au vendredi : 02 35 27 04 92 PHARMACIE 9h - 12h / 14h - 19h15 Samedi : 9h - 12h CHARCUTERIE - Mardi au samedi : 02 35 27 06 07 Livraison sous condition BOUCHERIE 8h - 18h30 Lundi au samedi Pour les commandes et (jeudi fermé) : 8h 02 35 29 66 73 livraisons, appeler à 7h. -

Liste Des Elus Du Departement De Seine-Maritime
LISTE DES ELUS DU DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME CANTON QUALITE COLLEGE NOM PRENOM MANDATAIRE CP VILLE 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 BELLET MARC 76780 LA HALLOTIERE 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 BULEUX FRANCOISE 76780 NOLLEVAL 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 CAGNIARD PHILIPPE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 DOMONT LYDIE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 GRISEL JEROME 76780 LE MESNIL LIEUBRAY 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 LANCEA PHILIPPE 76220 LA FEUILLIE 01 ARGUEIL SUPPLEANT 1 LETELLIER JEAN-PIERRE 76780 SIGY EN BRAY 01 ARGUEIL TITULAIRE 1 ROHAUT ARMELLE 76780 LA CHAPELLE ST OUEN 02 AUMALE TITULAIRE 1 AVYN SANDRINE 76390 RICHEMONT 02 AUMALE TITULAIRE 1 CHAIDRON GERARD 76390 ELLECOURT 02 AUMALE SUPPLEANT 1 CHOQUART CHRISTOPHE 76390 VIEUX ROUEN SUR BRESLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 COOLS CHRISTOPHE 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE TITULAIRE 1 FERON YOLAINE 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 PINGUET JEAN-JACQUES 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE TITULAIRE 1 POULET NICOLAS 76390 CONTEVILLE 02 AUMALE SUPPLEANT 1 VATTIER JACQUES 76390 RICHEMONT 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 AUBLE CHRISTINE 76730 AVREMESNIL 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 LEVASSEUR BRIGITTE 76730 AVREMESNIL 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 MASSE STEPHANE 76730 BACQUEVILLE EN CAUX 03 BACQUEVILLE EN CAUX TITULAIRE 1 VAILLANT GERALDINE 76730 AUPPEGARD 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 VASSEUR JEAN-BAPTISTE 76730 BACQUEVILLE EN CAUX 03 BACQUEVILLE EN CAUX SUPPLEANT 1 VIARD MARIE-PAULE 76730 AUPPEGARD 04 BELLENCOMBRE SUPPLEANT 1 BARRE GILLES 76680 BELLENCOMBRE 04 BELLENCOMBRE SUPPLEANT 1 DEHONDT -

Rapport D’Activités
Rapport d’activités 2017 Édito Madame, Monsieur, Chers élus, 2017 est la première année d’existence de la nouvelle Agglomération Fécamp Caux Littoral agrandie au 1er janvier, suite à la fusion des intercommunalités de Fécamp et Valmont. Une année test, de transition, d’adaptation et de réflexion pour répondre aux nouveaux enjeux qui se présentent à nous ! Des préparatifs conséquents, notamment administratifs, avaient été menés en amont pour mener à bien et faciliter au mieux cette fusion territoriale. En 2017, il a fallu poser les fondations de la nouvelle intercommunalité, en définissant précisément son champ de compétences et son organisation. Ce travail d’harmonisation se poursuit encore aujourd’hui, afin de mettre en place des services publics homogènes sur l’ensemble du territoire. La loi laisse un délai réglementaire de deux ans pour y parvenir. Nous avons ainsi lancé dès 2017 une profonde réforme pour uniformiser le service de collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire et la qualité environnementale du cadre de vie des habitants. L’Agglomération Fécamp Caux Littoral est la 5ème intercommunalité de Seine-Maritime. En grandissant, elle a gagné en poids et stature, elle a tout pour jouer « dans la cour des grands » ! Nous voulons la faire exister et rayonner largement, à la hauteur de ses atouts ! C’est pourquoi, nous avons engagé une étude économique et touristique visant à définir une stratégie de développement pour les 10 à 15 prochaines années : savoir se positionner et se différencier pour se démarquer sur l’échiquier régional et national ! Trente-deux fiches actions en découlent, que nous avons commencé à décliner pour mettre en œuvre concrètement la stratégie. -

Tronçon Et Cours D'eau Hydrographiques En Seine-Maritime
Tronçon et cours d'eau hydrographiques en Seine-Maritime LE TREPORT EU ETALONDES CRIEL-SUR-MER SAINT-REMY-BOSCROCOURT INCHEVILLE TOCQUEVILLE-SUR-EU Légende de la carte MONCHY-SUR-EU BAROMESNIL ASSIGNY LONGROY Tronçon hydrographique PENLY CANEHAN BRUNVILLE LE MESNIL-REAUME AUQUEMESNIL MELLEVILLE BELLEVILLE-SUR-MER Cours d'eau GRENY SEPT-MEULES BAZINVAL DERCHIGNY SAINT-QUENTIN-AU-BOSC DIEPPE GREGES GOUCHAUPRE ANCOURT AVESNES-EN-VAL GRANDCOURT BLANGY-SUR-BRESLE Limite de commune HAUTOT-SUR-MER BAILLY-EN-RIVIERE QUIBERVILLE ENVERMEU DANCOURT FRESNOY-FOLNY LONGUEIL PIERRECOURT ARQUES-LA-BATAILLE PREUSEVILLE LE BOURG-DUN OFFRANVILLE DOUVREND HODENG-AU-BOSC FALLENCOURT SAINT-VALERY-EN-CAUX AMBRUMESNIL BLOSSEVILLE MARTIGNY WANCHY-CAPVAL SMERMESNIL CAMPNEUSEVILLE PALUEL INGOUVILLE AUBERMESNIL-BEAUMAIS GUEURES FOUCARMONT CAILLEVILLE LA GAILLARDE ANNEVILLE-SUR-SCIE MEULERS AUBERVILLE-LA-MANUEL ANGIENS LONDINIERES NEVILLE SAINT-MARTIN-AU-BOSC PLEINE-SEVE FREAUVILLE CALLENGEVILLE BUTOT-VENESVILLE BRACHY FONTAINE-LE-DUN BERTREVILLE-SAINT-OUEN FREULLEVILLE VILLERS-SOUS-FOUCARMONT SASSETOT-LE-MAUCONDUIT CRASVILLE-LA-MALLET BAILLEUL-NEUVILLE AUBERMESNIL-AUX-ERABLES AUBEGUIMONT ANCRETTEVILLE-SUR-MER CLASVILLE DROSAY AUTIGNY SAINTE-FOY BACQUEVILLE-EN-CAUX OSMOY-SAINT-VALERY ELLECOURT CANY-BARVILLE BAILLOLET FESQUES ANGLESQUEVILLE-LA-BRAS-LONG CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE BIVILLE-LA-RIVIERE LANDES-VIEILLES-ET-NEUVES ANGERVILLE-LA-MARTEL BURES-EN-BRAY HAUTOT-L'AUVRAY BELMESNIL LES CENT-ACRES LUCY LE CAULE-SAINTE-BEUVE AUMALE COLLEVILLE BERTHEAUVILLE BOSVILLE -

Bulletin Municipal N°30
Thérouldeville …à propos BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 30 - JANVIER 2019 2018 en images VIE MUNICIPALE VIVRE ENSEMBLE ASSOCIATIONS INFOS INTERCOMMUNALES www.therouldeville.com Une expérience et un savoir-faire transmis dans notre famille depuis 1890 COUVERTURE A votre service BECHET 24h/24 COMPAGNONS Travail de qualité Respect des traditions 76540 THEROULDEVILLE Route de Bosville - 76450 Cany-Barville 02 35 97 73 55 02 35 29 82 04 Rue B. Thélu - 76640 Fauville-en-Caux 05 35 97 73 55 al SARL Daniel Grancher - Siret 349 947 036 00019 - 452J 3, place du G Leclerc - 76400 Fécamp 05 35 28 97 15 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION N° 30 - JANVIER 2019 Alain Coufourier Sarl FAUVEL COUVERTURE Zinguerie - Etanchéité QUALITÉ et SERVICE à DOMICILE Joël : 06 70 88 00 55 DÉCRET DU 2 FEVRIER 1988 [email protected] Thérouldeville : 02 35 29 28 34 Prêt-à-porter Homme-Femme Vêtements de travail Angerville-la-Martel : 02 35 29 82 69 Linge de maison ZA route de Sassetot TELEPHONE / FAX 02 35 27 64 54 76540 THEROULDEVILLE PORTABLE 06 24 36 13 84 mail : [email protected] - fax : 02 35 27 81 94 Madame, Monsieur, L’atmosphère frénétique des fêtes de fin d’année s’est progressivement estompée... laissant place aux résolutions de la nouvelle année. En 2019, les élus de Thérouldeville ont l’ambition de maintenir le cap pour continuer d’offrir un cadre de vie meilleur aux habitants du village. Faire avancer Thérouldeville - en développant ses potentialités - demeure, en effet, notre priorité : terminer - comme il se doit - les travaux de la rue -

Commune 76550 AMBRUMESNIL 76560 AMFREVILLE-LES
Commune 76550 AMBRUMESNIL 76560 AMFREVILLE-LES-CHAMPS 76370 ANCOURT 76560 ANCOURTEVILLE-SUR-HERICOURT 76740 ANGIENS 76280 ANGLESQUEVILLE-L'ESNEVAL 76560 ANVEVILLE 76780 ARGUEIL 76880 ARQUES-LA-BATAILLE 76630 ASSIGNY 76390 AUBEGUIMONT 76630 AUQUEMESNIL 76690 AUTHIEUX-RATIEVILLE 76740 AUTIGNY 76190 AUTRETOT 76640 AUZOUVILLE-AUBERBOSC 76760 AUZOUVILLE-L'ESNEVAL 76630 AVESNES-EN-VAL 76660 BAILLEUL-NEUVILLE 76660 BAILLOLET 76630 BAILLY-EN-RIVIERE 76190 BAONS-LE-COMTE 76260 BAROMESNIL 76340 BAZINVAL 76440 BEAUBEC-LA-ROSIERE 76850 BEAUMONT-LE-HARENG 76870 BEAUSSAULT 76890 BEAUTOT 76890 BEAUVAL-EN-CAUX 76220 BEAUVOIR-EN-LYONS 76110 BEC-DE-MORTAGNE 76680 BELLENCOMBRE 76890 BELLEVILLE-EN-CAUX 76590 BELMESNIL 76110 BENARVILLE 76560 BENESVILLE 76640 BENNETOT 76640 BERMONVILLE 76370 BERNEVAL-LE-GRAND 76210 BERNIERES 76450 BERTHEAUVILLE 76450 BERTREVILLE 76590 BERTREVILLE-SAINT-OUEN 76890 BERTRIMONT 76560 BERVILLE 76190 BETTEVILLE 76450 BEUZEVILLE-LA-GUERARD 76750 BIERVILLE 76630 BIVILLE-SUR-MER 76750 BOIS-GUILBERT 76750 BOIS-HEROULT 76190 BOIS-HIMONT 76160 BOIS-L'EVEQUE 76750 BOISSAY 76790 BORDEAUX-SAINT-CLAIR 76680 BOSC-BERENGER 76750 BOSC-BORDEL 76750 BOSC-EDELINE 76710 BOSC-GUERARD-SAINT-ADRIEN 76850 BOSC-LE-HARD 76680 BOSC-MESNIL 76750 BOSC-ROGER-SUR-BUCHY 76450 BOSVILLE 76560 BOUDEVILLE 76270 BOUELLES 76760 BOURDAINVILLE 76740 BOURVILLE 76360 BOUVILLE 76850 BRACQUETUIT 76680 BRADIANCOURT 76740 BRAMETOT 76110 BREAUTE 76110 BRETTEVILLE-DU-GRAND-CAUX 76560 BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT 76630 BRUNVILLE 76270 BULLY 76660 BURES-EN-BRAY 76890 BUTOT 76450 -

Liste Des Maires Du Département De La Seine-Maritime Mise À Jour Au 07 Juillet 2020 – Celle Liste N’Est Pas Exhaustive
Liste des maires du département de la Seine-Maritime Mise à jour au 07 juillet 2020 – Celle liste n’est pas exhaustive. -
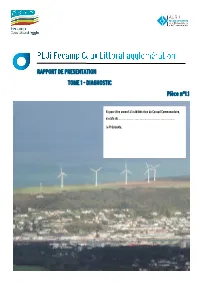
RAPPORT DE PRESENTATION TOME 1 - DIAGNOSTIC Pièce N°1.1
RAPPORT DE PRESENTATION TOME 1 - DIAGNOSTIC Pièce n°1.1 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire, en date du …………………………………………………………… La Présidente, SOMMAIRE ÉLÉMENTS DE CONTEXTE ET DOCUMENTS DE CADRAGE ................................................................................................................................. 5 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE ........................................................................................................................................ 7 DOCUMENTS D’URBANISME EN VIGUEUR ....................................................................................................................................................... 9 ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS DE RANG SUPÉRIEUR .................................................................................................................. 11 1 Le SCOT des Hautes Falaises ....................................................................................................................................................... 12 2 Le schéma départemental des carrières de Seine-Maritime ............................................................................................ 21 3 Le SRCE Haute Normandie ........................................................................................................................................................... 23 4 Le SDAGE Seine Normandie ........................................................................................................................................................ -

Saint Léonard Services
Saint-Léonard et vous... Bulletin municipal d’informations Juin 2019 www.saint-leonard.fr Sommaire n°151 Le Fournil D’Albâtre 472, route d’Etretat FROBERVILLE 02 35 27 32 38 Pain Sur Levain - Pain du Matelot Baguette de Tradition - “La Normande“ OUVERT 7h-13h30 / 15h-19h - Fermeture hebdomadaire Le Lundi - OUVERT les LUNDIS FERIES - JUILLET/AOUT 7/7 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - DÉPANNAGE - ENTRETIEN Roger ODIEVRE Entrepreneur de Parcs et Jardins 38, rue André-Paul Leroux 76400 FÉCAMP 76110 Bretteville-du-Grand-Caux Tél. 02 35 27 91 10 02 35 28 27 20 [email protected] SIÈGE AGENCE DU CALVADOS ZA les Sapins 83 Rue du Lieu Doré 76110 BREAUTE 14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE Tél. 02 35 38 26 19 Tél. 02 31 61 76 40 Fax 02 35 31 26 55 Fax 02 31 61 58 41 [email protected] Chambres d’hôtes et gîtes Eclairage Public - Illuminations Electrification Rurale Réseaux HTA – BTA Réseaux Incendie - Réseaux Eau Potable Réseaux Assainissement – Réseaux GAZ Entreprise fondée en 1978 Electricité générale Bâtiment - Industrie FECAMP ELEC Agriculture SARL Ludovic Vasseur SAINT-LÉONARD 76400 FÉCAMP Neuf - Rénovation Tél. 02 35 28 15 76 Cablage informatique - Alarme Fax 02 35 27 40 17 Chauffage électrique - Magasins [email protected] 2 Dépannage - Chauffe eau électrique Chères Saint-Léonardaises, Vie municipale Chers Saint-Léonardais, · Travaux ....................................................................................... 2 · Parc de la Chapelle ............................................................. 3 Édito · Boîtes à livres .......................................................................... 3 2019 sera une année marquée par des mouvements sociaux inédits, des événements atypiques · Le panneaux lumineux.......................................................... 3 comme l’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris et une prise de conscience des · Aménagement centre bourg ...........................................