PPR Sur La Commune De VEYRIER-DU-LAC……
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Assemblée Générale 2019
1 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 14 mars 2019 Rapport moral 01/01/2018 au 31/12/2018 2 Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein 74 [email protected] - www.cancerdusein-depistage74.org Au cours de l'exercice 2018, le Comité Féminin 74 a poursuivi, à destination du public, ses actions d'information sur l’importance du dépistage précoce du cancer du sein. Le cancer du sein, premier cancer féminin, touche 1 femme sur 8. Identifié comme un problème de santé publique, un programme de dépistage organisé a été mis en œuvre par l’Etat. Le dépistage est une démarche qui vise à détecter, au plus tôt, en l’absence de symptômes, des lésions susceptibles d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer. Il constitue l’une des armes les plus efficaces contre le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein non seulement peut être guéri dans 90% des cas, mais aussi être soigné par des traitements moins agressifs entraînant moins de séquelles. Le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en Haute-Savoie s’est inscrit dans cette démarche de prévention. L’objet principal du Comité est en effet de sensibiliser les Femmes de tous âges et le public en général à l’importance d’un dépistage précoce, grâce à la mammographie, pour optimiser les chances de guérison. Le Comité Féminin adhère à la Fédération Nationale des Comités pour le dépistage des cancers et participe à son Conseil d’administration. Il est membre de l’OSDC – Œuvre Sociale pour le Dépistage des Cancers de la Caisse Primaire d’Assurance maladie de Haute-Savoie, réseau de dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. -

Guide Des Transports Interurbains Et Scolaires De La Haute-Savoie
2018 Guide des Transports interurbains et scolaires Haute-Savoie Guide des transports interurbains et scolaires 2018 - Haute-Savoie Sommaire Les points d’accueil transporteurs Les points d’accueil transporteurs ................ p. 3 TRANSDEV HAUTE-SAVOIE SAT - PASSY • ANNECY • PAE du Mont-Blanc 74190 PASSY Siège social - 10 rue de la Césière Tél : 04 50 78 05 33 Z.I. de Vovray 74600 ANNECY • Gare routière de Megève 74120 MEGÈVE Tél : 04 50 51 08 51 Tél : 04 50 21 25 18 Les points d’accueil transport scolaire .......... p. 4 Gare routière - 74000 ANNECY • Gare routière de Saint-Gervais le Fayet Tél : 04 50 45 73 90 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS • THÔNES Tél : 04 50 93 64 55 Gare routière - 2 route du Col des Aravis • Gare routière de Sallanches 74230 THÔNES 74700 SALLANCHES Les localités desservies ................................p. 5-7 Tél : 04 50 02 00 11 Tél : 04 50 58 02 53 • LE GRAND-BORNAND SAT - THONON Gare routière 74450 LE GRAND-BORNAND • Gare routière place des Arts Tél : 04 50 02 20 58 74200 THONON-LES-BAINS La carte des lignes ..................................... p. 8-9 • LA CLUSAZ Tél : 04 50 71 85 55 Gare routière - 39 route des Riondes • AUTOCARS SAT Siège social 74220 LA CLUSAZ 5 rue Champ Dunand Tél : 04 50 02 40 11 74200 THONON-LES-BAINS • THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 71 00 88 La carte Déclic’ ............................................. p. 10 Boutique transport place des Arts • Gare routière de Morzine 74110 MORZINE 74200 THONON-LES-BAINS Tél : 04 50 79 15 69 Tél : 04 50 81 74 74 • Bureau SAT Châtel 74390 CHÂTEL • GENÈVE Tél : 04 50 73 24 29 Gare routière place Dorcière GENÈVE (Suisse) sat-autocars.com Tél : 0041 (0)22/732 02 30 Car+bus ticket gagnant ................................ -

La Plage Avec Style Farniente Pique-Nique Fashion
N° 4 TENDANCES Tissus outdoor Milan 2014 : les nouveautés DANS L'AIR DU TEMPS Esprit barbecue traits ÉDITION ANNECY La plage avec style FARNIENTE PIQUE-NIQUE FASHION DOSSIER SPÉCIAL LAc d’ANNECY 30 adresses coups de cœur entre lac et montagne 23 juin / 15 septembre 2014 2014 23 juin / 15 septembre 3 R 29177 782917 - 001 F : 4 703508 3,50 Votre sommaire nouveau magasin à Annemasse © ci-contre : Savoie Mont Blanc / Lansard ; panier sur vélo Variopinte 28 Centre Commercial D’co NEWS 7 Coups de cœur et produits phare, Cap Bernard notre sélection au parfum de l'été... 6 rue de Montreal PARTI PRIS traits D’co, le magazine Archi déco 51 74100 Ville-la-Grand de votre région / Edition Annecy 10 Tissus d'extérieur : techniques et stylés Directeur de la publication : Vincent Maurer. tendances DECO [email protected] ALBIGNY-PETIT PORT / ANNECY-LE-VIEUX Rédactrice en chef : Cathy Maurer. Le lac d’Annecy partait à vau l’eau, il est aujourd’hui le plus pur d’Europe grâce Rédaction : Caroline Lavergne (SD Consult), aux efforts conjugués des collectivités et de la population. VISITE PRIVÉE / ARCHI DÉCO traits Louise Raffin-Luxembourg, Vincent Louvigne. NOUVEAU BÂTIMENT Les pratiques nautiques, la faune et la 14 Une villa graphique flore sont surveillées comme le lait sur le Secrétaire de rédaction : Marie Nicolas. feu et c’est dans un décor limpide que s’étendent langoureusement nos plages GENÈVE [email protected] à Annecy-le-Vieux de sable, d’herbe et de galets. FLÂNEZ Le programme de l’été ? Bronzette, bai- Création graphique : Marie Augoire. -

Bassin Albanais – Annecien
TABLEAU I : BASSIN ALBANAIS – ANNECIEN COLLEGES COMMUNES ET ECOLES René Long ALBY -SUR -CHERAN ; ALLEVES ; CHAINAZ -LES -FRASSES ; CHAPEIRY ; CUSY ; GRUFFY ; HERY -SUR -ALBY ; MURES ; SAINT - ALBY-SUR-CHERAN SYLVESTRE ; VIUZ-LA-CHIESAZ Les Balmettes ANNECY - Annecy : groupes scolaires Vaugelas, La Prairie, Quai Jules Philippe (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY Départemental ou collège) ANNECY- Annecy : groupes scolaires Carnot, La Plaine (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) , Le Raoul Blanchard Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Les Romains, Quai Jules Philippe (selon un ANNECY- ANNECY listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège) Les Barattes ANNECY- Annecy : groupes scolaires Le Parmelan (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège); ANNECY- Annecy-le-Vieux (selon un listing de rues ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX précis – cf. Conseil Départemental ou collège); BLUFFY ; MENTHON-SAINT-BERNARD ; TALLOIRES-MONTMIN ; VEYRIER-DU-LAC ANNECY-Annecy : groupes scolaires Vallin-Fier (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), La Plaine Evire (selon un listing de rues précis – cf. Conseil Départemental ou collège), Novel (selon un listing de rues précis – cf. Conseil ANNECY- ANNECY-LE-VIEUX Départemental ou -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial Du 06/07/2009
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS année 2009 date de parution 6 juillet 2009 ISSN 07619618 spécial Sommaire DELEGATIONS DE SIGNATURE...............................................................................................................................................3 Arrêté n° DDEA-2009-530 du 1er juillet 2009........ ................................................................................................................3 Objet : subdélégation de signature du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture (DDEA).....................3 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................6 Objet : portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, en matière de compétence générale...............................................................................................................................6 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................8 Objet : portant subdélégation de signature de M. Denis HIRSCH, directeur interdépartemental des Routes Centre-Est, pour l'exercice des compétences d'ordonnateur secondaire délégué..............................................................................8 Arrêté du 18 juin 2009..........................................................................................................................................................9 -

Inventaire Départemental Des Cavités Souterraines Hors Mines —R De La Haute-Savoie ' Rapport Final Convention MEDD N° CV04000065
•••, «> i, Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines —r de la Haute-Savoie ' Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 ^ BRGM/RP-54130-FR V..,L , Septembre 2006 \ \ ' - - • :'11 ' "".. /^/ " -•/•..•'' F.9 3740/c-.t -615 5 l* íiwlii. RÉriJSLIQUt F brgGéosciencesm pour une Terre durable JÖ» Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Rapport final Convention MEDD n° CV04000065 BRGM/RP-54130-FR Septembre 2006 Étude réalisée dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2005 PSP04RHA06 O. Renault Avec la collaboration de D. Clairet Vérificateur : Approbateur : Nom : C. Lembezat Nom : F. Deverly Date : 12/10/06 Date : 14/11/06 Signature : Signature : Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2000. BRGM Geosciences pour une lene durable 2 0 DEC. 2006 BIBLIOTHEQUE brgm Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Mots clés : base de données, inventaire, département de la Haute-Savoie, cavités souterraines, cavités naturelles, carrières souterraines abandonnées, ouvrages civils et militaires En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : O. Renault avec la collaboration de D. Clairet (2006) - Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie. Rapport final. BRGM/RP-54130-FR, 47 p., 27 ill., 3 ann., 1 carte hors texte ® BRGM, 2006, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. BRGM/RP-54130-FR - Rapport final Inventaire départemental des cavités souterraines hors mines de la Haute-Savoie Synthèse Dans le cadre de la constitution d'une base de données nationale des cavités souterraines, le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD), a chargé le BRGM de réaliser l'inventaire des cavités souterraines abandonnées hors mines dans le département de la Haute-Savoie (Convention MEDD n° CV04000065). -

Liste Des Vidangeurs Agréés Pour La Réalisation De Vidanges, La Prise En Charge Du Transport Et L'élimination Des Matières
Liste des vidangeurs agréés pour la réalisation de vidanges, la prise en charge du transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif Haute-Savoie Mise à jour : 15 octobre 2015 Société Adresse N° agrément N° arrêté Fin de validité préfectoral de l'agrément 7 rue des Chasseurs – 74100 VILLE LA SAS THERMOZ 2011-N-S-74-0001 2011017-0037 17-01-2021 GRAND SACP 1021 rue de la Centrale – 74190 PASSY 2011-N-S-74-0002 2011017-0038 17-01-2021 181 rue des Courchamps - ZI les Bracots – ICART SAS 2011-N-S-74-0003 2011017-0039 17-01-2021 BP 8 – 74890 BONS EN CHABLAIS ZA Malchamps – 46 Allée des Prêles – SARL G. HOMINAL 2011-N-S-74-0004 2011017-0040 17-01-2021 74160 FEIGERES ARVE ALPES ZAE du bord d'Arve – 952 rue Claude ASSAINISSEMENT 2011-N-S-74-0005 2011017-0041 17-01-2021 Ballaloud – 74950 SCIONZIER SARL DECARROZ 313 route des Chapelles – 74410 SAINT 2011-N-S-74-0006 2011017-0042 17-01-2021 ASSAINISSEMENT JORIOZ Route de l'Arny -74350 ALLONZIER LA SARP CENTRE EST 2011-N-S-74-0007 2011017-0043 17-01-2021 CAILLE SARL DEGEORGES TP Mougny – 74270 CHILLY 2011-N-S-74-0008 2011024-0014 24-01-2021 EURO 119 chemin de la Coudre – 74460 2011-M-S-74-0009 2015041-0023 24-01-2021 ASSAINISSEMENT 74 MARNAZ Ferme la Gentiane Bleue – Les Galfas – Pierre CREDOZ 2011-N-A-74-0010 2011024-0016 24/01/2021 74230 LES CLEFS ISS HYGIENE ET 3 Allée des Nielles – 74600 SEYNOD 2011-N-S-74-0011 2011040-0014 9-02-2021 PREVENTION 844 route des Tattes de Borly – 74380 BORCAD SUD-EST 2011-N-S-74-0012 2011040-0015 9-02-2021 CRANVES SALES -
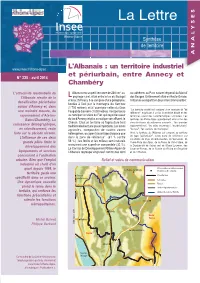
L'albanais : Un Territoire Industriel
La Lettre Synthèse de territoire A N A L Y S E S L Y S A N A L'Albanais : un territoire industriel N° 225 - avril 2014 et périurbain, entre Annecy et Chambéry L'attractivité résidentielle de 'Albanais est un petit territoire de 268 km2 au six adhèrent au Parc naturel régional du Massif l'Albanais résulte de la L paysage rural, situé entre le lac du Bourget des Bauges. Entièrement situé en Haute-Savoie, densification périurbaine et le lac d'Annecy. Il se compose d'une pénéplaine, l'Albanais se répartit en deux intercommunalités : bordée à l'est par la montagne du Semnoz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- autour d'Annecy et, dans (1 700 mètres), et à l'ouest par celles du Gros 1 Le territoire étudié est comparé à un territoire dit "de une moindre mesure, du Foug et de Cessens (1 000 mètres). Il est parcouru référence", englobant à la fois le territoire étudié et des rayonnement d’Aix-les- au nord par la rivière du Fier, qui reçoit les eaux territoires ayant des caractéristiques similaires. Les Bains/Chambéry. La du lac d'Annecy, et plus au sud par son affluent, le territoires de Rhône-Alpes appartiennent ainsi à l'un des croissance démographique, Chéran. C'est un territoire où l'agriculture tient cinq territoires de référence suivants : "les grandes traditionnellement une place importante. Les terres agglomérations", "les villes moyennes", "le périurbain", en ralentissement, reste agricoles, composées de vastes zones "le rural", "les stations de montagne". forte sur la période récente. hétérogènes, occupent davantage d'espace que Ainsi, le territoire de l'Albanais est comparé au territoire dans la zone de référence1 (61 % contre de type "périurbain". -

Aménagement Des Rd 3508 Nord Et Rd 1508 : Des Routes Plus Sûres Plus Fluides
w DOSSIER DE PRESSE OCTOBRE 2019 AMÉNAGEMENT DES RD 3508 NORD ET RD 1508 : DES ROUTES PLUS SÛRES PLUS FLUIDES CONTACTS PRESSE Cécile Menu - 06 89 19 46 62 Leslie Gros - 06 74 25 76 63 site : hautesavoie.fr @htesavoiepresse [email protected] DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE P.03 DES AXES SATURÉS QUI DOIVENT ÊTRE ADAPTÉS À LA HAUSSE DU TRAFIC P.04 Des travaux qui s’inscrivent dans un projet global d’aménagement Des routes plus fluides et plus sûres L’impact des travaux sur la circulation limité au maximum 2 MISE À 2 X 2 VOIES DE LA RD 3508 NORD ENTRE LES ÉCHANGEURS DE GILLON ET DE L’HÔPITAL P.06 AMÉNAGEMENT DE LA RD 1508 ENTRE LA BALME DE SILLINGY ET L’ÉCHANGEUR DE GILLON P.09 ROUTES : LE DÉPARTEMENT FORTEMENT INVESTI P.12 Les routes départementales 3508 nord et 1508 DE NOUVEAUX sont des axes routiers structurants pour la desserte du bassin d’Annecy qui font déjà face AMÉNAGEMENTS à un phénomène de saturation. POUR ACCOMPAGNER Compte tenu du développement et de l’urba- nisation à venir du territoire traversé, et des projections qui font état d’une augmentation si- LE DEVELOPPEMENT gnificative du trafic au cours des 20 prochaines années, le Département de la Haute-Savoie et DU TERRITOIRE le Grand Annecy ont décidé renforcer la capa- cité de ces infrastructures. 3 Les travaux d’aménagement qui vont s’enga- ger dès cette fin d’année et qui s’achèveront d’ici 2023 permettront aux usagers de bénéfi- cier de routes plus fluides et plus sûres. -

La Ronde De Doussard Classement De L'épreuve
La Ronde de Doussard Classement de l'épreuve Clt Dos. Nom et prénom Ville Club Catégorie (Clt) Sexe Clt Sexe Temps Ecart Ronde 7,7 km 1 528 BELLATON Mathias SEVRIER Ahsa Seniors Homme (1) Homme (1) 27:42.513 2 418 GUIGARD Jeff VEYRIER DU LAC Team Mermillot Triathlon Vétéran 1 Homme (1) Homme (2) 27:53.773 11.260 3 475 MOCELLIN Grégory SEVRIER Staubli Sport Seniors Homme (2) Homme (3) 28:07.582 25.069 4 567 MAHUT Paul LA ROCHE Entente Athlétique Grenoble Juniors Homme (1) Homme (4) 28:23.439 40.926 5 564 COTTENAU Sébastien ANNECY LE VIEUX Seniors Homme (3) Homme (5) 28:30.328 47.815 6 533 MEPAL Joel ANNECY Seniors Homme (4) Homme (6) 28:40.742 58.229 7 517 PASTUREL Thomas ANNECY LE VIEUX Seniors Homme (5) Homme (7) 28:46.700 1:04.187 8 521 CHAUVETET Paul RUMILLY Espoirs Homme (1) Homme (8) 29:02.658 1:20.145 9 544 LUISET Charlie SILLINGY Espoirs Homme (2) Homme (9) 29:15.153 1:32.640 10 511 LARRIEU David VIUZ LA CHIESAZ Asptt Annecy Seniors Homme (6) Homme (10) 29:44.686 2:02.173 11 487 BERTHE Benoît ANNECY Les Alligators Seniors Homme (7) Homme (11) 30:21.315 2:38.802 12 485 DUSANTER Frederic POISY Asl Salomon Vétéran 1 Homme (2) Homme (12) 30:29.564 2:47.051 13 402 DAVID Frédéric ANNECY LE VIEUX Avoc Vétéran 2 Homme (1) Homme (13) 30:55.373 3:12.860 14 432 DEMICHELIS Nicolas VIEUGY Vétéran 1 Homme (3) Homme (14) 31:13.970 3:31.457 15 559 ARNAUD Cédric EPAGNY Seniors Homme (8) Homme (15) 31:20.074 3:37.561 16 562 DURAND Mathieu POISY Seniors Homme (9) Homme (16) 31:20.712 3:38.199 17 445 MANSORD Fabien UGINE Juniors Homme (2) Homme (17) -

Liste Des Regroupements De Communes
ANNEXE 6 Liste des regroupements de communes Regroupement de communes : SEYSSEL / FRANGY Communes Secteur collège IEN BASSY SEYSSEL RUMILLY CHALLONGES SEYSSEL RUMILLY CHESSENAZ FRANGY RUMILLY CHILLY FRANGY RUMILLY CLARAFOND FRANGY RUMILLY CLERMONT SEYSSEL RUMILLY DESINGY SEYSSEL RUMILLY ELOISE FRANGY RUMILLY FRANCLENS SEYSSEL RUMILLY FRANGY FRANGY RUMILLY MARLIOZ FRANGY RUMILLY MENTHONNEX CLERMONT SEYSSEL RUMILLY MINZIER FRANGY RUMILLY SEYSSEL SEYSSEL RUMILLY USINENS SEYSSEL RUMILLY Regroupement de communes : CRUSEILLES / GROISY Communes Secteur collège IEN ALLONZIER LA CAILLE CRUSEILLES ST JULIEN ANDILLY CRUSEILLES ST JULIEN CERCIER CRUSEILLES ST JULIEN CERNEX CRUSEILLES ST JULIEN CHARVONNEX GROISY BONNEVILLE 2 COPPONEX CRUSEILLES ST JULIEN CRUSEILLES CRUSEILLES ST JULIEN CUVAT CRUSEILLES ST JULIEN FILLIERES Aviernoz GROISY BONNEVILLE 2 Evires GROISY BONNEVILLE 2 Les Ollières GROISY BONNEVILLE 2 Saint Martin Bellevue GROISY BONNEVILLE 2 Thorens Glières GROISY BONNEVILLE 2 GROISY GROISY BONNEVILLE 2 MENTHONNEX EN BORNES CRUSEILLES ST JULIEN VILLAZ GROISY BONNEVILLE 2 VILLY LE BOUVERET CRUSEILLES ST JULIEN VILLY LE PELLOUX GROISY ST JULIEN VOVRAY EN BORNES CRUSEILLES ST JULIEN Regroupement de communes : RUMILLY / ALBY SUR CHERAN Communes Secteur collège IEN ALBY SUR CHERAN ALBY SUR CHERAN RUMILLY ALLEVES ALBY SUR CHERAN RUMILLY BLOYE RUMILLY Le Chéran RUMILLY BOUSSY RUMILLY Clergeon RUMILLY CHAINAZ LES FRASSES ALBY SUR CHERAN RUMILLY CHAPEIRY ALBY SUR CHERAN RUMILLY CUSY ALBY SUR CHERAN RUMILLY ETERCY RUMILLY Clergeon RUMILLY GRUFFY ALBY -

Etablissements-ER2013-RECAPITULATIF-ECOLES PUBLIQUES
ÉCOLES SECTEUR PUBLIC-ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS 2012-2013 BASSIN COMMUNE SECTEUR DE COLLÈGE Nom Enseignant Référent NAT NOM DE L'ÉCOLE secteur Enseignant Référent CHABLAIS ABONDANCE ABONDANCE MERCIER GALLAY KARINE PRIM ABONDANCE EVIAN ANNECY ALBY-SUR-CHERAN ALBY CHERAN DUBOURVIEUX JEAN-LOUIS ELEM LE BOURG CRAN ANNECY ALBY-SUR-CHERAN ALBY CHERAN DUBOURVIEUX JEAN-LOUIS MAT ALBY-SUR-CHERAN CRAN ANNECY ALEX THONES PHILIPONA ELISABETH PRIM THURIN ANNECY EST ANNECY ALLEVES ALBY CHERAN DUBOURVIEUX JEAN-LOUIS ELEM ALLEVES CRAN CHABLAIS ALLINGES THONON - ROUSSEAU COULON THIERRY PRIM LA CHAVANNE THONON EST GENEVOIS ALLONZIER-LA-CAILLE CRUSEILLES AMOUDRUZ AURENCE ELEM ALLONZIER-LA-CAILLE SAINT JULIEN GENEVOIS ALLONZIER-LA-CAILLE CRUSEILLES AMOUDRUZ AURENCE MAT ALLONZIER-LA-CAILLE SAINT JULIEN ARVE AMANCY LA ROCHE FORON BEAL MARIANNE ELEM AMANCY GAILLARD ARVE AMANCY LA ROCHE FORON BEAL MARIANNE MAT LES 3 LUTINS GAILLARD GENEVOIS AMBILLY GAILLARD - PREVERT BEAL MARIANNE ELEM LA PAIX GAILLARD GENEVOIS AMBILLY GAILLARD - PREVERT BEAL MARIANNE MAT LA PAIX GAILLARD GENEVOIS AMBILLY GAILLARD - PREVERT BEAL MARIANNE PRIM LA FRATERNITE GAILLARD GENEVOIS ANDILLY CRUSEILLES AMOUDRUZ AURENCE PRIM ANDILLY SAINT JULIEN ANNECY ANNECY ANNECY-BLANCHARD PIATON CENDRINE ELEM LA PLAINE ANNECY SUD ANNECY ANNECY ANNECY-BLANCHARD PIATON CENDRINE ELEM CARNOT ANNECY SUD ANNECY ANNECY ANNECY LE VIEUX - EVIRE PHILIPONA ELISABETH ELEM NOVEL ANNECY EST ANNECY ANNECY ANNECY LE VIEUX - BARATTES PHILIPONA ELISABETH ELEM PARMELAN - SALOMONS ANNECY EST ANNECY ANNECY ANNECY-BALMETTES