Découvrir Les Villages Du Vent Des Forêts
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sec Civ 1328711366.Pdf
PREFECTURE DE LA MEUSE Service interministériel de défense et de protection civile Liste des DAE* /DSA** opérationnels (tout public et réservé aux personnels) Ancerville Centre de secours 1 Andernay Porche de la mairie 1 Bar-le-Duc Leclerc 1 Bar-le-Duc A.L Médical 1 Bar-le-Duc La Poste : centre courrier+ plateforme coliposte 3 Bar-le-Duc Sté d'ambulances AGUIR 2 Bar-le-Duc Sté Ambulances barisiennes 9 Bar-le-Duc Maison de retraite Blanpain 1 Bar-le-Duc Conseil départemental de la Croix Rouge 1 Bar-le-Duc Piscine 1 Bar-le-Duc Préfecture 1 Bar-le-Duc Inspection académique 1 Bar-le-Duc Direction départementale des territoires 1 Bar-le-Duc Lycées : Poincaré, Lycée Richier, Zola, EPL 4 AGRO Bar-le-Duc Hôpital 11 Bar-le-Duc Clinique du Parc 3 Bar-le-Duc Jeunesse et Sports/DDCSPP 1 Bar-le-Duc CPAM 1 Bar-le-Duc Sdis 2 Bar-le-Duc Conseil Général - Accueil de l'hôtel du 1 département Bar-le-Duc Fromagerie BEL 1 Beausite Centre de secours 1 Behonne Mairie 1 Belleville sur Meuse Pharmacie 1 Belleville sur Meuse Jean Dailly Ambulances 1 Beney en Woëvre Mairie 1 Beurey sur Saulx Centre de secours – Mairie 2 Biencourt sur Orge Gite communal de randonnée 1 Billy sous les Côtes Mairie 1 Billy sous Mangiennes Mairie 1 Boncourt sur Meuse Mairie 1 Bouchon sur Saulx (Le) Mairie 1 Bouligny Mairie 1 Bouligny Centre de secours 1 Bovée sur Barboure Mairie 1 Brabant le Roi Porche de la mairie 1 Bras sur Meuse MFR 1 Brauvillers Mairie 1 Bure Mairie 1 Charny sur Meuse Bechamp ambulances 1 Clermont en Argonne Maison de retraite 1 Clermont en Argonne Centre de secours -
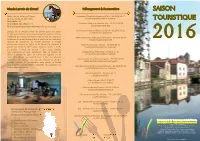
Depliant ST 11 CORRIGE V3.Indd
Musée Lorrain du Cheval Hébergement & Restaurati on SAISON Dates : du 1er juillet au 31 août, Chambres d’Hôtes des Bords de la Tour – 03 29 89 63 57 sauf les mardis, de 14h à 18h 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU TOURISTIQUE Tarif adulte : 3€ Tarif enfants (12 -18ans) : 2 € Chambres d’Hôtes de Vouthon-Bas – 03 29 89 74 00 Tarif groupe (10 personnes minimum) : 2€ par personne 55130 VOUTHON-BAS Chambres d’Hôtes La Maison du Canal – 03 29 46 41 52 Chaque été, le Musée Lorrain du Cheval ouvre ses portes 55130 HOUDELAINCOURT et off re aux visiteurs une occasion unique de parcourir la tour médiévale de Gondrecourt tout en découvrant les collecti ons Hôtel Restaurant L’Auberge du Père Louis – 03 29 89 64 14 du Musée. La rareté, la diversité et la qualité de ces collecti ons 55130 HOUDELAINCOURT 2016 raviront les passionnés du monde équestre, à l’image du harnais complet de liti ère et du harnais de traîneau à Hôtel Restaurant Le Central – 03 29 89 63 42 grelots du début du 18ème siècle. Simples curieux ? Sorti e 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU en famille ? Sorti e de groupe ? Des visites guidées sont organisées et vous plongeront dans le monde du Restaurant Au Peti t Resto – 03 29 46 47 92 cheval à travers les âges. Le musée est organisé en six 55130 GONDRECOURT-LE-CHATEAU salles thémati ques qui traitent tour à tour des diverses uti lisati ons des chevaux au cours de l’histoire et de leur Aire naturelle de la Ferme d’Orgeval – 03 29 89 77 88 encrage culturel. -

0 CC De L'aire À L'argonne 0 Foncier Portrait
Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier Autrécourt-sur-Aire, Baudrémont, Beaulieu-en-Argonne, Beausite, Belrain, CC de l'Aire à Bouquemont, Brizeaux, Chaumont-sur-Aire, Les Hauts-de-Chée, Courcelles-en- Barrois, Courcelles-sur-Aire, Courouvre, Érize-la-Brûlée, Érize-la-Petite, Érize-Saint- Dizier, Èvres, Foucaucourt-sur-Thabas, Fresnes-au-Mont, Géry, Gimécourt, Ippécourt, Les Trois-Domaines, Lahaymeix, Lavallée, Lavoye, Levoncourt, Lignières- l'Argonne sur-Aire, Lisle-en-Barrois, Longchamps-sur-Aire, Louppy-le-Château, Neuville-en- Verdunois, Nicey-sur-Aire, Nubécourt, Pierrefitte-sur-Aire, Pretz-en-Argonne, Rembercourt-Sommaisne, Raival, Rupt-devant-Saint-Mihiel, Seigneulles, Thillombois, Seuil-d'Argonne, Vaubecourt, Ville-devant-Belrain, Villotte-devant- Louppy, Villotte-sur-Aire, Waly, Woimbey 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC de l'Aire à l'Argonne Périmètre Communes membres 01/2019 47 ( Meuse : 47) Surface de l'EPCI (km²) 664,00 Dépt Meuse Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 10 Poids dans la ZE Bar-le-Duc*(65,4%) Commercy(27,2%) Verdun(7,4%) ZE 43 Pop EPCI dans la ZE Bar-le-Duc(7,2%) Commercy(4,1%) Verdun(0,8%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 6 584 2016 6 579 Évolution 2006 - 2011 34 hab/an Évolution 2011 - 2016 -1 hab/an 10 communes les plus peuplées (2016) Les Hauts-de-Chée 739 11,2% Seuil-d'Argonne 518 7,9% 0 Rembercourt-Sommaisne -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 23 Mars 2014
ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Liste des candidatures par commune (scrutin plurinominal) Département 55 - MEUSE Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abainville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. BONTANT Antoine Mme BOURGUIGNON Magali Mme CAREL Sylvie M. HERPIERRE Jean-Claude Mme LABAT Bérengère M. LEDUC Christian M. LHUILLIER Daniel M. MULLER Serge M. PRUDHOMME Christian Mme SOMMER Jessica Mme THIERY Céline Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Abaucourt-Hautecourt (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. ADAM Gérard M. CHANCELLE Didier M. CLAUSSIN Michel Mme DUBAUX Christine M. GARDIEN Gilles Mme GARDIEN Mélina Mme LAGARDE Noëlle M. MITTAUX Jean-Marie M. PALHIES Lionel M. ROLLINGER Philippe M. TEDESCO Richard M. TOLUSSO Luc Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Aincreville (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 M. DUBAUX Christophe M. GARAND Jeremy M. GERARD Gregory M. HANNEQUIN Judicaël M. MAGISSON Jean-Marie M. MARTIN Fabien M. RAVENEL Guy Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Amanty (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 7 Mme AUER Marie-José M. BELLAMY Xavier M. BERTIN Jean-Michel M. BONTANT Joachim Mme DE KONING Véronique M. DIOTISALVI Jean-Luc Mme GROSS Anne-Sophie M. HUBER Stéphane M. PREY Alain M. RIGAUX Joël Elections municipales 1er tour du 23 mars 2014 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Ambly-sur-Meuse (MEUSE) Nombre de sièges à pourvoir : 11 M. -

ZRP Meuse Au 26 Oct 2020
INSEE NOM DEPT COMMUNE ZONE A RISQUE PARTICULIER / IA COM MEUSE 55008 AMEL-SUR-L’ETANG LA WOEVRE MEUSE 55010 ANCERVILLE CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55011 ANDERNAY ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55012 APREMONT-LA-FORET LA WOEVRE MEUSE 55017 AUTRECOURT-SUR-AIRE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55021 AVILLERS-SAINTE-CROIX LA WOEVRE MEUSE 55024 AZANNES-ET-SOUMAZANNES LA WOEVRE MEUSE 55031 BAUDONVILLIERS CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55038 BEAULIEU-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55039 BEAUMONT-EN-VERDUNOIS LA WOEVRE MEUSE 55046 BENEY-EN-WOEVRE LA WOEVRE MEUSE 55049 BEUREY-SUR-SAULX CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55053 BILLY-SOUS-MANGIENNES LA WOEVRE MEUSE 55058 BONCOURT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55062 BOUCONVILLE-SUR-MADT LA WOEVRE MEUSE 55069 BRABANT-LE-ROI ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55070 BRABANT-SUR-MEUSE LA WOEVRE MEUSE 55076 BREHEVILLE LA WOEVRE MEUSE 55081 BRIZEAUX ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55085 BROUSSEY-RAULECOURT LA WOEVRE MEUSE 55093 BUXIERES-SOUS-LES-COTES LA WOEVRE MEUSE 55096 CHAILLON LA WOEVRE MEUSE 55101 CHARDOGNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55107 CHAUMONT-DEVANT-DAMVILLERS LA WOEVRE MEUSE 55117 CLERMONT-EN-ARGONNE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55123 LES HAUTS-DE-CHEE ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55124 CONSENVOYE LA WOEVRE MEUSE 55125 CONTRISSON ETANGS D’ARGONNE (Nord et Sud) MEUSE 55132 COUSANCES-LES-FORGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55134 COUVONGES CHAMPAGNE HUMIDE (DONT LAC DU DER) MEUSE 55145 DAMVILLERS -

Répertoire Numerique Detaille De La Sous-Serie 2 Z
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MEUSE RÉPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE DE LA SOUS-SERIE 2 Z SOUS-PREFECTURE DE COMMERCY (1800-1940) par Yves KINOSSIAN conservateur stagiaire du patrimoine avec la participation d’Annie ÉTIENNE et de Monique HUSSENOT sous la direction de Jacques MOURIER directeur des Archives de la Meuse BAR-LE-DUC 1994, 1997 INTRODUCTION Historique C'est le décret-loi du 30 janvier 1790 qui crée le département du Barrois rebaptisé département de la Meuse un mois plus tard. Celui-ci est divisé en huit districts (Bar-le-Duc, Clermont-en-Argonne, Commercy, Etain, Gondrecourt-le-Château, Saint-Mihiel, Stenay puis Montmédy et Verdun) et soixante-dix-neuf cantons. Bar-le-Duc est choisi comme chef-lieu du département contre Verdun et devient la capitale administrative de la Meuse. La gestion des districts est confiée à un conseil de douze membres, un directoire de quatre membres et un procureur-syndic. Les cantons sont des circonscriptions électorales, sièges de justice de paix, mais dépourvues d'administration propre. La constitution de l'an III (22 août 1795) a supprimé les districts, laissant une structure département – canton – commune. L'idée du district est reprise et modifiée dans le cadre de la réforme de l'organisation administrative de l'an VIII : à la création de préfectures répond la fondation de districts agrandis, nommés initialement « arrondissements communaux ». Ce sont les ancêtres de nos arrondissements ; en l'an VIII on en compte 402 pour 5 105 cantons. D'anciens chefs-lieux de districts dépouillés de leurs prérogatives se mobilisent pour être désignés chefs-lieux d'arrondissement 1. -

Aire Nouvelle 70
MARS 2020 / Trimestriel / 1 € n°70 is o n u rd e V u d né en oy d le ns da re ’Ai e L es d cqu nt-Ja se Sai Bulletin de la parois Le sport est à la mode. Dans notre société, il faut transpirer pour avoir une activité physique qui nous permette de compenser l’inactivité au travail, pour avoir un corps qui corresponde aux canons de la beauté, E pour être en bonne santé afin de profiter pleinement de sa retraite, pour avoir la dose d’endorphines qui va nous permettre de nous dépasser et de nous rendre heureux. Ces activités vont soigner notre aspect D charnel mais tout cela a une fin inéluctable : nous savons que notre vie se termine par la mort. Au-delà de notre corps, au plus profond de lui, il y a une partie spirituelle à ne pas négliger qui pose la question que I les hommes se sont toujours posée : d’où je viens, où je vais ? T En ce mercredi, 1er jour du Carême, le prêtre nous marque le front d’une croix avec des cendres en prononçant ces paroles tirées de la Genèse : "Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en O poussière." C’est un avertissement fort, faisant réfléchir et pouvant peut-être effrayer. Il y a aussi cette autre formule tirée de l’évangile de Marc : "Convertissez-vous et croyez à l’Evangile" (Mc 1, 15). Les deux formulations s’éclairent l’une l’autre, elles ne sont pas en contradiction. -

The Uncensored Letters of a Canteen Girl
THE UNCENSORED LETTERS OF A CANTEEN GIRL NEW YORK HENRY HOLT AND COMPANY 1920 3i 570 ^1 Copyright, 1920 BY HENRY HOLT AND COMPANY TO PAT GATTS BRADY SNOW NEDDY BILL NICK HARRY JERRY and THE REST THIS BOOK is DEDICATED 436oo9 CONTENTS PAGE CHAPTER I BOURMONT Company A i CHAPTER II GONCOURT The Doughboys 59 CHAPTER III Rattentout The Front. .;.... 87 CHAPTER IV GONDRECOURT The Artillery 112 CHAPTER V Abainville The Engineers 132 CHAPTER VI Mauvages The Ordnance 167 CHAPTER Vn Verdun The French 214 CHAPTER VIII CONFLANS Pioneers, M. P.'s and Others 237 FOREWORD ToM. D. M. andM. H. M: My dears. These letters were all written for you; scratched down on odds and ends of writing paper, in a rare spare moment at the canteen; at night, at my billet, by candle-light; in the mornings, perched in front of Madame's fire-place with my toes tucked up on an orna- mental chaufrette foot-warmer. Why were they never sent? Simply because all letters mailed from France in those days, must of course pass under the eyes of the Censor. And as the Censor was likely to be a young man who sat opposite you at the mess-table, it meant that one mustn't say the things one could, and one couldn't say the things one would. So, after my first fortnight over there I decided to write my letters to you just as I would at home, putting down everything I saw and thought— and did, quite brazenly and shame- lessly, and then keep them, under lock and key if need be,—until I could give them to you in person. -

Usages Locaux
mot du Président Il serait difficile de vivre dans une société qui n’établit pas un minimum de règles à respecter par les différents individus qui la mposent. Très tôt dans notre Histoire, l’homme a éprouvé la nécessité d’édicter des codes, des règles, des lois qui organisent la vie des hommes. Bien avant le Code Rural, dans notre département, comme sur tout le territoire national, le monde agricole avait édicter des règles, d’usages qui encore aujourd’hui font force de loi. Le Code Rural dans ses articles L.551-3 et R 511-1 reconnaît l’existence et la force juridique des règles qui nous ont été léguées. Dans ses articles, il appartient aux Chambres d’agriculture de grouper, coordonner, codifier les coutumes et les usages à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. De même les Chambres d’Agriculture sont tenues de déposer un exemplaire des usages codifiés au secrétariat des maires qui le tient à la disposition du public. Ainsi, après un long travail de remise en forme, la Chambre d’Agriculture de la Meuse réédite les «les Usages Locaux ayant force de loi dans le département de la Meuse » en souhaitant qui contribue à faciliter les relations entre les Hommes qui gèrent et valorisent l’espace rural. Phillippe MANGIN Président de la Chambre d’Agriculture ANNEXE à la délibération du Conseil général de la Meuse n° 20, du 26 août 1876 -------------------- USAGES LOCAUX AYANT FORCE DE LOI DANS LE DEPARTEMENT DE LA MEUSE --------------------- SOMMAIRE I. USAGES DU CANTON DE BAR 9 II. -

Tél.: (38) 63.80.01
BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45060 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63.80.01 DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT GROUPE d?ETUDE et de PROGRAMMATION Estimation des besoins en granuláis et recensement des gisements potentiels dans la Vallée de la Meuse entre PAGNY-SUR-MEUSE et DOMREMY-LA-PUCELLE J. RICOUR avec la collaboration de Cl. MAROTEL Service géologique régional LORRAINE Rue du Parc de Brabois - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Tél. : (83) 51.43.51 79 SGN 587 LOR Vandoeuvre, le 26 novembre 1979 RESUME L'étude des ressources et des besoins en granuláis dans le Sud du département de la Meuse fait suite aux études antérieures réalisées en particulier pour le Groupement d'Etude et de Programmation de la DIRECTION DEPARTEMENTALE de 1'EQUIPEMENT. L'évaluation des besoins montre que ceux-ci sont en stagnation du fait de l'évolution de la démographie du secteur concerné. L'étude des ressources montrent que celles-ci sont en général de qualité moyenne à médiocre et sont susceptibles de couvrir la demande locale sous réserve que les exploitations plus importantes du secteur de PAGNY - VOID, au Nord, n'absorbent la demande du Sud du département. SOMMAIRE Pages Résumé 1 - Introduction.. 1 2 - Cadre géologique du secteur d'étude . 2 2.1. Aperçu géologique 2.2. Caractéristiques des matériaux rocheux et meubles 3 - Etude des besoins 8 3.1. Aperçu des besoins au niveau national 3.2. Définition des besoins au niveau local 4 - Etat des contraintes dans le secteur d'étude 13 4.1. Définition des contraintes 4.2. -

Recensement De La Population
Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 MEUSE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 55 - MEUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 55-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 55-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 55-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 55-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

Palmares Opera
ASSOCIATION LES ELEVEURS MEUSIENS Maison de l'agriculture Zone du Wameau – La Warpillière Bras sur Meuse – CS 50400 55108 VERDUN Cedex 03.29.83.30.23 - 06.72.66.18.66 03.29.83.30.88 [email protected] CONCOURS DEPARTEMENTAL DE LA RACE PRIM HOLSTEIN VERDUN - MEUSE SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 Juge : SAUNIER Thomas ULM / ELITEST / FROMAGERIE 1 SECTION A : GENISSES DE 6 à 9 MOIS parrainé par DONGE 55250 FOUCAUCOURT SUR 1 1 OTARIE DE LILY 5502540732 07/02/18 MCCUTCHEN SAMMY GEN GAEC DE LILY THABAS OKLAHOMA DE 2 6 5502472777 06/01/18 CALLEN ALTA5G GAEC MISSOURI 55100 MONTZEVILLE L'ESPERANCE EARL DE LA 3 5 OH LALA 5502545243 24/01/18 JAPPELOU AVIC SHO 55170 RUPT AUX NONAINS MALANDIERE EARL DE LA 4 3 OMBELINE 5502545244 30/01/18 JUMP ON CASTER 55170 RUPT AUX NONAINS MALANDIERE EARLU DERRIERE LA 5 2 ROSCOW OHANNA 5502520378 06/02/18 NOVO BALTIMOR 55400 MOGEVILLE TOUR 6 8 NIDINA 5502498088 27/12/17 JETSET HURION ISY GAEC DE LA FROMIERE 55120 JUBECOURT 1 SECTION B : GENISSES DE 6 à 9 MOIS parrainé par LA GAMELLE MEUSIENNE / ULM 1 15 NESSY 5502498756 15/11/17 ABS SILVER GOLD CHIP GAEC DU MONTY 55260 LEVONCOURT 2 9 LUX NOCIBEL 5502472770 18/12/17 DOORMAN SANCHEZ GAEC MISSOURI 55100 MONTZEVILLE 3 13 ROSCOW NELLYA 5502499423 02/12/17 CINDERDOOR GOLD CHIP EARLU DERRIERE LA TOUR 55400 MOGEVILLE 4 11 NINON 5502541462 03/12/17 SHOUT REMERSON GAEC DU MONTY 55260 LEVONCOURT 5 12 LUX NIDDEN 5502472762 02/12/17 CINDERDOOR BRAWLER GAEC MISSOURI 55100 MONTZEVILLE 6 10 NORINE TOP 5502484218 05/12/17 KINGBOY GOLD CHIP SCEA DE LA TETE AUX PIEDS