Pierre BOUFFLERS Mémoire De Seconde Année De Master
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Au Service De La Ressource En Eau Et Des Milieux Aquatiques Du Bassin
Au service de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin versant de la Canche AIRON-NOTRE-DAME B 1 BERLENCOURT-LE-CAUROY D 5 CAMPAGNE-LES-HESDIN C 2 ENQUIN-SUR-BAILLONS A 2 COURSET AIRON-SAINT-VAAST B 1 BERMICOURT C 4 CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES B 1 EPS B 4 AIX-EN-ISSART B 2 BERNIEULLES A 2 CAMPIGNEULLES-LES-PETITES B 2 EQUIRRE B 4 ALETTE B 2 BEUSSENT A 2 CANETTEMONT D 5 ERIN B 4 AMBRICOURT B 4 BEUTIN B 2 CAVRON-SAINT-MARTIN B 3 ESTREE B 2 DOUDEAUVILLE AMBRINES C 5 BEZINGHEM A 2 CLENLEU B 2 ESTREELLES B 2 ANVIN B 4 BIMONT A 2 CONCHY-SUR-CANCHE C 4 ESTREE-WAMIN D 5 ATTIN B 2 BLANGERVAL-BLANGERMONT C 4 CONTES B 3 ETAPLES B 1 ourse AUBIN-SAINT-VAAST C 3 BLANGY-SUR-TERNOISE B 4 CONTEVILLE-EN-TERNOIS B 5 FIEFS B 5 HALINGHEN LACRES AUBROMETZ C 4 BLINGEL C 4 CORMONT A 2 FILLIEVRES C 4 La C BEZINGHEM AUCHY-LES-HESDIN C 3 BOISJEAN C 2 COURSET A 2 FLERS C 4 PARENTY AVERDOINGT C 5 BONNIERES D 4 CREPY B 4 FLEURY B 4 AVONDANCE B 3 BOUBERS-LES-HESMOND B 3 CREQUY B 3 FONTAINE-LES-BOULANS B 4 A WIDEHEM HUBERSENT PREURES AZINCOURT B 4 BOUBERS-SUR-CANCHE C 4 CROISETTE C 4 FOUFFLIN-RICAMETZ C 5 ENQUIN- BAILLEUL-AUX-CORNAILLES C 5 BOURET-SUR-CANCHE D 5 CROIX-EN-TERNOIS C 4 FRAMECOURT C 5 SUR-BAILLONS CORMONT BEALENCOURT B 4 BOYAVAL B 5 CUCQ B 1 FRENCQ A 1 HUCQUELIERS Les Baillons BEAUDRICOURT D 5 BREXENT-ENOCQ B 2 DENIER C 5 FRESNOY C 4 BEAUFORT-BLAVINCOURT D 5 BRIMEUX B 2 DOUDEAUVILLE A 2 FRESSIN B 3 FRENCQ BEUSSENT in BERNIEULLES BEAUMERIE-SAINT-MARTIN B 2 BRIAS C 5 ECLIMEUX C 4 FREVENT D 4 p BEAURAINVILLE B 2 BUIRE-LE-SEC C 2 ECOIVRES C 4 GALAMETZ -

Service Assainissement Des Eaux Usées
Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois– Pôle opérationnel- Service de l’eau-assainissement 11-13 place Gambetta 62170 MONTREUIL-SUR-MER Téléphone : 03-21-06-66-66 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT. EXERCICE 2017 A- Présentation du service : Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois (CA2BM) a pris la compétence assainissement en lieu et place des services de la Communauté de Communes Opale Sud (CCOS), du SIVOM de la région d’ETAPLES et de la Communauté de Communes du Montreuillois (CCM). Le service est composé de deux entités : Service public d’assainissement collectif sur 24 communes Service public d’assainissement non collectif sur 22 communes. Il est géré par 14 personnes réparties comme suit : - Un directeur de service - Une responsable administrative et financière avec 2 agents administratifs - Un responsable technique avec 9 agents techniques. B- Zonage collectif : 1 – Caractéristiques techniques : Le service gère 4 stations d’épuration situées : BERCK-SUR-MER : 63 équivalent/habitants pour 11 260 abonnés. Les communes de BERCK-SUR-MER, RANG-DU-FLIERS, GROFFLIERS et VERTON possèdent un réseau de collecte des eaux usées de 100 kms raccordé à cette usine épuratoire. La gestion des réseaux et de la station a été confié à VEOLIA EAU par l’intermédiaire de 2 contrats de délégation : Un contrat pour la Commune de Verton concernant uniquement la gestion des réseaux. Ce dernier a été renégocié en 2013 et arrive à échéance le 30 Novembre 2021. Un contrat général pour les Communes de Groffliers, Rang-du-Fliers et Berck- sur-mer concernant la gestion des réseaux et de l’usine épuratoire. -

Saveurs Savoir-Faire
Saveurs & savoir-faire en Côte d’Opale GUIDE 2020 des producteurs locaux Edito En cette année particulière, le confinement nous a fait redécouvrir nos producteurs locaux et combien nous avons besoin d’eux. Parce qu’ils sont gage de proximité, de qualité mais aussi de convivialité et de partage. Avec ce nouveau rapport au temps pendant cette longue parenthèse, petits et grands, parents et enfants se sont réappropriés les plaisirs simples d’une recette partagée, réalisée avec de bons produits. Retrouvez tous les producteurs agricoles et artisanaux dans ce guide, pour faciliter l’approvisionnement de chacun, touriste ou habitant. Fromages, fruits et légumes, yaourts et autres produits laitiers, boissons, gourmandises, viandes et poissons, la gamme est large pour se faire plaisir, bien manger et soutenir notre économie locale. Même avec distanciation, les producteurs sauront vous accueillir pour vous faire découvrir et déguster leurs produits. Daniel Fasquelle Président de l’Agence d’Attractivité Opale&CO Les produits locaux font partie de la richesse et de l’identité des territoires. Pendant cette période inédite, les agriculteurs ont montré leur capacité d’adaptation pour continuer de produire et vous approvisionner en produits locaux de qualité. Nous sommes heureux de leur mise en lumière à travers ce guide «Saveurs et Savoir Faire» réalisé par Opale&Co. A nous citoyens, d’être consomm’acteurs afin de faire vivre nos producteurs et artisans. Sur les marchés, dans les magasins, en direct à la ferme, via des distributeurs automatiques ou encore avec le Drive fermier du Montreuillois, les agriculteurs vous donnent rendez-vous tout au long de l’année pour vous proposer leurs produits pleins de saveurs. -

Relais Assistants Maternels De La Communauté D’Agglomération Des 2 Baies En Montreuillois
Relais Assistants Maternels de la Communauté d’Agglomération des 2 Baies en Montreuillois Planning des ateliers d’éveil - 2019 JANVIER FEVRIER MARS 10h00 à 11h3009h45 à 11h15 15h30 à 16h30 10h00 à 11h3009h45 à 11h1515h30 à 16h30 10h00 à 11h30 09h45 à 11h1515h30 à 16h30 04 LEtaples Neuville 04 LEtaples Neuville 07 L Etaples Neuville 05 M Merlimont Rang-du-fliers** 05 M Merlimont Rang-du-fliers Médiathèque Médiathèque 08 M Merlimont Rang-du-fliers 06 M Ecuires Conchil-le- 06 M Ecuires Rang-du-fliers Temple Médiathèque Les P'tits nageurs Les P'tits nageurs 09 M Ecuires 07 J Wailly-Beaucamp Lefaux 07 J Wailly-Beaucamp Lefaux Rang-du-fliers du RAM du RAM Les P'tits nageurs 10 J Wailly-Beaucamp Lefaux 08 V 08 V du RAM 11 V 09 S 09 S 12 S 10 D 10 D Médiathèque Médiathèque 13 D 25 L Etaples Camiers Neuville 11 L Etaples Camiers Neuville (10h-10h45) (10h-10h45) Médiathèque 14 L Etaples Camiers Neuville 26 M Merlimont Rang-du-fliers 12 M Merlimont Rang-du-fliers (10h-10h45) 15 M Merlimont Rang-du-fliers 27 M Ecuires Verton* 13 M Ecuires Verton Les P'tits nageurs 16 M Ecuires Verton 28 J Wailly-Beaucamp St Josse* 14 J Wailly-Beaucamp* St Josse du RAM 17 JWailly-BeaucampSt Josse* 15 V 18 V 16 S 19 S* Intervention d’Aurélie Degrave du Pôle 17 D 20 DIntercommunal des Musiques 18 LEtaples Neuville 21 LPas d'atelier - Réunion à l'extérieur 19 MMerlimontRang-du-fliers Médiathèque 22 M Merlimont Rang-du-fliers 20 M Ecuires** Berck-sur-Mer Médiathèque Les P'tits nageurs 23 M Ecuires 21 J Wailly-Beaucamp Lefaux** Berck-sur-Mer du RAM Les P'tits nageurs 24 J Wailly-Beaucamp Lefaux 22 V du RAM ** Intervention de Cirq’Ovent 25 V 23 S 26 S 24 D 27 D 25 LEtaples Neuville 28 LEtaples** Neuville 26 M Merlimont Rang-du-fliers 29 M Merlimont Rang-du-fliers 27 M Ecuires Verton* 30 M Ecuires Verton* 28 JWailly-Beaucamp St Josse* 31 J Wailly-Beaucamp* St Josse Pour des raisons d’organisation, une inscription est obligatoire pour chaque séance. -

Liste Montreuil 2010
ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 2 LACHERE Guillaume 30/09/1975 26 Rue Principale 62180 AIRON NOTRE DAME 4 LEBLOND Guy 08/02/1951 34 Rue du Bas 62180 AIRON NOTRE DAME 1 DUPONT Dominique 16/09/1952 2 Rue du Marais 62180 AIRON NOTRE DAME 3 LAMADON Yves 01/11/1949 2 Rue de la Petite Tringue 62180 AIRON NOTRE DAME 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 5 LECLERCQ Stephane 29/10/1963 58 Impasse St Georges 62180 AIRON SAINT VAAST 2 BETHOUART Luc 06/04/1950 327 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 1 BETHOUART Bernard 04/03/1950 1 Rue de Bavemont 62180 AIRON SAINT VAAST 6 MERLOT Thierry 16/02/1973 218 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 4 DELATTRE Rémi 22/05/1980 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 3 DELATTRE BOITEL Marie-José 04/11/1954 769 Henri Béthouart 62180 AIRON SAINT VAAST 0 ELECTIONS DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX LISTE ELECTORALE PROVISOIRE DES PRENEURS N° DATE DE COMMUNE NOM OU SOCIETE NOM DE NAISSANCE PRENOM ADRESSE CPOST ORDRE NAISSANCE D'INSCRIPTION 1 GILLET David 02/10/1973 120 Rue de l'Eglise 62650 AIX EN ERGNY 4 ROUSSEL Hervé 09/05/1961 269 Rue du Tronquoy 62650 AIX EN ERGNY 3 GILLIOT Bernard 04/06/1955 15 Rue du Haut Pays 62650 AIX EN ERGNY 2 GILLIOT Antoine 11/05/1949 207 Rue du Haut Pays -
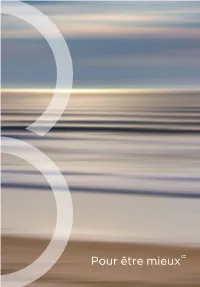
Pour Être Mieux Dir
Pour être mieux Dir. Boulogne-sur-Mer Calais - Bruxelles - Londres BECOURT CAMPAGNE LES-BOULONNAIS 27 ZOTEUX D131 Boulonnais D131 BOURTHES D127E D125 BEZINGHEM A D343 a D156 WIDEHEM HUBERSENT D150 D148E PARENTY D128 D132 D127 ERGNY AIX D940 D148 D156E EN -ERGNY RUMILLY D146E WICQUINGHEM D113 PREURES CAMIERS ENQUIN D148 SUR-BAILLONS CAMIERS D129E D147E se D127 ur VERCHOCQ SAINTE-CECILE D147 Co HUCQUELIERS FRENCQ D131E CORMONT MENCAS D92 BERNIEULLES D150 VINCLY D128 D146 D146E D147 D133 D152 HERLY AVESNES D104 BEUSSENT BIMONT MATRINGHEM MANINGHEM D928 D940 RADINGHEM LEFAUX D129E D133 LONGVILLIERS D151 D126 D148 INXENT D152E D133E M D148 D156 D343 D152 D126 D129 D155E HEZECQUES SENLIS D145 MARESVILLE QUILEN ETAPLES D150 D104 SUR-MER D343 TUBERSENT ois Bim e D149 D113 CLENLEU D901 MONTCAVREL D151E SAINT-MICHEL COUPELLE RECQUES D129E D343 LUGY SOUS-BOIS VIEILLE D130 SUR-COURSE D108 ne ALETTE L D149 e n Trax y D127 LE TOUQUET s M 26 D155 PARIS-PLAGE D149 D93 C BREXENT e RIMBOVAL FRUGES an D146E n ch ENOCQ on e Br D130 ESTREELLES e d HUMBERT D104 D146 D129s Bra D153 D143 ESTREE COUPELLE NEUVE D343 D113 EMBRY CREQUY ne VERCHIN BEUTIN D126 n STELLA D139 e ATTIN D150 ri LA MANCHE LA b PLAGE D144 D155 D144 m E TORCY D154 CANLERS D144 D104 CUCQ LA CALOTERIE RUISSEAUVILLE TREPIED-STELLA NEUVILLE ROYON D71E SOUS-MONTREUIL D130 AVONDANCE LA MADELAINE 7 Vallées SOUS-MONTREUIL CREPY D343 D154 D940 e is SAINS AMBRICOURT SAINT-JOSSE équo LEBIEZ Ternois r LES-FRESSIN D144E C PLANQUES MERLIMONT SORRUS D144 M D144E MERLIMONT SAINT-AUBIN D108 MONTREUIL BEAUMERIED138 -

COMPTE-RENDU De La RÉUNION Du CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL le 24 NOVEMBRE 2015 à 19H15 J-B SAILLY qui remet pouvoir à M.BAILLET oOo Monsieur le Maire a préalablement établi et déposé, devant la place de chacun des conseillers et adjoints, un dossier de travail et d’informations qui leurs est remis. Mr le Maire ouvre la séance et souhaite tout d'abord remercier les Elus qui étaient présents lors de la commémoration du 11 Novembre 2015. D'autre part, dans la continuation de la rénovation des peintures de la Mairie rue de Frencq, Mr le Maire a offert un lustre à la commune. Une autre personne a également offert 2 prises de courant + 1 bouton d'allumage décent, pour la Mairie rue de Frencq, Mr le Maire remercie cette personne. 1 - LECTURE DU COMPTE RENDU PRECEDENT Monsieur le Maire propose d’approuver le procès-verbal de la séance du 27 Octobre 2015 et demande préalablement si celui-ci appelle des observations. Compte tenu qu’il n’y a pas d’observation écrite, le procès-verbal de la séance du 27 Octobre 2015 est approuvé des présents et représentés. 2 - DELIBERATION SUR LE DON DE L’ANCIEN PHOTOCOPIEUR M. le Maire rappelle que depuis Mars 2015, un nouveau photocopieur (couleur, A3, recto-verso avec chargeur, fax, mails, scans…) a été installé au secrétariat et que l’ancien, SHARP Noir et Blanc n’était plus utilisé depuis cette date. Ce photocopieur fonctionne encore de manière satisfaisante mais n’est plus garanti et sa valeur sur le marché de l’occasion est très limitée. -

Dunes De Camiers Et Baie De Canche (Identifiant National : 310007015)
Date d'édition : 05/07/2018 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007015 Dunes de Camiers et Baie de Canche (Identifiant national : 310007015) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000060) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBl, GON, CEN NPDC, .- 310007015, Dunes de Camiers et Baie de Canche. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/310007015.pdf Région en charge de la zone : Nord-Pas-de-Calais Rédacteur(s) :CBNBl, GON, CEN NPDC Centroïde calculé : 546155°-2614453° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 12/10/2010 Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 5 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 5 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 6 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 7 6. HABITATS ...................................................................................................................................... 7 7. ESPECES .................................................................................................................................... -

Recueil Des Actes Administratifs N°42 En Date Du 05 Juillet 2021.Odt
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N°42 Publié le 05 juillet 2021 Rue Ferdinand Buisson 62020 ARRAS Cedex 9 Tél : 03 21 21 20 00rue Ferdinand BUISSON www.pas-de-calais.gouv.fr @prefetpasdecalais @prefet62 62020 ARRAS CEDEX 9 tél. 03.21.21.20.00 fax 03.21.55.30.30 CABINET DU PRÉFET............................................................................................................4 Direction des Sécurités – Service Interministériel de défense et de Protection Civile......................................................4 - Arrêté préfectoral n°CAB-SIDPC-2021-42 en date du 2 juillet 2021 portant modification du plan départemental de stockage et de distribution des comprimés d'iode..................................................................................................................4 DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ...................................................6 Bureau des Institutions Locales et de l’Intercommunalité..................................................................................................6 - Arrêté en date du 21 juin 2021 portant transfert du siège social du Syndicat intercommunal des Eaux du Sud-Artois....6 - Arrêté interdépartemental en date du 30 juin 2021 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Canche et Authie (SYMCEA)................................................................................................................................................................6 - Arrêté en date du 30 juin 2021 portant extension des compétences de la Communauté de communes -

1 Rappels Sur Le Contrat De Baie De Canche
SYNDICAT MIXTE POUR LE SAGE DE LA CANCHE Objet de la réunion : GT qualité des eaux Date : 09/12 /20 11 Rédacteurs : Anaïs Pouyte Participants : Roger Blot Com de Com du Montreuillois Julien Dehays Technicien SPAC Com de Com du Montreuillois M. Cornu Com de Com Opale Sud Brice Van Meirhaeghe Technicien SPANC Com de Com du Montreuillois Bertrand Leleu Com de Com Opale Sud M. Bridennes Com de Com du Canton d’Hucqueliers Christophe Coffre Maire de Preures M. Delorme Com de Com Opale Sud M. Flipo Com de Com Mer et Terre d’Opale M. Persyn Ville du Touquet M. Magnier Maire de Frencq Yves Martel Maire de Longvilliers M. Kahn Président du SIVOM de la Région d’Etaples, Maire de Cucq Mme Margueritte Maire de Lefaux Mme Roussel SIVOM de la Région d’Etaples M. Sauvage Maire de Cormont M. Bruyelles CLE du SAGE de la Canche M. Lemaire Chef de la mission littorale Agence de l’eau Artois Picardie M. Coche Directeur d’Agence Véolia Eau Mme Bette Ville du Touquet Delphine Decuf CG 62 Benjamin Bigot Fédération de Pêche 62 Déborah Kreisel SEMPACO M. Sauvage Président de la Commission Littoral, Maire de Cormont, élus CCMTO Anaïs Pouyte Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche Valérie Chérigié Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche Excusés M. Hedin Maire de Brexent-Enocq M. Cousin Maire d’Ecuires M. Savary CRC Normandie Mer du Nord 1 Rappels sur le contrat de baie de Canche : Le contrat de baie de Canche est un programme d’actions sur 5 ans qui aborde plusieurs thématiques : - La qualité de l’eau ; - La gestion et la prévention des risques ; - La préservation et la reconquête des milieux naturels et aquatiques ; - Les usages ; - La communication et la sensibilisation. -

18 Dossier L’Écho Du Pas-De-Calais No 209 – Juin 2021
18 Dossier L’Écho du Pas-de-Calais no 209 – Juin 2021 Liste des cantons du Pas-de-Calais Canton d’Aire-sur-la-Lys : Aire-sur-la- Amplier, Aubigny-en-Artois, Avesnes-le- Capelle-lès-Boulogne, Conteville-lès-Bou- Canton de Calais-3 : Partie de la commune ris, Saint-Venant, Westrehem. Lys, Blessy, Estrée-Blanche, Guarbecque, Comte, Bailleul-aux-Cornailles, Bailleulmont, logne, Pernes-lès-Boulogne, Pittefaux, de Calais non incluse dans les cantons de Ca- Canton de Longuenesse : Arques, Blen- Isbergues, Lambres, Liettres, Ligny-lès-Aire, Bailleulval, Barly, Basseux, Bavincourt, Beau- Wimereux, Wimille. lais-1 et de Calais-2. decques, Campagne-lès-Wardrecques, Hal- Linghem, Mazinghem, Quernes, Rely, Rom- dricourt, Beaufort-Blavincourt, Berlencourt- La partie de la commune de Boulogne-sur- Canton de Carvin : Carvin, Courrières, lines, Helfaut, Longuenesse, Wizernes. bly, Roquetoire, Saint-Hilaire-Cottes, Witter- le-Cauroy, Berles-au-Bois, Berles-Monchel, Mer située au nord d’une ligne définie par Libercourt. Canton de Lumbres : Acquin-Westbé- nesse, Wittes. Berneville, Béthonsart, Bienvillers-au-Bois, l’axe des voies et limites suivantes : depuis Canton de Desvres : Alincthun, Amble- court, Affringues, Aix-en-Ergny, Alette, Canton d’Arras-1 : Acq, Anzin-Saint-Aubin, Blairville, Boiry-Saint-Martin, Boiry-Sainte- le littoral, jetée Nord-Est, quai des Paque- teuse, Audembert, Audinghen, Audresselles, Alquines, Audrehem, Avesnes, Bayenghem- Beaumetz-lès-Loges, Dainville, Écurie, Étrun, Rictrude, Cambligneul, Camblain-l’Abbé, bots, quai Léon-Gambetta, boulevard Fran- Bazinghen, Bellebrune, Belle-et-Houllefort, lès-Seninghem, Bécourt, Beussent, Bezin- Marœuil, Mont-Saint-Éloi, Neuville-Saint- Canettemont, Capelle-Fermont, La Cauchie, çois-Mitterrand, boulevard Daunou, rue de Beuvrequen, Bournonville, Brunembert, Car- ghem, Bimont, Bléquin, Boisdinghem, Bon- Vaast, Roclincourt, Sainte-Catherine, Wailly. -

Étaples-Sur-Mer
Édition 2019/2020 | numéro 3 Étaples-sur-mer Destination Côte d'Opale Pour être mieux Ensemble Osez nos (p. 10) expériences de la mer Mode de vie Marches Vie & Bonheur restauratrices (p. 8) Soyez de bon vivant (p. 14) Patrimoine Prendre soin de la mémoire des hommes (p. 12) “Voyagez au gré de vos envies” ÉDITO 2019, Étaples-sur-mer classée Station de Tourisme Étaples-sur-mer s’arme pour vous faire vivre une expérience vous donnant envie de revenir… En 2018, plus de 10 000 passagers ont été au Étaples-sur-mer : la promesse d’histoires rendez-vous de son nouveau navire de croisières à découvrir, de parcours singuliers permettant et de pêches en mer, le Baie de Canche. un voyage au gré de vos envies… De très nombreux témoignages de satisfaction nous appellent à poursuivre le développement des aménagements qui y ont déjà été réalisés. Ainsi, à bord vous pourrez sur réservation, déguster des fumaisons de poisson, des huîtres voire même partager des repas à thème… autant d’ingrédients qui vous promettent des rencontres autour d’un voyage d’émerveillement dans le site exceptionnel de la baie de Canche. Puis pour vous proposer toujours plus, le très grand chantier en cours sur le port départemental donnera naissance à une promenade touristique le long et en bord de Canche. Elle reliera le port de plaisance à la future «maison de la baie» implantée à la porte de la réserve naturelle qui elle se termine à 50 mètres du cimetière militaire. Le cheminement s’effectuera en partie sur pilotis. Une scénographie comprenant des Philippe FAIT membrures de bateau est prévue dans la cour du Maire d’Étaples-sur-mer chantier de construction navale traditionnelle ; Conseiller départemental du Pas de Calais les plus curieux pourront aussi visiter Maréis, juste en face.