Carte Hydrogéologique De Bertrix - Recogne BERTRIX - RECOGNE
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
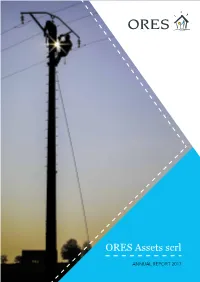
ORES Assets Scrl
ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 1 TABLE OF ORES Assets scrl ANNUAL REPORT 2017 CONTENTS I. Introductory message from the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer p.4 II. ORES Assets consolidated management report p.6 Activity report and non-financial information p.6 True and fair view of the development of business, profits/losses and financial situation of the Group p.36 III. Annual financial statements p.54 Balance sheet p.54 Balance sheet by sector p.56 Profit and loss statement p.60 Profit and loss statement by sector p.61 Allocations and deductions p.69 Appendices p.70 List of contractors p.87 Valuation rules p.92 IV. Profit distribution p.96 V. Auditor’s report p.100 VI. ORES scrl - ORES Assets consolidated Name and form ORES. cooperative company with limited liability salaries report p.110 VII. Specific report on equity investments p.128 Registered office Avenue Jean Monnet 2, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. VIII. Appendix 1 point 1 – List of shareholders updated on 31 December 2017 p.129 Incorporation Certificate of incorporation published in the appen- dix of the Moniteur belge [Belgian Official Journal] on 10 January 2014 under number 14012014. Memorandum and articles of association and their modifications The memorandum and articles of association were modified for the last time on 22 June 2017 and published in the appendix of the Moniteur belge on 18 July 2017 under number 2017-07-18/0104150. 2 3 networks. However, it also determining a strategy essen- Supported by a suitable training path, the setting up of a tially hinged around energy transition; several of our major "new world of work" within the company should also pro- business programmes and plans are in effect conducted to mote the creativity, agility and efficiency of all ORES’ active succeed in this challenge with the public authorities, other forces. -

Commune De Harnoncourt (Rouvroy). Dépôt 2014
BE-A0521_714548_714879_FRE Inventaire des archives de la commune de Harnoncourt. Dépôt 2014, (1822) 1906- 1976 (1980) Het Rijksarchief in België Archives de l'État en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is written in French. 2 Commune de Harnoncourt (Rouvroy). Dépôt 2014 DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:................................................................7 Consultation et utilisation................................................................................8 Conditions d'accès.......................................................................................8 Conditions de reproduction..........................................................................8 Histoire du producteur et des archives............................................................9 Producteur d'archives..................................................................................9 Nom..........................................................................................................9 Historique.................................................................................................9 Compétences et activités.......................................................................11 Organisation...........................................................................................11 Archives.....................................................................................................12 Historique...............................................................................................12 -

Bataille Des Frontières
vers Liège Province de Liège Houmart Les villages martyrs : Bende-Jenneret Borlon Ozo Izier Fonds Tijenke Dagnelie Tijenke Fonds [email protected] Bomal Tohogne ©Archives de l’État à Arlon, Arlon, à l’État de ©Archives Palenge Sabine Vandermeulen, Directreur FTLB Directreur Vandermeulen, Sabine Entre le 21 et le 26 août, plus de 867 civils sont exécutés en Neufchâteau, Rendeux Neufchâteau, Villers-Saint-Gertrude Harre Editeur responsable : responsable Editeur Luxembourg belge, près de 1000 si l’on compte les défunts des vers Liège vers ©Communes : Manhay, Manhay, : ©Communes ème ème Septon Libramont DurbuyDurbuy zones frontières. Les massacres sont perpétrés par la 4 et la 5 Barvaux-Sur-Ourthe ème Heyd © Office de tourisme : : tourisme de Office © armées allemandes (la 3 au Nord). Ces cruautés témoigneraient Marche-Nassogne, Gaume Marche-Nassogne, du mythe allemand de l’existence de « francs tireurs » contre lesquels Chêne-al-Pierre www.luxembourg-tourisme.be Vielsalm-Gouvy, Saint-Hubert, Saint-Hubert, Vielsalm-Gouvy, Wéris il fallait sévir immédiatement pour protéger les troupes. Ils voyaient Petit-Han Grand-Talleux Ourthe et Aisne, Aisne, et Ourthe Fax : +32 (0)84/412 439 (0)84/412 +32 : Fax Grandhan Mormont ©Maisons du tourisme : : tourisme du ©Maisons en chaque habitant (femme, vieillard, enfant) un tireur potentiel. Les Biron Oppagne Fanzel Tél.: +32 (0)84/411 011 (0)84/411 +32 Tél.: Province Neufchâteau, Libin Libin Neufchâteau, « atrocités allemandes» désignent aussi les destructions volontaires Petit-Thier ©J.Brisy, ©Cercles historiques : : historiques ©Cercles ©J.Brisy, 6980 La Roche-en-Ardenne La 6980 le Pays d’Ourthe & Aisne des villages, les exécutions de prisonniers, les pillages et les Bruxelles de Namur ©P.Dumont, ©G.Fairon, ©G.Fairon, ©P.Dumont, Quai de l’Ourthe, 9 l’Ourthe, de Quai nombreux otages déportés dans les camps. -

Lijst Erkende Inrichtingen Afdeling 0
Lijst erkende inrichtingen 1/09/21 Afdeling 0: Inrichting algemene activiteiten Erkenningnr. Benaming Adres Categorie Neven activiteit Diersoort Opmerkingen KF1 Amnimeat B.V.B.A. Rue Ropsy Chaudron 24 b 5 CS CP, PP 1070 Anderlecht KF10 Eurofrost NV Izegemsestraat(Heu) 412 CS 8501 Heule KF100 BARIAS Ter Biest 15 CS FFPP, PP 8800 Roeselare KF1001 Calibra Moorseelsesteenweg 228 CS CP, MP, MSM 8800 Roeselare KF100104 LA MAREE HAUTE Quai de Mariemont 38 CS 1080 Molenbeek-Saint-Jean KF100109 maatWERKbedrijf BWB Nijverheidsstraat 15 b 2 CS RW 1840 Londerzeel KF100109 maatWERKbedrijf BWB Nijverheidsstraat 15 b 2 RW CS 1840 Londerzeel KF100159 LA BOUCHERIE SA Rue Bollinckx 45 CS CP, MP, PP 1070 Anderlecht KF100210 H.G.C.-HANOS Herkenrodesingel 81 CS CC, PP, CP, FFPP, MP 3500 Hasselt KF100210 Van der Zee België BVBA Herkenrodesingel 81 CS CP, MP 3500 Hasselt KF100227 CARDON LOGISTIQUE Rue du Mont des Carliers(BL) S/N CS 7522 Tournai KF100350 HUIS PATRICK Ambachtenstraat(LUB) 7 CS FFPP, RW 3210 Lubbeek KF100350 HUIS PATRICK Ambachtenstraat(LUB) 7 RW CS, FFPP 3210 Lubbeek KF100378 Lineage Ieper BVBA Bargiestraat 5 CS 8900 Ieper KF100398 BOURGONJON Nijverheidskaai 18 b B CS CP, MP, RW 9040 Gent KF100398 BOURGONJON Nijverheidskaai 18 b B RW CP, CS, MP 9040 Gent KF1004 PLUKON MOUSCRON Avenue de l'Eau Vive(L) 5 CS CP, SH 7700 Mouscron/Moeskroen 1 / 196 Lijst erkende inrichtingen 1/09/21 Afdeling 0: Inrichting algemene activiteiten Erkenningnr. Benaming Adres Categorie Neven activiteit Diersoort Opmerkingen KF100590 D.S. PRODUKTEN Hoeikensstraat 5 b 107 -

Géologie Mai Version Xpress 5.Qxd
Les carrières souterraines abandonnées d'ardoise et de coticule à Vielsalm et Bertrix Xavier DEVLEESCHOUWER (1) (Province du Luxembourg, Belgique) : Eric GOEMAERE (1) développement d'un outil de gestion SIG Cyril MULLARD (1) Abandoned underground slate and coticule workings at Vielsalm and Bertric (Luxembourg, Belgium): development of a GIS management tool Géologie de la France, n° 1-2, 2006, pp. 135-140, 4 fig. Mots-clés : Système d’information géologique, Carrière souterraine, Gisement ardoisier, Abrasif, Coticule, Analyse des risques, Belgique Key words: Geographic information systems, Underground quarries, Slate quarries, Abrasives, Risk assessment, Belgium Abstract Introduction Rare minerals and famous rocks (slate veins and Les carrières souterraines d'ardoise et de coticule coticule) are known since the XVIIth century. During more constituèrent une activité essentielle au cours de la révolution than three centuries, the commune of Vielsalm was the industrielle et une phase de développement pour la région centre of an extractive industry, which exploits the rocks of avant la première guerre mondiale. Aujourd'hui, l'activité the Salm Group (Ordovician age). At the same time, even extractive souterraine est quasi éteinte en Belgique à earlier, slate veins were also exploited in the vicinity of l'exception de quelques exploitations locales. Le Bertrix along the Aise Valley. The underground workings développement de la mine à court et moyen terme était établi are opened in Lower Devonian series. afin de garantir un rendement, un bénéfice optimal et la sécurité des ouvrages souterrains pendant la période de The slate veins and coticule were initially exploited in l'exploitation. Ce n'est que très récemment que les questions open pits and later, starting from the middle of the XIXth commencèrent à se poser sur le devenir de la mine et l'impact century, in underground workings. -

Brochure D'accueil Du Patient Hospitalisé (Libramont)
Sommaire 9 Hygiène et urgences 6 - 8 En maternité En hospitalisation En pédiatrie 10 -11 À votre 13 12 écoute Services spécifiques 14 -15 16 -17 18 Droits et devoirs En visite Renseignements 20-21 Votre fin de séjour 19 nue ve Vous êtes actuellement hospitalisé dans un n de nos établissements. Nous vous remercions ie de la confiance que vous nous témoignez. B Pendant votre séjour, nous mettons tout en œuvre pour vous assurer les meilleurs soins par une médecine de pointe mais aussi par une qualité d’écoute, de respect et d’accom- pagnement. L’hospitalisation soulève de nombreuses questions, parfois très pratiques, auxquelles nous avons tenté de répondre en créant cette brochure. Elle vous renseignera sur la vie quo- tidienne à l’hôpital, sur les différents services dont vous pouvez bénéficier et sur les modali- tés pratiques de votre séjour. Toujours soucieux d’améliorer les conditions d’hospitalisation des patients, nous vous se- rions reconnaissants de compléter le ques- tionnaire de satisfaction que nous joignons à cette brochure. Tenant compte de vos remarques et suggestions, nous veillerons à améliorer la qualité de nos services. La Direction LIBRAMONT Direction médicale : Dr Pierre-Yves MACHUROT Secrétariat : 061/62.29.32 Direction des soins infirmiers : Mme Bénédicte LEROY Secrétariat: 061/62.29.60 Supervision : M. Olivier BINET Directeur Général Adjoint Secrétariat : 061/62.29.32 www.vivalia.be w w w . v i v a l i a . b 4 e Somme-Leuze Marche Vielsalm Rochefort Sainte-Ode epuis le 1er janvier 2009, VIVALIA associe Chanly Bastogne 44 communes luxembourgeoises et 3 com- Vresse-sur-Semois Libramont munes namuroises ainsi que les Provinces de DLuxembourg et de Namur. -

Liste PDF De Toutes Les Entreprises
Entreprises implantées sur les parcs d’activités économiques d’IDELUX 3F AUTO SERVICE Activités : Carrosserie, mécanique générale, reprogrammation AUBANGE - PED - LES 2 LUXEMBOURG Rue des 2 Luxembourg, 2 6791 ATHUS Nombre d'emplois : 2 4DIGITALES Activités : Agence publicitaire (graphismes, lettrages, enseignes), atelier de céramique, création de santons WELLIN Rue de Wellin, 38 6922 WELLIN Nombre d'emplois : 1 A.R.T.WORKS Activités : Entretien de grues de toitures LIBIN - LE CERISIER Z.I. Le Cerisier, 1 6890 LIBIN Nombre d'emplois : 2 AAC Activités : Import/Export de voitures ARLON - WEYLER Rue Claude Berg, 44 6700 ARLON Nombre d'emplois : 1 AAK BASTOGNE Activités : Centre de production de phospholipides extraits d##ufs BASTOGNE 1 Rue de la Fagne d#Hi, 43 6600 BASTOGNE Entreprises implantées sur les parcs d’activités économiques d’IDELUX ABRAHAM BENELUX Activités : Fabrication de salaisons LIBRAMONT - RECOGNE Rue de Saint-Hubert, 18 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY Nombre d'emplois : 14 ABSA ÉNERGIES Activités : Installations de chauffage, de sanitaire et d'électricité avec application des énergies renouvelables WELLIN Rue Jean Meunier, 1 6922 WELLIN Nombre d'emplois : 4 ACRC (ADAM CAR REPAIR CENTER) Activités : Atelier de carrosserie ARLON - WEYLER Rue Claude Berg, 28 bte 2 6700 ARLON Nombre d'emplois : 9 ADAM ET MENTEN Activités : Agence en douane AUBANGE - PED Rue du Terminal, 7 6791 ATHUS Nombre d'emplois : 2 ADAM RENÉ Activités : Pose caveaux, monuments funéraires DURBUY - BARVAUX Rue de l'industrie, 23 6940 BARVAUX-SUR-OURTHE Nombre d'emplois -

L Trein Dienstrooster & Lijnroutekaart
L trein dienstrooster & lijnkaart L Aarlen - Arlon →Libramont Bekijken In Websitemodus De L treinlijn (Aarlen - Arlon →Libramont) heeft 8 routes. Op werkdagen zijn de diensturen: (1) Aarlen - Arlon →Libramont: 06:05 - 21:43 (2) Aarlen - Arlon →Virton: 07:43 - 19:43 (3) Bertrix →Libramont: 08:54 - 20:54 (4) Bertrix →Virton: 08:08 - 20:08 (5) Libramont →Aarlen - Arlon: 05:21 - 20:58 (6) Libramont →Bertrix: 07:58 - 19:58 (7) Virton →Aarlen - Arlon: 08:39 - 20:39 (8) Virton →Bertrix: 08:22 - 20:22 Gebruik de Moovit-app om de dichtstbijzijnde L treinhalte te vinden en na te gaan wanneer de volgende L trein aankomt. Richting: Aarlen - Arlon →Libramont L trein Dienstrooster 9 haltes Aarlen - Arlon →Libramont Dienstrooster Route: BEKIJK LIJNDIENSTROOSTER maandag 06:05 - 21:43 dinsdag 06:05 - 21:43 Aarlen - Arlon 37 Avenue de la Gare, Arlon woensdag 06:05 - 21:43 Messancy donderdag 06:05 - 21:43 Athus vrijdag 06:05 - 21:43 Place des Martyrs, Athus zaterdag 07:05 - 19:04 Aubange zondag 07:05 - 19:04 Halanzy Rue de la Motte, Halanzy Virton L trein Info Avenue Bouvier, Virton Route: Aarlen - Arlon →Libramont Haltes: 9 Florenville Ritduur: 34 min Samenvatting Lijn: Aarlen - Arlon, Messancy, Athus, Bertrix Aubange, Halanzy, Virton, Florenville, Bertrix, Libramont Libramont Rue de la Gare, Libramont Richting: Aarlen - Arlon →Virton L trein Dienstrooster 6 haltes Aarlen - Arlon →Virton Dienstrooster Route: BEKIJK LIJNDIENSTROOSTER maandag 07:43 - 19:43 dinsdag 07:43 - 19:43 Aarlen - Arlon 37 Avenue de la Gare, Arlon woensdag 07:43 - 19:43 Messancy donderdag -

Horaires De Bus : Travaux Entre Dinant/Libramont
sncb Travaux sur votre trajet Des travaux de renouvellement des voies seront effectués par Infrabel. La carte montre où ces travaux pourraient influencer votre voyage. entre Dinant/Libramont - Bertrix/Arlon Du 4 août au 1er septembre 2019 A Plus d’info : Planifiez votre voyage sur app sncb sncb.be Brussels Airport - Zaventem Pas d’internet ? 02 528 28 28 Namur Beauraing Libramont Bertrix Arlon Quels trains ? trains IC trains P • Brussels Airport-Zaventem - Dinant • Gedinne - Libramont Libramont - Bertrix trains L • • Libramont - Bertrix - Arlon • Namur - Dinant - Bertrix - Libramont Et mon trajet ? Tous les jours Les trains L Namur - Bertrix - Libramont sont remplacés par des bus entre Beauraing et Libramont. En semaine Le lundi 19 août, le départ de certains trains IC Brussels Airport-Zaventem - Dinant est retardé à Yvoir. L’heure de départ de certains trains L Libramont - Bertrix - Arlon est adaptée sur l’ensemble de leur parcours. Les trains P Libramont - Bertrix et Gedinne - Bertrix ne circulent pas. Le week-end Le dimanche 11 août, certains trains L Libramont - Bertrix - Virton sont remplacés par des bus entre Libramont et Bertrix. 02/08/19 FR-08027 BNX-44N-19176-004 sncb Gare de Beauraing Arrêt de bus Travaux entre Dinant/Libramont et Bertrix/Arlon Travaux entre Dinant/Libramont - Bertrix/Arlon Du 4 août au 1 septembre 2019 Arrêt de bus provisoire: Libramont Arrêts TEC « Libramont gare », Rue de la Gare, devant la gare. Bertrix : Arrêts TEC « Bertrix gare », Rue de la Gare, devant la gare. Paliseul : Arrêts TEC « Paliseul gare », Place de la Gare, devant la gare. Carlsbourg : Arrêts TEC « Carlsbourg gare », Avenue Arthur Tagnon, à 150m de la gare. -

ESS5 Appendix A4 Population Statistics Ed
APPENDIX A4 POPULATION STATISTICS, ESS5-2010 ed. 5.0 Austria ........................................................................................... 2 Belgium .......................................................................................... 5 Bulgaria ........................................................................................ 19 Croatia ......................................................................................... 25 Cyprus .......................................................................................... 27 Czech Republic .............................................................................. 63 Denmark ....................................................................................... 67 Estonia ......................................................................................... 83 Finland ......................................................................................... 84 France ........................................................................................ 124 Germany ..................................................................................... 130 Greece ....................................................................................... 145 Hungary ..................................................................................... 149 Ireland ....................................................................................... 155 Israel ......................................................................................... 162 Lithuania -

Page 1 G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN
G 1203 B AMTSBLATT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1 . FEBRUAR 1964 AUSGABE IN DEUTSCHER SPRACHE 7. JAHRGANG Nr. 18 INHALT EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT VERORDNUNGEN Verordnung Nr . 7/64/EWG der Kommission vom 29 . Januar 1964 zur Fest legung der Liste der Gemeinden innerhalb der beiderseits der gemeinsamen Grenze zwischen Frankreich und den angrenzenden Mitgliedstaaten fest gelegten Grenzzonen 297/64 Anlage : I. Französisch-belgisches Grenzgebiet : A. Belgische Gemeinden 298/64 B. Französische Gemeinden 304/64 II . Französisch-luxemburgisches Grenzgebiet : A. Luxemburgische Gemeinden 314/64 B. Französische Gemeinden 314/64 III . Französisch-deutsches Grenzgebiet : A. Deutsche Gemeinden 317/64 B. Französische Gemeinden 322/64 IV. Französisch-italienisches Grenzgebiet : A. Italienische Gemeinden 330/64 B. Französische Gemeinden 331/64 3 8083 * — STUDIEN — REIHE ÜBERSEEISCHE ENTWICKLUNGSFRAGEN Nr. 1/1963 — Der Kaffee-, Kakao- und Bananenmarkt der EWG Die im Auftrag der Kommission entstandene Arbeit stammt vom ,, Inra Europe Marketing Research Institute", einem Zusammenschluß verschiedener Forschungs institute des EWG-Raums (Divo-Frankfurt , NSvS-Den Haag, Sema-Paris , Sirme Mailand, Sobemap-Brüssel), und gibt einen Überblick über die augenblickliche Marktlage sowie die voraussichtliche Entwicklung der nächsten Jahre . Die Erzeugnisse, die hier behandelt werden, Kaffee, Kakao, Bananen, stellen einen großen Teil der Exporterlöse der Entwicklungsländer . Die Kommission hat sich entschlossen, diese Arbeit zu veröffentlichen , da sie glaubt, daß sie für öffentliche wie private Stellen in der EWG und den assoziierten Staaten von einigem Interesse sein dürfte. Der Bericht behandelt Einfuhr und Durchfuhr, Verarbeitung, Absatz und Preis bildung und die Ergebnisse einer Verbraucher-Umfrage . Ein Ausblick auf die Ver brauchsentwicklung bis 1970 beschließt das Ganze . Das Werk (226 Seiten , 50 Diagramme) ist in den vier Sprachen der Gemeinschaft erschienen . -

Tableau De Bord Socio-Économique De La Province De Luxembourg
Tableau de bord socio-économique de la province de Luxembourg avec le soutien du Collège provincial de la Province de Luxembourg Ce document a été réalisé par l’équipe technique du REAL, qui rassemble: Chers lecteurs, Daniel CONROTTE, Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg Véritable scanner socio-économique de la province de Luxembourg, l’ouvrage que vous Jocelyne COUSET, Promemploi Marie-Caroline DETROZ, Ressources Naturelles Développement asbl tenez entre vos mains est l’outil indispensable pour cerner, chiffres à l’appui, les réalités, Adeline DUSSART, Le Forem enjeux et singularités de notre territoire. Edith GOBLET, Direction de l’Economie de la Province de Luxembourg Catherine HABRAN, Instance Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi Dans de trop nombreux domaines, notre province est encore sous-estimée. Des publi- Christophe HAY, Chambre de commerce et d’industrie du Luxembourg belge cations telles que ce tableau de bord socio-économique sont donc nécessaires, je dirais Suzanne KEIGNAERT, Cellule Développement Durable de la Province de Luxembourg Sylvie LEFEBVRE, Promemploi même indispensable, non seulement pour défendre et exporter notre territoire au-delà Sophie MAHIN, Observatoire de la santé de la Province de Luxembourg de ses frontières, mais également pour que les Luxembourgeois eux-mêmes prennent Pierre PEETERS, Direction de l’Economie Rurale de la Province de Luxembourg Alexandre PETIT, IDELUX-AIVE conscience de tout le potentiel socio-économique de notre province. Bertrand PETIT, FTLB Christine VINTENS, NGE asbl La ruralité a trop souvent été perçue comme un frein au développement. Pourtant, à l’heure Le secrétariat a été assuré par Carline BAQUET, Direction de l’Economie de la Province de Luxembourg actuelle, les perspectives économiques de la «verte province» sont nombreuses.