Fiches Végétales Groupe 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

000841833.Pdf
UNESP – UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “Julio de Mesquita Filho” - Câmpus Araraquara Instituto de Química PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA FRANCISCO JOSÉ MININEL Estudo Fitoquímico de extratos polares e infusão das folhas de Terminalia catappa L. (COMBRETACEAE) e avaliação das suas atividades antiulcerogênica e mutagênica Araraquara – SP 2015 FRANCISCO JOSÉ MININEL “Estudo Fitoquímico de extratos polares e infusão das folhas de Terminalia catappa L. (COMBRETACEAE) e avaliação das suas atividades antiulcerogênica e mutagênica” Tese apresentada ao Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista, como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Química. Orientadora: Profa. Dra. Lourdes Campaner dos Santos Araraquara 2015 DADOS CURRICULARES Dados pessoais Nascimento: 21/02/1966 Filiação: Antenor Mininel e Irene Oratti Mininel Naturalidade: Fernandópolis-SP Endereço residencial: Rua Aviador Eduardo Borges de Freitas nº 199, Residencial Terra Verde – Fernandópolis-SP Telefone: (17) 3462-1418 E-mail: [email protected] Formação Acadêmica Ciências com Habilitação em Química Centro Universitário de Votuporanga-SP. Ano de conclusão: 1987. Especialista em Química Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO-SP). Ano de conclusão: 1996. Mestre em Ciências Farmacêuticas Universidade São Francisco (USF) - Bragança Paulista-SP. Ano de conclusão: 2003. Mestre em Química Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil. Ano de conclusão: 2009. Atuação profissional Universidade Camilo Castelo -

Ethnographic Assessment and Overview National Park of American Samoa
PACIFIC COOPERATIVE STUDIES UNIT UNIVERSITY OF HAWAI`I AT MĀNOA Dr. David C. Duffy, Unit Leader Department of Botany 3190 Maile Way, St. John #408 Honolulu, Hawai’i 96822 Technical Report 152 ETHNOGRAPHIC ASSESSMENT AND OVERVIEW NATIONAL PARK OF AMERICAN SAMOA November 2006 Jocelyn Linnekin1, Terry Hunt, Leslie Lang and Timothy McCormick 1 Email: [email protected]. Department of Anthropology, University of Connecticut Beach Hall Room 445, U-2176 354 Mansfield Road Storrs, Connecticut 06269-2176 Ethnographic Assessment and Overview The National Park of American Samoa Table of Contents List of Tables and Figures iii List of Slides v Preface: Study Issues vi Maps vii Key to Maps x I. The Environmental Context 1 Climate and Vegetation 1 The National Park Environments 4 II. Archaeology and Samoan Prehistory 8 Early Settlement 8 Later Inland Settlement 9 Late Prehistoric Period 9 European Contact and the Historical Period 10 Archaeology in the National Park Units 10 III. Research Methodology 15 Documentary Phase 15 Field Research 15 Limitations of the Research 17 IV. Ethnohistory 22 Myths and Legends Relevant to the Park 22 The European Contact Period 25 Western Ethnohistorical and Ethnographic Reports 31 V. Agriculture and Domestically Useful Plants 46 Tutuila Unit 46 Ta'u Unit 49 Ofu Unit 51 Summary 52 VI. Marine Resources 53 Tutuila Unit 53 Ta'u Unit 57 Ofu Unit 58 Summary 61 i VII. Medicinal Plants 63 Ofu Unit 63 Ta'u Unit 66 Tutuila Unit 66 Summary 67 VIII. Analysis of Freelist Data 75 Crops and Cultivated Plants 76 Medicinal Plants 81 Fish and Marine Species 84 Animals and Birds 86 Summary of the Freelist Results 88 IX. -

Atoll Research Bulletin No. 503 the Vascular Plants Of
ATOLL RESEARCH BULLETIN NO. 503 THE VASCULAR PLANTS OF MAJURO ATOLL, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS BY NANCY VANDER VELDE ISSUED BY NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON, D.C., U.S.A. AUGUST 2003 Uliga Figure 1. Majuro Atoll THE VASCULAR PLANTS OF MAJURO ATOLL, REPUBLIC OF THE MARSHALL ISLANDS ABSTRACT Majuro Atoll has been a center of activity for the Marshall Islands since 1944 and is now the major population center and port of entry for the country. Previous to the accompanying study, no thorough documentation has been made of the vascular plants of Majuro Atoll. There were only reports that were either part of much larger discussions on the entire Micronesian region or the Marshall Islands as a whole, and were of a very limited scope. Previous reports by Fosberg, Sachet & Oliver (1979, 1982, 1987) presented only 115 vascular plants on Majuro Atoll. In this study, 563 vascular plants have been recorded on Majuro. INTRODUCTION The accompanying report presents a complete flora of Majuro Atoll, which has never been done before. It includes a listing of all species, notation as to origin (i.e. indigenous, aboriginal introduction, recent introduction), as well as the original range of each. The major synonyms are also listed. For almost all, English common names are presented. Marshallese names are given, where these were found, and spelled according to the current spelling system, aside from limitations in diacritic markings. A brief notation of location is given for many of the species. The entire list of 563 plants is provided to give the people a means of gaining a better understanding of the nature of the plants of Majuro Atoll. -
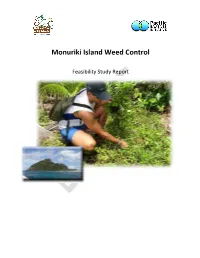
Eradication Feasibility Study Report
Monuriki Island Weed Control Feasibility Study Report Author: Baravi Thaman, Jone Niukula Reviewers: <Reviewers> Version History: VERSION DATE AUTHOR REASON FOR CHANGE VERSION 1 15th APRIL 2013 Baravi Thaman, Jone Niukula Citation: This report should be cited as: Thaman, B and Niukula, J. 2013. Monuriki Invasive Plant Project – Feasibility Study. Ver.1. National Trust of Fiji, Suva. i Table of Contents EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................. iii 1. INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 1 2. GOAL, OBJECTIVES and OUTCOMES ...................................................................................................... 1 2.1 Goal ............................................................................................................................................... 1 2.2 Objectives and Outcomes ............................................................................................................. 1 3. THE SITE ................................................................................................................................................. 1 4. THE TARGET SPECIES, IMPACTS AND BENEFITS OF MANAGEMENT ..................................................... 2 4.1 Target Species .............................................................................................................................. -

Plant Biodiversity Science, Discovery, and Conservation: Case Studies from Australasia and the Pacific
Plant Biodiversity Science, Discovery, and Conservation: Case Studies from Australasia and the Pacific Craig Costion School of Earth and Environmental Sciences Department of Ecology and Evolutionary Biology University of Adelaide Adelaide, SA 5005 Thesis by publication submitted for the degree of Doctor of Philosophy in Ecology and Evolutionary Biology July 2011 ABSTRACT This thesis advances plant biodiversity knowledge in three separate bioregions, Micronesia, the Queensland Wet Tropics, and South Australia. A systematic treatment of the endemic flora of Micronesia is presented for the first time thus advancing alpha taxonomy for the Micronesia-Polynesia biodiversity hotspot region. The recognized species boundaries are used in combination with all known botanical collections as a basis for assessing the degree of threat for the endemic plants of the Palau archipelago located at the western most edge of Micronesia’s Caroline Islands. A preliminary assessment is conducted utilizing the IUCN red list Criteria followed by a new proposed alternative methodology that enables a degree of threat to be established utilizing existing data. Historical records and archaeological evidence are reviewed to establish the minimum extent of deforestation on the islands of Palau since the arrival of humans. This enabled a quantification of population declines of the majority of plants endemic to the archipelago. In the state of South Australia, the importance of establishing concepts of endemism is emphasized even further. A thorough scientific assessment is presented on the state’s proposed biological corridor reserve network. The report highlights the exclusion from the reserve system of one of the state’s most important hotspots of plant endemism that is highly threatened from habitat fragmentation and promotes the use of biodiversity indices to guide conservation priorities in setting up reserve networks. -
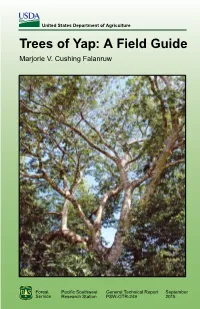
Trees of Yap: a Field Guide Marjorie V
United States Department of Agriculture Trees of Yap: A Field Guide Marjorie V. Cushing Falanruw Forest Pacific Southwest General Technical Report September Service Research Station PSW-GTR-249 2015 In accordance with Federal civil rights law and U.S. Department of Agriculture (USDA) civil rights regulations and policies, the USDA, its Agencies, offices, and employees, and institutions participating in or administering USDA programs are prohibited from discriminating based on race, color, national origin, religion, sex, gender identity (including gender expression), sexual orientation, disability, age, marital status, family/parental status, income derived from a public assistance program, political beliefs, or reprisal or retaliation for prior civil rights activity, in any program or activity conducted or funded by USDA (not all bases apply to all programs). Remedies and complaint filing deadlines vary by program or incident. Persons with disabilities who require alternative means of communication for program information (e.g., Braille, large print, audiotape, American Sign Language, etc.) should contact the responsible Agency or USDA’s TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TTY) or contact USDA through the Federal Relay Service at (800) 877-8339. To file a program discrimination complaint, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form, AD-3027, found online at http://www.ascr. usda.gov/complaint_filing_cust.html and at any USDA office or write a letter addressed to USDA and provide in the letter all of the information requested in the form. To request a copy of the complaint form, call (866) 632-9992. Submit your completed form or letter to USDA by: (1) mail: U.S. -
Angiosperm Phylogeny Inferred from Sequences of Four Mitochondrial Genes 1Yin-Long QIU∗ 1Libo LI 1Bin WANG 1,2Jia-Yu XUE 1Tory A
Journal of Systematics and Evolution 48 (6): 391–425 (2010) doi: 10.1111/j.1759-6831.2010.00097.x Angiosperm phylogeny inferred from sequences of four mitochondrial genes 1Yin-Long QIU∗ 1Libo LI 1Bin WANG 1,2Jia-Yu XUE 1Tory A. HENDRY 1Rui-Qi LI 1Joseph W. BROWN 1Ya n g L I U 1Geordan T. HUDSON 3Zhi-Duan CHEN 1(Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109, USA) 2(School of Life Sciences, Nanjing University, Nanjing 210093, China) 3(Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100093, China) Abstract An angiosperm phylogeny was reconstructed in a maximum likelihood analysis of sequences of four mitochondrial genes, atp1, matR, nad5, and rps3, from 380 species that represent 376 genera and 296 families of seed plants. It is largely congruent with the phylogeny of angiosperms reconstructed from chloroplast genes atpB, matK, and rbcL, and nuclear 18S rDNA. The basalmost lineage consists of Amborella and Nymphaeales (including Hydatellaceae). Austrobaileyales follow this clade and are sister to the mesangiosperms, which include Chloranthaceae, Ceratophyllum, magnoliids, monocots, and eudicots. With the exception of Chloranthaceae being sister to Ceratophyllum, relationships among these five lineages are not well supported. In eudicots, Ranunculales, Sabiales, Proteales, Trochodendrales, Buxales, Gunnerales, Saxifragales, Vitales, Berberidopsidales, and Dilleniales form a basal grade of lines that diverged before the diversification of rosids and asterids. Within rosids, the COM (Celastrales–Oxalidales–Malpighiales) clade is sister to malvids (or rosid II), instead of to the nitrogen-fixing clade as found in all previous large-scale molecular analyses of angiosperms. Santalales and Caryophyllales are members of an expanded asterid clade. -

Phylogenetic Distribution and Evolution of Mycorrhizas in Land Plants
Mycorrhiza (2006) 16: 299–363 DOI 10.1007/s00572-005-0033-6 REVIEW B. Wang . Y.-L. Qiu Phylogenetic distribution and evolution of mycorrhizas in land plants Received: 22 June 2005 / Accepted: 15 December 2005 / Published online: 6 May 2006 # Springer-Verlag 2006 Abstract A survey of 659 papers mostly published since plants (Pirozynski and Malloch 1975; Malloch et al. 1980; 1987 was conducted to compile a checklist of mycorrhizal Harley and Harley 1987; Trappe 1987; Selosse and Le Tacon occurrence among 3,617 species (263 families) of land 1998;Readetal.2000; Brundrett 2002). Since Nägeli first plants. A plant phylogeny was then used to map the my- described them in 1842 (see Koide and Mosse 2004), only a corrhizal information to examine evolutionary patterns. Sev- few major surveys have been conducted on their phyloge- eral findings from this survey enhance our understanding of netic distribution in various groups of land plants either by the roles of mycorrhizas in the origin and subsequent diver- retrieving information from literature or through direct ob- sification of land plants. First, 80 and 92% of surveyed land servation (Trappe 1987; Harley and Harley 1987;Newman plant species and families are mycorrhizal. Second, arbus- and Reddell 1987). Trappe (1987) gathered information on cular mycorrhiza (AM) is the predominant and ancestral type the presence and absence of mycorrhizas in 6,507 species of of mycorrhiza in land plants. Its occurrence in a vast majority angiosperms investigated in previous studies and mapped the of land plants and early-diverging lineages of liverworts phylogenetic distribution of mycorrhizas using the classifi- suggests that the origin of AM probably coincided with the cation system by Cronquist (1981). -

Nasoata Mangrove Island, the PABITRA Coastal Study Site for Viti Levu, Fiji Islands
Nasoata Mangrove Island, the PABITRA Coastal Study Site for Viti Levu, Fiji Islands Thaman, Randolph R. Keppel, Gunnar. Whatling, Dick. Thaman, Batiri. More Pacific Science, Volume 59, Number 2, April 2005, pp. 193-204 (Article) Published by University of Hawai'i Press DOI: 10.1353/psc.2005.0027 For additional information about this article http://muse.jhu.edu/journals/psc/summary/v059/59.2thaman.html Access Provided by Curtin University of Technology at 01/11/12 6:18AM GMT Nasoata Mangrove Island, the PABITRA Coastal Study Site for Viti Levu, Fiji Islands1 R. R. Thaman,2 Gunnar Keppel,3 Dick Watling,4 Batiri Thaman,5 Timoci Gaunavinaka,6 Alifereti Naikatini,7 Baravi Thaman,8 Nemani Bolaqace,9 Etika Sekinoco,9 and Manasa Masere9 Abstract: Nasoata Island is a predominantly mangrove island located near the outflow and delta of the Rewa River, Fiji’s largest and longest river. The river originates on the eastern slopes of Mt. Tomaniivi in the Central Highlands of Viti Levu. The island has been selected as an integral coastal site for Fiji’s PABITRA Gateway Transect. Information is provided on: (1) the reasons it was selected as a PABITRA site; (2) geographical, geological, climatic, and eda- phic setting; (3) the vegetation; and (4) brief notes on the fauna, with particular focus on the avifauna. Because of its rich flora and fauna, Nasoata Island is an excellent ‘‘prototype’’ coastal and mangrove site for enhancing our understand- ing of the complexities of island biodiversity, both within Fiji and in relation to other small offshore islands within the broader PABITRA network. -

174 Appendices
APPENDICES 174 Appendix 2. Samoan and Taxonomic Names: Crops and Cultigens `aute garden hibiscus Hibiscus rosa-sinensis L. coral hibiscus H. schizopetalus Mast. Rose of Sharon H. syriacus L. `ava kava Piper methysticum Forester `ava pui wild ginger Zingiber zerumbet L. esi papaya Carica papaya L. fa`i banana Musa spp. fau beach hibiscus Pariti tiliaceus L. fetila nd fu`afu`a guest tree Kleinhovia hospita L. *canoe floats fue sosolo bush taro vine Rhaphidophora graeffei Engl. *fish traps futu Barringtonia asiatica L. gatae Erythrina spp. hibiscus see `aute; fau kapisi cabbage Brassica spp. koko cocoa Theobroma cacao L. kopa nd ku`ava guava Psidium guajava/littorale kukama cucumber (Milner) laga`ali garland tree Aglaia samoensis Gray lau fala Scripodendron costatum Kurz. Pandanus samoensis Warb. P. turritus Martelli P. tectoris Parkinson lau i`e Pandanus odoratissimus L. Freycinetia samoensis Warb. lau talotalo lily Crinum asiatica L. *decorative, ceremonial, fishing Anthrophyum plantagineum Cav. lau talotalo samasama nd (yellow lily? TM) lau ta`ata`a Crow's foot grass Eleusine indica L. *no use listed; "weed" lili lily (Milner) mago mango Mangifera indica L. manioka cassava/manioc/tapioca Manihota esculeta Crantz ma-soa- Polynesian arrowroot Tacca leontopetaloides L. maukeni nd meleni watermelon Citrullus vulgaris Schrad. moli citrus fruit Citrus and Fortunella spp. moli `aina common sweet orange Citrus sinensis L. moli ai suka pomelo C. gradis (Whistler, 176 1984) moso`oi ylang-ylang Canaga odorata Lam. niu coconut Cocos nucifera L. nonu Indian mulberry Morinda citrifolia L. nonu vao rose or mountain apple Syzygium malaccense L. `ofe Samoan bamboo Schizostachyum glaucifolium Ruprecht pi- bean, pea (Milner) pineapple fala `aina (Milner) pua pua sami/pua same no data pulu (pulutai) beach spurge (medicinal) Euphorbia atoto Forst. -

Terminalia Catappa (Tropical Almond)
April 2006 Species Profiles for Pacific Island Agroforestry ver. 2.2 www.traditionaltree.org Terminalia catappa (tropical almond) Combretaceae (combretum family) alite (Solomon Islands pidgin); ‘autara‘a, ‘aua, ‘auari‘i, ‘auari‘iroa (Societies); kamani haole, kamani ‘ula, false kamani (Hawai‘i); kauariki, kaukauariki, taraire (Cooks: Mangaia); ma‘i‘i, koa‘i‘i, koua‘i‘i, ta‘ie (Marquesas); natapoa (Vanu- atu: Bislama); tropical, beach, or Indian almond (English); talie (Samoa); talise (Papua New Guinea: Tok Pisin); tavola, tivi (Fiji); telie (Tonga, ‘Uvea, Futuna, Tokelau, Tuvalu) Lex A. J. Thomson and Barry Evans IN BRIEF h C vit Distribution Naturally widespread in sub E El tropical and tropical zones of Indian and Pacific C. Oceans and planted extensively throughout the tropics. photo: Size Large tree 25–40 m (82–130 ft) tall. Habitat Subtropical and tropical maritime climates with annual rainfall generally 1000– 3500 mm (40–140 in); elevations below 300–400 m (1000–1300 ft). Vegetation Associated with coastal vegetation, especially strandline communities and beach forests including rocky shores and edges of man grove swamps. Soils Adapted to a wide range of lighter tex tured soil types. Growth rate Fast in early years, about 2 m/yr (6.6 ft/yr). Main agroforestry uses Soil stabilization, coas tal protection. Main products Nuts, timber. Yields Kernel yield is estimated to be about 5 kg (11 lb) per tree per year; timber yields can reach 15–20 m3/ha/yr (215–286 ft3/ac/yr) (estimate). Intercropping Short term crops can be interplanted during the first 2–3 years after es tablishment. -

View Catalog
Graham-1 Catalog and Literature Guide for Cretaceous and Cenozoic Vascular Plants of the New wo rld Alan Graham Missouri Botanical Garden, P. O. Box 299, St.Louis, Missouri 63166-0299 [email protected] Citation: Graham, A. 2011 et seq. Catalog and literature guide for Cretaceous and Cenozoic vascular plants of the New World. http://www.mobot.org/mobot/research/CatalogFossil/catalog.shtml. Reference: Graham, A. 2012. Catalog and literature guide for Cretaceous and Cenozoic vascular plants of the New World. Annals of the Missouri Botanical Garden 98: 539- 541. Last revision: 3/15/15; 12/31/2019 Graham-2 NULLIS IN VERBA (take no man’s word for it) Motto on the coat of arms of the Royal Society (London) granted by Charles II, September 17, 1662 Notes: Most identifications above family level and tentative generic identifications (e.g., ‘cf.’ or ‘type’) are not included. Fl.= flora; Fm.= formation; Ma- million years; NLR= nearest living relative (see Mosbrugger, 1999; Mosbrugger & Utescher, 1997). Among records of particular biogeographic interest, 1) Hansen et al. (2001) report pollen similar to regionally extinct taxa (including some Asian exotics) in deposits as young as ‘after 2.8 Ma’ (latest Pliocene) from Polk Co., FL: cf. Zamiaceae, cf. Ginkgo, cf. Sciadopitys, Tsuga/Sciadopitys, Tsuga canadensis-type, cf. Tsuga mertensiana, cf. Dacrydium, Podocarpus, Pterocarya, cf. Engelhardtia [Alfaroa-Oreomunnea], cf. Zelkova [Ulmus/Zelkova]. Some of these exotics (Alangium, Engelhardia, Sciadopitys) have been reported from the late middle to early late Miocene Bryn Mawr Formation along the mid-Atlantic Coast (head of Chesapeake Bay, MD; Pazzaglia et al., 1997).