Albert Sorel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
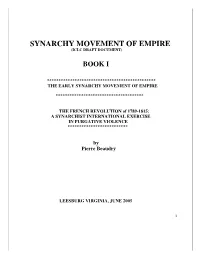
Synarchy Movement of Empire (Iclc Draft Document)
SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE (ICLC DRAFT DOCUMENT) BOOK I *********************************************** THE EARLY SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE ************************************** THE FRENCH REVOLUTION of 1789-1815: A SYNARCHIST INTERNATIONAL EXERCISE IN PURGATIVE VIOLENCE ************************** by Pierre Beaudry LEESBURG VIRGINIA, JUNE 2005 1 DEDICATION. This book is dedicated to the LaRouche Youth Movement (LYM) worldwide, and particularly to the French LYM, who deserve to know the truth about French history and world affairs. Previous generations of French citizens had settled their accounts with their immediate past history by either going to war, or by getting involved into absurd coups d'Etat, however, they never knew why they were doing so. My generation of Bohemian Bourgeois (BoBos) has not done that; it didn't care to do anything for history, nor for the future generations. It was only interested in lying and in taking care of "Me, Me, Me!" The problem that the youth of today are face with is that the truth about the French Revolution, about Napoleon Bonaparte, about the synarchy, about the destruction of the Third Republic, or about Vichy fascism, has never been told. So, either the truth comes out now, and finally exorcises the French population as a whole, once and forever, or else the French nation is doomed to repeat the same mistakes of the past, again and again. 2 BEASTMAN BONAPARTE 3 SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE (ICLC DRAFT DOCUMENT) BOOK I *********************************************** THE EARLY SYNARCHY MOVEMENT OF EMPIRE ************************************** THE FRENCH REVOLUTION of 1789-1815: A SYNARCHIST INTERNATIONAL EXERCISE IN PURGATIVE VIOLENCE ************************** 1.1 THE ORIGINAL MARTINIST CULT OF LYON . ………………………………18 1.2 INTRODUCTION 2.2 RELIGIOUS FANATICISM OF THE MARTINIST CULT 3.2 THE GNOSTIC HERESY AND THE MARTINIST SYNARCHY 4.2 THE CATHARS 5.2 WHAT IS MARTINISM? 6.2 THE CHARACTERISTIC OF LOUIS-CLAUDE DE SAINT-MARTIN. -

Public Opinion and Foreign Policy: British and French Relations with the Netherlands
Public Opinion and Foreign Policy: British and French Relations with the Netherlands, 1785-1815 Graeme Edward Callister PhD University of York Department of History September 2013 ABSTRACT This thesis examines the interplay of public opinion, national identity and foreign policy during the period 1785-1815, focusing on three consistently interconnected countries: the Netherlands, France and Great Britain. The Netherlands provides the centrepiece to the study, which considers how the Dutch were perceived as a nation, a people and as a political entity, at both governmental and popular levels, in the three countries throughout the period. Public opinion is theorised as a two-part phenomenon. Active public opinion represents the collated thoughts and responses of a certain public to an event or set of circumstances. Latent public opinion represents the sum of generally-accepted underlying social norms, stereotypes or preconceptions; the perceptions and representations latently present in unconscious mentalités. The thesis examines how perceptions and representations of the Netherlands in all three countries fed into public opinion and, ultimately, into national identity either of the self or the ‘other’. It then investigates the extent to which the triangular policies of Britain, France and the various incarnations of the Dutch state were shaped by popular perceptions, identities and opinion. While active opinion is shown to have generally been of negligible importance to the policy-making process, it is argued that the underlying themes of latent opinion often provided the conceptual background that politicians from all three countries used to make policy. The influence of latent opinion was often as much unconscious as deliberate. -

The French Diplomatic Corps, 1789-1799
““PPrroovveenn PPaattrriioottss””:: tthhee FFrreenncchh DDiipplloommaattiicc CCoorrppss,, 11778899--11779999 Linda S. Frey and Marsha L. Frey St Andrews Studies in French History and Culture ST ANDREWS STUDIES IN FRENCH HISTORY AND CULTURE The history and historical culture of the French-speaking world is a major field of interest among English-speaking scholars. The purpose of this series is to publish a range of shorter monographs and studies, between 25,000 and 50,000 words long, which illuminate the history of this community of peoples between the end of the Middle Ages and the late twentieth century. The series covers the full span of historical themes relating to France: from political history, through military/naval, diplomatic, religious, social, financial, cultural and intellectual history, art and architectural history, to literary culture. Titles in the series are rigorously peer-reviewed through the editorial board and external assessors, and are published as both e-books and paperbacks. Editorial Board Dr Guy Rowlands, University of St Andrews (Editor-in-Chief) Professor Andrew Pettegree, University of St Andrews Professor Andrew Williams, University of St Andrews Dr David Culpin, University of St Andrews Dr David Evans, University of St Andrews Dr Justine Firnhaber-Baker, University of St Andrews Dr Linda Goddard, University of St Andrews Dr Bernhard Struck, University of St Andrews Dr Stephen Tyre, University of St Andrews Dr Malcolm Walsby, University of St Andrews Dr David Parrott, University of Oxford Professor Alexander Marr, University of St Andrews/University of Southern California Dr Sandy Wilkinson, University College Dublin Professor Rafe Blaufarb, Florida State University Professor Darrin McMahon, Florida State University Dr Simon Kitson, University of London Institute in Paris Professor Eric Nelson, Missouri State University “Proven Patriots”: the French Diplomatic Corps, 1789-1799 by LINDA S. -

Why Did Napoleon Invade Russia? a Study in Motivation and the Interrelations of Personality and Social Structure Author(S): Harold T
Why Did Napoleon Invade Russia? A Study in Motivation and the Interrelations of Personality and Social Structure Author(s): Harold T. Parker Reviewed work(s): Source: The Journal of Military History, Vol. 54, No. 2 (Apr., 1990), pp. 131-146 Published by: Society for Military History Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1986039 . Accessed: 07/01/2013 14:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Society for Military History is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of Military History. http://www.jstor.org This content downloaded on Mon, 7 Jan 2013 14:32:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Whydid Napoleon Invade Russia? A Studyin Motivationand the Interrelationsof Personality and Social Structure* * Harold T. Parker "Your character and mine are opposed. You like to cajole people and obey their ideas. Moi, I like for them to please me and obey mine." Napoleon to Joseph, March 1814. "You ideologues, you act according to a system,prepared in advance. Moi, I am a practical person, I seize events and I push them as far as theywill go. -

Georges Lefebvre, the French Revolution: from Its Origins to 1793
The French Revolution ‘This is more than a history of the French Revolution. It covers all Europe during the revolutionary period, though events in France naturally take first place. It is particularly good on the social and intellectual back- ground. Surprisingly enough, considering that Lefebvre was primarily an economic historian, it also breaks new ground in its account of international relations, and sets the wars of intervention in their true light. The French have a taste for what they call works of synthesis, great general summaries of received knowledge. We might call them textbooks, though of the highest level. At any rate, in its class, whether synthesis or textbook, this is one of the best ever produced.’ A. J. P. Taylor Georges Lefebvre The French Revolution From its origins to 1793 Translated by Elizabeth Moss Evanson With a foreword by Paul H. Beik London and New York La Révolution française was first published in 1930 by Presses Universitaires de France. A new, entirely rewritten, version was published in 1951. The present work is a translation of the first three parts of the revised edition of 1957. First published in the United Kingdom 1962 by Routledge and Kegan Paul First published in Routledge Classics 2001 by Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. “To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’s collection of thousands of eBooks please go to www.eBookstore.tandf.co.uk.” © 1962 Columbia University Press All rights reserved. -
1 the Ancien Régime
Cambridge University Press 978-1-108-49745-9 — Revolutionary France's War of Conquest in the Rhineland Jordan R. Hayworth Excerpt More Information 1 The Ancien Régime To have somewhere to live is to begin to exist. France had frontiers and a place to live even before it formally existed. These frontiers, inherited, conquered, or reconquered, marked out an enormous area if it is mea- sured, as it should be, by the slow pace of communications in the past. In this respect, France was for a long time a “monster,” a “continent” in itself, a super-state, an over-sized political unit, not unlike an empire, uniting regions which were consequently hard to hold together and which had to be defended both against threats from within and, no less, from external dangers. The whole enterprise required an unbelie- vable outlay of strength, patience and vigilance. Fernand Braudel, The Identity of France1 For French nationalist historians like Henri Martin, history showed the unity of “the new France, the old France, and ancient Gaul.” Reflecting his early nineteenth-century and romantic mentality, Martin even described these historical Frances as “the same moral person.”2 Identifying France as Gaul had profound implications. In The Gallic War, Julius Caesar defined the boundaries of ancient Gaul as the Rhine, the Pyrenees, and the Alps.3 The ancient world’s most prominent geo- grapher, a Greek scholar named Strabo of Amasia, approved of Caesar’s assertion in a work that solidified the idea of the Gallic frontiers as permanent locations marked out by clear geographical features, most notably the Rhine.4 The statements by Caesar and Strabo, removed from their appropriate contexts, provided fodder for much subsequent mythmaking. -
Le 25 Fauteuil De L'académie Française
1 À la Bibliothèque de l’Institut, du 4 février au 30 avril 2008 Présentation de documents sur le thème : Le 25ème fauteuil de l’Académie française Le 13 décembre 2007, Monsieur Dominique FERNANDEZ a été reçu sous la Coupole au 25ème fauteuil de l’Académie française, occupé précédemment par le Professeur Jean BERNARD. Vingt-et-unième titulaire de ce fauteuil depuis la fondation de l’Académie, il y fut précédé par des personnalités variées, évoquées ici par des ouvrages et documents choisis dans le fonds de la Bibliothèque de l’Institut, où sont réunies les bibliothèques des Cinq Académies qui composent l’Institut de France. 1. Claude de L’ESTOILE.1602-1652. Admis à l’Académie française en 1634. Auteur dramatique, poète. Fils de l’auteur du célèbre journal sur les règnes de Henri III et Henri IV, il est l’auteur de pièces de théâtre, de poésies et de ballets. ¡ La Comédie des Tuileries, [Paris, 1659]. 8° Q 561 E*. Reliure en parchemin refaite Pièce écrite en 1638 à la demande de Richelieu qui fournit la trame de la pièce et en collaboration « par cinq différents auteurs qui, pour n’être pas nommés, ne laissent pas toutefois d’avoir beaucoup de nom », dit l’avis au lecteur. Parmi les auteurs se trouvaient Pierre Corneille et Jean Rotrou.. ¡ La Belle Esclave. Tragicomédie de Monsieur de L’Estoille. Paris, se vend à l’imprimerie des nouveaux caractères de Pierre Moreau… 1643. 4° R 69 ZZ 15. Reliure en parchemin de l’époque. ¡ L’Intrigue des Filous, comédie. Paris, 1649. 8° Q 562 A 13. -

The French Revolution and the Russian Revolution: Some Suggestive Analogies*
THE FRENCH REVOLUTION AND THE RUSSIAN REVOLUTION: SOME SUGGESTIVE ANALOGIES* By ISAAC DEUTSCHER AN eminent French historian once wrote: "Consider the revolutions of the Renaissance: in them you will find all the passions, all the spirit, and all the language of the French Revolution." With some reservations,one might also say that if one considers the Great French Revolution, one can find in it the passions, the spirit,and the language of the Russian Revolu- tion. This is true to such an extent that it is absolutely necessary for the student of recent Russian historyto view it every now and then throughthe French prism. (The studentof the French Revolution, too, may gain new insightsif occasionallyhe analyzes his subject in the light of the Russian experience.) Historical analogy by itselfis, of course, only one of the many angles from which he ought to approach his subject; and it may be down- right misleading if he merely contents himselfwith assembling the points of formal resemblance between historical situations. "History is concrete"; and this means, among other things,that every event or situation is unique, regardless of its possible similarityto other eventsand situations. In drawing any analogy, it is thereforeimportant to know where the analogy ends. I hope that I shall not offendbadly against this rule; and I would like to acknowledge my great debt to the eminent French historians whose works on the French Revolution have helped me to gain new insightsinto the Russian Revolution. It is well known that the controversyover the "Russian Thermidor" played in its time a great role in the strugglesin- * The forthcomingpublication of a French edition of Stalin: A Political Biography (English ed., New York and London, Oxford University Press, 1949) has given me an opportunityto comment for the benefitof the French reader on one aspect of that book, the analogies frequentlydrawn between the Russian and the French Revolutions. -

Lettres Et Manuscrits Autographes Lettres Et Manuscrits Autographes Lettres Et Manuscrits
13 AVRIL 2011 13 AVRIL LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES LETTRES ET MANUSCRITS AUTOGRAPHES LETTRES ET MANUSCRITS Alexis VELLIET Henri-Pierre TEISSEDRE Delphine de COURTRY Commissaires-priseurs EXPERT : Thierry BODIN 5 rue Drouot 75009 Paris - Tél. : +33 (0) 1 53 34 10 10 - Fax : +33 (0) 1 53 34 10 11 - [email protected] - www.piasa.fr PIASA SA - Ventes volontaires aux enchères publiques - agrément n° 2001-020 MERCREDI 13 AVRIL 2011 - DROUOT RICHELIEU COUV PIASA 130411.indd 1 18/03/11 13:50:39 CALENDRIER DES VENTES AVRIL – JUIN 2011 AVRIL JUIN DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES PHOTOGRAPHIES ANCIENNES, MODERNES DES XIXe ET XXe SIÈCLES Vendredi 1er avril 2011 ET CONTEMPORAINES Mercredi 1er juin 2011 ART D’ASIE Lundi 4 avril 2011 BANDE DESSINÉE ART CONTEMPORAIN Mardi 7 juin 2011 Vendredi 8 avril 2011 HAUTE ÉPOQUE MANUSCRITS Mercredi 8 juin 2011 Mercredi 13 avril 2011 ESTAMPES H. M. PETIET Jeudi 9 juin 2011 MAI ART D’ASIE LIVRES ANCIENS ET MODERNES Vendredi 10 juin 2011 Mardi 3 mai 2011 DESSINS, TABLEAUX ET SCULPTURES MOBILIER ET OBJETS D’ART DES XIXe ET XXe SIÈCLES Mercredi 4 mai 2011 PIASA Vendredi 17 juin 2011 ESTAMPES ANCIENNES ET MODERNES Jeudi 5 mai 2011 MANUSCRITS ESTIMATIONS GRATUITES Lundi 20 et mardi 21 juin 2011 ET CONFIDENTIELLES ART D’ASIE SANS RENDEZ-VOUS Mardi 17 mai 2011 ART CONTEMPORAIN MODE - HAUTE COUTURE Mercredi 22 juin 2011 Alexis VELLIET Henri-Pierre TEISSEDRE Delphine de COURTRY Jeudi 19 mai 2011 TABLEAUX ANCIENS Commissaires-priseurs ARTS DÉCORATIFS DU XXe SIÈCLE Vendredi 24 juin 2011 Vendredi 20 mai 2011 5, rue Drouot 75009 Paris BIJOUX ET ARGENTERIE Tél. -

H-France Review Vol. 20 (October 2020), No. 184 Jordan R. Hayworth, Revolutionary France
H-France Review Volume 20 (2020) Page 1 H-France Review Vol. 20 (October 2020), No. 184 Jordan R. Hayworth, Revolutionary France’s War of Conquest in the Rhineland: Conquering the Natural Frontier, 1792-1797. Cambridge Military Histories. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2019. xviii + 340 pp. Map, notes, bibliography, and index. $120.00 U.S. (hb). ISBN 9781108497459. Review by Ilya Berkovich, Institute for Habsburg and Balkan Studies, Austrian Academy of Sciences. Anyone who studied Latin in high school or university is likely to be familiar with the opening phrase of Julius Caesar’s Commentaries on the Gallic Wars: “Gallia est omnis divisa in partes tres.” While dealing more with its internal subdivisions, Caesar’s text could also be taken to infer the outer frontiers of Ancient Gaul: the Pyrenean mountains in the south and the great rivers Rhine and Rhône to the east.[1] Writing about a generation later, and using Caesar as one of his sources, the Greek geographer Strabo defined the boundaries of Gaul as the Pyrenees, the Rhine, and the Alps.[2] Many years later, these venerable classical authors were given a new lease of life. Taken out of context and cited selectively, the physical boundaries of ancient Gallia were evoked as the appropriate political frontiers for her modern successor state. But how early and to what extent did this desire for “natural frontiers” enter French political discourse? The Pyrenees have left little room for interpretation, while in the south east Caesar’s Rhône was typically substituted with Strabo’s Alps--albeit the former was prominently quoted to give Roman imperial flavour to modern territorial ambitions. -

320 Rue St Jacques:The Diary of Madeleine Blaess
Introduction 1942 An ongoing struggle with no respite In 1942, a fatigued and anxious public was facing a third year of Occupation. The difficulties with which the population had struggled in 1941 continued, but the hardship was all the more brutal and challenging because there was still no visible prospect of it coming to an end. As in 1941, malnutrition and the illness and disease it abetted were rife. Anxiety about finding enough food to eat to stay alive and to stave off serious illness was constant, and, for many, there was the perpetual fear that loved ones from whom they were separated were in harm’s way in POW camps or factories in Germany. The Occupation had forced people into compromises and put them under additional pressure in every aspect of their lives. Women were very much on the front line. Many women had to continue to care for elderly and for children and, at the same time, be the family breadwinner in the absence of fathers, husbands and broth- ers. The period was stagnant and lived very much in the present. Plans to study and to pursue a career often had to be put on hold. The possibility of marrying and starting a family was a remote aspiration for many. The future was deter- mined by circumstances of war which were unpredictable and uncontrollable. Madeleine’s 1942 entries continued broadly in the vein of those of the previous year. Her record still shows that most Parisians were preoccupied with getting through their lives from day-to-day. We get an insight into the extent to which the hardships of the Occupation were forcing Madeleine to forsake her scholarly ambitions. -

FRENCH EXPANSION to the RHINE RIVER DURING the WAR of the FIRST COALITION, 1792-1797 Jordan R
CONQUERING THE NATURAL FRONTIER: FRENCH EXPANSION TO THE RHINE RIVER DURING THE WAR OF THE FIRST COALITION, 1792-1797 Jordan R. Hayworth, M.A. Dissertation Prepared for Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 2015 APPROVED: Michael V. Leggiere, Major Professor Guy Chet, Committee Member Marie-Christine Weidmann Koop, Committee Member Nancy Stockdale, Committee Member Geoffrey Wawro, Committee Member Richard B. McCaslin, Chair of the Department of History Costas Tsatsoulis, Dean of the Robert B. Toulouse Graduate School Hayworth, Jordan R. Conquering the Natural Frontier: French Expansion to the Rhine River during the War of the First Coalition, 1792-1797. Doctor of Philosophy (European History), December 2015, 487 pp., 14 maps, references, 445 titles. After conquering Belgium and the Rhineland in 1794, the French Army of the Sambre and Meuse faced severe logistical, disciplinary, and morale problems that signaled the erosion of its capabilities. The army’s degeneration resulted from a revolution in French foreign policy designed to conquer the natural frontiers, a policy often falsely portrayed as a diplomatic tradition of the French monarchy. In fact, the natural frontiers policy – expansion to the Rhine, the Pyrenees, and the Alps – emerged only after the start of the War of the First Coalition in 1792. Moreover, the pursuit of natural frontiers caused more controversy than previously understood. No less a figure than Lazare Carnot – the Organizer of Victory – viewed French expansion to the Rhine as impractical and likely to perpetuate war. While the war of conquest provided the French state with the resources to survive, it entailed numerous unforeseen consequences.