AGRT1112853D CDC Saumur Et Cabernet De Saumur
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

C44 Official Journal
Official Journal C 44 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 10 February 2020 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 44/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9594 — CMA CGM/CIMC Neocontainer/JV) (1) . 1 2020/C 44/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9593 — PTT GC/ALPLA TH/JV) (2) . 2 2020/C 44/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9693 — Liberty/Aleris Divestment Business) (3) . 3 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 44/04 Euro exchange rates — 7 February 2020 . 4 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2020/C 44/05 Prior notification of a concentration (Case M.9713 — EQT/Recover) Candidate case for simplified procedure (4) . 5 EN (4) Text with EEA relevance. OTHER ACTS European Commission 2020/C 44/06 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. 7 2020/C 44/07 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. 15 2020/C 44/08 Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. -

Circonscription 1Er Degré 2012
Circonscriptions du premier degré - Maine-et-Loire Ille-et-Vilaine Mayenne Pouancé La Chapelle-Hullin Chazé Châtelais Henry Grugé-l'Hôpital L' Hôtellerie Saint-Sauveur Miré de-Flée de-Flée Chemiré Bouillé-Ménard sur-Sarthe Carbay Bourg-l'Évêque La Ferrière de-Flée Montguillon Sœurdres La Prévière Vergonnes La Jaille-Yvon Contigné Armaillé Morannes Noyant Nyoiseau Marigné la-Gravoyère Aviré Combrée Saint-Martin Brissarthe Noëllet Segré du-Bois Cherré Chenillé- Changé St-Michel Louvaines SEGRESEGRE Chambellay et-Chanveaux SEGRESEGRE Châteauneuf Le Tremblay Le Bourg-d'Iré Ste-Gemmes sur-Sarthe Sartre La Chapelle d'Andigné Champteussé Daumeray Durtal sur-Oudon Andigné Querré Montreuil sur-Baconne sur-Maine Champigné Juvardeil Étriché Challain Marans Huillé la-Potherie Thorigné-d'Anjou Sceaux-d'Anjou Les Rairies Gené Baracé Loiré Le Lion-d'Angers St-Quentin Chazé Cheffes Lézigné DURTALDURTAL lès-Beaurepaire sur-Argos Montigné Tiercé Écuillé lès-Rairies Fougeré Clefs Seiches La Chapelle St-Laud Grez-Neuville sur-le-Loir Vern-d'Anjou Brain Vaulandry Angrie sur-Longuenée Pruillé Montreuil Beauvau Feneu Soulaire-et-Bourg Soucelles sur-Loir Cheviré-le-Rouge Briollay Marcé Montpollin Broc Candé Genneteil La Membrolle Saint-Martin Chigné La Pouëze sur-Longuenée d'Arcé Freigné Le Plessis-Macé Villevêque Montreuil- Cantenay- Jarzé Chalonnes ANORDANORD Juigné Épinard Échemiré sous-le-Lude La Cornuaille ANORDANORD Corzé Chaumont Baugé Pontigné St-Clément ÉcouflantAESTAEST d'Anjou Lasse de-la-Place AESTAEST Pellouailles Chavaignes Dénezé Le Louroux-Béconnais -

Le Président Les Vice-Présidents Jackie Goulet Maire De La Ville De Saumur
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE Le président Les vice-présidents Jackie Goulet Maire de la Ville de Saumur 1 2 3 4 5 6 7 8 Sylvie Prisset Michel Pattée Isabelle Devaux Frédéric Mortier Jérôme Harrault Rodolphe Mirande Grégory Pierre Marc Bonnin Bellevigne-les-Châteaux Doué-en-Anjou Gennes-Val-de-Loire Longué-Jumelles Allonnes Rou-Marson Saumur Montreuil-Bellay 9 10 11 12 13 14 15 Anatole Micheaud Sophie Métayer Christian Ruault Guy Bertin Sandrine Lion Eric Mousserion Eric Touron Doué-en-Anjou Tuffalun Saint-Philbert-du-Peuple Neuillé Fontevraud-l’Abbaye Antoigné Distré Les conseillers délégués Les autres membres du bureau décisonnel Sophie Thomas Didier Armel Jean- Philippe Yves Armelle Gilles Isabelle Gérard Tubiana Guilmet Rousseau Froger Rétif Boucher Poncet Roussillat Grandhomme Police Saumur Saumur Artannes-sur-Thouet Bellevigne-les-Châteaux Blou Brain-sur-Allonnes La Breille-les-Pins Brossay Cizay-la-Madeleine Coudray-Macouard Astrid Laurent Jean-Pierre Yann Pilven Thierry Guillaume Jeannick Jacky Eric Isabelle Lelièvre Nivelle Antoine Le Sevellec Morisset Martin Cantin Marchand Lefièvre Isabellon Saumur Saint-Clément-des-levées Courchamps Courléon Denezé-sous-Doué Epieds La Lande-Chasles Montsoreau Parnay Le Puy-Notre-Dame Béatrice Pierre-Yves Benoit Pierre Alain Christian Didier Gilles Pierre-Yves Fabrice Bertrand Douet Ledoux De Boutray Boissonnot Gallé Guillaume Talluau Delamare Bardy Vivy Louresse-Rochemenier Artannes-sur-Thouet Saint-Macaire-du-Bois Souzay-Champigny Turquant Les Ulmes Varennes-sur-Loire Varrains Vaudelnay Alain -
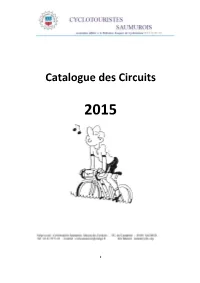
Catalogue Des Circuits
Catalogue des Circuits 2015 1 Les Circuits en 2015 Ce qui change Pour répondre aux normes de sécurité évoquées ci-dessous, le dimanche, tous les groupes ne partiront pas systématiquement sur le même parcours, un catalogue de circuits vous est proposé, il suffit de se reporter à la date concernée, au n° de parcours inscrit en regard de votre n° de groupe pour connaitre le parcours du jour. Quel groupe choisir ? Nous vous rappelons qu’il est impératif de s’auto-évaluer pour savoir avec quel groupe rouler. Pour ce faire nous vous invitons à prendre note des allures moyennes approximatives des groupes constitués, le calendrier des circuits est tracé en fonction de ces moyennes. Groupe 1 : +/- 30 - 32 km/h Groupe 3 : +/- 26 – 28 km/h Groupe 2 : +/- 28 – 30 km/h Groupe 4 : +/- 24 – 25 km/h A chacune/chacun de se positionner pour savoir dans quel groupe elle/il sera à l’aise. Rappel SÉCURITÉ Pour des raisons évidentes de sécurité, il est rappelé que les cyclos doivent se conformer aux règles strictes du Code de la Route comme tous véhicules circulant sur la chaussée. Les recommandations en vigueur nous demandent de ne pas circuler à plus de 20 cyclos par groupe, les départs des groupes doivent donc s’échelonner en fonction de cet impératif. En cas d’accident, même minime à vos yeux, faire une déclaration d’accident, il vaut mieux faire une déclaration pour rien que de se trouver « hors délais » en voulant la faire ultérieurement. Les équipements du cyclo comme du vélo doivent apporter pour les autres usagers de la route une bonne visibilité du cyclo et de sa « monture », notamment en temps de brouillard, de pluie et bien entendu la nuit (ou à l’aube et au crépuscule) pensez aux gilets jaunes (gratuits à retirer au Club pour celles et ceux qui en sont dépourvus) et à l’éclairage. -

European Commission
29.9.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 321/47 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2020/C 321/09) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF A STANDARD AMENDMENT TO THE SINGLE DOCUMENT ‘VAUCLUSE’ PGI-FR-A1209-AM01 Submitted on: 2.7.2020 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Description of the wine(s) Additional information on the colour of wines has been inserted in point 3.3 ‘Evaluation of the products' organoleptic characteristics’ in order to add detail to the description of the various products. The details in question have also been added to the Single Document under the heading ‘Description of the wine(s)’. 2. Geographical area Point 4.1 of Chapter I of the specification has been updated with a formal amendment to the description of the geographical area. It now specifies the year of the Geographic Code (the national reference stating municipalities per department) in listing the municipalities included in each additional geographical designation. The relevant Geographic Code is the one published in 2019. The names of some municipalities have been corrected but there has been no change to the composition of the geographical area. This amendment does not affect the Single Document. 3. Vine varieties In Chapter I(5) of the specification, the following 16 varieties have been added to those listed for the production of wines eligible for the ‘Vaucluse’ PGI: ‘Artaban N, Assyrtiko B, Cabernet Blanc B, Cabernet Cortis N, Floreal B, Monarch N, Muscaris B, Nebbiolo N, Pinotage N, Prior N, Soreli B, Souvignier Gris G, Verdejo B, Vidoc N, Voltis B and Xinomavro N.’ (1) OJ L 9, 11.1.2019, p. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard Amendment to a Product Specification for a Name in the Wine Sector Refe
10.2.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 44/15 Publication of a communication of approval of a standard amendment to a product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33. (2020/C 44/07) This communication is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATING THE APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Coteaux de Saumur’ PDO-FR-A0179-AM01 Date of communication: 13 November 2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Geographical name ‘Supplementary geographical name’ has been reduced to ‘geographical name’ in Chapter I points II and XII(2)(b). A number of the product specifications for Loire Valley wines allow the use of what is known as the ‘eponymous geographical designation’ — ‘Val de Loire’ — to refer to this wider region. The use of this term on wine labels is subject to specific rules laid down in those product specifications. As the term ‘supplementary geographical name’ is also used in some cases to denote smaller geographical units with more restrictive production conditions, the word ‘supplementary’ has been removed in order to prevent confusion. Point 9 of the Single Document, ‘Further conditions’, has been amended accordingly. 2. Geographical area The passage concerning the geographical area now reads as follows: All stages of production must take place in the geographical area, which spans the territories of the following municipalities, based on the 2018 -

Continental Atmospheric Circulation Over Europe During the Little Ice Age Inferred from Harvest Dates
Continental atmospheric circulation over Europe during the Little Ice Age inferred from harvest dates Supplementary Information P. Yiou (1), I. García de Cortázar-Atauri (2,*), I. Chuine (2), V. Daux (1), E. Garnier (1,3), N. Viovy (1), C. van Leeuwen (4), A. K. Parker (4,**), J.-M. Boursiquot (5,6) 1. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, UMR CEA-CNRS-UVSQ, CE Saclay l’Orme des Merisiers, 91191 Gif-sur-Yvette, France 2. Equipe BIOFLUX, Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, CNRS, 1919 route de Mende, 34293 Montpellier cedex 05, France 3. Centre de Recherche en Histoire Quantitative, UMR Université de Caen – CNRS, Esplanade de la Paix, 14032 Caen cedex 5 4. ENITA, Université de Bordeaux, UMR EGFV, ISVV, 1 Cours du Général de Gaulle, CS 40201, 33175, Gradignan-cedex, France. 5. Montpellier SupAgro – INRA, UMR DIAPC 1097, Equipe Génétique Vigne, 2 place Viala, F-34060 Montpellier, France. 6. INRA Unité Expérimentale du Domaine de Vassal, route de Sète, F-34340 Marseillan Plage, France (*) present address: European Commission JRC-IPSC-MARS-Agri4cast action, via E. Fermi 2749 - TP483, I-21027 Ispra (VA), Italy. (**) present address: Lincoln University, P.O. Box 84, Lincoln 7647, New Zealand Supplementary Tables Table 1. Main characteristics of the 9 composites series of grapevine harvest dates used in this study. $ mean temperature over March 15th to August 31st. * Important varieties identified in the region which are not used in our study because of insufficient data to calibrate the model. **Mean GHD is in day -

LE Guide Du Transport À La Demande Saumur Agglobus LA LANDE CHASLES MOULIHERNE
À PARTIR DU 3 SEPTEMBRE 2018 LE Guide du transport à la demandE Saumur Agglobus LA LANDE CHASLES MOULIHERNE LONGUÉ- JUMELLES VERNOIL SAINT-PHILIBERT -DU-PEUPLE VERNANTES LES-ROSIERS- COURLÉON SUR-LOIRE BLOU GENNES- VAL-DE-LOIRE SAINT-CLÉMENT- BREILLE-LES-PINS DES-LEVÉES NEUILLÉ VIVY BRAIN-SUR- ALLONNES TUFFALUN ALLONNES VERRIE SAUMUR DENEZÉ VILLEBERNIER ROU VARENNES- MARSON SUR-LOIRE LOURESSE- ROCHEMENIER VARRAINS ULMES DISTRÉ PARNAY CHACÉ SOUZAY MONTSOREAU CHAMPIGNY COURCHAMPS ARTANNES TURQUANT SUR THOUET ST CYR EN BOURG DOUÉ-EN-ANJOU COUDRAY CIZAY-LA- MACOUARD FONTEVRAUD ST JUST L’ABBAYE MADELEINE SUR DIVE BROSSAY BRÉZÉ VAUDELNAY ÉPIEDS MONTREUIL ST-MACAIRE -BELLAY -DU-BOIS PUY-NOTRE -DAME ANTOIGNÉ SOMMAIRE LE TRANSPORT À LA DEMANDE 4 MODE D’EMPLOI TAD ZONAL > 5 TAD EN DÉCLENCHEMENT > 6 J’HABITE DANS LE SECTEUR ROUGE 8 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 9 J’HABITE DANS LE SECTEUR VIOLET 10 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 11 CARTE TAD ZONAL > 12 J’HABITE DANS LE SECTEUR ORANGE 14 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 15 CARTE TAD ZONAL > 13 3 J’HABITE DANS LE SECTEUR BLEU 16 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 17 CARTE TAD ZONAL > 18 J’HABITE DANS LE SECTEUR JAUNE 20 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 21 CARTE TAD ZONAL > 19 J’HABITE DANS LE SECTEUR VERT 22 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI > 23 CARTE TAD ZONAL > 24 JE RÉSERVE MES TRAJETS 25 BIEN VOYAGER EN 26 TRANSPORT À LA DEMANDE LE transport à la demande MODE D’EMPLOI Le transport à la demande est un service de Fonctionnement transport en commun sur réservation proposé par le réseau Saumur Agglobus. -

Février 2021
C'PAGES LE MAGAZINE D'INFORMATION DE BRISSAC LOIRE AUBANCE VIE MUNICIPALE SCOLAIRE RENCONTRE CULTURE Une enquête pour le Le parc informatique Avec Vivien Landrin, 2021, année Polar projet de territoire des écoles renforcé militant de la nature P. 5 P.11 P.27 P.31 www.brissacloireaubance.fr N°12 CONSOMMER LOCAL UN ENJEU Février POUR DEMAIN 2021 Les Alleuds / Brissac-Quincé / Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance Chemellier / Coutures / Luigné / Saint-Rémy-la-Varenne Saint-Saturnin-sur-Loire / Saulgé-l’Hôpital / Vauchrétien services municipaux EDITO Accueil 5 rue du maréchal Foch – Brissac-Quincé - Brissac Loire Aubance. Tel : 02 41 91 74 00 [email protected] et sur www.brissacloireaubance.fr Sylvie Sourisseau Service affaires scolaires et périscolaires [email protected] Maire de Brissac Loire Aubance A Chemellier, la permanence a lieu chaque mardi après-midi. Service Rayonnement du Territoire accueil mairies Communication, vie associative, sport et culture. [email protected] 2020 est passée, et Et malgré le contexte et la gestion de cette crise BRISSAC LOIRE AUBANCE [email protected] nous avons tourné la inédite, où nous devons sans cesse nous adapter 5 rue du maréchal Foch - Brissac-Quincé [email protected] dernière page de cette aux directives sanitaires, les 53 premiers élus de 49320 BRISSAC LOIRE AUBANCE - 02 41 91 74 00 › Lundi, jeudi et samedi : 9h - 12h [email protected] année bien particulière, BLA se sont attelés à leurs tâches avec énergie et › Mardi, mercredi, vendredi : 9h - 12h, 14h - 17h [email protected] en espérant une année passion ! En cas de fermeture des Mairies déléguées, contactez la Mairie de 2021 différente ! La proximité reste un élément essentiel de notre Brissac Loire Aubance. -

Essai De Classement Des Cépages Français En Écogéogroupes Phénotypiques
ESSAI DE CLASSEMENT DES CÉPAGES FRANÇAIS EN ÉCOGÉOGROUPES PHÉNOTYPIQUES FRENCH GRAPEVINES CLASSED IN PHENOTYPICAL ECOGEOGROUPS ESSAY J. BISSON B.P. 51, 45250 Briare, France Résumé : Les propositions antérieures de structure des cépages français en groupes écogéographiques sont déve- loppées par l'intégration des formes individuelles en unités taxonomiques basées sur la morphologie. Sans que le travail présenté ici puisse être considéré comme certain et définitif, tel quel, il est offert à titre comparatif aux avan- cées de biochimie génétique récemment effectuées. Abstract : Two specialists, NEGRUL (1946) et LEVADOUX (1948) proposed for Europe vine-plants cultiva- ted a classification in natural groups issued from ecogeographical areas relatively closed in their situations and evo- lutions. These ampelographs are complementary in their propositions, Russian for Eastern Europe and French for Western forms. Middle-East is the probable origin of mediterranean viticulture with its vine-varieties then the local wild forms in more septentrional vineyard extensions. After sortotypes or ecogeogroups definitions, anterior structural propositions of French vine-varieties in eco-geo- graphical groups are developped by individual integration forms in taxonomic and morphologic unities. The pre- sent propositions are not immovable nor definitive but as such they may be useful in recent genetic advancements. They can confirm or not some new biochemical diagnosis. Mots clés : Vitis vinifera, cépages, ampélographie, taxonomie Key words : Vitis vinifera, vine-varieties, ampelography, taxonomy INTRODUCTION Aujourd'hui, la mise au point de méthodes biochi- miques d'identification et de codage génétique La taxonomie ampélographique classique basée (BOURSIQUOT, 1987 ; CUISSET 1997 ; BOWERS essentiellement sur la morphologie des cépages condui- et MEREDITH, 1997) viendra confirmer ou infirmer sit NEGRUL (1946) et LEVADOUX (1948) à les résultats obtenus par les observations morpholo- proposer la notion de sortotype ou de groupe écolo- giques. -

Saumur Val De Loire Le Territoire De L'epci
DREAL Pays de la Loire Saumur Val de Loire 11, rue du Maréchal Leclerc 49 408 Saumur Cedex Tel : 02 41 40 45 50 Président : Jean-Michel Marchand Date de création de l'EPCI : 1er janvier 2017 Délibération d'approbation du PLH : 5 mars 2020 Validité du PLH : 2020-2026 Avancement du PLH : 1er PLH sur ce nouvel EPCI Élaboration avec l'appui de : Cérur et Novascopia Motif d'engagement : obligatoire Présenté en bureau du CR2H en avril 2020 Le territoire de l’EPCI La Communauté d’agglomération (CA) se situe à l'est du département de Maine-et-Loire. Cet EPCI est issu de la fusion de la CA de Saumur Loire Développement et des CC de la région de Doué-la-Fontaine, du Gennois et Loire Longué. Il regroupe 45 communes et la population atteint presque les 100 000 habitants. Le périmètre de l’EPCI est notamment couvert par : - le SCoT du Grand Saumurois approuvé le 23 mars 2017 ; - le plan départemental de l'habitat et de l'hébergement (PDHH) de Maine-et-Loire pour la période 2020-2025, - les communes de l'ancienne CC de la Région de Doué-La-Fontaine sont couvertes par un PLUIH approuvé en décembre 2016. 6 communes de la CA sont concernées par le dispositif de l'article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU). 2 communes ont atteint le taux de logements locatifs sociaux (LLS) requis : Saumur et Montreuil-Bellay. 4 communes sont exemptées pour la période 2020-2022 : Bellevigne-les-Châteaux, Doué-en-Anjou, Longué-Jumelles et Gennes-Val de Loire. -

Cahier Des Charges Des Appellations D'origine Contrôlées Anjou
Publié au BO-AGRI le 30 juin 2016 Cahier des charges des appellations d’origine contrôlées « ANJOU », « CABERNET D’ANJOU » et « ROSÉ D’ANJOU » homologué par le décret n°2011-1556 du 15 novembre 2011,modifié par arrêté du 20 juin 2016 publié au JORF du 30 juin 2016 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre aux appellations d’origine contrôlées suivantes les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après : - « Anjou », initialement reconnue par les décrets du 14 novembre 1936 (vins tranquilles) et du 14 mai 1938 (vins mousseux) ; - « Cabernet d’Anjou », initialement reconnue par le décret du 9 mai 1964 ; - « Rosé d’Anjou », initialement reconnue par le décret du 31 décembre 1957. II. - Dénominations géographiques, mentions complémentaires, indication 1°- Les noms des appellations d’origine contrôlées peuvent être complétés par la dénomination géographique « Val de Loire » selon les règles fixées dans le présent cahier des charges pour l’utilisation de cette dénomination géographique. 2°- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée « Anjou » est suivi de l’indication « gamay » pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette indication dans le présent cahier des charges. 3°- Les noms des appellations d’origine contrôlées « Anjou » suivi de l’indication « gamay », « Cabernet d’Anjou », « Rosé d’Anjou », peuvent être complétés par la mention «primeur» ou «nouveau» pour les vins répondant aux conditions particulières fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges. III. - Couleur et types de produit 1°- L’appellation d’origine contrôlée « Anjou » est réservée aux vins tranquilles blancs et rouges et aux vins mousseux blancs et rosés.