Togo) : Évolution, Facteurs Associés Et Perceptions
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Fight Hidden in Plain Sight
THE FIGHT HIDDEN IN PLAIN SIGHT SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH AND RIGHTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE AND CENTRAL ASIA Table of contents: Introduction 5 Albania 6 Armenia 14 Belarus 22 Bosnia and Herzegovina 32 Bulgaria 38 Croatia 44 Georgia 52 Kazakhstan 60 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Latvia 64 Introduction: Antonina Lewandowska North Macedonia 68 Proof reading: Joel Henderson Cover and layout design: Julia Karwan-Jastrzębska, Joanna Meuś Moldova 76 ISBN 978-83-88-568-67-1 Published by: ASTRA Network Secretariat Poland 82 Nowolipie 13/15, 00-150, Warsaw, Poland Warsaw, Poland, 2020 Romania 92 Publication of this report was possible due to financial support of International Women’s Health Coalition. Russia 100 Introduction The year 2019 marked ASTRA Network’s 20th international attention, just like Polish Black anniversary of existence. For two decades, we Protest or Slovak Nebudeme Ticho to name have been monitoring the situation of sexual the latest ones, have had the power to stop and reproductive health and rights in Central draconian laws and keep the legislature intact. and Eastern Europe and Central Asia. Our However, Poland and Slovakia are not the only work focuses on supporting grassroot organ- ones that can mobilize the people – similar isations in the region and providing them initiatives, often organized or coordinated with opportunities to forward their work by ASTRA Network member organisations, even further – including the international were attended by tens of thousands in differ- arena. Our members are amazing actors in ent countries of the region as well. Activists their home countries, who do game-chang- defending human rights are fighting relent- ing grassroot work on community organizing, lessly to not let the far-right and religious providing healthcare and education, mobiliz- fundamentalists alter the system. -

The FIAPAC Newsletter, April 2019 Editorial. Table of Content
The FIAPAC Newsletter, April 2019 Table of content 2 Executive Committee, Membership, Official seat 3 2020 Conference Berlin 4 SheDecides 5 Interesting links, MyBodyMyLife exhibition 6 Cochrane fertility regulation 7 News from FIAPAC (board)members Editorial. Dear FIAPAC Members, colleagues and friends, The new FIAPAC board met in Brussels on 9 March 2019 and I am pleased to report that the recent congress in Nantes in September 2018, was not just a huge success but also a small financial success. As part of the board business the new executive committee was established and essentially will provide the same stable team for the next two years. FIAPAC is now looking forward to the next congress and the board voted overwhelming that this be held in Berlin in the autumn 2020. Berlin is a vibrant city with excellent conference and leisure facilities. In addition, there is increasing pressure from providers, policy makers and civil rights groups to improve reproductive rights for women in Germany and so hosting FIAPAC in Berlin will give support to future developments in this area. The exact dates for the 2020 confer- ence remain to be confirmed (pending availability and cost of a sufficiently large venue that can meet the requirements of a conference of our size and diversity). We will of course send news of dates to all members as soon as dates are secured. In the meantime we are about to prepare the scientific programme and so we are asking mem- bers to send us ideas for topics, speakers, workshops or other formats for the congress that they feel may be of interest - by the end of May. -

Abortion Issue in Croatia
“GREY AREA”: ABORTION ISSUE IN CROATIA ABSTRACT: This paper involves analysis and mapping of relevant stakeholders, legislation, policy and practice of the issue of abortion on demand in the Republic of Croatia in year 2014, with the aim of obtai- ning better insights and contributing to the understanding of the overall situation. Data collection methods that were used included focus group discussion, individual semi-structured interviews, written submissions and statements. Questions and problems related to the abortion issue belong to the “grey area”, thus characterized by: inadequate state regulation, deficiencies in the aborti- on records, cases of medical corruption and official misconduct, variability of medical treatment (high) cost on regional and hospital level and the incidence of conscientious objection. With all of the above, as well as with traditional, patriarchal stigmatization of women who voluntarily termi- nate pregnancy, along with current neoconservative threats - the accessibility and safety of legal abortions in Croatia is difficult. Further difficulties are the result of the indifference of managing structures of the health care system that do not accept responsibility for the failures in regulation and supervision. In the current situation, it is essential that the Ministry of Health and other rele- vant stakeholders in the health sector take affirmative actions to promote the options for materia- lisation of women’s reproductive rights. Given the findings of this study, with the aim of achieving the accessibility and safety of abortion on demand, it is necessary to ensure the accessibility of the procedure in all qualified institutions - regulate cases of conscientious objection, sanction abortion procedures in private gynaecological practices, standardize procedures and costs, and make all information (on procedures, costs ...) available on the Internet. -

Covid- 19 Pandemic and the Protection of the Right to Abortion
UDK 34-055.2: 616-036.21 Original scientific article COVID- 19 PANDEMIC AND THE PROTECTION OF THE RIGHT TO ABORTION Ivana Tucak, PhD, Associate Professor Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia [email protected] Anita Blagojević, PhD, Associate Professor Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Law Stjepana Radića 13, Osijek, Croatia [email protected] ABSTRACT The COVID - 19 pandemic that swept the world in 2020 and the reactions of state authorities to it are unparalleled events in modern history. In order to protect public health, states have limited a number of fundamental human rights that individuals have in accordance with national constitutions and international conventions. The focus of this paper is the right of access to abortion in the Member States of the European Union. In Europe, the situation with regard to the recognition of women’s right to abortion is quite clear. All member states of the European Union, with the exception of Poland and Malta, recognize the rather liberal right of a woman to have an abortion in a certain period of time after conception. However, Malta and Poland, as members of the European Union, since abortion is seen as a service, must not hinder the travel of women abroad to have an abortion, nor restrict information on the provi- sion of abortion services in other countries. In 2020, a pandemic highlighted all the weaknesses of this regime by preventing women from traveling to more liberal countries to perform abortions, thus calling into question their right to choose and protect their sexual and reproductive rights. -

Recours À L'avortement Provoqué À Lomé (Togo) : Évolution, Facteurs Associés Et Perceptions
Université de Montréal Recours à l’avortement provoqué à Lomé (Togo) : évolution, facteurs associés et perceptions Par Afiwa N’BOUKE Département de démographie Faculté des arts et des sciences Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) en Démographie Juillet 2011 © Afiwa N’BOUKE, 2011 Université de Montréal Faculté des études supérieures et postdoctorales Cette thèse intitulée : Recours à l’avortement provoqué à Lomé (Togo) : évolution, facteurs associés et perceptions Présentée par : Afiwa N’BOUKE a été évaluée par un jury composé des personnes suivantes : Thomas LeGrand, président-rapporteur Solène Lardoux, directrice de recherche Anne-Emmanuèle Calvès, co-directrice Nathalie Mondain, membre du jury Agnès Guillaume, examinatrice externe Mamoudou Gazibo, représentant du doyen i Résumé Le sujet de l’avortement provoqué demeure encore tabou au Togo et la compréhension du phénomène reste incomplète. La présente étude vise à dresser un portrait complet de ses divers aspects dans la capitale togolaise, qui a connu une baisse importante de la fécondité au cours des dernières années. À partir des données des Enquêtes démographiques et de santé (EDS) de 1988 et 1998, et de celles de l’Enquête sur la planification familiale et l’avortement provoqué (EPAP) de 2002, l’étude montre que le recours à l’avortement est à la hausse à Lomé, bien que l’estimation de son ampleur dépende de la méthode utilisée. Plus de 32 % des femmes ayant déjà été enceintes ont déclaré avoir avorté au moins une fois. Toutefois, l’avortement est plus fréquent chez les jeunes, qui y ont recours de manière plus précoce et plus rapprochée que leurs aînées. -

PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE PRODUCTION ABOUT ABORTION: the POLITICS of LOCATION and REPRESENTATION Data Set References
Supplementary material BMJ Sex Reprod Health PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE PRODUCTION ABOUT ABORTION: THE POLITICS OF LOCATION AND REPRESENTATION Catriona Ida Macleod, Jabulile Mavuso, Malvern Chiweshe, Ryan du Toit Data set references Adler NE (1976) Sample Attrition in Studies of Psychosocial Sequelae of Abortion: How Great a Problem? Journal of Applied Social Psychology 6(3): 240–259. Adler NE, David HP, Major BN, et al. (1992) Psychological factors in abortion: A review. American Psychologist 47(10): 1194–1204. Adler NE, Ozer EJ and Tschann J (2003) Abortion among adolescents. American Psychologist 58(3): 211–217. Allanson S (2007) Abortion decision and ambivalence: insights via an abortion decision balance sheet. Clinical Psychologist 11(2): 50–60. Allgeier AR, Allgeier ER and and Rywick T (1982) Response to requests for abortion: The influence of guilt and knowledge. Journal of Applied Social Psychology 12(4): 281–291. Alter R (1984) Abortion outcome as a function of sex-role identification. Psychology of Women Quarterly 8(3): 211–233. Ambuel B (1995) Adolescents, unintended pregnancy, and abortion: The struggle for a compassionate social policy. Current Directions in Psychological Science 4: 1–5. Baluk U and O’Neill PO (1980) Health professionals’ perceptions of the psychological consequences of abortion. American Journal of Community Psychology 8(1): 67–75. Bègue L (2001) Social judgment of abortion: a black-sheep effect in a Catholic sheepfold. The Journal of Social Psychology 141(5): 640–9. Bernas RS and Stein N (2001) Changing stances on abortion during case-based reasoning tasks: Who changes and under what conditions. Discourse Processes 32(3): 177–190. -

1 Universidade Federal Da Paraiba Centro De Ciências Humanas, Letras E Artes Programa De Pós-Graduação Em Psicologia Social
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL ATITUDES E VULNERABILIDADES FRENTE AO ABORTO PROVOCADO EM CONTEXTOS DE LEGALIDADE E ILEGALIDADE IRIA RAQUEL BORGES WIESE Núcleo de Pesquisa Vulnerabilidades e Promoção da Saúde JOÃO PESSOA-PB 2017 1 IRIA RAQUEL BORGES WIESE ATITUDES E VULNERABILIDADES FRENTE AO ABORTO PROVOCADO EM CONTEXTOS DE LEGALIDADE E ILEGALIDADE Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) como requisito para obtenção do título de doutora. Orientadora: Profª Draª Ana Alayde Werba Saldanha JOÃO PESSOA-PB 2017 2 W651a Wiese, Iria Raquel Borges. Atitudes e vulnerabilidades frente ao aborto provocado em contextos de legalidade e ilegalidade / Iria Raquel Borges Wiese. - João Pessoa, 2017. 333 f. : il. - Orientadora: Ana Alayde Werba Saldanha. Tese (Doutorado) - UFPB/PPGPS 1. Aborto provocado. 2. Legalidade - Aborto. 3. Ilegalidade - Aborto. I. UFPB/B Título. CDU – C 173.4(043) 3 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL – DOUTORADO ATITUDES E VULNERABILIDADES FRENTE AO ABORTO PROVOCADO EM CONTEXTOS DE LEGALIDADE E ILEGALIDADE Iria Raquel Borges Wiese BANCA AVALIADORA Profª Drª. Ana Alayde Werba Saldanha (Orientadora – Universidade Federal da Paraíba) Prof. Dr. Júlio Rique Neto (Membro interno à universidade – Universidade Federal da Paraíba) Prof. Dr. Eduardo Sérgio Soares Sousa (Membro interno à universidade – Universidade Federal da Paraíba) Prof. Dr. Degmar Francisco dos Anjos (Membro externo à universidade – Instituto Federal da Paraíba) Profª Drª. Josevânia da Silva (Membro externo à universidade – Universidade Estadual da Paraíba) 4 “A utopia está lá no horizonte. -

CHAPTER 4: Results ……………………..………….………………………
THE ATTITUDES OF YOUNG MALE LEARNERS TOWARDS ABORTION BY LEBOHANG M. M. SELEBALO SUBMITED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE MASTER OF COUNSELLING PSYCHOLOGY DEGREE AT THE UNIVERSITY OF KWAZULU-NATAL HOWARD COLLEGE CAMPUS DURBAN 2010 SUPERVISOR: MRS CYNTHIA PATEL DECLARATION I, Lebohang M. M. Selebalo declare that this research is a result of my own work, except where otherwise stated. I have given the full acknowledgement of the sources referred to in the text. This study has not been submitted before for any degree or examination at any university. Student No: 203515206 Date: November 2010 Signature: ………..……………… ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to extend my sincere gratitude to the following: - First of all, my supervisor Mrs. Cynthia Patel, for her commitment and dedication in assisting and guiding me throughout the research project. Her support and continued encouragement is highly appreciated. - The male learners from Brettonwood High School, Chesterville Extension High School, Glenwood High School, Grove End Secondary School, Orient Islamic School, and Stanmore Secondary School who were participants in this study. Without them, this research project would have not been possible. - The educators and management from the above mentioned schools for their support and assistance during the data collection process. - My editor, Mrs. Jayde Aitken, for her assistance in professional editing of this research paper. - My loving husband, Ntate Theko C. Bereng for his continued love, support and assistance in proof reading this paper during the research process. - Lastly but not least, God Almighty for giving me the strength and courage to carry out this research project. It‟s all by his grace. -
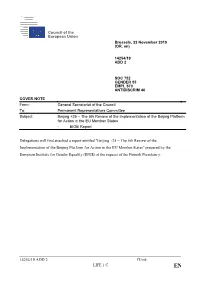
14254/19 ADD 2 IT/Mk LIFE.1.C Delegations Will Find Attached a Report Entitled "Beijing +25 – the 5Th Review of the Imple
Council of the European Union Brussels, 22 November 2019 (OR. en) 14254/19 ADD 2 SOC 752 GENDER 53 EMPL 570 ANTIDISCRIM 46 COVER NOTE From: General Secretariat of the Council To: Permanent Representatives Committee Subject: Beijing +25 – The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States - EIGE Report Delegations will find attached a report entitled "Beijing +25 – The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States" prepared by the European Institute for Gender Equality (EIGE) at the request of the Finnish Presidency. 14254/19 ADD 2 IT/mk LIFE.1.C EN Beijing +25 The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States Draft report, October 4, 2019 Contents Contents ........................................................................................................................................... 1 List of figures .................................................................................................................................... 2 Acronyms .......................................................................................................................................... 4 Executive Summary .......................................................................................................................... 5 Introduction .................................................................................................................................... 18 1. Institutional developments -

Right to Reproductive Health As Legal Avenue for Access to Safe Abortion in Ireland, Poland and Croatia
Right to reproductive health as legal avenue for access to safe abortion in Ireland, Poland and Croatia by Lejla Hodžić LL.M in Human Rights, Long Thesis Professor: Judit Sandor CEU eTD Collection Legal Studies Department Central European University 1051 Budapest, Nador utca 9. Hungary © Central European University November 2018 Table of Contents Abbreviations ............................................................................................................................ iii Executive Summary .................................................................................................................. iv Introduction .............................................................................................................................. 1 a) Gap in the research .......................................................................................................... 1 b) Explanation of jurisdictions ............................................................................................ 1 Chapter I Access to safe abortion in international human rights framework and in legislation of Ireland, Poland and Croatia ............................................................................. 2 Introduction ............................................................................................................................ 2 Development of reproductive rights and access to safe abortion ........................................... 4 Right to reproductive health and its importance for access to safe abortion ..................... -

Liberating Women - Removing Barriers and Increasing Access to Safe Abortion Care”
THE th FIAPAC CONFERENCE 13 “Liberating women - removing barriers and increasing access to safe abortion care” Nantes, France La Cité, Nantes Events Center 4- 5 September 20 8 1 1 1 www.fiapac.org FIAPAC International*Federation*of*Professional*Abortion*and*Contraception*Associates Table of content Plenary sessions .................................................. 2 Concurrent sessions ............................................ 8 Lunch sessions .................................................... 21 Free communications ........................................... 27 Poster presentations ............................................ 45 Abbreviations PS: Plenary session CS: Concurrent session LS: Lunch session FC: Free communication P: Poster presentation Plenary sessions PS1.1 The Global Abortion Policies Database – a policy tool designed to increase the transparency of global abortion laws and policies and state accountability for the protection of women’s and girls’ health and human rights Antonella Lavelanet, World Health Organization, Switzerland WHO strives for a world where all women’s and men’s rights to enJoy sexual and reproductive health are promoted and protected, and all women and men, including adolescents and those who are underserved or marginalized, have access to sexual and reproductive health information and services. Access expressed through laws, policies, and guidelines is a key component of the enabling environment for safe abortion. However, abortion laws and policies can be punitive or protective; specific or non-specific; confusing and even contradictory at times, all of which may exacerbate a chilling effect on those who seek, provide or advocate for access to services. Launched in June 2017, the Global Abortion Policies Database (GAPD) contains abortion laws, policies, standards and guidelines for UN and WHO Member States designed to strengthen global efforts to eliminate unsafe abortion by facilitating comparative analyses of countries’ abortion laws and policies. -

RETHINKING the RIGHT to ABORTION1 Associate Professor, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek E-Mai
RETHINKING THE RIGHT TO ABORTION1 Anita BLAGOJEVIĆ Associate professor, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek E-mail:[email protected] Ivana TUCAK Associate professor, Faculty of Law Osijek, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek E-mail: [email protected] Abstract The ending of pregnancy is an issue that keeps attracting great attention even today, at the beginning of the 21st century. Since the 1970s, abortion legislation has moved steadily towards liberalization, especially in developed countries around the world. In Europe, only a few countries still prohibit abortion on request. Yet neither the current legislation nor the relevant case law of supreme and constitutional courts have brought about consensus on the justification thereof. An exceptionally delicate matter made so by a wealth of moral, ethical, philosophical, medical, religious, economic, legal and other aspects, abortion is a bone of contention in the general public and many an expert community. The reasoning provided in constitutional reviews of law is lambasted in equal measure by the pro-choice and the pro-life camps, the latter of which are felt in presence and influence despite the ever-growing liberalization. The paper primarily examines the matter of abortion in comparative and Croatian constitutional law and legislation from the perspective of human rights. Key words: human rights, the right to privacy, freedom, dignity. 1This article has been translated from Croatian by Aleksandra Živković in collaboration with the authors. Anita BLAGOJEVIĆ, Ivana TUCAK 1. Introduction Termination of pregnancy has remained a storm center to this day. Since the 1970s, abortion legislation has moved steadily towards liberalization, especially in developed countries around the world.