Quartier Mangin" Qui Deviendra Finalement La Terminologie Définitive
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Communes-Aisne-IDE.Pdf
Commune Arrondissement Canton Nom et Prénom du Maire Téléphone mairie Fax mairie Population Adresse messagerie Abbécourt Laon Chauny PARIS René 03.23.38.04.86 - 536 [email protected] Achery Laon La Fère DEMOULIN Georges 03.23.56.80.15 03.23.56.24.01 608 [email protected] Acy Soissons Braine PENASSE Bertrand 03.23.72.42.42 03.23.72.40.76 989 [email protected] Agnicourt-et-Séchelles Laon Marle LETURQUE Patrice 03.23.21.36.26 03.23.21.36.26 205 [email protected] Aguilcourt Laon Neufchâtel sur Aisne PREVOT Gérard 03.23.79.74.14 03.23.79.74.14 371 [email protected] Aisonville-et-Bernoville Vervins Guise VIOLETTE Alain 03.23.66.10.30 03.23.66.10.30 283 [email protected] Aizelles Laon Craonne MERLO Jean-Marie 03.23.22.49.32 03.23.22.49.32 113 [email protected] Aizy-Jouy Soissons Vailly sur Aisne DE WULF Eric 03.23.54.66.17 - 301 [email protected] Alaincourt Saint-Quentin Moy de l Aisne ANTHONY Stephan 03.23.07.76.04 03.23.07.99.46 511 [email protected] Allemant Soissons Vailly sur Aisne HENNEVEUX Marc 03.23.80.79.92 03.23.80.79.92 178 [email protected] Ambleny Soissons Vic sur Aisne PERUT Christian 03.23.74.20.19 03.23.74.71.35 1135 [email protected] Ambrief Soissons Oulchy le Château BERTIN Nicolas - - 63 [email protected] Amifontaine Laon Neufchâtel sur Aisne SERIN Denis 03.23.22.61.74 - 416 [email protected] Amigny-Rouy Laon Chauny DIDIER André 03.23.52.14.30 03.23.38.18.17 739 [email protected] Ancienville Soissons -

Reglement Du Service De Transport a La Demande Organisé Par La Communaute D’Agglomeration Du Pays De Laon
REGLEMENT DU SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE LAON ADOPTE EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 JUIN 2018 Applicable à compter du 3 septembre 2018 1 PREAMBULE Le service de transport à la demande (TAD) de la Communauté d’Agglomération du Pays de Laon (CAPL) est un service complémentaire à l’offre régionale de transport interurbain et au réseau des Transports Urbains Laonnois (TUL) existants. Il propose aux habitants de la CAPL un rabattement vers les lignes du réseau TUL au niveau de la gare de LAON. Toutes les communes de la CAPL sont desservies par une ou plusieurs lignes de TAD, exceptées les communes d’Athies-sous-Laon et Samoussy, amplement desservies par des lignes de transport régionales, Laon et Chambry desservies par le réseau TUL. Le service de TAD de la CAPL fonctionne avec des véhicules 9 places équipés pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il est organisé en lignes virtuelles fonctionnant à des jours et horaires prédéfinis. Il ne fonctionne qu’en cas de réservations sachant qu’une seule réservation suffit à déclencher le service. ARTICLE 1 : PERIMETRE DE FONCTIONNEMENT Le périmètre de fonctionnement du service de TAD correspond au périmètre de la CAPL composée des communes suivantes: Arrancy, Aulnois-sous-Laon, Besny-et-Loizy, Bièvres, Bruyères-et-Montbérault, Bucy-les- Cerny, Cerny-en-Laonnois, Cerny-les-Bucy, Cessières, Chamouille, Chérêt, Chivy-les- Étouvelles, Clacy-et-Thierret, Colligis-Crandelain, Crépy, Eppes, Étouvelles, Festieux, Laniscourt, Laval-en-Laonnois, Lierval, Martigny-Courpierre, Molinchart, Mons-en- Laonnois, Montchâlons, Monthenault, Nouvion-le-Vineux, Orgeval, Parfondru, Presles-et- Thierny, Vaucelles-et-Beffecourt, Veslud, Vivaise, Vorges. -

The Purpose of the First World War War Aims and Military Strategies Schriften Des Historischen Kollegs
The Purpose of the First World War War Aims and Military Strategies Schriften des Historischen Kollegs Herausgegeben von Andreas Wirsching Kolloquien 91 The Purpose of the First World War War Aims and Military Strategies Herausgegeben von Holger Afflerbach An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org Schriften des Historischen Kollegs herausgegeben von Andreas Wirsching in Verbindung mit Georg Brun, Peter Funke, Karl-Heinz Hoffmann, Martin Jehne, Susanne Lepsius, Helmut Neuhaus, Frank Rexroth, Martin Schulze Wessel, Willibald Steinmetz und Gerrit Walther Das Historische Kolleg fördert im Bereich der historisch orientierten Wissenschaften Gelehrte, die sich durch herausragende Leistungen in Forschung und Lehre ausgewiesen haben. Es vergibt zu diesem Zweck jährlich bis zu drei Forschungsstipendien und zwei Förderstipendien sowie alle drei Jahre den „Preis des Historischen Kollegs“. Die Forschungsstipendien, deren Verleihung zugleich eine Auszeichnung für die bisherigen Leis- tungen darstellt, sollen den berufenen Wissenschaftlern während eines Kollegjahres die Möglich- keit bieten, frei von anderen Verpflichtungen eine größere Arbeit abzuschließen. Professor Dr. Hol- ger Afflerbach (Leeds/UK) war – zusammen mit Professor Dr. Paul Nolte (Berlin), Dr. Martina Steber (London/UK) und Juniorprofessor Simon Wendt (Frankfurt am Main) – Stipendiat des Historischen Kollegs im Kollegjahr 2012/2013. Den Obliegenheiten der Stipendiaten gemäß hat Holger Afflerbach aus seinem Arbeitsbereich ein Kolloquium zum Thema „Der Sinn des Krieges. Politische Ziele und militärische Instrumente der kriegführenden Parteien von 1914–1918“ vom 21. -

Michel Glastre, De Serres En Parterres Michel Glastre S’Est Laissé Emporter Par Une Cascade D’Emplois Divers
LAON 9 DIMANCHE 22 MARS 2015 LE PORTRAIT DU DIMANCHE Michel Glastre, de serres en parterres Michel Glastre s’est laissé emporter par une cascade d’emplois divers. Bâtiment, artisanat, travaux publics… Il s’est stabilisé à Vivaise sur une activité horticole. avait bien vu mes aptitudes à la po- À SAVOIR lyvalence, c’est-à-dire ma capacité à « Je ne connaissais rien ▶ Michel Glastre, dernier d’une intervenir aussi bien sur le bâti fratrie de neuf enfants, est né le communal que sur les espaces fleu- aux fleurs mais mon 9 décembre 1967. ris même si, en ce dernier domaine, nouvel employeur avait ▶ Recruté en 1999 par Jean une formation ne semblait pas su- Simphal, le maire de Vivaise, il perflue. Pendant huit mois de l’an- bien vu mes aptitudes est devenu le plus ancien des née, il n’y en a que pour les fleurs : il à la polyvalence » acteurs du fleurissement, toujours n’est pas question de prendre le Michel Glastre primé, de la commune de Vivaise. risque d’être exclu de l’élite à quatre ▶ Après avoir travaillé avec fleurs au sein de laquelle Vivaise Jean-Jacques Lenoble, Michel s’est déjà fait une solide réputa- « Les jurys successifs qui sont venus Glastre est aujourd’hui l’assistant tion. » évaluer notre travail nous ont beau- de Frédéric Perryn. coup aidés et nous ont fait évoluer Apprendre en pratiquant notamment dans la forme des mas- En près de vingt ans – il a com- sifs qui a perdu de sa rigidité ini- mencé l’horticulture en 1999 – il a tiale, dans le choix des collections Michel Glastre a touché à beaucoup de métiers avant de s’arrêter sur l’horticulture. -
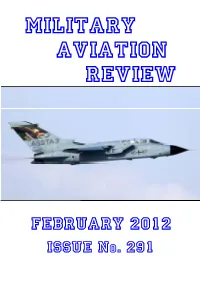
FEBRUARY 2012 ISSUE No
MILITARY AVIATION REVIEW FEBRUARY 2012 ISSUE No. 291 EDITORIAL TEAM COORDINATING EDITOR - BRIAN PICKERING WESTFIELD LODGE, ASLACKBY, SLEAFORD, LINCS NG34 0HG TEL NO. 01778 440760 E-MAIL”[email protected]” BRITISH REVIEW - GRAEME PICKERING 15 ASH GROVE, BOURNE, LINCS PE10 9SG TEL NO. 01778 421788 EMail "[email protected]" FOREIGN FORCES - BRIAN PICKERING (see Co-ordinating Editor above for address details) US FORCES - BRIAN PICKERING (COORDINATING) (see above for address details) STATESIDE: MORAY PICKERING 18 MILLPIT FURLONG, LITTLEPORT, ELY, CAMBRIDGESHIRE, CB6 1HT E Mail “[email protected]” EUROPE: BRIAN PICKERING OUTSIDE USA: BRIAN PICKERING See address details above OUT OF SERVICE - ANDY MARDEN 6 CAISTOR DRIVE, BRACEBRIDGE HEATH, LINCOLN LN4 2TA E-MAIL "[email protected]" MEMBERSHIP/DISTRIBUTION - BRIAN PICKERING MAP, WESTFIELD LODGE, ASLACKBY, SLEAFORD, LINCS NG34 0HG TEL NO. 01778 440760 E-MAIL.”[email protected]” ANNUAL SUBSCRIPTION (Jan-Dec 2012) UK £40 EUROPE £48 ELSEWHERE £50 @MAR £20 (EMail/Internet Only) MAR PDF £20 (EMail/Internet Only) Cheques payable to “MAP” - ALL CARDS ACCEPTED - Subscribe via “www.mar.co.uk” ABBREVIATIONS USED * OVERSHOOT f/n FIRST NOTED l/n LAST NOTED n/n NOT NOTED u/m UNMARKED w/o WRITTEN OFF wfu WITHDRAWN FROM USE n/s NIGHTSTOPPED INFORMATION MAY BE REPRODUCED FROM “MAR” WITH DUE CREDIT EDITORIAL - Welcome to the February edition of MAR! This issue sees the United Kingdom 2012 Review from Graeme - a month later than usual due to his work commitments. Because of this the issue is somewhat truncated in the Foreign Section department, but we should catch up with the March issue. -

Air & Space Power Journal
July–August 2013 Volume 27, No. 4 AFRP 10-1 Senior Leader Perspective The Air Advisor ❙ 4 The Face of US Air Force Engagement Maj Gen Timothy M. Zadalis, USAF Features The Swarm, the Cloud, and the Importance of Getting There First ❙ 14 What’s at Stake in the Remote Aviation Culture Debate Maj David J. Blair, USAF Capt Nick Helms, USAF The Next Lightweight Fighter ❙ 39 Not Your Grandfather’s Combat Aircraft Col Michael W. Pietrucha, USAF Building Partnership Capacity by Using MQ-9s in the Asia-Pacific ❙ 59 Col Andrew A. Torelli, USAF Personnel Security during Joint Operations with Foreign Military Forces ❙ 79 David C. Aykens Departments 101 ❙ Views The Glass Ceiling for Remotely Piloted Aircraft ❙ 101 Lt Col Lawrence Spinetta, PhD, USAF Funding Cyberspace: The Case for an Air Force Venture Capital Initiative ❙ 119 Maj Chadwick M. Steipp, USAF Strategic Distraction: The Consequence of Neglecting Organizational Design ❙ 129 Col John F. Price Jr., USAF 140 ❙ Book Reviews Master of the Air: William Tunner and the Success of Military Airlift . 140 Robert A. Slayton Reviewer: Frank Kalesnik, PhD Selling Air Power: Military Aviation and American Popular Culture after World War II . 142 Steve Call Reviewer: Scott D. Murdock From Lexington to Baghdad and Beyond: War and Politics in the American Experience, 3rd ed . 144 Donald M. Snow and Dennis M. Drew Reviewer: Capt Chris Sanders, USAF Beer, Bacon, and Bullets: Culture in Coalition Warfare from Gallipoli to Iraq . 147 Gal Luft Reviewer: Col Chad T. Manske, USAF Global Air Power . 149 John Andreas Olsen, editor Reviewer: Lt Col P. -
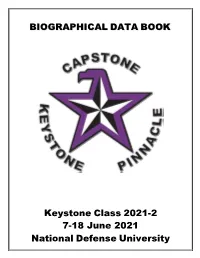
2021-2 Bio Book
BBIIOOGGRRAAPPHHIICCAALL DDAATTAA BBOOOOKK Keystone Class 2021-2 7-18 June 2021 National Defense University NDU PRESIDENT Lieutenant General Mike Plehn is the 17th President of the National Defense University. As President of NDU, he oversees its five component colleges that offer graduate-level degrees and certifications in joint professional military education to over 2,000 U.S. military officers, civilian government officials, international military officers and industry partners annually. Raised in an Army family, he graduated from Miami Southridge Senior High School in 1983 and attended the U.S. Air Force Academy Preparatory School in Colorado Springs, Colorado. He graduated from the U.S. Air Force Academy with Military Distinction and a degree in Astronautical Engineering in 1988. He is a Distinguished Graduate of Squadron Officer School as well as the College of Naval Command and Staff, where he received a Master’s Degree with Highest Distinction in National Security and Strategic Studies. He also holds a Master of Airpower Art and Science degree from the School of Advanced Airpower Studies, as well as a Master of Aerospace Science degree from Embry-Riddle Aeronautical University. Lt Gen Plehn has extensive experience in joint, interagency, and special operations, including: Middle East Policy in the Office of the Secretary of Defense, the Joint Improvised Explosive Device Defeat Organization, and four tours at the Combatant Command level to include U.S. European Command, U.S. Central Command, and twice at U.S. Southern Command, where he was most recently the Military Deputy Commander. He also served on the Air Staff in Strategy and Policy and as the speechwriter to the Vice Chief of Staff of the Air Force. -
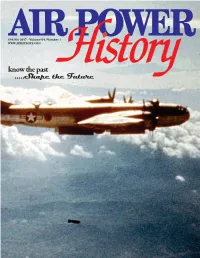
Spring 2017 Issue-All
SPRING 2017 - Volume 64, Number 1 WWW.AFHISTORY.ORG know the past .....Shape the Future The Air Force Historical Foundation Founded on May 27, 1953 by Gen Carl A. “Tooey” Spaatz MEMBERSHIP BENEFITS and other air power pioneers, the Air Force Historical All members receive our exciting and informative Foundation (AFHF) is a nonprofi t tax exempt organization. Air Power History Journal, either electronically or It is dedicated to the preservation, perpetuation and on paper, covering: all aspects of aerospace history appropriate publication of the history and traditions of American aviation, with emphasis on the U.S. Air Force, its • Chronicles the great campaigns and predecessor organizations, and the men and women whose the great leaders lives and dreams were devoted to fl ight. The Foundation • Eyewitness accounts and historical articles serves all components of the United States Air Force— Active, Reserve and Air National Guard. • In depth resources to museums and activities, to keep members connected to the latest and AFHF strives to make available to the public and greatest events. today’s government planners and decision makers information that is relevant and informative about Preserve the legacy, stay connected: all aspects of air and space power. By doing so, the • Membership helps preserve the legacy of current Foundation hopes to assure the nation profi ts from past and future US air force personnel. experiences as it helps keep the U.S. Air Force the most modern and effective military force in the world. • Provides reliable and accurate accounts of historical events. The Foundation’s four primary activities include a quarterly journal Air Power History, a book program, a • Establish connections between generations. -

Congressional Record—Senate S7717
November 3, 2015 CONGRESSIONAL RECORD — SENATE S7717 to try something new, Ashley em- Force Personnel Center, it is awarded years, first in his home State of Mis- braced the opportunity whole- by the Secretary of the Air Force to sissippi and in Alabama since 1986. He heartedly. units that ‘‘distinguished themselves began his career in Alabama as the di- Ashley has achieved several impres- by exceptionally meritorious service or rector of the Division of Disease Con- sive titles as a result of her hard work. outstanding achievement.’’ trol from 1986 to 1988. He then served as Ashley is a three-time first place North The 366th FW earned the award for the director of the Bureau of Preventa- Regional Champion, as well as the the period of June 1, 2014, to May 31, tive Health Services from 1988 to 1992, North Regional Most Outstanding Lift- 2015, and is credited with 9,200 hours when he was appointed as the State er on the light-weight platform. Addi- spent in the air. When making the health officer and director of the Ala- tionally, Ashley broke the bench and nomination, U.S. Air Force Lt. Gen. bama Department of Public Health. deadlift records at North Regionals. Mark C. Nowland cited the fighter Dr. Williamson received his medical Moreover, Ashley is a three-time first wing’s ‘‘determination and relentless degree, cum laude, from the University place Louisiana State Champion. Ash- pursuit of excellence.’’ He noted a num- of Mississippi School of Medicine and ley has earned the Billy Jack Talton ber of the wing’s accomplishments: the completed a residency in internal med- Award for Best Lifter in the State of successful use of airpower during Re- icine at the University of Virginia Hos- Louisiana and has placed second at public of Korea theater security pack- pital. -

Each Cadet Squadron Is Sponsored by an Active Duty Unit. Below Is The
Each Cadet Squadron is sponsored by an Active Duty Unit. Below is the listing for the Cadet Squadron and the Sponsor Unit CS SPONSOR WING BASE MAJCOM 1 1st Fighter Wing 1 FW Langley AFB VA ACC 2 388th Fighter Wing 388 FW Hill AFB UT ACC 3 60th Air Mobility Wing 60 AMW Travis AFB CA AMC 4 15th Wing 15 WG Joint Base Pearl Harbor-Hickam PACAF 5 12th Flying Training Wing 12 FTW Randolph AFB TX AETC 6 4th Fighter Wing 4 FW Seymour Johonson AFB NC ACC 7 49th Fighter Wing 49 FW Holloman AFB NM ACC 8 46th Test Wing 46 TW Eglin AFB FL AFMC 9 23rd Wing 23 WG Moody AFB GA ACC 10 56th Fighter Wing 56 FW Luke AFB AZ AETC 11 55th Wing AND 11th Wing 55WG AND 11WG Offutt AFB NE AND Andrews AFB ACC 12 325th Fighter Wing 325 FW Tyndall AFB FL AETC 13 92nd Air Refueling Wing 92 ARW Fairchild AFB WA AMC 14 412th Test Wing 412 TW Edwards AFB CA AFMC 15 355th Fighter Wing 375 AMW Scott AFB IL AMC 16 89th Airlift Wing 89 AW Andrews AFB MD AMC 17 437th Airlift Wing 437 AW Charleston AFB SC AMC 18 314th Airlift Wing 314 AW Little Rock AFB AR AETC 19 19th Airlift Wing 19 AW Little Rock AFB AR AMC 20 20th Fighter Wing 20 FW Shaw AFB SC ACC 21 366th Fighter Wing AND 439 AW 366 FW Mountain Home AFB ID AND Westover ARB ACC/AFRC 22 22nd Air Refueling Wing 22 ARW McConnell AFB KS AMC 23 305th Air Mobility Wing 305 AMW McGuire AFB NJ AMC 24 375th Air Mobility Wing 355 FW Davis-Monthan AFB AZ ACC 25 432nd Wing 432 WG Creech AFB ACC 26 57th Wing 57 WG Nellis AFB NV ACC 27 1st Special Operations Wing 1 SOW Hurlburt Field FL AFSOC 28 96th Air Base Wing AND 434th ARW 96 ABW -

France Historical AFV Register
France Historical AFV Register Armored Fighting Vehicles Preserved in France Updated 24 July 2016 Pierre-Olivier Buan Neil Baumgardner For the AFV Association 1 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION....................................................................................................4 ALSACE.................................................................................................................5 Bas-Rhin / Lower Rhine (67)........................................................5 Haut-Rhin / Upper Rhine (68)......................................................10 AQUITAINE...........................................................................................................12 Dordogne (24) .............................................................................12 Gironde (33) ................................................................................13 Lot-et-Garonne (47).....................................................................14 AUVERGNE............................................................................................................15 Puy-de-Dôme (63)........................................................................15 BASSE-NORMANDIE / LOWER NORMANDY............................................................16 Calvados (14)...............................................................................16 Manche (50).................................................................................19 Orne (61).....................................................................................21 -

Historical Brief Installations and Usaaf Combat Units In
HISTORICAL BRIEF INSTALLATIONS AND USAAF COMBAT UNITS IN THE UNITED KINGDOM 1942 - 1945 REVISED AND EXPANDED EDITION OFFICE OF HISTORY HEADQUARTERS THIRD AIR FORCE UNITED STATES AIR FORCES IN EUROPE OCTOBER 1980 REPRINTED: FEBRUARY 1985 FORE~ORD to the 1967 Edition Between June 1942 ~nd Oecemhcr 1945, 165 installations in the United Kingdom were used by combat units of the United States Army Air I"orce~. ;\ tota) of three numbered .,lr forl'es, ninc comllklnds, frJur ;jfr divi'iions, )} w1.l\~H, Illi j(r,IUpl', <lnd 449 squadron!'! were at onE' time or another stationed in ',r'!;rt r.rftaIn. Mnny of tlal~ airrll'lds hnvc been returned to fann land, others havl' houses st.lnding wh~rr:: t'lying Fortr~ss~s and 1.lbcratorR nllce were prepared for their mis.'ilons over the Continent, Only;l few rcm:l.1n ;IS <Jpcr.Jt 11)11., 1 ;'\frfll'ldH. This study has been initl;ltcd by the Third Air Force Historical Division to meet a continuin~ need for accurate information on the location of these bases and the units which they served. During the pas t several years, requests for such information from authors, news media (press and TV), and private individuals has increased. A second study coverin~ t~e bases and units in the United Kingdom from 1948 to the present is programmed. Sources for this compilation included the records on file in the Third Air Force historical archives: Maurer, Maurer, Combat Units of World War II, United States Government Printing Office, 1960 (which also has a brief history of each unit listed); and a British map, "Security Released Airfields 1n the United Kingdom, December 1944" showing the locations of Royal Air Force airfields as of December 1944.