Annexe XI : Retranscription Des Attentes En Termes De Valorisation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INTRODUCTION by Peter Brigg
INTRODUCTION By Peter Brigg Fly fshing, not just for trout, is a multifaceted sport that will absorb you in its reality, it will take you to places of exceptional beauty, to explore, places to revel in the solitude and endless stimulation. He stands alone in the stream, a silver thread, alive, tumbling and Fly fshing, not just for trout, is a multifaceted sport that will absorb sliding in the soft morning light: around him the sights, sounds you in its reality, it will take you to places of exceptional beauty, to and smells of wilderness. Rod under his arm he carefully picks out explore, places to revel in the solitude and endless stimulation. Or, you a fy from amongst the neat rows, slides the fy box back into its vest can lose yourself between the pages of the vast literature on all facets pocket and ties on the small dry fy. Slowly, with poetic artistry he lifts of fy fshing, get absorbed by the history, the heritage, traditions and the rod and ficks the line out, gently landing the fy upstream of the skills, be transported in thought to wild places, or cast to imaginary diminishing circles of the feeding trout – watching, waiting with taut, fsh and gather knowledge. So often fy fshing is spoken of as an art quiet anticipation as the fy bobs and twirls on the current. form and having passed the half century of experience, I’m not averse to this view, just as I believe that fytying is inextricably linked to fy It is a scene we as fy fshers know well, a fascination and pre-occupation fshing, but is in its own right a craft, a form of artistry. -
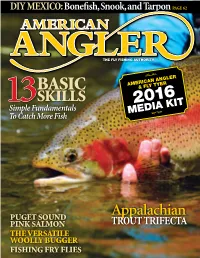
Fly Tyer 13 Skills 2016 Simple Fundamentals Media Kit to Catch More Fish We
DIY MEXICO: Bonefish, Snook, andT arpon PAGE 62 ® THE FLY FISHING AUTHORITY we AMERICAN ANGLER BASIC & FLY TYER 13 SKILLS 2016 Simple Fundamentals MEDIA KIT To Catch More Fish we PUGET SOUND Appalachian PINK SALMON TROUT TRIFECTA THE VERSATILE WOOLLY BUGGER FISHING FRY FLIES ”EXPEDITIONS” TRAVEL RATES AMERICAN ANGLER FREQUENCY 1X 3X 6X 2015/16PUBLICATION PUBLICATION A D SIZ ES SCHEDULE BLACK & WHITE: S C H EDU LE March–APRIL NOVEMBER/DECEMBER 2015 FULL PAGE FULL-PAGE $2,260 $1,840 $1,530 Ad Close: 12/23/09 1 7 Ad Closing: 8/24/15 8 ⁄8” x 10 ⁄8” MaterialsMaterials D Due:ue: 8/28/15 12/28/09 TWO-THIRDS 1,740 1,430 1,230 Mail Date: 2/2/10 TRIM Mailing Date: 9/24/15 3 1 8 ⁄8” x 11 ⁄8” ONE-HALF 1,430 1,120 920 BLEED JMANUAAY-JRY/FUNEEBRUARY 2016 ONE-THIRD 920 710 550 AAdd C Closing:lose: 2/25/10 10/27/15 (SEE MECHANICAL MaterialsMaterials D Due:ue: 11/5/15 3/1/10 REQUIREMENTS) ONE-SIXTH 610 500 330 MailingMailing D Date:ate: 11/25/15 4/6/10 ONE-TWELFTH 400 230 180 MJULY-ARCHA/UGUSTAPRIL 2016 AAdd C Closing:lose: 4/21/10 12/28/15 Materials Due: 1/7/16 TWO-C OLOR A DVERTISING: Materials Due: 4/26/10 MailingMailing D Date:ate: 2/18/16 6/2/10 Contact your advertising representative. ONE- THIRD MAY/JUNE 2016 TWO- SEPTEMBER-OCTOBER THIRDS VERTICAL Ad Closing: 2/19/16 5 1 Ad Closing: 6/23/10 4 ⁄8” x 10” 2 ⁄4” FOUR-C OLOR: Materials Due: 2/29/16 x MailingMaterials Date: Due: 3/28/16 6/28/10 10” FULL-PAGE $3,080 $2,670 $2,260 Mailing Date: 8/4/10 JULY/AUGUST 2016 TWO-THIRDS 2,360 1,950 1,740 ANdOVE Closing:MBer– 4/18/16DECEMBER MaterialsAd Closing: -

Fly Fishing Video Index
CGTU Fly Fishing Library Index Page 1. A Casting Approach – Nymphing Tactics ………………………………………………….. 3 2. A Casting Approach to Dry Fly Tactics in Tight Brush ……………………………….. 4 3. Advanced FlyFishing Techniques – The MayFly………………………………………… 5 4. An Introduction to Fly Tying – Part One & Part Two…………………………………. 6 5. Anatomy of a Trout Stream……………………………………………………………………… 7 6. Deep Water: Building the New York City Watershed……………………………….. 8 7. Fishing Adventures with Trout Unlimited…………………………………………………. 9 a. Great American Trout Streams 8. Fishing the Dry Fly……………………………………………………………………………………. 10 9. Fishing the Midge…………………………………………………………………………………….. 11 10. Fly Fishing America………………………………………………………………………………….. 12 11. Fly Fishing America – The Utah River……………………………………………………….. 13 12. Fly Fishing Basics ‐ A Beginners Guide………………………………………………………. 14 13. Fly Fishing for Trout…………………………………………………………………………………. 15 14. Fly Fishing Success Series – Nymphing Strategies…………………………………….. 16 15. Fly Fishing Tips from the Travelling Fly Fishermen……………………………………. 17 16. Fly Tying Bass Flies…………………………………………………………………………………… 18 17. Fly Tying for Beginners…………………………………………………………………………….. 19 18. Fundamental Fly Tying – Designed for the Instructional Fly Tying Novice…. 20 19. Fundamentals: How to Tie Dry Flies…………………………………………………………. 21 20. Glass Bead Flies for Trout………………………………………………………………………… 22 21. Hal Janssen’s Fly Fishing Secrets – The Dry Fly…………………………………………. 23 22. Hooked on Fly Tying ‐ Basic Techniques & Tips………………………………………… 24 23. Hooked on Fly Tying ‐ Classic Streamer Patterns……………………………………… 25 24. Hooked on Fly Tying ‐ Classic Wet Flies & Nymphs…………………………………… 26 25. Hooked on Fly Tying ‐ Lake Flies That Work……………………………………………… 27 26. Hooked on Fly Tying ‐ Mayflies………………………………………………………………… 28 27. Hooked on Fly Tying ‐ Popular Northwest Steelhead Patterns…………………. 29 Page 1 of 56 CGTU Fly Fishing Library Index 28. Hooked on Fly Tying ‐ Practical Atlantic Salmon Flies………………………………. 30 29. Hooked on Fly Tying ‐ Spade Steelhead Patterns……………………………………… 31 30. -

European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas
European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas Overview of coastal and marine conservation efforts in the European Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Carole Martinez, Sylvie Rockel, Caroline Vieux IUCN GLOBAL MARINE AND POLAR PROGRAMME European Union Overseas Coastal and Marine Protected Areas Overview of coastal and marine conservation efforts in the European Union’s Overseas Countries and Territories and Outermost Regions Carole Martinez, Sylvie Rockel, Caroline Vieux This publication has been made possible by funding from the French Development Agency (AFD). The designation of geographical entities in this document and the presentation of the materials do neither imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN. Published by: IUCN, Gland, Switzerland Copyright: © 2017 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction of this publication for educational or other non-commercial purposes is authorized without prior written permission from the copyright holder provided the source is fully acknowledged. Reproduction of this publication for resale or other commercial purposes is prohibited without prior written permission of the copyright holder. Citation: Martinez, C., Rockel, S., Vieux, C. European Overseas coastal and -

November 2014 the Angler’S Creel
November 2014 The Angler’s Creel The Cleveland Museum of Natural History Trout Club Promoting Knowledge of cold water fisheries, Volume 14 Issue 2 fish habitat, conservation and stream ecology Roll casts from the President’s desk: Eric Baumann Upcoming Events November Fish Fry Wednesday, November 19, 2014 DINNERS Tuck Scott will speak on: (For Reservations see page 3 & 4) Wednesday, November 19, 2014 “Fly Fishing South Carolina Low Tuck Scott: Fly Fishing South Caro- lina’s Low Country Saltwater Marsh Country Saltwater Marsh” Wednesday, December 17, 2014 Jerry Darkes: Fly Fishing Across the Great Lakes Wednesday, January 21, 2015 On Saturday, November 1st, 2014, the Museum honored the Trout Club by making us a mem- Dan Leavens: Montana Fishing; Big ber of the Museum’s Arkite Society for donors who have made an annual gift to the museum Hole, Beaverhead, Madison, Jefferson, of $1,000 or more for over 25 consecutive years. This great honor is a reflection of the stew- and Ruby Rivers. ardship the Trout Club has enjoyed over the years through the ongoing support of our mem- Friday, March 6, 2015 bers, the enduring work of our Committees that touches everything we do, the unsung efforts Film Festival: Note change of of our Executive / Advisory Committee, our club officers, the Museum, and donors who gen- date. erously support our fund raising efforts. Saturday, April 25, 2015 Banquet and Benefit Thanks to members Bill Grake, Jim DeCoker, Cheri Baumann, Ara Hamamjian and new mem- bers Samantha Butler and Bob Barnes (both graduates of Ara’s Fly Tying Class) for volunteer- ing to share their knowledge and experiences about the artful sport of fishing at the Museum’s Outings & Classes Think and Drink with the Extinct event last month. -

Global Conference on Animal Welfare: an OIE Initiative
Global conference on animal welfare: an OIE initiative Paris, 23–25 February 2004 PROCEEDINGS The views expressed in this document are solely the responsibility of the authors and may not, under any circumstances, be regarded as stating an official position either of the Commission of the European Communities or of the Office international des épizooties. Corrigendum Readers should note that in this CD-ROM version of the conference proceedings, as compared to the already published hard-copy (ISBN 92-894-6614-6), an additional paper by Dr. F.A. Abiola entitled "Transport and slaughter of animals: current constraints in Sub-Saharan Africa" is presented, as well as a modified version of Dr. A.B.M. Raj's paper "Cultural, religious and ethical issues". Consequently, there is no correlation between the pagination of the two published versions. Full information about the World Organisation for Animal Health (OIE) and its activities can be reached at www.oie.int or by addressing requests to [email protected]. General information is also available by calling directly at (33-1) 44 15 18 88 Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number: 00 800 6 7 8 9 10 11 A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004 © European Communities, 2004 © Office international des épizooties, 2004 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. -

September, 2008
RipRapRipRap A Publication of the Kiap-TU-Wish Chapter of Trout Unlimited VOLUME 2, ISSUE 1 SEPTEMBER, 2008 SSEPTEMBEREPTEMBER MMEETINGEETING IINFORMATIONNFORMATION RipRap editor Scott Hanson was so eager to get back to work that he decided do a September issue of RipRap instead of the usual post card reminder of the September meeting. You gotta love that enthusiasm. The first meeting of the year is Wednesday, September 3, at Bob Smith’s Sports Club in downtown Hudson. There is no speaker for the September meeting. This is an opportunity to check in with chapter members, eat dinner, hear stories and catch up on chapter news. Please join us on the 3rd, 6 PM for dinner and 7 for the meeting. Bring a friend or two and introduce them to the chapter. KIAP-TU-WISH - Greg Dietl CHAPTER INSIDE THIS ISSUE: To the left is MEETING INFO 1 a photo of some of the PRESIDENT’S LINES 2 stream work being done SCOTT’S SCOOP 3 on Pine Creek by the DNR and THE HORROR! 4 volunteers from Kiap‐ SEPTEMBER SONG 5 TU‐Wish LY YING ORNER F T C 6 Photo by Gary Richardson AL FARMES 7 MEMORIAL PAGE 2 RIPRAP PPRESIDENTRESIDENT’’SS LLINESINES BY GREG DIETIETL Pine Creek Update We had the first work night on Pine Creek, Tuesday, August 5. Ten volunteers built 22 LUNKER structures and seeded and mulched a large area of stream bank. Work was planned for Aug 12 and 19. (I was scheduled to be out of town the week before press deadline and needed to get this to Scott). -

Lower Lough Erne
LOWER LOUGH ERNE Lower Lough Erne is situated in Co.Fermanagh on the western edge of Northern Ireland some six miles from the Atlantic Ocean. It is one of the great Irish limestone loughs and holds an interest to the game angler from the start of the season in March right through to the season’s end on September 30th. While the main quarry are wild brown trout the lough also has salmon and sea trout. The following brief notes are an attempt to help the angler find the productive areas safely and to explain some of the methods used to catch them. Again it must be emphasised that there is no substitute for local knowledge nor can these notes identify every rock or drift on the lough. SAFETY Like all the big loughs it is best fished from a boat, although there are some limited bank fishing opportunities. Loughs of this size require the angler to pay a great deal of respect to weather conditions and safety. With the lightness and comfort of modern day life jackets it is inexcusable to venture on to this type of water without wearing one. Equally important are a well-found boat and a reliable outboard engine. It is also very useful to know how to change a shear pin and clean a spark plug. It might seem like stating the obvious but an adequate fuel supply is also imperative as to run out of fuel in a big wave several miles from a safe landing spot can be a lot worse than just uncomfortable and tiring. -

Project1 Advert Template
CONTENTS Volume 29 Number 156 August/September 2016 COVER: MADE IN MINIATURE A perfectly formed Cape stream rainbow. Photo by Leonard Flemming. FEATURES 10 20 YEARS STRONG 2016 TOPS @ Spar Kamberg Trout Festival — by Mark Wilson & Ed Erskine 17 Bungezi Beetle A new take on bugginess — by Rex Fey 20 Materials Matter Fundamental Fly-Tying part 4 — by Gordon van der Spuy 28 In His Boots Part 1: Meeting the master — by Pami Simpson 31 Frontier Catch and Release Competition Brett Blackbeard’s largemouth yellowfish wins him a R7 250 Sage Pulse rod! 10 33 Conning Carp Dry flies they just can’t resist — by Terry Babich 39 Xplorer Big Fish Competition Ian Gibson’s 68cm rainbow trout makes him this issue’s prize winner 40 Good Progress, Bru An update on the Umgeni initiative — by Andrew Fowler 42 Relax! It’s just another rod revolution — by Andrew Savs 44 Big Move! New view for Natal Caravans after 56 years 33 46 The Joy of Chile A DIY fishing trip to South America — by Andrew Vos 52 Learning to Cast — and Teach The benefits of an IFFF experience — by Andre van der Werff 55 Change the Way You Tie Review of Fundamental Fly-Tying DVD — by MC Coetzer 17 DEPARTMENTS 6 From the Editor — by Sheena Carnie 50 Calling all Junior Flyfishers — Win awards from Stealth 6 In my Opinion — by Erwin Bursik 51 Property Sales 7 Items of Interest to FOSAF members 66 Directory Adverts 37 Subscribe and Win! 66 Ad Index Publisher: Erwin Bursik Editor: Sheena Carnie FROM THE EDITOR Advertising Executive: Mark Wilson UST a few weeks and it will be spring .. -

Fly Fishing with Fly Fishing with Chris Dore
Fly Fishing with Chris Dore Your FFF Certified, Fly Fishing Professional P. 027 693 3027 E. [email protected] W. www.chrisdore.com Fly Recipes These flies form the basis of my south island fly selection year after year. Remember though, it all comes down to presentation, and if you don’t get the fly, drifting as desired in front of the fish, he will not take it. Have fun! Backcountry PT Hook: Tiemco 3769 size 8 - 14 Tail: Several Pheasant tail fibres Abdomen: as for tail, ribbed securely with copper wire Thorax: Black sparkle dub – squirrel – bright, glister etc Collar: Hot orange tying thread as used in construction. Bead: Usually black tungsten, oversized for heavier versions. Comments: For most of my local backcountry waters trout food can be thrown into one of two categories – big and dark, or big and green. Tied with an oversized bead and loaded with lead, this fly works well in the heavier water ‘Czech style’ and the addition of a hotspot in behind the bead really locks on those feisty rainbows. Feel free to add a short, orange tag of SLF or similar underlaying the tail for added attraction. Tied from sizes 8 through 14, anything smaller and I just use the Glister Nymph. Green Caddis Hook: Tiemco 2457 size 12 Tail: If required, short tag of black possum, rabbit or a hotspot red tag of SLF Abdomen: Under body of caddis green Squirrel Brite or similar dubbing. Overwrapped with green flexi-floss. Thorax: Black sparkle dub – squirrel brite, glister etc Collar: Hot orange or red tying thread as used in construction. -

Ip Rap TROUT April Meeting
Published Monthly by Kiap-TU-Wish Chapter April 1998 TROUT ip Rap April Meeting UNLIMITED When : Wednesday, April 1 Where: JR Ranch, Hudson Dinner: 6:30 Program: 8:00 Fly Tying Presideit's Lines: lf you missed the fast meeting...the business meeting...then you also missed one of my rare, public demonstrations of the finer points of "Roberts Rules of Order." But we stiff managed to elect three new members to the Board of Directors. (see pg. 2) We have convened our first board meeting with these new members, an d I am impressed with the substance they wiff each contribute to the group. One of the things we talked about was the need for a stream project coordinator. This chapter has a history of being very active with hanifs-on stream projects. We have had members transfer to Riap-771- Wish from other chapters simply because they wanted' to do physical work. on the streams. Alf of the officers and board' members are currently involved' to various degrees in monitoring projects, the video project, the annual ffy fishing clinic (see pg. 2), the Christmas Banquet, dam removal, eta There are many more opportunities to work. on our local streams than are currently being pursued by the chapter, not because of a fack.of wiff, but because there is no one person to turn a 'need" into a 'project.' If you think. you mO t be interested in being a Project Coordinator for the chapter, pkase contact me to find out what such a rote mOt entail:. We can then discuss what to expect before you decide that you would like to try your hand' at it. -
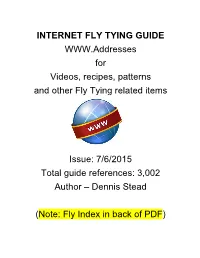
Fly Tying Guide 7-6-2015
INTERNET FLY TYING GUIDE WWW.Addresses for Videos, recipes, patterns and other Fly Tying related items Issue: 7/6/2015 Total guide references: 3,002 Author – Dennis Stead (Note: Fly Index in back of PDF) In January 2012, I was introduced to fly tying by a group of people that belonged to the Missouri Trout Fishermen’s Association (MTFA). I was hooked. I soon realized that flies to be tied came in all sizes, shapes, colors and names. Well I thought, maybe I would start collecting fly tying patterns (recipes) and put them in a data base in my computer. At first, I thought it would be easy. Then I found The Fisherman’s Handbook of Trout Flies by Donald DuBois. This was published in 1960, and it included a comprehensive identification list of 5,939 trout fly patterns. That was over 50 years ago. Since that time, I could not even guess how many new trout fly patterns (recipes) were added. Collecting fly tying patterns (recipes) was not the way to go. I watched fly tying DVD’s and thought that this was a great way to have the pattern (recipes) and also learn how to tie the fly pattern. Then one of the MTFA members suggested that I search for the fly tying patterns (recipes) on the Internet, especially YouTube. Have you ever searched YouTube for a fly tying video or the Internet for a fly tying recipe? If the answer is yes, then you know that both have more fly tying instructions on just about every pattern you have heard of.