Enseignement De La Civilisation Dans La Classe De Fle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Retail Food Sector Retail Foods France
THIS REPORT CONTAINS ASSESSMENTS OF COMMODITY AND TRADE ISSUES MADE BY USDA STAFF AND NOT NECESSARILY STATEMENTS OF OFFICIAL U.S. GOVERNMENT POLICY Required Report - public distribution Date: 9/13/2012 GAIN Report Number: FR9608 France Retail Foods Retail Food Sector Approved By: Lashonda McLeod Agricultural Attaché Prepared By: Laurent J. Journo Ag Marketing Specialist Report Highlights: In 2011, consumers spent approximately 13 percent of their budget on food and beverage purchases. Approximately 70 percent of household food purchases were made in hyper/supermarkets, and hard discounters. As a result of the economic situation in France, consumers are now paying more attention to prices. This situation is likely to continue in 2012 and 2013. Post: Paris Author Defined: Average exchange rate used in this report, unless otherwise specified: Calendar Year 2009: US Dollar 1 = 0.72 Euros Calendar Year 2010: US Dollar 1 = 0.75 Euros Calendar Year 2011: US Dollar 1 = 0.72 Euros (Source: The Federal Bank of New York and/or the International Monetary Fund) SECTION I. MARKET SUMMARY France’s retail distribution network is diverse and sophisticated. The food retail sector is generally comprised of six types of establishments: hypermarkets, supermarkets, hard discounters, convenience, gourmet centers in department stores, and traditional outlets. (See definition Section C of this report). In 2011, sales within the first five categories represented 75 percent of the country’s retail food market, and traditional outlets, which include neighborhood and specialized food stores, represented 25 percent of the market. In 2011, the overall retail food sales in France were valued at $323.6 billion, a 3 percent increase over 2010, due to price increases. -
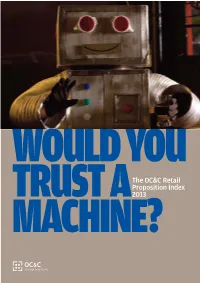
21361 Would You Trust a Machine New Layout Layout 1
WOULD YOU The OC&C Retail TRUST A Proposition Index MACHINE?2013 An OC&C Insight Taking on the Machines<#> WOULD YOU TRUST A MACHINE? THE OC&C PROPOSITION INDEX 2013 This is the fourth year of the OC&C Proposition Index, a major piece of consumer research into shopper attitudes towards the world’s leading retailers. Consumers are asked WINNER to rate the retailers they have shopped on the strength of OVERALL their overall proposition, and then to score the key elements PROPOSITION of that proposition (Price, Range, Service, etc). The results are then used to compile a ranking of consumers’ favourite retailers from across the globe. The OC&C Proposition Index continues to grow, this year capturing 300,000 ratings from over 30,000 consumers 2ND PLACE 3RD PLACE OVERALL OVERALL regarding nearly 600 retailers across 9 countries. This PROPOSITION PROPOSITION combination of breadth and depth gives a powerful view into the relative strength of retail propositions across the world. Virtual Reality Check It is no longer a surprise that Amazon stands In Germany, Amazon’s second largest global Germany Germany YoY atop our global index. In 2010, when we market and historically its strongest territory 2013 2012 Change released the first OC&C Proposition Index, in the OC&C Proposition Index, its crown has Rank Rank in Rating there was genuine shock in some quarters very much slipped. Recent labour disputes that an online player had already usurped with warehouse workers and subsequent Overall Rating 2 1 -8 large household names as the world’s strikes have tainted the company’s Low Prices 12 6 -5 favourite retailer. -

27 MANDARINA Precios Consumidor Mercados Europeos
PRECIOS MANDARINA CONSUMIDOR EN MERCADOS EUROPEOS. SEMANA 27 - 2020 Semana Semana Variación Semana Dif. % Sem.27 Semana Semana Variación Semana Dif. % Sem.27 26 27 27 vs 26 27/2019 20 vs 19 26 27 27 vs 26 27/2019 20 vs 19 ALEMANIA Tipo Confección € € % € % FRANCIA Tipo Confección € € % € % REWE Ud. Mandarina CARREFOUR Clementina Feuilles M/1 Kg. - Esp. Rewe Bio Mandarina M/750gr. Clementina BIO M/1 Kg. Esp. 3,29 3,29 0% è Rewe Bio Clementina M/750gr. Clementina €/Kg. Esp. Beste Wahl Clementinen M/750gr. Clementina Corse 2 Kg. Francia Clementina M/1Kg. -Esp. Clementina M/650 gr. CEE 2,00 2,00 0% è Clementina M/750Kg. -Esp. Clemenvilla M/ 2 Kg. CEE Mandarina M/1Kg. -Esp. Clementina Feuilles 1 Kg. - CEE. 2,89 2,89 0% è Beste Wahl Mandarina M/900gr. Mandarina 1,5 Kg. - 3º Paises Clementinas 2 Kg. CEE 4,59 4,59 0% è Mandarina 2,3 Kg. CEE REINO UNIDO Tipo Confección € € % € % Mandarina a jus 2 Kg. - Esp. Clemenules 2,3 Kg. CEE 4,65 4,65 0% è TESCO Tesco Goodness for Kisd Easy Peelers M/600 gr. Clemenvillas BIO 1 Kg. CEE Tesco Goodness for Kisd Easy Peelers M/500 gr. Mandarinas 1,5 Kg. - CEE Tesco Clementinas Ud. Clementina Petit Prix 1 K. - CEE Tesco Organic sweet easy peeler M/ 4 Uds. Tesco Satsumas M/600gr. 1,12 1,12 0% è 1,76 -36,36% Tesco Jaffa Satsumas M/650 gr. AUCHAN Clementina España Caja de 2,3 Kg. Jaffa Clementinas M/650 gr. Clementina M/1,5 Kg. -
The Evolution of In-Store Customer Experience 1800-2050, Back to the Future
THE EVOLUTION OF IN-STORE CUSTOMER EXPERIENCE 1800-2050, BACK TO THE FUTURE SHOP WINDOWS • First seen in Department Stores 1800-1899 thanks to broader access to electricity and the industrialisation of glass manufacturing PAYMENT • Price tags, introduced in the STORE FORMAT 18th century, are now commonly • Rise of department stores: Bennett's used. Introduction of fixed pricing of Irongate (Derby, Ang -1734), Tapis by the retail chain Woolworth. Rouge (Paris, Fr - 1784), Trois Quartiers (USA - 1879) (Paris, Fr - 1829), Austin's (Ireland of • Direct cash payment replaces the North - 1832) retailers taking on credit in stores • First public shopping centres SERVICES “Galeries de Bois” (Paris, FR - 1786), • Department Stores introduce changing Burlington Arcade (London, Ang - rooms, open access, sales by catalogue 1879) and free returns INFLUENTIAL PERSONALITY • Aristide Boucicaut, creator of the Bon Marché (Paris, Fr. - 1852) STORE FORMAT • Retailers focus on adding pleasure to 1900-1919 the shopping experience Selfridge's INFLUENTIAL PERSONALITY (London, Eng - 1909) • Clarence Sounders and his • Grocers focus on managing flows. 1st Piggly Wiggly store with the self-service store Piggly-Wiggly (Memphis, installation of shelves and USA - 1916) gondolas and the invention of self-service ATMOSPHERE • Restauration starts to be featured inside stores • Rise of in-store hair salons, giving SERVICES hairstyle, makeup and posture • Paper bags start to be used to lessons encourage customers to carry • Department stores start to become their shopping rather than being entertainment centres with music delivered rooms, art exhibition, special SHOP WINDOWS decorations and book readings • Rise of the realistic wax models (1910) • Neon signs appear (1910) ADVENT OF ADVERTISING • The Department store Mitsukoshi innovates by advertising on Mount Fuji (Japan - 1908) SERVICES 1920-1939 • Invention of the supermarket shopping cart by Sylvan N. -

Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco: Innovative performance 2012 ANNUAL ANd sUstAiNAbLe deveLopmeNt report 02 milestones 2012 CorporAte The values which distinguish us 08 interview with the Ceo and the Chairman of the management board 12 interview with the Chairman of the supervisory board 14 Corporate governance and risk management 16 Figures on the rise 18 eprA performance measures 20 shareholder’s report strAtegy Re-inventing the customer experience 24 re-inventing the customer experience 26 so ouest – a new generation shopping centre 28 the 4 star shopping experiencel 30 projects in the pipeline operAtioNs Iconic Assets 36 moments to remember 42 iconic shopping centres 48 our shopping centre managers 50 offices 52 Convention & exhibition sUstAiNAbLe deveLopmeNt Creating sustainable value everyday 56 Unibail-rodamco’s sustainability journey 58 A transparent governance for sustainability 60 material issues to create sustainable value 62 re-align our sustainability vision and priorities with the group’s strategy 64 A motivated workforce empowered to deliver change 66 Creating opportunities for communities to prosper 70 building resilience through innovation citizenship 74 Unlock opportunities for tenants and customers to make sustainable decisions 82 shopping centres Nordic countries * in Europe Germany* 9 shoppiNg CeNtres Netherlands 7 Central Europe* 5 shoppiNg CeNtres shoppiNg CeNtres 8 shoppiNg CeNtres France Austria 34 shoppiNg CeNtres 3 shoppiNg CeNtres Spain 16 shoppiNg CeNtres Offices and Convention & Exhibition venues in Paris C&E oFFiCes MAJOR eUROpeAn cities from west to east which host Unibail-Rodamco assets: seviLLe / vALeNCiA / mAdrid / bArCeLoNA / bordeAUX / LYON / NiCe / pAris / LiLLe / AmsterdAm / the hAgUe / CopeNhAgeN / STOCKhoLm / prAgUe / vieNNA / brAtisLAvA / WArsAW / heLsiNKi / * Including shopping centres consolidated under the equity menthod: • Central europe: Złote tarasy. -

FRENCH MARKET PRESENTATION for : FEVIA from : Sophie Delcroix – Elise Deroo – Green Seed France Date : 19Th June, 2014
FRENCH MARKET PRESENTATION For : FEVIA From : Sophie Delcroix – Elise Deroo – Green Seed France Date : 19th June, 2014 FEVIA 1 I. GREEN SEED GROUP : WHO WE ARE II. MARKET BACKGROUND AND CONSUMER TRENDS III. THE FRENCH RETAIL SECTOR IV. KEY RETAILERS PROFILES V. FOODSERVICE VI. KEY LEARNINGS VII. CASE STUDIES FEVIA 2 Green Seed Group Having 25 years of experience, the Green Seed Group is a unique international network of 11 offices in Europe, North America and Australia, specializing in the food & beverage sector OUR MISSION Advise both French and foreign food and beverage companies or marketing boards, on how to develop a sustainable and profitable position abroad Green Seed France help you to develop your activity in France using our in-depth knowledge of the local food and beverage market and our established contacts within the trade FEVIA 3 A growing and unique international network Germany (+ A, CH) The Netherlands Scandinavia U.S.A./Canada Great Britain Belgium France Portugal Spain Italy 11 offices covering 18 countries Australasia FEVIA 4 The Green Seed model Over the last decade, one of the most important trends in the French food & drink trade has been for retailers to deal with their suppliers on a direct line. Green Seed France has developed its business model around this trend. We act as business facilitators ensuring that every step of the process is managed with maximum efficiency. From first market visit, to launch as well as the ongoing relationship that follows. We offer a highly cost-effective solution of “flexible local sales and marketing management support” aimed at adding value. -

Premium Position in Poland Leads To… Recommendation: HOLD Vs Previous Recommendation BUY
MMAASSTTEERRSS IIINN FFIIINNAANNCCEE QUITY ESEARCH EEQUIITY RRESEARCH JERÓNIMO MARTINS, SGPS COMPANY REPORT FOOD RETAIL 06 JUNE 2011 STUDENT: MARGARIDA CARREIRA [email protected] Premium position in Poland leads to… Recommendation: HOLD Vs Previous Recommendation BUY …positive results in the Portuguese stock market. Price Target FY11 (PT): 13.98 € We’ve downgraded our PT from €14.31 to €13.98 driven by the Vs Previous Price Target 14.31 € riskier Portuguese profile and tougher macroeconomic Price (as of 3-Jun-11) 13.59 € outlook. Both our sales and EBITDA margins estimates (2011E- Reuters: JMT.LS, Bloomberg: JMT PL 2013E) for all domestic business units suffered cuts, reflecting the 52-week range (€) 6.84-13.70 measures imposed by the Troika’s agreement. As a result, our Market Cap (€m) 8,552.09 valuation for Portugal was reduced in 10.80%, meaning -2.31% in Outstanding Shares (m) 629.293 Source: Bloomberg our PT and our recommendation has changed to HOLD. Poland - Polish operations are the major source of JMT vs PSI20 70% value creation: We place our hope in Biedronka whose LfL sales 60% 50% and EBITDA margin grew 11.7% and 60bp in 1Q11. We expect 40% sales to grow at a CAGR of 10.8% in 2010 (local currency). 30% 20% Biedronka’s expansion plan will allow JMT to benefit from high 10% growth rates as long as the food retail market converges to 0% European standards and Biedronka enlarges its market share gap 2010 Jul Aug Sept Oct Nov Dec 2011 Feb Mar Apr May Jun to its direct competitors. -

KLEPIERRE RF2015 UK.Pdf
Financial report 2015 With retail facilities in 57 01 07 metropolitan areas spanning Business for the year Corporate financial p. 01 —29 statements at 16 countries, and privileged December 31, 2015 p. 200 — 225 access to 150 million 02 consumers, Klépierre is Property portfolio as of December 31, 2015 08 Continental Europe’s p. 30 — 41 Information on specialist in shopping the Company and the capital center properties. 03 p. 226 — 249 Main risk factors Its property portfolio was p. 42 — 51 09 valued at 22 billion euros as of General Meeting December 31, 2015. For leading 04 p. 250 — 263 Corporate governance retailers, Klépierre offers an p. 52 — 91 unrivaled platform of 10 Additional shopping centers, which 05 information draws more than 1.2 billion Environmental, p. 264 — 273 societal and social visitors each year. information p. 92 — 131 11 Glossary p. 274 — 279 06 Consolidated fi nancial statements as of December 31, 2015 p. 132 —199 Opposite Grand Littoral, Marseille (France) Below and below right Nave de Vero, Venise (Italy) Cover Passages, Paris region (France) 1. Business for the year Above Nave de Vero, Venise (Italy) 1. Business for the year 1.1. 1.2. 1.3. Shopping center Business activity Investments, operational business by region developments overview p. 05 and disposals p. 02 p. 12 1.4. 1.5. 1.6. Consolidated earnings Parent company earnings Property and cash-fl ow and distribution portfolio valuation p. 15 p. 17 p. 18 1.7. 1.8. 1.9. EPRA key performance Financial Outlook indicators policy p. 28 p. -

Global Consumer Survey List of Brands June 2018
Global Consumer Survey List of Brands June 2018 Brand Global Consumer Indicator Countries 11pingtai Purchase of online video games by brand / China stores (past 12 months) 1688.com Online purchase channels by store brand China (past 12 months) 1Hai Online car rental bookings by provider (past China 12 months) 1qianbao Usage of mobile payment methods by brand China (past 12 months) 1qianbao Usage of online payment methods by brand China (past 12 months) 2Checkout Usage of online payment methods by brand Austria, Canada, Germany, (past 12 months) Switzerland, United Kingdom, USA 7switch Purchase of eBooks by provider (past 12 France months) 99Bill Usage of mobile payment methods by brand China (past 12 months) 99Bill Usage of online payment methods by brand China (past 12 months) A&O Grocery shopping channels by store brand Italy A1 Smart Home Ownership of smart home devices by brand Austria Abanca Primary bank by provider Spain Abarth Primarily used car by brand all countries Ab-in-den-urlaub Online package holiday bookings by provider Austria, Germany, (past 12 months) Switzerland Academic Singles Usage of online dating by provider (past 12 Italy months) AccorHotels Online hotel bookings by provider (past 12 France months) Ace Rent-A-Car Online car rental bookings by provider (past United Kingdom, USA 12 months) Acura Primarily used car by brand all countries ADA Online car rental bookings by provider (past France 12 months) ADEG Grocery shopping channels by store brand Austria adidas Ownership of eHealth trackers / smart watches Germany by brand adidas Purchase of apparel by brand Austria, Canada, China, France, Germany, Italy, Statista Johannes-Brahms-Platz 1 20355 Hamburg Tel. -

GROCERY CX Driving Loyalty in a Disloyal Market
GROCERY CX Driving loyalty in a disloyal market In association with AT A GLANCE CONTENTS he concept of good customer experience is nothing new CHAPTER 1: and cannot be judged on just one factor, such as exemplary In-store experience: what customers want from customer service or a smooth user journey online. Customer grocery stores experience, or CX, is more expansive, with the Harvard CHAPTER 2: TBusiness Review neatly defining it in 2010 as the “sum-totality of Online experience: what makes or breaks how customers engage with your company and brand, not just in a ecommerce loyalty? snapshot in time, but throughout the entire arc of being a customer”. Although that was nine years ago, the definition still stands. CHAPTER 3: And for grocers the pressure to deliver is acute – people shop more Taking CX up a level: future trends for keeping frequently at supermarkets than any other retail business, and customers happy competition is incredibly fierce. On top of that, omnichannel grocery shopping means there are more ways than ever for customers to engage with a retailer and experience either good, satisfactory or bad CX. From easily parking in the supermarket car park to finding every item on a shopping list or receiving a food delivery at a specified time with no substitutions – these all factor into how customers perceive a retailer. And intertwined into CX is loyalty and a customer’s likelihood to choose one grocer over another. To better understand what customers want from a food shopping experience, Retail Week partnered with dunnhumby to conduct an exclusive survey of 2,000 UK consumers about their in-store and online retail grocery experiences. -

Internationalisation of Retail, 2015
Internationalisation of Retail, 2015 Globalisation still on the agenda for leading grocery and health & beauty players June 2015 In partnership with Planet Retail is the leading provider of global retailing information, from news and analysis to market research and digital media. Covering more than 9,000 retail and foodservice operations across 211 markets around the world, many of the world’s leading companies turn to Planet Retail as a definitive source of business intelligence. For more information please visit PlanetRetail.net All images © PlanetRetail.net unless otherwise stated. Robert Gregory Global Research Director [email protected] @RobGregOnRetail Boris Planer Chief Economist [email protected] @boris_planer Researched and published by Planet Retail Limited Company No: 3994702 (England & Wales) Registered Office: : c/o Top Right Group Limited, The Prow, 1 Wilder Walk, London W1B 5AP Terms of use and copyright conditions Content provided within this documentation which is the Intellectual Property (IP) of Planet Retail is copyrighted. All rights reserved and no part of this publication as it relates to Planet Retail’s IP may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without the prior permission of the publishers. We have taken every precaution to ensure that details provided in this document are accurate. The publishers are not liable for any omissions, errors or incorrect insertions, nor for any interpretations made from the document. PlanetRetail.net Internationalisation -

Strategic Retail Management Text and International Cases 3Rd Edition Strategic Retail Management Joachim Zentes • Dirk Morschett • Hanna Schramm-Klein
Joachim Zentes Dirk Morschett Hanna Schramm-Klein Strategic Retail Management Text and International Cases 3rd Edition Strategic Retail Management Joachim Zentes • Dirk Morschett • Hanna Schramm-Klein Strategic Retail Management Text and International Cases 3rd Edition Joachim Zentes Hanna Schramm-Klein FB Wirtschaftswissenschaften, Universität Siegen Universität des Saarlandes Siegen, Germany Saarbrücken, Germany Dirk Morschett Universität Fribourg Fribourg, Switzerland ISBN 978-3-658-10182-4 ISBN 978-3-658-10183-1 (eBook) DOI 10.1007/978-3-658-10183-1 Springer Gabler Library of Congress Control Number: 2016954795 Springer Gabler © Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2007, 2011, 2017 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, repro- duction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, elec- tronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. The use of general descriptive names, registered names, trademarks, service marks, etc. in this publication does not imply, even in the absence of a specific statement, that such names are exempt from the relevant protective laws and regulations and therefore free for general use. The publisher, the authors and the editors are safe to assume that the advice and information in this book are believed to be true and accurate at the date of publication. Neither the publisher nor the authors or the editors give a warranty, express or implied, with respect to the material contained herein or for any errors or omissions that may have been made.