Mantha Mylene 2014 Memoire.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Psychopathology-Madjirova.Pdf
NADEJDA PETROVA MADJIROVA PSYCHOPATHOLOGY psychophysiological and clinical aspects PLOVDIV 2005 I devote this book to all my patients that shared with me their intimate problems. © Nadejda Petrova Madjirova, 2015 PSYCHOPATHOLOGY: PSYCHOPHYSIOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS Prof. Dr. Nadejda Petrova Madjirova, MD, PhD, DMSs Reviewer: Prof. Rumen Ivandv Stamatov, PhD, DPS Prof. Drozdstoj Stoyanov Stoyanov, PhD, MD Design: Nadejda P. Madjirova, MD, PhD, DMSc. Prepress: Galya Gerasimova Printed by ISBN I. COMMON ASPECTS IN PSYCHOPHYSIOLOGY “A wise man ought to realize that health is his most valuable possession” Hippocrates C O N T E N T S I. Common aspects in psychophysiology. ..................................................1 1. Some aspects on brain structure. ....................................................5 2. Lateralisation of the brain hemispheres. ..........................................7 II. Experimental Psychology. ..................................................................... 11 1. Ivan Petrovich Pavlov. .................................................................... 11 2. John Watson’s experiments with little Albert. .................................15 III. Psychic spheres. ...................................................................................20 1. Perception – disturbances..............................................................21 2. Disturbances of Will .......................................................................40 3. Emotions ........................................................................................49 -

The Nature and Treatment of Hoarding Disorder
11/19/2013 THE NATURE AND TREATMENT OF HOARDING DISORDER Randy Frost, PhD Nov. 25 & 26, 2013 Canad Inn Polo Park 1405 St. Matthews Avenue Winnipeg, MB ROAD MAP | Phenomenology | Diagnostic & Assessment | Conceptual Model | Motivation & Treatment | Other Interventions RECENT BOOKS Houghton/Mifflin/Harco urt Oxford University Press Tr ea Tme n Ts Th aT Wo r k Treatment for Hoarding Disorder Treat ment for Second Edition Hoarding Disorder Sec o n d Ed i t i o n WORKBOOK Gail SteKetee theRapiSt Guide Ran d y O. FROSt Gail Steketee Ra n d y O. FROSt 2 1 11/19/2013 OTHER HISTORICAL REFERENCES TO HOARDING | Shakespeare’s Shylock from The Merchant of Venice (1597) | Nikolai Gogol’s Plyushkin from Dead Souls (()1842) | Charles Dickens’ Krook from Bleak House (1850) | George Elliot’s Silas Marner (1861) | Sir Arthur Conan Doyle’s Sherlock Holmes (1890s) MODERN DAY CASES Skokie Hoarder Dies in Home; Removed Via Hole in Roof – “A hoard er was stuck in so much garbage and debris and junk that when she died, she had to be removed through a hole cut into the roof of her hovel.” IndyPosted, July 20, 2010 ANDY WARHOL 2 11/19/2013 WHAT IS COMPULSIVE HOARDING? | The acquisition of, and failure to discard, a large 34:341-350 Frost & Hartl, number of possessions Behav ResTher 1996; | Living spaces that are sufficiently cluttered as to preclude their intended use | Significant distress or impairment caused by the clutter MANIFESTATIONS OF HOARDING Acquisition Saving Disorganization ACQUISITION y Buying y Free Things y Stealing y Passive 3 11/19/2013 COMPULSIVE SAVING / DIFFICULTY DISCARDING | Types of items y Clothes, newspapers, books, containers y DSM-IV – worthless & worn | Attachments y Sentimental y Instrumental y Intrinsic DISORGANIZATION | Condition of Home y Clutter y Mixed importance | Behavior y Churning y Out of sight fear OTHER CORE FEATURES OF HOARDING |Indecisiveness |Perfectionism |Procrastination |Central Coherence 4 11/19/2013 DIAGNOSIS OF HOARDING AND THE DSM HOARDING AND DSM-5: INCLUSION CRITERIA | A. -
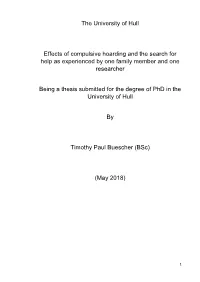
The University of Hull Effects of Compulsive Hoarding and The
The University of Hull Effects of compulsive hoarding and the search for help as experienced by one family member and one researcher Being a thesis submitted for the degree of PhD in the University of Hull By Timothy Paul Buescher (BSc) (May 2018) 1 For Sarah, Peggy and Ted 2 Acknowledgements There are a lot of people to thank for the existence of this work. So many wonderful people educated me, nurtured me, rescued me from myself and had more patience than ought to be expected of anyone with me going back long before I could ever have conceived of writing a thesis. I can’t name them all here and they wouldn’t be reading this but they all are owed. The idea that I could and perhaps should write a thesis came from one of the most dynamic and inspiring forces I have ever met. Judith Dyson not only saw me through the toughest of times towards the end of my BSc but went on to continue exemplifying the patient, non-judgemental stance through an unpredictable, unorthodox and sometimes uncertain doctoral path. In suggesting that I approach Fiona Cowdell to accompany us on this path, you showed how well you knew me despite (at the time) our having not known each other all that long. Fiona, you have given me so much encouragement in taking the route less travelled and have proved to be a repository of all manner of valuable experience and knowledge. For supervisors I couldn’t ask for more. Thankyou. As mentioned above, there has been some turbulence throughout the process of completing this work and Sarah, Peggy and Ted have borne the brunt of it in temperamental days, absent days and long monologues on subjects which were frankly not of interest or value to you. -
Compulsions Free Compulsions Charge
FREE COMPULSIONS PDF Rockne S O'Bannon,Keith R A DeCandido,Will Sliney | 112 pages | 27 Dec 2011 | Boom! Studios | 9781608866397 | English | Los Angeles, United States International OCD Foundation | What is OCD? People with OCD may have symptoms of obsessions, compulsions, or both. These symptoms can interfere with all aspects of life, such as work, Compulsions, and personal relationships. Obsessions are repeated thoughts, urges, or mental images that cause anxiety. Common symptoms include:. Compulsions are repetitive behaviors Compulsions a person with OCD feels the urge to do in response to an obsessive thought. Common compulsions include:. Not all rituals or habits are compulsions. Everyone double checks things sometimes. But a person with OCD generally:. Some Compulsions with OCD also have a tic disorder. Motor tics are sudden, brief, repetitive movements, such as Compulsions blinking and other eye movements, facial grimacing, shoulder shrugging, and head or shoulder jerking. Common vocal tics include repetitive throat-clearing, sniffing, or grunting sounds. Symptoms may come and go, ease over time, or worsen. People with OCD may try to help themselves by avoiding situations that trigger their obsessions, or they may use alcohol or drugs to calm themselves. Parents or teachers typically recognize OCD symptoms in Compulsions. If you think you have OCD, talk to your Compulsions about your symptoms. If left untreated, OCD can interfere in all aspects of life. OCD is a common disorder that affects adults, adolescents, and children all over the world. Most people are diagnosed by about age 19, typically with an earlier age of onset in boys than in Compulsions, but onset after age 35 does happen. -

7 Literaturverzeichnis
7 Literaturverzeichnis 1 Abrams RC, Lachs M, McAvay G, Keohane DJ, Bruce ML: Predictors of self-neglect in community-dwelling elders. Am J Psychiatry 159[10] (2002) 1724-1730 2 American Psychiatric Association: Diagnostic and statistic manual of mental disorders. American Psychiatric Association, 4th edn., Washington DC, 1994 3 Arieti S: Interpretation of schizophrenia. Second edition, Basic, New York, 1974 4 Barocka A, Seehuber D, Schone D: Sammeln und Horten: ein Messie kann nicht anders. Die Wohnung als Müllhalde. Fortschr Med 146[45] (2004) 36-39 5 Beauchet O, Imler D, Cadet L, Blanc P, Ramboa, P., Girtanner, C., Gonthier, R: Le syndrome de Diogène du sujet âgé: forme clinique d`un dysfonctionnement frontal? À propos de quatre observations. Rev Med Interne 23[2] (2002) 122-131 6 Böcker FM, Jeschke F, Brieger P: Psychiatrische Versorgung in Sachsen-Anhalt: Einrichtungen und Dienste im Überblick. Psychiatr Prax 28 (2001) 1-9 7 Brieger P: Gemeindenahe Psychiatrieplanung der Stadt Halle. Die Oberbürgermeisterin, Halle/Saale, 2001 8 Calamari JE, Wiegartz PS, Janeck AS: Obsessive-compulsive disorder subgroups: a symptom-based clustering approach. Behav Res Ther 37 (1999) 113-125 9 Cermele JA, Melendez-Pallitto L, Pandina GJ: Intervention in compulsive hoarding. A case study. Behav Modif 25[2] (2001) 214-232 10 Clark AN, Mankikar GD, Gray I: Diogenes syndrome. A clinical study of gross neglect in old age. Lancet 1[7903] (1975) 366-368 11 Clark AN: The Diogenes syndrome. Nurs Times 71[21] (1975) 800-802 12 Clark ANG: Diogenes syndrome. How to assess severe self-imposed neglect. Geriatric Medicine (1980) 65-67 13 Clark J: Neglect: the challenge of senile squalor syndrome. -

The Hoarders
The Hoarders THE HOARDERS university of chicago press Chicago and London scott herring is associate professor in the Department of English at Indiana University. He is the author of Another Country: Queer Anti-Urbanism and Queering the Underworld: Slumming, Literature, and the Undoing of Lesbian and Gay History, also published by the University of Chicago Press. The University of Chicago Press, Chicago 60637 The University of Chicago Press, Ltd., London © 2014 by The University of Chicago All rights reserved. Published 2014. Printed in the United States of America 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 1 2 3 4 5 isbn-13: 978-0-226-17168-5 (cloth) isbn-13: 978-0-226-17171-5 (paper) isbn-13: 978-0-226-17185-2 (e-book) doi: 10.7208/chicago/9780226171852.001.0001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Herring, Scott, 1976– author. The hoarders : material deviance in modern American culture / Scott Herring. pages cm Includes bibliographical references and index. isbn 978-0-226-17168-5 (cloth : alkaline paper) — isbn 978-0-226-17171-5 (paperback : alkaline paper) — isbn 978-0-226-17185-2 (e-book) 1. Compulsive hoarding—Popular works. 2. Compulsive hoarding—Patients—Public opinion. I. Title. rc569.5.h63h47 2014 616.85′84—dc23 2014013969 This paper meets the requirements of ansi/niso z39.48 –1992 (Permanence of Paper). For Marty Dowling CONTENTS Preface and Acknowledgments ix Introduction 1 1 19 2 51 3 85 4 112 Note on Method 143 Notes 147 Index 177 hen I was a child, some afternoons my mother would drive us out to a small neighborhood community—nothing more than a street of compact houses—called Wilkes Circle. -

|||GET||| Obsessive-Compulsive Disorder 1St Edition
OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Wayne K Goodman | 9781317200239 | | | | | Advanced Casebook of Obsessive-Compulsive and Related Disorders If you decide to participate, a new browser tab will open so you Obsessive-Compulsive Disorder 1st edition complete the survey after you have completed your visit to this website. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. The "cleaning factor" correlated highly with obsessions about contamination and compulsions related to cleaning. Archived from the original PDF on 19 February Some people with OCD perform compulsive rituals because they inexplicably feel they have to, while others act compulsively so as to mitigate the anxiety that stems from particular obsessive thoughts. Such obsessions, the DSM says, are recurrent and persistent thoughts, impulses or images that are experienced as intrusive and that cause marked anxiety or distress. Depression and Anxiety. Generally two categories of models for OCD have been postulated, the first involving deficits in executive function, and the second involving deficits in modulatory control. Assessment of obsessive-compulsive symptom dimensions: Development and evaluation of the dimensional obsessive-compulsive scale. Disorder that involves repeated thoughts obsessions that make a person feel driven to do something compulsions. Published Date: 10th July The first category of executive dysfunction is based on the observed structural and functional abnormalities in the dlPFC, striatumand thalamus. Obsessive Children: A Sociopsychiatric Study. Child abusestress [2]. Annual Review of Psychology. More than 50 percent of people experience suicidal tendencies, and 15 percent have attempted suicide. The American Journal of Psychiatry. For example, an individual who engages in compulsive hoarding might be inclined to treat inorganic matter as if it had the Obsessive-Compulsive Disorder 1st edition or rights of living organisms, while accepting that such behavior is irrational on a more intellectual level.