Cet Obscur Objet Du Désir Damien Detcheberry
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Petition Form and Materials in Support of Pamela Smart's
PETITION FORM AND MATERIALS IN SUPPORT OF PAMELA SMART’S PETITION FOR COMMUTATION OF SENTENCE Date February 26, 2018 FRIED, FRANK, HARRIS, SHRIVER & JACOBSON LLP Robert E. Juceam One New York Plaza New York, New York 10004 (212) 859-8000 Of Counsel: Amelia Gordon Matthew Joseph Katherine St. Romain 801 17th Street, NW Washington, DC 20006 (202) 639-7000 TABLE OF CONTENTS Tab I. Pardon Petition Form and Supporting Letters ...........................................................1 II. Memorandum in Support ..........................................................................................2 III. Appendix A – Letters & Signatures of Support .........................................................A IV. Appendix B – Pamela Smart Achievements & Certifications ...................................B V. Appendix C – Governors’ Recent Life-Without-Parole Commutations ....................C VI. Appendix D – Steve Cain & Associates, Tape Lab Report .......................................D VII. Appendix E – Exhibits to the Memorandum………................................................. E INFORMATION REQUIRED WITH PARDON PETITION Full Name: _____________________________________________________________________Pamela A. Smart Residence: _____________________________________________________________________Bedford Hills Correctional Facility for Women, 247 Harris Rd, Bedford Hills, NY 10507 (Street) (Town or City) Date of Birth: ___________________________August 16, 1967 (age: 50) Marital Status: Are you married? ________________________________________No -

Fenton Bailey & Randy Barbato
LA ‘14 Friday, 12/05 The Paramount Theater at Paramount Studios Los Angeles, CA 30 1 2 CONGRATULATIONS ON YOUR 2014 IDA AWARDS NOMINATION BEST LIMITED SERIES ©2014 Showtime Networks Inc. All rights reserved. 3 YEAR OF LIVING DANGEROUSLY - Showtime_YOLD_IDA_NomAd_FIN.indd 1 project: IDA NOMINATION FP 4C AD trim: 8.5" x 11" bleed: 8.75" x 11.25" mo#: 310940 FIN 11/13/14 4:52 PM client: SHOWTIME safe: 7.5" x 10" mech: 100% print: 100% date: 11/13/14 Our Sponsors luminary sponsor platinum sponsors gold sponsors silver sponsors bronze sponsors Law Offices of Larry Verbit Entertainment Law 4 pearl sponsors BIRDSTREET PRODUCTIONS media sponsor 5 RED FIRE FILMS honors and supports this year’s IDA Emerging Filmmaker. Congratulations to Darius Clark Monroe from Houston, Texas. redfirefilmsllc.com 6 December 5, 2014 SCHEDULE AWARDS CEREMONY 7:00 PM HOST: CAROL LEIFER Welcome Reception Celebrating 30 Years of the IDA Documentary Awards 30 Year Tribute Reel LOCATION: Bronson Plaza David L. Wolper Student Documentary Award 8:00 PM ABCNEWS VideoSource Award Awards Ceremony Pare Lorentz Award Best Curated Series Award LOCATION: Paramount Theater Emerging Documentary Filmmaker Award sponsored by Red Fire Films and Modern VideoFilm 9:30 PM Best Short Form Series Award After Party Preservation And Scholarship Award Sponsored by SHOWTIME® HUMANITAS Documentary Award LOCATION: Bronson Plaza Best Episodic Series Award Best Limited Series Award Pioneer Award Creative Recognition Awards: Best Cinematography presented by Canon Best Editing Best Music Best Writing -

Directed by Jeremiah Zagar StarringEvan Rosado, Isaiah Kristian
Directed by Jeremiah Zagar Starring Evan Rosado, Isaiah Kristian, Josiah Gabriel Raúl Castillo & Sheila Vand SUNDANCE FILM FESTIVAL SCREENINGS Saturday, Jan. 20th at 12:00pm - Library Center Theatre - World Premiere *Sunday, Jan. 21st at 1:00pm - Holiday Village, Cinema 4 - P&I* Monday, Jan. 22nd at 9:00am - The Ray Wednesday, Jan. 24th at 6:00pm. - Salt Lake City Library Theatre Thursday, Jan. 25th at 1:00pm - Redstone Cinema 2 Friday, Jan. 26th at 3:00pm - Sundance Mountain Resort Screening Room Saturday, January 27th at 2:30pm - Egyptian Theatre 2017 / 90 mins. / Drama / USA / Color / English Publicity Contacts Sales Contacts PMK•BNC Cinetic Media Omar Gonzales/ [email protected] John Sloss / [email protected] Sara Sampson/ [email protected] Eric Sloss / [email protected] 212.373.6120 212.204.7979 LOGLINE Us three, us brothers, us kings. Manny, Joel and Jonah tear their way through childhood and push against the volatile love of their parents. As Manny and Joel grow into versions of their father and Ma dreams of escape, Jonah, the youngest, embraces an imagined world all his own. SYNOPSIS Us three. Us brothers. Us kings, inseparable. Three boys tear through their rural New York hometown, in the midst of their young parents’ volatile love that makes and unmakes the family many times over. While Manny and Joel grow into versions of their loving and unpredictable father, Ma seeks to keep her youngest, Jonah, in the cocoon of home. More sensitive and conscious than his older siblings, Jonah increasingly embraces an imagined world all his own. With a screenplay by Dan Kitrosser and Jeremiah Zagar based on the celebrated Justin Torres We the Animals novel, is a visceral coming-of-age story propelled by layered performances from its astounding cast – including three talented, young first-time actors - and stunning animated sequences which bring Jonah’s torn inner world to life. -

PDF MFA Social Documentary Film Dept Brochure
Graduate Programs giving students the benefit of their expertise. The department Documentary also works to foster a direct line to the production professionals who will be their best network after graduation. film has changed SocDoc alumni have made an impressive impact. Alumni films have received more than a million dollars in production dramatically funding from Sundance Institute, ITVS, JustFilms/Ford Foundation, Jerome Foundation, CAAM, IDFA Bertha Fund, over the years, evolving into a fully realized art form. Growing Chicken & Egg Pictures, Tribeca Film Institute, Frameline audiences watch nonfiction in theaters, on TV and online and others. They have won an Emmy and the Student to see fresh global stories, and be inspired by the lives of Academy Award, and received multiple nominations. change-makers, artists and everyday people. These stories Alumni have been broadcast on TV, garnered industry delve into our history, inspire action and let us discover support via international film markets, received theatrical distant regions and our neighborhoods with a fresh eye. But, release in the U.S. and around the globe, received countless as evolutions in technology make it easier to create films, views online and played top-tier festivals including Berlin, more content competes for the opportunity to be seen. So it Sundance, IDFA, SXSW, Hot Docs, Busan and Tribeca. becomes vital to have the talent to produce a film that stands Now in our 12th year, MFA SocDoc is proud to inspire and out. Those with true fluency in the form—and a network of support the next generation of documentary filmmakers. A like-minded artists and mentors—have a crucial advantage. -

Supplementary Memorandum in Support of February 26, 2018 Petition of Pamela Smart for Commutation of Sentence and Comment On
SUPPLEMENTARY MEMORANDUM IN SUPPORT OF FEBRUARY 26, 2018 PETITION OF PAMELA SMART FOR COMMUTATION OF SENTENCE AND COMMENT ON RECOMMENDATION IN OPPOSITION OF THE ATTORNEY GENERAL OF NEW HAMPSHIRE Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP Robert E. Juceam One New York Plaza New York, New York 10004 (212) 859-8040 [email protected] Of Counsel Amelia Gordon Matthew Joseph Katherine. St. Romain Ronald Williams 807 17th Street, NW Washington, D.C. 20006 (202) 639-7000 I. Pamela Smart Never Had a Sentencing Hearing. Unlike the men who stood over Greg Smart and killed him by gunshot to the back of his head, all of whom are now on parole, Pamela Smart was sentenced to life imprisonment without the possibility of parole because of a legislatively mandated minimum sentence. She was 22 when convicted of accomplice to murder, has been incarcerated 28 years and remains so at Bedford Hills Correctional Facility. The judiciary never had an opportunity to determine whether the punishment fit the offender as well as the crime or whether it was inappropriately disparate from the sentence of the shooters or to give effect to the guidance of the New Hampshire Constitution (Pt. first, art. Xvii) that “the true design of all punishments [is] to reform, not to exterminate.” Executive Grace is the sole mechanism to individualize her punishment -- access to which is guaranteed to every New Hampshire citizen as of the present. II. Breadth of Support for the Petition. The State’s opposition attempts to discredit Ms. Smart’s wide-ranging support from the academic, celebrity, religious, philanthropic and other communities as well as decades of prison authorities and fellow inmates among others. -

Kidman Does a Lot of Sucking in to Die for Fell's Point Fun Fest Brews
October 10,1995 PAGE 9 Features Kidman Does a Lot of Sucking in To Die For by Nicole Kidman, not Helen Hunt. Citizen Kane in comparison. the characters are poorly developed; Jessica Greaves Suzanne is also not a teacher; she is The biggest crime that this mur- most of the jokes aren't funny; and Retriever Editorial Staff a narcissist who desperately wants der movie commits is that it wastes much of the dialogue leaves you Dateline, New Hampshire: A to get on television, and will liter- its potential. The idea that TV turns thinking, "Huh?" Additionally, the young high school teacher named ally do anything to make that hap- ordinary people into self-serving me- clothes and decorating are heavily Pamela Smart seduces a dipshit dia whores is certainly timely, reminiscent of The Brady Bunch. In student from her video produc- and could be the basis for a other words, if the bad writing doesn't tion class and convinces him "Matt Dillon ... is lucky that he provocative and funny movie. get you, the lime-green polyester will. and two of his friends to whack gets iced before the movie's over." To Die For, which is being The movie's actors are also her husband. touted in commercials as just wasted for the most part. Nicole Some of you may remember such a movie, does try a little bit Kidman, who gives an excellent this real-life soap opera from a few pen. Additionally, Suzanne is em- of ironic cultural critique, but succeeds performance, all things considered, years back, perhaps because you ployed as a weather girl for a local only in losing the audience's interest. -

Whose Life Is It Anyway: a Proposal to Redistribute Some of the Economic Benefits of Cameras in the Courtroom from Broadcasters to Crime Victims
South Carolina Law Review Volume 49 Issue 1 Article 3 Fall 1997 Whose Life Is It Anyway: A Proposal to Redistribute Some of the Economic Benefits of Cameras in the Courtroom from Broadcasters to Crime Victims Stephen D. Easton Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/sclr Part of the Law Commons Recommended Citation Easton, Stephen D. (1997) "Whose Life Is It Anyway: A Proposal to Redistribute Some of the Economic Benefits of Cameras in the Courtroom from Broadcasters to Crime Victims," South Carolina Law Review: Vol. 49 : Iss. 1 , Article 3. Available at: https://scholarcommons.sc.edu/sclr/vol49/iss1/3 This Article is brought to you by the Law Reviews and Journals at Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in South Carolina Law Review by an authorized editor of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Easton: Whose Life Is It Anyway: A Proposal to Redistribute Some of the E SOUTH CAROLINA LAW REVIEW VOLUME 49 FALL 1997 NUMBER 1 WHOSE LIFE Is IT ANYWAY?: A PROPOSAL TO REDISTRIBUTE SOME OF THE ECONOMIC BENEFITS OF CAMERAS IN THE COURTROOM FROM BROADCASTERS TO CRIME VICTIMS STEPHEN D. EASTON* I. INTRODUCTION ................................. 2 II. CAMERAS IN THE COURTROOM ....................... 7 A. Cameras in Courtrooms:A Brief HistoricalPerspective ...... 8 1. The Pre-Television Era ....................... 8 2. ABA Canon 35 ............................ 9 3. Three States Allow Cameras..................... 10 4. Estes v. Texas: The United States Supreme Court Speaks 11 5. The FloridaExperiment ..................... 12 6. Chandler v. Florida: The Supreme Court Speaks Again . 12 7. The Few Become the Many ................... -

Deconstructing the Image of the Female Journalist in the Film and Novel to Die For
She’d Kill to Be Famous: Deconstructing the Image of the Female Journalist in the Film and Novel To Die For Courtney Kabot To Die For - Courtney Kabot 2 ABSTRACT You're not anybody in America unless you're on TV. On TV is where we learn about who we really are. Because what's the point of doing anything worthwhile if nobody's watching? And if people are watching, it makes you a better person. --Suzanne Stone1 All she wanted was a little attention. But aspiring television reporter Suzanne Stone got much more. Joyce Maynard’s novel To Die For, which was adapted into the Gus Van Sant movie, is a satire of television, journalists, and the price of fame. The protagonist Suzanne Stone is twenty-five years old, married, and has always dreamt of a career on television. But when she finds herself at a dead-end weather girl job at a local cable station, Stone decides to take matters into her own hands to make sure she gets her fame. She refuses to let anyone stand in her way— even her husband. Stone embodies characteristics that are often found in popular culture references of female reporters including narcissism and manipulation, and using sexuality and appearance to get ahead. To Die For explores some of the exaggerated or accurate representations of women journalists that are commonly found in movies, television, and literature. This image may be more than just a fictitious character in entertainment and may in influence the way viewers look at real female reporters in the media. -

Women and Drugs •• Property Crimes by Women Offenders •• Prostitution and Sex Work •• Violent Crimes by Women Post, •• Women Who Kill Their Children
SECTION VIII FemaleFemale OffendersOffenders andand TheirTheir CrimesCrimes distribute or Section Highlights •• Women and drugs •• Property crimes by women offenders •• Prostitution and sex work •• Violent crimes by women post, •• Women who kill their children omen engage in every type of criminal activity. Much like their male counterparts, females are involved in a variety of different types of crime. While female crimes of violence are highly sensationalized by the media, these crimescopy, are rare occurrences. Instead, the majority of female offending is made up of crimes Wthat are nonviolent in nature or are considered victimless crimes, such as drug abuse and sexually based offenses. Males have always engaged in greater numbers of criminal acts. However, women are becoming more involved in crime and the criminal justice system. Research over the past several decades has focused on the narrowing of the gender gap, which refers to the differences in male and female offending for different types of offenses. But what does this really mean?not Are women becoming more violent than they were in the past, as media reports have suggested? Is the rise in women’s incarceration a result of more women engaging in serious criminal acts? What contributes to these changes? How do we investigate these questions? In Section I, you learned about the changes in male and female crime participation over a 1-year and 10-year period,Do using arrest data from the Uniform Crime Reports. Using these same data, we can investigate the gender gap in offending. Table 8.1 compares the percentage of males and females in different offense types. -
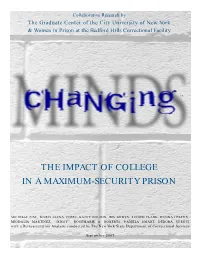
The Impact of College in a Maximum-Security Prison
Collaborative Research by The Graduate Center of the City Un i versity of New Yo rk &Women in Prison at the Bedford Hills Correctional Facility S M THE IMPACT OF COLLEGE IN A MAXIMUM-SECURITY PRISON MICHELLE FINE, MARIA ELENA TORRE, KATHY BOUDIN, IRIS BOWEN, JUDITH CLARK, DONNA HYLT O N , MIGDALIA MARTINEZ, “MISSY”, ROSEMARIE A. ROBERTS, PAMELA SMART, DEBORA UPEGUI with a Re i n c a rceration Analysis conducted by The New Yo rk State De p a rtment of Correctional Se rv i c e s September 2001 CHANGING MINDS The Impact of College in a Maximum-Security Prison: Effects on Women in Prison, the Prison Environment, Reincarceration Rates and Post-Release Outcomes Table of Contents Page Preface by Helena Huang, Open Society Institute .....................................................i-iii Introduction..................................................................................................................1 Executive Summary of the Research Findings ...............................................................3 College Education in Prison ..........................................................................................4 The Women at BHCF: Who’s in College? .................................................................6 Research Design ............................................................................................................9 Methods.....................................................................................................................9 Results.........................................................................................................................13 -
MPAA-WDS-Satellite-1
Before the COPYRIGHT ROYALTY JUDGES Washington, D.C. ) In the Matter of ) ) Distribution of the ) Docket No. 2012-7 CRB SD 1999-2009 ) (Phase II) 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, ) 2005, 2006, 2007, 2008, and 2009 ) Satellite Royalty Funds ) ) WRITTEN DIRECT STATEMENT OF THE MPAA-REPRESENTED PROGRAM SUPPLIERS VOLUME II OF II DESIGNATED PRIOR TESTIMONY Gregory O. Olaniran D.C. Bar No. 455784 Lucy Holmes Plovnick D.C. Bar No. 488752 Kimberly P. Nguyen D.C. Bar No. 996237 Naomi Straus D.C. Bar No. 1011753 MITCHELL SILBERBERG & KNUPP LLP 1818 N Street, NW, 8th Floor Washington, D.C. 20036 Telephone: (202) 355-7917 Facsimile: (202) 355-7887 [email protected] [email protected] Attorneys for MPAA-Represented May 9, 2014 Program Suppliers TABLE OF CONTENTS DESIGNATED PRIOR TESTIMONY Tab Marsha E. Kessler, Written Direct Testimony, submitted in Docket No. 2008-2 CRB CD 2000-2003 (Phase II) (filed May 30, 2012) (admitted as MPAA Exhibit 358) ........................................................................... A Marsha E. Kessler, Written Rebuttal Testimony, submitted in Docket No. 2008-2 CRB CD 2000-2003 (Phase II) (filed May 15, 2013) (admitted as MPAA Exhibit 359) ........................................................................... B Marsha E. Kessler, Oral Testimony, Docket No. 2008-2 CRB CD 2000-2003 (Phase II), Transcript pp. 94-221(June 3, 2013) ..................................................... C Paul B. Lindstrom, Written Direct Testimony, submitted in Docket No. 2008-2 CRB CD 2000-2003 (Phase II) (filed May 30, 2012) (admitted as MPAA Exhibit 363) ........................................................................... D Paul B. Lindstrom, Oral Testimony, Docket No., 2008-2 CRB CD 2000-2003 (Phase II), Transcript pp. 280-324 and 368-433 (June 3-4, 2013) ........................ -

Smart V. NYS DOC CV-99-179-M 09/30/02 UNITED STATES DISTRICT COURT
Smart v. NYS DOC CV-99-179-M 09/30/02 UNITED STATES DISTRICT COURT DISTRICT OF NEW HAMPSHIRE Pamela Smart, Petitioner v. Civil No. 99-179-M Opinion No. 2002 DNH 174 Glenn S. Goord, New York State Department of Correctional Services, Respondent O R D E R Petitioner was convicted in the New Hampshire Superior Court as an accomplice to the first degree murder of her husband, conspiracy to commit that murder, and witness tampering. She seeks habeas corpus relief, asserting violations of her Fifth, Sixth, and Fourteenth Amendment rights, denial of due process and a fair trial, and violation of her Eighth Amendment protection from cruel and unusual punishment. Respondent counters that petitioner is entitled to no relief on any of her claims. Procedural History Petitioner was convicted on March 22, 1991, following a 23- day jury trial. She filed post-trial motions for relief in the New Hampshire Superior Court, and pursued a direct appeal of her convictions to the New Hampshire Supreme Court on several grounds, some of which are reasserted in this habeas petition. The New Hampshire Supreme Court affirmed the petitioner’s conviction in a published opinion. See State v. Smart, 136 N.H. 639 (1993). Four years later, petitioner filed a state habeas petition in the Superior Court, raising (and exhausting) the claims presented here. The state habeas court denied relief, and, on appeal from that decision, the New Hampshire Supreme Court summarily affirmed. Petitioner then timely filed this petition for federal habeas relief.1 She is currently serving a mandatory sentence of life imprisonment, without the possibility of parole.