Nema Ould Taleb Août 1999
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Visite Du Président Au Brakna : Périple Sous Fond D'empoignades Politiques
Visite du président au Brakna : Périple sous fond d'empoignades politiques Extrait du L'Authentique http://lauthentic.info/spip.php?article763 Visite du président au Brakna : Périple sous fond d'empoignades politiques - Politique - Date de mise en ligne : mardi 17 avril 2012 L'Authentique Copyright © L'Authentique Page 1/3 Visite du président au Brakna : Périple sous fond d'empoignades politiques Forces de la majorité et celles de l'opposition s'affrontent toutes canines dehors pendant la visite que le président Mohamed Ould Abdel Aziz entame depuis hier au Brakna et au Gorgol. Une visite que les thuriféraires du pouvoir auraient bien voulue sans fronde, afin de mieux vendre l'image de régions totalement acquises au régime. La bataille se fait à coups de mobilisations populaires et de démobilisations, sous fonds de vieilles vaisselles à laver tout au long d'un périple qui ne sera pas de tout repos pour les deux protagonistes de la scène politique. La Wilaya du Brakna était en alerte politique maximale, quelques heures avant l'arrivée du président Mohamed Ould Abdel Aziz qui entame depuis hier un périple de trois jours qui devra le conduire dans la région puis au Gorgol. Des dizaines de cadres se sont rués dans les Wilayas précitées, laissant un vide dans les administrations qui roulent au ralenti. Les forces de l'ordre et de sécurité ont également décuplé leur effectif, en prévision d'une tournée qui s'annonce chaude. Il faut dire que déjà à Aleg, la tension était à son comble, avec une opposition qui a jeté toutes ses forces dans la bataille. -

Commission Nationale Des Concours Concours D'entrée Aux ENI(S) 2012-2013 Liste Des Admissibles Par Ordre Alphabétique Ecole Annexe
Commission Nationale des Concours Concours d'Entrée aux ENI(s) 2012-2013 Liste des Admissibles par ordre Alphabétique Ecole Annexe Option : Instituteurs Francisants N° Ins Nom Complet Année Naiss Lieu Naiss 0027 Ababacar Abdel Aziz Diop 1984 Sebkha 0005 Abdarrahmane Boubou Niang 1981 Boghe 0142 Abdoul Oumar Ba 1985 Niabina 0063 Abdoulaye Sidi Diop 1986 Teyarett 0060 Aboubacar Moussa Mbaye 1976 Tevragh Zeina 0015 Adam Dioum Diallo 1985 Rosso 0125 adama abdoulaye Sow 1982 Rosso 0025 Adama Cheikhou Traore 1981 Selibaby 0197 Ahmed Abdel kader Ba 1981 Tevragh Zeina 0096 Ahmed Tidjane Yero Sarr 1985 Kiffa 0061 Al Diouma Cheikhna Ndaw 1986 Selibaby 0095 Aly Baila Sall 1984 Nouadhibou 0139 Amadou Ibrahima Sow 1985 Rosso 0159 Amadou Oumar Ba 1984 Sebkha 0045 Aminetou Amadou Dieh 1880 Djeol 0128 Aminetou Mamadou Diallo 1987 Zoueratt 0003 Aminetou Mamadou Seck 1987 Sebkha 0135 Aminetou Med EL Moustapha Limam 1988 Diawnaba 0085 Binta Ghassoum Ba 1987 Bababe 0164 Biry Med Camara 1985 Dafor 0155 Bocar lam Toro Camara 1982 Bababe 0069 Boubacar Billa Yero Sy 1986 Zoueratt 0089 Boudé Gaye Yatera 1981 Boully 0117 Cheikh Oumar Mamadou Anne 1985 Niabina 0175 Cheikh Tidjane Khalidou Ba 1977 Sebkha 0156 Daouda Ousmane Diop 1986 El Mina 0140 Dieynaba Abou Dia 1988 Boghe 0182 Dieynaba Ibrahima Dia 1986 Bababe 0137 Dieynaba Mamadou Ly 1986 Tevragh Zeina 0007 Fatimata Abdoullahi Ba 1985 Bababe 0032 Fatimata Alyou thiam 1987 Nouadhibou 0018 Fatimata Mamadou Sall 1988 Zoueratt 0047 Habsatou Amadou Sy 1985 Aere Mbar 0166 Hacen Ibrahima Lam 1984 Boghe 0078 Hacen Mbaye -

Mauritanie, Pour
16°O LAS PALMAS 12° O vers TAN-TAN vers GUELMIM 8° O vers BÉCHAR vers BÉCHAR 4° O Cap Juby Gomera Tenerife Grande Canarie MAURITANIE TARFAYA MASPALOMAS M A R O C TINDOUF Hierro EL MHABAS 20° O Î l e s C a n a r i e s JDIRIYA LA'YOUN E (ESPAGNE) s S GARA DJEBILET a amr . m e qia el H a 449 ( in s) SMARA TFARITI BOUJDOUR E BOU KRA' Chenachane 'Aïn Ben Tili Z E M M O U R I g u î d i U Bîr Bel g Chegga Bîr Aïdiat Guerdâne Sebkhet ' E r A L G É R I E Dâya . Q Agmar Iguetti 'Ayoûn 'Abd el Khadra 347 GUELTAT ZEMMOUR Bîr Mogreïn el Mâlek I El Mzereb K Tourassine ÎR R E T T IS ZEMMOU N N A c h M A e 24° 24° N SAHARA Sebkhet Oumm ed Droûs A Sebkha h L Oued el Ma Zednes H OCCIDENTAL L C A ED DAKHLA 460 Cancer A El Mreïti Tropique du H g L Gleïb Dbâq G L 574 i Ti-n-Bessaïs m Tenoûmer r Agâraktem Zouérat â 370 E T ê E Fd rik a m m r Bîr 'Amrâne ' TAOUDENNI AOUSSERD ï (salines) Kediet ej Jill 915 l H e Mejaouda A E Tourîne t vers TESSA AGHOUINIT Touîjinjert q â îl BIR Tou j Aghreïjît a GANDOUZ TICHLA ZOUG M 330 e L I EL GARGARAT Châr 647 Zemlet Toffal Bir Ounâne T El Ghallâouîya n El Beyyed Cheïrîk â Nouâdhibou û â Aghoueyyît âl Ch ûm Aghouedir r N Bo Lanou r In Tmeïmîchât o Guelb er Rîchât a LAGOUIRA A 485 u Cansado Ntalfa Ahmeyim D Ouadâne O Râs Nouâdhibou â R A Azougui At r A M A L I (Cap Blanc) DAKHLET R Tiberguent 4° vers ARAOUANE NOUÂDHIBOU A z e f f â l 855 Chinguetti ADRAR É Terjît 20° 20° PARC NATIONAL Châmi DU BANC D'ARGUIN î A k c h â r Oujeft Capitale d'État Iou k Akjoujt 501 Et Tîdra Far 'aoun (plus de 750 000 hab.) C ÎR INCH I E Râs Timirist l M r e y Plus de 50 000 hab. -

Etudes Techniques Du Reseau Cible
ETUDES TECHNIQUES DU RESEAU CIBLE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 7. Etude technique du réseau cible 1 7.1 Contexte 1 7.2 Objectifs 1 7.3 Contexte actuel, contexte engagé (moyen terme) du système de transport et choix techniques en vigueur 1 7.3.1 Objectifs et critères d’analyse 1 7.3.1.1 Objectifs 1 7.3.1.2 Critères 2 7.3.2 Analyse de la situation existante 2 7.3.2.1 Lignes 3 7.3.2.2 Calculs de répartition à la pointe de charge 6 7.3.2.3 Calculs de court-circuit 9 7.3.2.4 Calculs de stabilité transitoire 10 7.3.2.5 Situation au creux de charge 14 7.3.2.6 Conclusion 15 7.4 Projets annoncés (projets SOMELEC et OMVS) 15 7.4.1 Projets supposés engagés 15 7.4.1.1 Projets d’extension de réseau 15 7.4.1.2 Projets de production d’électricité 16 7.4.2 Projets moins certains 16 7.5 Rappels du contexte futur: Prévisions de la demande et plan de production long terme 17 7.5.1 Prévisions de la demande 17 7.5.1.1 Charge des localités des Réseaux Autonomes (RA ou "Réseaux Araignées") 17 7.5.1.2 Charge des localités du Réseau Interconnecté (RI) 18 7.5.1.3 Charge de Nouakchott et Nouadhibou 18 7.5.2 Année de raccordement des autres grandes localités 19 7.5.3 Plan de production 19 7.6 Projets "Plan Directeur" : calculs de répartition 20 7.6.1 Variantes envisageables 20 7.6.2 Plan de tension et compensation de la puissance réactive 22 7.6.3 Niveau de charge des lignes et transformateurs 25 7.6.4 Pertes à la pointe en 2030 25 7.6.5 Introduction -

GE84/223 BR IFIC Nº 2778 Section Spéciale Special Section Sección
Section spéciale Index BR IFIC Nº 2778 Special Section GE84/223 Sección especial Indice International Frequency Information Circular (Terrestrial Services) ITU - Radiocommunication Bureau Circular Internacional de Información sobre Frecuencias (Servicios Terrenales) UIT - Oficina de Radiocomunicaciones Circulaire Internationale d'Information sur les Fréquences (Services de Terre) UIT - Bureau des Radiocommunications Date/Fecha : 16.09.2014 Expiry date for comments / Fecha limite para comentarios / Date limite pour les commentaires : 25.12.2014 Description of Columns / Descripción de columnas / Description des colonnes Intent Purpose of the notification Propósito de la notificación Objet de la notification 1a Assigned frequency Frecuencia asignada Fréquence assignée 4a Name of the location of Tx station Nombre del emplazamiento de estación Tx Nom de l'emplacement de la station Tx B Administration Administración Administration 4b Geographical area Zona geográfica Zone géographique 4c Geographical coordinates Coordenadas geográficas Coordonnées géographiques 6a Class of station Clase de estación Classe de station 1b Vision / sound frequency Frecuencia de portadora imagen/sonido Fréquence image / son 1ea Frequency stability Estabilidad de frecuencia Stabilité de fréquence 1e carrier frequency offset Desplazamiento de la portadora Décalage de la porteuse 7c System and colour system Sistema de transmisión / color Système et système de couleur 9d Polarization Polarización Polarisation 13c Remarks Observaciones Remarques 9 Directivity Directividad -
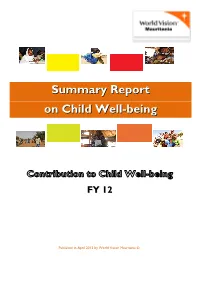
Summary Report on Child Well-Being
SSuummmmaarryy RReeppoorrtt oonn CChhiilldd WWeellll--bbeeiinngg FFYY 1122 Published in April 2013 by World Vision Mauritania © Table of Contents ACRONYMS .......................................................................................................................................... 4 1. Executive Summary ......................................................................................................................... 5 2. INTRODUCTION ............................................................................................................................... 6 3. Challenges and Enablers .................................................................................................................. 8 4. Influencing Factors .......................................................................................................................... 9 5. ACHIEVEMENTS ............................................................................................................................. 10 5.1. Improved the number of children in preschool prepared .................................................... 10 5.2. Improved Access and Quality of Education ........................................................................... 12 5.3. Improved nutritional status of children ................................................................................ 14 5.4. Improve the immunization status of children ....................................................................... 17 5.5. Increased households’ capacities to ensure -

Prevision De La Demande
PREVISION DE LA DEMANDE Mauritanie: Plan directeur de production et transport de l'énergie électrique en Mauritanie entre 2011 et 2030 - Rapport final Table des Matières Page 3. Prévision de la demande 1 3.1 Introduction 1 3.2 Développement démographique 2 3.2.1 Période 2000 - 2010 2 3.2.2 Période 2011 - 2030 3 3.3 Développement économique 4 3.3.1 L'objectif primordial - réduction de la pauvreté 4 3.3.2 Développement du PIB dans la période 1995 - 2010 4 3.3.3 Le secteur minier et le secteur de la pêche 6 3.3.3.1 Statistique de production 6 3.3.3.2 Secteur minier 7 3.3.3.3 Secteur de la pêche 7 3.3.4 Perspectives de développement 8 3.4 Demande d'électricité dans le passé 10 3.4.1 Cadre institutionnel 10 3.4.2 Ventes BT et MT de la SOMELEC dans la période 2000 - 2012 10 3.4.3 Période 2006 - 2012 : Abonnés BT et ventes BT 11 3.4.4 Période 2006 - 2012 : Abonnés MT et ventes MT 14 3.4.5 Résumé de la situation en 2010 20 3.4.6 Le secteur minier 21 3.5 Modèle de demande des localités déjà électrifiées 22 3.5.1 Développement du taux d'électrification 24 3.5.2 Développement de la demande spécifique des abonnés domestiques 25 3.5.2.1 Nouakchott et Nouadhibou 25 3.5.2.2 Autres localités 25 3.5.3 Développement de la demande des abonnés BT non domestiques 27 3.5.4 Développement de la demande MT 28 3.5.5 Demande en puissance (pointes annuelles) 29 3.6 Demande potentielle des localités NON électrifiées 30 3.7 Demande du secteur minier 33 3.8 Résultats 34 3.8.1 Localités déjà électrifiées en 2011 34 3.8.1.1 Demande en énergie électrique 34 3.8.1.2 Demande -

Appui À La Gestion De Frontières En Mauritanie, ACQUISITION D
TC.0558.MR10 DOSSIER D’APPEL D’OFFRES Appui à la gestion de frontières en Mauritanie ACQUISITION D’EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET MOBILIER DE BUREAU pour la Direction Générale de la Sûreté Nationale Préparé par Tevragh Zeina, Lot 551 Nouakchott République Islamique de Mauritanie i Table des matières Section I. Instructions aux soumissionnaires (IAS) ............... 5 Section II. Planification des exigences .......................... 21 Section III. Spécifications techniques ........................... 36 Section IV. Conditions du contrat ................................ 52 Section V. Formulaires ........................................... 68 Section VI. Cartes et diagrammes ................................. 76 ii INVITATION A SOUMISSIONNER IAS N o. TC.0558.MR10 Date: 13/10/2011 L'Organisation Internationale pour les Migration (OIM) est une organisation humanitaire intergouvernementale créée en 1951 et commise au principe que la migration humanitaire et ordonnée est au bénéfice des migrants et de la société. Dans le cadre de son projet d’appui à la gestion de frontières en Mauritanie, financé par l’Union Européenne, le Comité d’évaluation et d’attribution des offres de l’OIM “CEAO” invite les soumissionnaires intéressés à proposer leurs offres pour l’acquisition des lots suivants : Item Description du bien et des services No. 1 Ordinateurs et périphériques 2 Lecteurs de passeports 3 Equipement de télécommunication 4 Panneaux solaires et climatiseurs 5 Mobilier de bureau Un dossier d’appel d’offre est disponible pour les soumissionnaires intéressés à l’adresse ci-après Tevragh Zeina Lot 551, Nouakchott, République Islamique de Mauritanie à partir du 16/10/2011. Les offres doivent être valides pour une période de 90 jours calendaires après le dépôt des offres et doivent être accompagnées d’une offre de sécurité équivalente à au moins 2,5 % du montant total de l’offre du soumissionnaire sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un chèque certifié et doit être incluse dans l’offre du soumissionnaire. -

The Senegal-Mauritania Conflict
Case no. 1 Senegal-Mauritania conflict Evolution of transhumance routes from 1950 to 1960 Moktar Lahjar Chogar 250 mm MAURITANIA Lake Aleg Lake Rkïz Lake Mâl 300 mm Dar El Barka Keur Massène Bogué Podor Bababé Drought cycle and evolution of Rosso Mbagne Kaedi pastoralist dynamics Lake Guier Senegal St Louis SENEGAL The transhumant and/or nomadic Matam agropastoralists in the region close to the river valley are predominantly from the Fulani haalpulaar communities. The toucouleur farmers live in large villages. Bakel In the lower valley, 75% of the Fulani farm the from 1960 to 1970 walo in the dry season, very few do so in the diéri area. The lands cultivated after flood MAURITANIA Lake Aleg waters recede are rented out by the Wolof Lake Rkïz Lake Mâl and the Moors. In Bogué, very little arable Dar El Barka land belong to the Fulani. Cropping was Keur Massène Bogué Podor concentrated in the walo and around Demèt Bababé Rosso 250 mm (middle valley). Mbagne Kaedi Senegal St Louis Lake Guier 300 mm Aridity advances north of the river as shown SENEGAL Matam by the shift in isohyets. During the dry season Moor and Fulani cattle herds find refuge south of the river. Campsites gradually move further south. Transhumant activities are carried out Bakel on over longer distances and durations. from 1980 to 1990 Flood recession agriculture is practiced by MAURITANIA two-thirds of Mauritanian Fulani in Rosso Lake Aleg 12 and Rkïz, especially in the four zones: Garak Lake Rkïz Lake Mâl 76 Dar El 12 streamlets, around the diéri, walo basins Barka Bogué Keur Massène 250 mm between Rosso and the Ganien forest, Lake 23 Podor Rosso Bababé Rkïz and its streamlets. -

Cerd/C/Mrt/8-14
United Nations CERD/C/MRT/8-14 International Convention on Distr.: General 20 February 2017 the Elimination of All Forms English of Racial Discrimination Original: French English, French and Spanish only Committee on the Elimination of Racial Discrimination Consideration of reports submitted by States parties under article 9 of the Convention Eighth to fourteenth periodic reports of States parties due in 2008 Mauritania* [Date received: 7 February 2017] * The present document is being issued without formal editing. GE.17-02680 (E) 280317 060417 CERD/C/MRT/8-14 Contents Page Introduction ................................................................................................................................... 3 Part I: General presentation of the Islamic Republic of Mauritania — General information ........ 3 A. Demographic and socioeconomic characteristics ................................................................. 3 B. Constitutional and judicial institutions ................................................................................. 5 C. General framework for the protection and promotion of human rights ................................ 7 D. Obstacles to the fulfilment of international human rights obligations .................................. 15 E. Reporting process ................................................................................................................. 16 F. Follow-up to concluding observations of human rights treaty bodies .................................. 16 G. Measures to ensure wide -

Brakna Recovery Initiative (BRI)
Catholic Relief Services (CRS) in partnership with Caritas Mauritania Brakna Recovery Initiative (BRI) 3nd Quarterly Report Project Period: 14 June 2013 – 13 June 2014 Reporting Period: January 1 – March 31, 2014 (FY14, Q2) Submitted: April 25, 2014 (via https://abacusxp.ofda.gov) Funded by USAID/OFDA Agreement No. AID-OFDA-G-13-00074 Contact: Nicole Poirier Contact: Hilary O’Connor Country Representative Public Donor Liaison Catholic Relief Services CRS Baltimore 72, Bd de la République, Dakar 228 W Lexington St Sénégal Baltimore, MD 21201 Tel: +221 33 889-15-75 Tel : (410) 927-7613 Fax: +221 33 823 -58-24 Fax : (410) 234-2995 Email: [email protected] Email: [email protected] CRS Senegal AID-OFDA-G-13-00074 (Brakna Recovery Initiative) 1 I. Introduction 1.1 Project Summary In partnership with Caritas Mauritania and the Government of Mauritania technical authorities, Catholic Relief Services (CRS) and USAID/OFDA are providing assistance to 2,600 extremely vulnerable and vulnerable households in Mauritania. The 12-month Brakna Recovery Initiative (BRI) targets the Bababe and Mbagne departments in the Brakna region of Mauritania, an area still suffering from the effects of the 2011/2012 Sahel food crisis. BRI is restoring community assets through Cash for Work (CFW) opportunities, Cash Transfers, small ruminants for those who lost or sold livestock, and technical trainings on improving soil fertility in agro- pastoral zones. 1.2 January-March 2014 Project Highlights During the 3nd quarter of the project, January-March 2014, CRS and Caritas Mauritania completed the following activities in each of the 33 targeted villages: 1st Cash for Work - $24,000 for 800 beneficiaries (January 2014) Set up demonstration sites for permaculture and key hole gardens (February 2014) Mid-term Review (February 2014) 3rd Cash transfer - $ 78,000 for 2600 beneficiaries (March 2014) Tree plantation (using the Irrigasc method) in selected villages (March 2014) Refresher trainings (February March 2014) II. -

Project/Programme Title: Support Green Development Poles To
Support green development poles to strengthen the resilience to climate change of communities, ecosystems and agro-silvopastoral Project/Programme title: production systems of municipalities in the Brakna Region in Mauritania Country(ies): Mauritania National Designated Ministère de l'Environnement et du Développement Durable Authority(ies) (NDA): Ministry of Environment and Sustainable Development Accredited Entity(ies) (AE): International Union for Conservation of Nature Date of first submission: 11/12/2020 V.1 Date of current submission: 12/11/2020 V.2 Version 2 A. Project / Programme Summary (max. 1 page) ☒ Project ☒ Public sector A.2. Public or A.1. Project or programme A.3 RFP Not applicable private sector ☐ Programme ☐ Private sector Mitigation: Reduced emissions from: ☒ Energy access and power generation: 10% ☐ Low emission transport: 0% ☐ Buildings, cities and industries and appliances: 0% A.4. Indicate the result ☒ Forestry and land use: 20% areas for the project/programme Adaptation: Increased resilience of: ☒ Most vulnerable people and communities: 20% ☒ Health and well-being, and food and water security: 20% ☐ Infrastructure and built environment: 0% ☒ Ecosystem and ecosystem services: 30% A.5.1. Estimated mitigation impact 1 tCO2eq (tCO2eq over project lifespan) A.5.2. Estimated adaptation impact 90,000 direct beneficiaries (number of direct beneficiaries) A.5. Impact potential A.5.3. Estimated adaptation impact 225,000 indirect beneficiaries (number of indirect beneficiaries) A.5.4. Estimated adaptation impact 6.66% of the country’s total population (% of total population) A.6. Financing information A.6.1. Indicative GCF funding requested (max Amount: 9,000,000 Currency: USD Financial Instrument: Grants 10M) Amount: 1 Currency: USD Financial Instrument: in-kind A.6.2.