Format Acrobat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rapport D´Information
N° 102 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2010 RAPPORT D´INFORMATION FAIT au nom de la commission des affaires européennes (1) et de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (2) par le groupe de travail (3) sur la réforme de la politique agricole commune, Par MM. Jean BIZET, Jean-Paul EMORINE, Mmes Bernadette BOURZAI et Odette HERVIAUX, Sénateurs. (1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet président ; MM. Denis Badré, Pierre Bernard-Reymond, Michel Billout, Jacques Blanc, Jean François-Poncet, Aymeri de Montesquiou, Roland Ries, Simon Sutour, vice-présidents ; Mmes Bernadette Bourzai, Marie-Thérèse Hermange, secrétaires ; MM. Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, Didier Boulaud, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. Gérard César, Christian Cointat, Philippe Darniche, Mme Annie David, MM. Robert del Picchia, Pierre Fauchon, Bernard Frimat, Yann Gaillard, Charles Gautier, Jean-François Humbert, Mme Fabienne Keller, MM. Serge Lagauche, Jean-René Lecerf, François Marc, Mmes Colette Mélot, Monique Papon, MM. Hugues Portelli, Yves Pozzo di Borgo, Josselin de Rohan, Mme Catherine Tasca et M. Richard Yung. (2) Cette commission est composée de : M. Jean-Paul Emorine, président ; MM. Gérard César, Gérard Cornu, Pierre Hérisson, Daniel Raoul, Mme Odette Herviaux, MM. Marcel Deneux, Daniel Marsin, Gérard Le Cam, vice-présidents ; M. Dominique Braye, Mme Élisabeth Lamure, MM. Bruno Sido, Thierry Repentin, Paul Raoult, Daniel Soulage, Bruno Retailleau, secrétaires ; MM. Pierre André, Serge Andreoni, Gérard Bailly, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jean Bizet, Yannick Botrel, Martial Bourquin, Jean Boyer, Jean-Pierre Caffet, Yves Chastan, Alain Chatillon, Roland Courteau, Jean-Claude Danglot, Philippe Darniche, Marc Daunis, Denis Detcheverry, Mme Évelyne Didier, MM. -

Projet De Loi
N° 828 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 septembre 2016 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR L 'A SSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE , relatif à l' égalité et à la citoyenneté , TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) (1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir, président ; Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Gatel, rapporteurs ; Mme Aline Archimbaud, MM. Philippe Dallier, René Danesi, Christian Favier, Jacques-Bernard Magner, Jacques Mézard, Mme Sophie Primas, MM. Yves Rome, Jean-Pierre Sueur, Henri Tandonnet, vice-présidents ; Mme Hélène Conway-Mouret, MM. Loïc Hervé, Alain Vasselle secrétaires ; Mmes Maryvonne Blondin, Agnès Canayer, M. Jean-Claude Carle, Mme Françoise Cartron, M. Francis Delattre, Mme Catherine di Folco, M. Daniel Dubois, Mmes Joëlle Garriaud-Maylam, Corinne Imbert, Françoise Laborde, Marie-Noëlle Lienemann, MM. Jean-Jacques Lozach, Louis Pinton, Hugues Portelli, Mme Christine Prunaud, MM. Alain Richard et René Vandierendonck. Voir le(s) numéro(s) : Assemblée nationale (14 ème législ.) : 3679 , 3851 et T.A. 787 Sénat : 773 et 827 (2015-2016) 3 PROJET DE LOI RELATIF À L’ÉGALITÉ ET À LA CITOYENNETÉ TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE TITRE IER ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION CHAPITRE IER Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité Article 1er La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, -

Conseil Constitutionnel
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2013 > 2013-684 DC Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 Loi de finances rectificative pour 2013 Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2013, le 19 décembre 2013, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Élie ABOUD, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Mme Nicole AMELINE, MM. Benoist APPARU, Julien AUBERT, Jean-Pierre BARBIER, Sylvain BERRIOS, Xavier BERTRAND, Étienne BLANC, Marcel BONNOT, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Jean-Louis CHRIST, Éric CIOTTI, Jean-François COPÉ, François CORNUT-GENTILLE, Jean-Louis COSTES, Olivier DASSAULT, Bernard DEBRÉ, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Rémi DELATTE, Patrick DEVEDJIAN, Jean Pierre DOOR, David DOUILLET, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Georges FENECH, François FILLON, Yves FOULON, Marc FRANCINA, Laurent FURST, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Claude GOASGUEN, Mmes Claude GREFF, Arlette GROSSKOST, Françoise GUÉGOT, MM. Michel HERBILLON, Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Mme Valérie LACROUTE, MM. Jacques LAMBLIN, Mme Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Pierre LELLOUCHE, Bruno LE MAIRE, Jean LEONETTI, Pierre LEQUILLER, Philippe LE RAY, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Alain MARC, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Alain MARTY, Jean-Claude MATHIS, Philippe MEUNIER, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Mme Dominique NACHURY, MM. Patrick OLLIER, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. -

Cartographie-Centre
Vice-Présidents Porte-Paroles Secrétaires généraux 22 bis, rue des Volontaires Délégué Général Yves JEGO Valérie LÉTARD Philippe FOLLIOT Catherine MORIN-DESSAILLY 75015 Paris Franck REYNIER Chantal JOUANNO Laurent DEGALLAIX Michel ZUMKELLER, Vie des Député –maire de Sénatrice du Nord Député du Tarn Sénatrice de la Seine-Maritime 01 53 71 20 17 Député-maire de Sénatrice de Paris Député-maire fédérations Montereau-Fault-Yonne Présidente de Jean-Marie BOCKEL de Valenciennes www.part-udi.fr Montélimar Brigitte FOURRE, Projet UDI Valenciennes Métropole Sénateur du Haut-Rhin Daniel LECA Conseillers Jean-Marie BOCKEL Sophie AUCONIE François SAUVADET Louis GISCARD D’ESTAING Trésorier Conseil National Sénateur du Haut-Rhin Gouverneure au Député de Côte-d’Or Maire de Chamalières Stéphane SALINI Dominique PAILLE Vincent CAPO-CANELLAS Conseil Mondial de l’Eau Président du Conseil Laurent HÉNART André SANTINI Conseiller politique Conseiller diplomatique Sénateur-maire du Bourget Départemental de la Côte d’Or Président Vice-président Député-maire Arnaud RICHARD Bertrand PANCHER Yannick FAVENNEC Maire de Nancy d’Issy-les-Moulineaux Député des Yvelines Député-maire de Député de la Mayenne Bar-le-Duc Président d’association d’élus Président de communauté urbaine Coordination parlementaire André ROSSINOT Assemblée nationale Sénat Parlement européen André SANTINI Président de Départements et communes Grand Nancy Philippe VIGIER François ZOCCHETO Jean ARTHUIS Président du groupe UDI Président du groupe UDI-UD Député européen ALDE Président de Conseil régional -
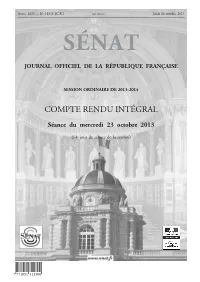
Et Au Format
o Année 2013. – N 113 S. (C.R.) ISSN 0755-544X Jeudi 24 octobre 2013 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du mercredi 23 octobre 2013 (14e jour de séance de la session) 7 771051 311300 9982 SÉNAT – SÉANCE DU 23 OCTOBRE 2013 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. JEAN-LÉONCE DUPONT M. Claude Dilain, rapporteur ; Mme Cécile Duflot, ministre ; M. Jean-Claude Lenoir. – Rejet des amende- Secrétaires : ments nos 90 et 362 rectifié. MM. Jean Desessard, Gérard Le Cam. Amendement no 651 rectifié bis de M. David Assouline. – 1. Procès-verbal (p. 9987) Mme Renée Nicoux, M. Claude Dilain, rapporteur ; Mme Cécile Duflot, ministre. – Adoption. 2. Engagement de la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi (p. 9987) Amendements nos 685 rectifié et 686 de Mme Marie-Noëlle Lienemann. – Mme Marie-Noëlle Lienemann, 3. Dépôt d'un rapport (p. 9987) M. Claude Dilain, rapporteur ; Mme Cécile Duflot, ministre. – Adoption des deux amendements. 4. Accès au logement et urbanisme rénové. – Suite de la dis- cussion d'un projet de loi dans le texte de la commission M. Jean-Claude Lenoir, Mme Élisabeth Lamure, (p. 9987) MM. René-Paul Savary, Daniel Dubois, Mmes Marie- Noëlle Lienemann, Muguette Dini, M. Joël Labbé, Article 1er (suite) (p. 9987) Mme Mireille Schurch, MM. Philippe Bas, Marc Laménie, Philippe Dallier. Amendement no 38 rectifié de M. Philippe Dallier. – MM. Philippe Dallier, Claude Dilain, rapporteur de la Rappel au règlement (p. 10002) commission des affaires économiques ; Mme Cécile Duflot, ministre de l'égalité des territoires et du Mme Élisabeth Lamure. -

Mardi 2 Juillet 2013
MARDI 2 JUILLET 2013 Allocution de M. le président du Sénat Réforme de la PAC Accord France AIEA Convention OSPAR Collectivités locales SOMMAIRE OUVERTURE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE 2012-2013 ................................................. 1 DÉCÈS D’UN SÉNATEUR.............................................................................................................. 1 REMPLACEMENT D’UN SÉNATEUR DÉCÉDÉ............................................................................ 1 ALLOCUTION DE M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT ....................................................................... 1 SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL................................................................................ 4 ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE (Candidatures)............................................................ 4 DÉPÔT D’UN RAPPORT ................................................................................................................ 4 RAPPELS AU RÈGLEMENT .......................................................................................................... 4 M. Jacques Mézard 4 M. François Zocchetto 5 RÉFORME DE LA PAC .................................................................................................................. 5 Orateurs inscrits 5 M. Stéphane Le Foll, ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt 5 M. Joël Labbé 5 M. Jean-Paul Emorine 6 Mme Bernadette Bourzai 6 M. Gérard Le Cam 7 M. Jean-Jacques Lasserre 7 M. Alain Bertrand 8 M. Yannick Botrel 8 Mme Renée Nicoux, coprésidente du groupe -

Mardi 28 Novembre 2017
MARDI 28 NOVEMBRE 2017 Projet de loi de finances pour 2018 (Suite) Articles de la première partie (Suite) Questions d’actualité SOMMAIRE COMMUNICATIONS ....................................................................................................................... 1 Commission et Office parlementaire (Nominations) 1 PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2018 (Suite) ................................................................... 1 Discussion des articles de la première partie (Suite) 1 ARTICLE 28 (État A) 1 Explications de vote sur la première partie 4 M. Pascal Savoldelli 4 M. Bernard Delcros 4 M. Claude Raynal 5 M. Emmanuel Capus 5 M. Jean-Claude Requier 6 Mme Christine Lavarde 6 M. Julien Bargeton 6 M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances 7 M. Vincent Éblé, président de la commission des finances 7 QUESTIONS D’ACTUALITÉ ........................................................................................................... 7 Formation universitaire de prévention de la radicalisation 7 Mme Colette Mélot 7 M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur 7 Immigration 7 M. François-Noël Buffet 7 M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'intérieur 8 Glyphosate (I) 8 M. Daniel Dubois 8 M. Stéphane Travert, ministre de l'agriculture et de l'alimentation 8 Glyphosate (II) 8 Mme Noëlle Rauscent 8 Mme Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes 8 Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) 9 M. Jean-Pierre Corbisez 9 M. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire 9 Violences faites aux femmes 9 Mme Laurence Cohen 9 Mme Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes 9 Glyphosate (III) 10 M. -

Conseil Constitutionnel
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2013 > 2013−679 DC Décision n° 2013−679 DC du 04 décembre 2013 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, le 6 novembre 2013, par MM. Jean−Claude GAUDIN, Pierre ANDRÉ, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Mme Françoise BOOG, MM. Pierre BORDIER, Joël BOURDIN, Mme Marie−Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François−Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean−Pierre CANTEGRIT, Jean−Noël CARDOUX, Jean−Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean−Pierre CHAUVEAU, Marcel−Pierre CLÉACH, Gérard CORNU, Jean−Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Francis DELATTRE, Gérard DERIOT, Mme Catherine DEROCHE, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, André DULAIT, Louis DUVERNOIS, Jean−Paul ÉMORINE, Louis−Constant FLEMING, Jean−Paul FOURNIER, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD−MAYLAM, MM. Jacques GAUTIER, Patrice GÉLARD, Bruno GILLES, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, François GROSDIDIER, Charles GUENÉ, Pierre HÉRISSON, Michel HOUEL, Jean−François HUSSON, Jean−Jacques HYEST, Mmes Sophie JOISSAINS, Christiane KAMMERMANN, M. Roger KAROUTCHI, Mme Elisabeth LAMURE, MM. Gérard LARCHER, Daniel LAURENT, Jean−René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean−Pierre LELEUX, Jean−Claude LENOIR, Philippe LEROY, Gérard LONGUET, Roland du LUART, Michel MAGRAS, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Mme Hélène MASSON−MARET, MM. -

Information Report
NOT 13 1 SENATE REGULAR SESSION OF 2019-2020 Recorded at the Presidency of the Senate November 19, 2019 INFORMATION REPORT MADE on behalf of the Committee on Economic Affairs (1) and the Committee on Foreign Affairs, Defense and Armed Forces (2) on the policy of the launch vehicles, By Sophie PRIMAS and Mr. Jean-Marie Bockel, senators (1) The commission is composed of: Sophie Primas President; Ms. Elizabeth Lamure MM. Daniel Gremillet, Alain Chatillon, Martial Bourquin, Franck Montaugé, Mrs Anne-Catherine Loisier, Noelle Rauscent, Alain Bertrand, Cécile Cukierman, Mr. Jean-Pierre Decool, Vice-Presidents; Messrs. François Calvet, Daniel Laurent, Mrs Catherine Procaccia Viviane Artigalas, Létard, secretaries; Serge Babary, Anne-Marie Bertrand, Mr. Bouloux Yves Bernard Buis Henry Cabanel, Mrs Anne-Larché Chain, Marie-Christine Chauvin Catherine Conconne Agnes Constant Messrs. Roland Courteau, Pierre Cuypers Marc Daunis, Daniel Dubois, Laurent DUPLOMB Alain Duran, Mrs Dominique Sassone, Françoise Férat, Fabien Gay, Annie Guillemot, MM. Iacovelli Xavier, Jean-Marie Janssens Joel Labbé, Marie-Noëlle Lienemann, Mr. Pierre Louault, Michel Magras, Jean-François Mayet, Franck Menonville, Jean-Pierre Moga, Mrs Patricia Morhet-Richaud, Sylviane Christmas, MM. Jackie Pierre, Michel Raison, Mrs Evelyne Renaud Garabedian, Denise St. Pé, Jean-Claude Tissot. (2) The commission is composed of: Mr. Christian Cambon, President ; Messrs. ALLIZARD Pascal, Bernard Cazeau, Robert del Picchia Ms. Sylvie Goy-Chavent MM. Jean-Noel Guerini, Joel Guerriau, Pierre Laurent, Cedric Perrin Gilbert Roger, Jean-Marc Todeschini, Vice-Presidents; Olivier Cigolotti, Joëlle Garriaud-Maylam, Philippe Paul, Marie-Françoise Perol-Dumont secretaries; Messrs. Jean-Marie Bockel, Gilbert Bouchet, Michel Boutant Olivier Cadic Alain Cazabonne Pierre Charon, Ms. -

Liste Des Co-Signataires
Liste des Co-Signataires : A l’Assemblée Nationale Les Députés du Groupe UMP : MM. Etienne PINTE, Jean-Paul ANCIAUX, Patrick BALKANY, François BAROIN, Patrick BEAUDOUIN, Jean- Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BENISTI, Jean-Louis BERNARD, Jérôme BIGNON, Chantal BOURRAGUE, Christine BOUTIN, Loïc BOUVARD, Ghislain BRAY, François CALVET, Richard CAZENAVE, Hervé De CHARRETTE, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Geneviève COLOT, Alain CORTADE, Jean-Yves COUSIN, YVES COUSSAIN, Paul-Henri CUGNENC, Jean-Pierre DECOOL, Patrick DELNATTE, Eric DIARD, Jacques DOMERGUE, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Pierre-Louis FAGNIEZ, Francis FALALA, Yannick FAVENNEC, Jean- Michel FERRAND, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, Jacques GODFRAIN, Gérard GRIGNON, Serge GROUARD, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Laurent HENART, Pierre HERIAUD, Antoine HERTH, Jean-Yves HUGON, Michel HUNAULT, Denis JACQUAT, Maryse JOISSAINS-MASSINI, Didier JULIA, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Pierre LASBORDES, Brigitte LE BRETHON, Robert LECOU, Jean-Marc LEFRANC, Dominique LE MÈNER, Jean LEMIERE, Jean-Claude LENOIR, Pierre LEQUILLER, Richard MALLIE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND- MILITELLO, Franck MARLIN, Jean MARSAUDON, Jean-Claude MATHIS, Bernard MAZOUAUD, Denis MERVILLE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Etienne MOURRUT, Jean-Marc NESME, Jean-Marc NUDANT, Dominique PAILLE, Robert PANDRAUD, Béatrice PAVY, Michel PIRON, Bérangère POLETTI, Eric RAOULT, Jean Luc REITZER, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Philippe ROUAULT, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT, Hélène TANGUY, Michel TERROT, Irène THARIN, Jean-Claude THOMAS, Léon VACHET, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Jean-Luc WARSMANN, Michel ZUMKELLER Les Députés du Groupe UDF : Pierre ALBERTINI, Pierre-Christophe BAGUET et M M. -

Appel Pour Une Nomination De Malala Au Prix Nobel De La Paix
Appel pour une nomination de Malala au Prix Nobel de la Paix "Si on ne donne pas de stylos à cette jeune génération, les terroristes leur donneront des armes " déclarait Malala Yousafzai sur Al-Jazeera il y a deux ans. Elle avait alors douze ans et défendait face aux talibans, via son blog, le droit des filles pakistanaises à aller à l’école au-delà du CM1. La semaine dernière, à la sortie de l’école, des talibans lui ont tiré dessus à bout portant. Tragique coïncidence, cette attaque est intervenue deux jours avant la tenue de la toute première Journée internationale des Filles proclamée par l’ONU, en soutien aux droits fondamentaux des fillettes et des adolescentes – au premier rang desquels l’éducation. Ce terrible attentat semble avoir déclenché une véritable prise de conscience au Pakistan, où l’opinion publique, les médias, et nombre d’imams se sont élevés contre la barbarie des talibans. Le président pakistanais Asif Ali Zardari a même déclaré que cette tentative d’assassinat était "une attaque contre toutes les filles" au Pakistan. Le 9 octobre 2012 pourrait bien constituer un tournant dans la lutte contre les talibans… Si Malala mérite le Prix Nobel de la Paix, au même titre que Martin Luther King, c’est parce que son combat dépasse largement les frontières de la vallée de Swat et du Pakistan. En quelques années seulement, et malgré son jeune âge, elle est devenue l’icône de la lutte contre la ségrégation du XXI e siècle : celle exercée à l’encontre des jeunes filles. Un fléau qui ne concerne pas seulement les zones gangrénées par les talibans et qui demeure trop souvent passé sous silence. -

Conseil Constitutionnel
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2012 > 2012−655 DC Décision n° 2012−655 DC du 24 octobre 2012 Loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et aurenforcement des obligations de production de logement social Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, le 10 octobre 2012 par MM. Jean−Claude GAUDIN, Jean−Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Jean ARTHUIS, Gérard BAILLY, Philippe BAS, René BEAUMONT, Christophe BÉCHU, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Joël BILLARD, Jean BIZET, Jean−Marie BOCKEL, Pierre BORDIER, Mme Natacha BOUCHART, MM. Joël BOURDIN, Jean BOYER, Mme Marie−Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François−Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Jean−Pierre CANTEGRIT, Vincent CAPO−CANELLAS, Jean−Noël CARDOUX, Jean−Claude CARLE, Mme Caroline CAYEUX, MM. Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Jean−Pierre CHAUVEAU, Marcel−Pierre CLEACH, Christian COINTAT, Gérard CORNU, Raymond COUDERC, Jean−Patrick COURTOIS, Philippe DALLIER, Serge DASSAULT, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Vincent DELAHAYE, Francis DELATTRE, Robert DEL PICCHIA, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Marie−Hélène DES ESGAULX, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Muguette DINI, MM. Éric DOLIGÉ, Philippe DOMINATI, Michel DOUBLET, Daniel DUBOIS, Mme Marie−Annick DUCHÊNE, MM. Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Jean−Léonce DUPONT, Louis DUVERNOIS, Jean−Paul EMORINE, Hubert FALCO, Mmes Jacqueline FARREYROL, Françoise FÉRAT, MM. André FERRAND, Louis−Constant FLEMING, Michel FONTAINE, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, Jean−Paul FOURNIER, Christophe−André FRASSA, Pierre FROGIER, Yann GAILLARD, René GARREC, Mme Joëlle GARRIAUD−MAYLAM, MM.