L'œuvre De Walter Savage Landor
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Literary Influences in the Art of Dante Gabriel Rossetti
Literary influences in the art of Dante Gabriel Rossetti Item Type text; Thesis-Reproduction (electronic) Authors Oswald, Artell Pikka, 1945- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 28/09/2021 18:19:44 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/347796 LITERARY INFLUENCES IN THE ART OF DANTE GABRIEL ROSSETTI by Artell Pikka Oswald A Thesis Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF ART In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF ARTS In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 19 7 2 STATEMENT BY AUTHOR This thesis has been submitted in partial ful fillment of requirements for an advanced degree at The University of Arizona and is deposited in the University Library to be made available to borrowers under rules of the Library. Brief quotations from this thesis are allowable without special permission, provided that accurate acknowledgment of source is made. Requests for permis sion for extended quotation from or reproduction of this manuscript in whole or in part may be granted by the head of the major department or the Dean of the Graduate College when in his judgment the proposed use of the material is in the interests of scholarship. In all other instances, however, permission must be obtained from the author. SIGNED APPROVAL BY THESIS CO-DIRECTORS This thesis has been approved on the date shown below; <r - 3 ~ 7 ROBERT W. -

Nicholas Stanley-Price. Shelley's Grave Re-Visited the Keats-Shelley
Shelley’s grave re-visited Nicholas Stanley-Price Independent scholar, Rome The grave in Rome of Percy Bysshe Shelley soon became a place of pilgrimage for admirers of his poetry, and remains one today. Evidence derived from cemetery records, early visitors’ accounts and depictions of the grave reveals how, during the 19th century, it acquired an aura of sanctity, an aspect of his posthumous fame that has not hitherto received much attention. I. Why were the ashes of Shelley, who drowned in July 1822, not buried in the grave of his little boy William who had died in Rome in June 1819? William’s grave lay in the old Protestant Cemetery adjacent to the pyramid of Caius Cestius, which Shelley himself had called the most beautiful and solemn cemetery that he had ever beheld.1 But in October 1821, the Papal Secretary of State, Cardinal Consalvi, forbade the Protestants to make any more burials there and allocated instead an adjacent plot of land further west.2 Burials started to be made in this New Cemetery on November 8, 1822.3 In letters written to Charles Brown, Joseph Severn in Rome on October 26 declared that he had not yet heard about Shelley’s ashes being dispatched to the city; but by December 7 he reported that they had arrived.4 Reminiscing fifty years later, the Reverend Richard Burgess recorded that he learned about the ashes when he visited the acting consul John Freeborn “a few days” after his arrival in Rome in the latter part of November.5 It therefore seems unlikely that the ashes had reached Rome much before, if at all by, November 8; i.e., they probably arrived after the New Cemetery had started to be used for burials. -

Mary Shelley in Italy: Reading Dante and the Creation of an Anglo-Italian Identity Antonella Braida
Mary Shelley in Italy: Reading Dante and the Creation of an Anglo-Italian Identity Antonella Braida To cite this version: Antonella Braida. Mary Shelley in Italy: Reading Dante and the Creation of an Anglo-Italian Identity. L’analisi linguistica e letteraria, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 2020, 17 (3), pp.107-118. hal-02495230 HAL Id: hal-02495230 https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02495230 Submitted on 1 Mar 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. l’analisi linguistica e letteraria xxvii (2019) 107-118 Mary Shelley in Italy: Reading Dante and the Creation of an Anglo-Italian Identity Antonella Braida Université de Lorraine This article analyses Mary Shelley’s textual and critical approach to Dante. It focuses on her sources in Mme de Staël’s, J.C.L. Simonde de Sismondi’s, August Schlegel’s and Henry Francis Cary’s critical readings of Dante. By analysing Mary Shelley’s use of Dante in Rambles, it will be shown that Mary Shelley became a mediator and introduced contemporary Italian political readings of his work and anticipated the Victorian interest in Dante’s Vita Nuova. -

William Blake
THE WORKS of WILLIAM BLAKE jSptfrolu, tmir dpritical KDITEO WITH LITHOORAPIIS OF THE ILLUSTRATED “ PROPHETIC BOOKS," AND A M8 M0 IH AND INTERPRETATION EDWIN JOHN ELLIS A ttlh n r n f “Miff »ii A rcatliit,** rfr* Asn WILLIAM BUTLER YEATS Author of ** The JVnnilerinfj* nf Ohin,** " The Crwutesi Kathleen," ifr. “ Hnng nin to the te»t Ami I Lh* m&ttor will iv-wnnl, which nmdnp** Would ftumlml from M Jfauttef /.V TUJIKE VOI.S. VOL 1 LONDON BERNARD QUARITCH, 15 PICCADILLY 1893 \ A lt R ig h t* k *M*rv*ifl & 0 WILLIAM LINNELL THIS WORK IS INSCRIBED. PREFACE. The reader must not expect to find in this account of Blake's myth, or this explanation of his symbolic writings, a substitute for Blake's own works. A paraphrase is given of most of the more difficult poems, but no single thread of interpretation can fully guide the explorer through the intricate paths of a symbolism where most of the figures of speech have a two-fold meaning, and some are employed systematically in a three fold, or even a four-fold sense. " Allegory addressed to the intellectual powers while it is altogether hidden from the corporeal understanding is my definition," writes Blake, "of the most sublime poetry." Letter to Butts from Felpham, July 6th, 1803. Such allegory fills the "Prophetic Books," yet it is not so hiddon from the corporeal understanding as its author supposed. An explanation, continuous throughout, if not complete for side issues, may be obtained from the enigma itself by the aid of ordinary industry. -

L'analisi Linguistica E Letteraria
ISSN 1122 - 1917 L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 3 ANNO XXVII 2019 EDUCATT - UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA FACOLTÀ DI SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 3 ANNO XXVII 2019 PUBBLICAZIONE QUADRIMESTRALE L’ANALISI LINGUISTICA E LETTERARIA Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature straniere Università Cattolica del Sacro Cuore Anno XXVII - 3/2019 ISSN 1122-1917 ISBN 978-88-9335-566-7 Comitato Editoriale Giovanni Gobber, Direttore Maria Luisa Maggioni, Direttore Lucia Mor, Direttore Marisa Verna, Direttore Sarah Bigi Giulia Grata Chiara Piccinini Maria Paola Tenchini Esperti internazionali Thomas Austenfeld, Université de Fribourg Michael D. Aeschliman, Boston University, MA, USA Elena Agazzi, Università degli Studi di Bergamo Stefano Arduini, Università degli Studi di Urbino György Domokos, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hans Drumbl, Libera Università di Bolzano Jacques Dürrenmatt, Sorbonne Université Françoise Gaillard, Université de Paris VII Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki Loretta Innocenti, Università Ca’ Foscari di Venezia Vincenzo Orioles, Università degli Studi di Udine Gilles Philippe. Université de Lausanne Peter Platt, Barnard College, Columbia University, NY, USA Andrea Rocci, Università della Svizzera italiana Eddo Rigotti, Università degli Svizzera italiana Nikola Rossbach, Universität Kassel Michael Rossington, Newcastle University, UK Giuseppe Sertoli, Università degli Studi di Genova William Sharpe, Barnard College, Columbia University, NY, USA Thomas Travisano, Hartwick College, NY, USA Anna Torti, Università degli Studi di Perugia Gisèle Vanhese, Università della Calabria I contributi di questa pubblicazione sono stati sottoposti alla valutazione di due Peer Reviewers in forma rigorosamente anonima © 2020 EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio universitario dell’Università Cattolica Largo Gemelli 1, 20123 Milano | tel. -

Drawing After the Antique at the British Museum
Drawing after the Antique at the British Museum Supplementary Materials: Biographies of Students Admitted to Draw in the Townley Gallery, British Museum, with Facsimiles of the Gallery Register Pages (1809 – 1817) Essay by Martin Myrone Contents Facsimile TranscriptionBOE#JPHSBQIJFT • Page 1 • Page 2 • Page 3 • Page 4 • Page 5 • Page 6 • Page 7 Sources and Abbreviations • Manuscript Sources • Abbreviations for Online Resources • Further Online Resources • Abbreviations for Printed Sources • Further Printed Sources 1 of 120 Jan. 14 Mr Ralph Irvine, no.8 Gt. Howland St. [recommended by] Mr Planta/ 6 months This is probably intended for the Scottish landscape painter Hugh Irvine (1782– 1829), who exhibited from 8 Howland Street in 1809. “This young gentleman, at an early period of life, manifested a strong inclination for the study of art, and for several years his application has been unremitting. For some time he was a pupil of Mr Reinagle of London, whose merit as an artist is well known; and he has long been a close student in landscape afer Nature” (Thom, History of Aberdeen, 1: 198). He was the third son of Alexander Irvine, 18th laird of Drum, Aberdeenshire (1754–1844), and his wife Jean (Forbes; d.1786). His uncle was the artist and art dealer James Irvine (1757–1831). Alexander Irvine had four sons and a daughter; Alexander (b.1777), Charles (b.1780), Hugh, Francis, and daughter Christian. There is no record of a Ralph Irvine among the Irvines of Drum (Wimberley, Short Account), nor was there a Royal Academy student or exhibiting or listed artist of this name, so this was surely a clerical error or misunderstanding. -
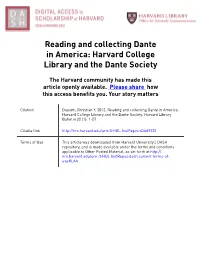
HLB 22-1 BOOK Dupont Penka.Indb
Reading and collecting Dante in America: Harvard College Library and the Dante Society The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Dupont, Christian Y. 2012. Reading and collecting Dante in America: Harvard College Library and the Dante Society. Harvard Library Bulletin 22 (1): 1-57. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:42669225 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Reading and Collecting Dante in America: Harvard College Library and the Dante Society Christian Y. Dupont t took the better part of a morning to move it, but no more.1 By noon, on Friday, October 18, 1912, building supervisor Frank Carney could Irecord in his pocket diary that the last of the 2,907 volumes comprising the Dante Collection had been crated, passed through a chute down to a waiting truck, and carried of to temporary storage in Randall Hall.2 In a few short weeks, the remaining bookshelves would be emptied and the hollowed carcass of Gore Hall torn down so that a new library of titanic dimensions could be erected in its place, the Harry Elkins Widener Memorial Library. At the time, the Dante Collection at Harvard was neither the only nor the largest such collection in America. Te distinction for having the most extensive collection had belonged to Cornell for nearly two decades.3 Meanwhile, the University of Notre Dame had quietly begun assembling a collection on the poet that would soon grow to several thousand volumes,4 and other institutions, such as the University of Pennsylvania, 1 Much of the research for this essay was conducted while I was a Joan Nordell Visiting Fellow at Houghton Library in 2002–2003. -

DANTE FIFTY BOOKS DANTE FIFTY BOOKS a Dialogue Between a Dook Collector and a Bookseller
DANTE FIFTY BOOKS DANTE FIFTY BOOKS A dialogue between a Dook Collector and a Bookseller FR: May I call you Livio ? LA: Of course, after all we’ve been friends for a long time now. FR: Anyway, once again I’ve persuaded you to sell! And this time nothing less than your Dante collection! LA: Hang on, don’ t rush things - you persuaded me to show some nice books to a few friends in the New World… FR: What has collecting Dante meant for you? LA: It’ s been one – the greatest – of the collections I’ve formed since I was six. FR: The exhibition of your collection which took place in Rome in 2011, celebrating 150 years since Italy’s reunification, do you see that as a kind of culmination? LA: Certainly, it was a very comprehensive presentation. Let’s just say it was like the forty- kilometre point in a marathon – not the conclusion (such a thing doesn’t exist) but you’ve gone a good part of the way… FR: But since then we’ve gone even further… And this exhibition in New York? LA: New York will reveal the progress of a life-long disease of collecting … and, who knows, it might also be the beginnings of something else, the seed of a great tree – a giant sequoia? – in the future. FR: What do you think of the catalogue? Do you find it a bit excessive? LA: Well, after all, it’s not just another catalogue it’s ‘the’ catalogue and a very beautiful one at that. -

Dante Alighieri
iir»^^:«y».>i.».. ....««»»««»»»««*«».«»»««»«»»»»»»»»«»«««.......»»» »...........»^, ThE: LIFE OF DmTE I •H or JUL uiiiuii.im... ....... ...,.. -/^ THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES To CA\yylS>ty}K^L^ f^(V2, DANTE ALIGHIERI DANTE ALIGHIERI BY PAGET TOYNBEE WITH TWELVE ILLUSTRATIONS METHUEN & CO. 36 ESSEX STREET W.C LONDON 1902 Second Edition, Revised and Enlarged "the grete poete of Ytaille That highte Dant." Chaucer, Monk''s Tale. p^"^ PREFACE little book lays no claim to originality, THISand makes no pretence to learning or research. It is addressed rather to the so-called general reader than to the serious Dante student. The narrative is taken largely from the pages of Villani, Boccaccio, and from other similar sources. The reader will find fiction (at any rate from the critic's point of view) as well as fact in these pages, but he will, I hope, be at no loss to distinguish between the two. The legends and traditions which hang around the name of a great personality are a not unimportant element in his biography, and may sometimes serve to place him as well as, if not better than, the more sober estimates of the serious historian. I have not, therefore, thought it outside the scope of this sketch of Dante's life to include some of the anecdotes which at an early date began to be associated with his name, though certain of them demonstrably belong to a far eai-lier period. Again, when a thing has been well said by a previous writer, I have been content to let him 2052138 6 PREFACE less well speak, instead of saying the same thing in my own words. -
Britain's Tribute to Dante in Literature and Art
yCrNRLF 6 ^ OME flflfl ''' ill, "^ '/ '-U." ' ^ 'i^i'$''^i0':;!'-' ^;?;!;: "'v^^ i'W ?•-'" '1 WIS*. THE BRITISH ACADEMY {Dante Commemoration 1921) Britain's Tribute to Dante in Literature and Art A Chronological Record of 540 Years (c. 1380—1920) By Paget Toynbee, D.Litt. Fellow of the Academy London Published for the British Academy By Humphrey Milford, Oxford University Press Amen Corner, E.G. J ' He who labours for Dante, labours to serve : Italy, Christianity, the World.' {W. E. Gladstone to G. B. Giuliani.) ALL' ITALIA NEL SESTO CENTENARIO DELLA MORTE DELL' ALTISSIMO POETA DANTE ALIGHIERI ' UI CUI LA FAMA ANCOR NEL MOXDO DURA, ' E DURERA QUANTO IL MOTO LON'JANA TRIBUTO DI RICONOSCENZA ^ P P^ f^ Q TABLE OF CONTENTS PAGE Prefatory Note V Leading Dates ix Chronological Record : Cent. XIV 1 Cent. XV . 2 Cent. XVI 2 Cent. XVII 10 Cent. XVIII 22 Cent. XIX " . 39 Cent. XX . 161 Addenda .... 190 Index : 1. Literature (Authors, &c.) 197 2. Art (Artists, &c.) 210 :; PREFATORY NOTE This Record is the outcome of notes taken during the last five-and-twenty years, primarily for the purposes of several projected works, of which the following have been published Chronological List of English Translations from Dante, from Chaucer to the Present Day (Boston, U.S.A., 1906); Dante in English Literature from Chaucer to Cary (2 vols., London, 1909) and Dante in English Art : A Chronological Record of Representa- tions by English Artists of Subjects from the Works of Dante, or connected with Dante (Boston, U.S.A., 1920) ; besides sundry articles in various English and foreign periodicals. -

Charles Armitage Brown, John Keats and Plymouth1 University of St
Charles Armitage Brown, John Keats and Plymouth1 NICHOLAS ROE University of St Andrews In the mean time I will tell you about our Plymouth Institution. We have many literary and scientific men here, three rather high in fame, and they are members. During the six winter months we have a lecture and an after discussion there every Thursday, and during the summer tea and coffee once a month to keep us together and settle various points. The building is very handsome, of Grecian architecture. Ill as I was, some how I ventured to get up with a speech in my mouth before a hundred strangers, — (I that never had spoken ten words before ten such!) — and, to my surprise, made an impression. I am now hand in hand with them. In March, just as their season was ending, they were disappointed of a lecture; when I, bettering in health, read them one on “Shakespear’s Sonnets”. I am down for one next November on “The intellectual history of Florence”, and, if I wanted, for another on “The influence of Italian on English poetry”. This Institution suits me to a hair. I have lately been made their librarian. Every summer, (and this is a third) the Institution is opened as a gallery of paintings and drawings by resident and other artists, — and I am on the Committee, — nay, on the hanging one. I shall send my Hogarths, my two portraits of Keats from you, and the medallion in plaister of him by Girometti, which Woodhouse gave me; and also Kirkup’s drawings of yourself and Carlino, — […] you will be exhibited at Plymouth!2 So Charles Armitage Brown wrote to Joseph Severn, a resident at Rome since John Keats’s death there in 1821. -

Library of L^Arbard Bniìjmitv- Blbliographical
Library of l^arbarD Bniìjmitv- BlBLIOGRAPHICAL CONTRIBUTIONS. EDITED BY JUSTIN WINSOR, LIBRARIAN. :N"O. 34. THE DANTE COLLECTIONS HARVARD COLLEGE AND BOSTON PUBLIC LIBRARIES. Bv WILLIAM COOLIDGE LANE, Assistant Librarian. For a large part of its Dante Collection Harvard' College Library is indebted to Professor CHARLES ELIOT NORTON and to the DA .TE SOCIETY. CAMBRIDGE, MASS.: Esaueti bg f^t ILiiijarg of l^arbatì) ^Ent'òergittgf. 1S90. Already issued or in preparation: VCL. I. 1. EDWARD S. HOLDEN. Index-Catalogue of Books and 11. SAMUEL H. SCUDDER. The Entomological Libraries Memoirs on the Transita of Mercury. of the United States. 2. JusTiN WiNSOR. Shaliespeare's Poems : a Bibliography 12. FIRST LIST OF THE PUBLICATIONS of Harvard Uni of the Earlier Editions. versity and its OfEcers. 1870-18S0. 3. CHARLES ELIOT NORTON. Principal books relating to 13. SAMUEL H. SCUDDER. A Bibliography of Fossil the Life and Works of Michelangelo, with Notes. Insects. 4. JusTiN WINSOR. Pietis et Gratulatio. An Inquiry 14. WILLIAM H. TILLINGHAST. Notes on the Historical into the authorship of the several pieces. Hydrography of the Handkerchief Shoal in the J. LIST OF APPARATUS in different Laboratories of the Bahamas. United States, available for Scientific Researches 15. J. D. WHITNEY. List of American Authors in Geology involving Accurate Measurements. and Palasontology. 6. THE COLLECTION OF BOOKS AND AUTOGRAPHS, be. 16. RICHARD BLISS. Classified Index to the Maps in queathed to Harvard College Library, by the Jtonor. Petermann's Geographische Mittheilungen. 1855- able Charles Sumner. 1881. 7. WILLIAM C. LANE. The Dante Collections in the 17. RICHARD BLISS. Classified Index to the Maps in the Harvard College and Boston Public Libraries.