Notes Du Service Géologique Du Maroc
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Morocco): Clues from Trace Elements and Sr–Nd–Pb–Hf Isotopes
Lithos 205 (2014) 247–265 Contents lists available at ScienceDirect Lithos journal homepage: www.elsevier.com/locate/lithos Lithospheric origin for Neogene–Quaternary Middle Atlas lavas (Morocco): Clues from trace elements and Sr–Nd–Pb–Hf isotopes Delphine Bosch a,⁎, René C. Maury b,M'hammedElAzzouzib,c,ClaireBollingerd, Hervé Bellon b, Patrick Verdoux e a UMR-UM2-CNRS 5243 Géosciences Montpellier, Université de Montpellier II, place E. Bataillon, c.c. 060, 34095 Montpellier, France b UMR-CNRS 6538 Domaines océaniques, Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), IUEM, Université de Brest, Université Européenne de Bretagne, place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France c Faculté des Sciences, Université Mohammed-V, av. Ibn Batouta, BP 1014, 10100 Rabat, Maroc d UMS-CNRS 3113 Pôle de spectrométrie océan, IUEM, Université de Brest, Université Européenne de Bretagne, place Nicolas Copernic, 29280 Plouzané, France e Laboratoire de Géochimie Isotopique environnementale, Université de Nîmes/Site GIS, UMR-CNRS 7330, rue Georges Besse, 30035 Nîmes Cedex 1, France article info abstract Article history: This study presents new geochemical data on 26 mafic lavas from the Middle Atlas and Central Morocco volcanic Received 17 April 2014 provinces, including Miocene nephelinites and Pliocene–Quaternary (3.9–0.6 Ma) nephelinites, basanites, alkali Accepted 11 July 2014 and subalkaline basalts. Most of them represent near-primary magmas, although some alkali basalts were derived Available online 21 July 2014 from the minor fractionation of olivine and diopside phenocrysts. These evolved samples and the subalkaline basalt display higher 207Pb/204Pb and Zr/Nb ratios and lower εNd consistent with their contamination by lower crustal Keywords: Intraplate alkali basalts granulites during an open fractionation process. -

Sedimentary Provenance of the Taza-Guercif Basin, South Rifean Corridor, Morocco: Implications for Basin Emergence GEOSPHERE; V
Research Paper GEOSPHERE Sedimentary provenance of the Taza-Guercif Basin, South Rifean Corridor, Morocco: Implications for basin emergence GEOSPHERE; v. 12, no. 1 Jonathan R. Pratt1, David L. Barbeau, Jr.1, Tyler M. Izykowski1, John I. Garver2, and Anas Emran3 1Department of Earth and Ocean Sciences, University of South Carolina, 710 Sumter Street, Columbia, South Carolina 29208, USA doi:10.1130/GES01192.1 2Department of Geology, Olin Building, Union College, 807 Union Street, Schenectady, New York 12308, USA 3Geotel, URAC 46, Mohammed V University, Scientific Institute, Rabat, Morocco 6 figures; 2 supplemental files CORRESPONDENCE: [email protected] ABSTRACT et al., 2013; Cornée et al., 2014). The combined effects of the MSC make it one of the most important oceanic events in the past 20 m.y. (Krijgsman CITATION: Pratt, J.R., Barbeau, D.L., Jr., Izykowski, The Taza-Guercif Basin is on the southern margin of the former Rifean et al., 1999a). T.M., Garver, J.I., and Emran, A., 2016, Sedimentary provenance of the Taza-Guercif Basin, South Rifean Corridor, one of the major Miocene marine connections between the Atlantic It is widely accepted that the MSC was initiated through the late Miocene Corridor, Morocco: Implications for basin emergence: Ocean and Mediterranean prior to the onset of the Messinian Salinity Crisis. severing of the Betic and Rifean marine corridors (e.g., Krijgsman et al., 1999a; Geosphere, v. 12, no. 1, p. 221–236, doi:10 .1130 As the first basin in the corridor to emerge during corridor closure, the basin Krijgsman and Langereis, 2000; Duggen et al., 2004, 2005; Braga et al., 2006; /GES01192.1. -

Insights on the Crustal Evolution of the West African (Raton from Hf Isotopes in Detrital Zircons from the Anti-Atlas Belt
Insights on the crustal evolution of the West African (raton from Hf isotopes in detrital zircons from the Anti-Atlas belt a b c d b ]acobo Abati ,., Abdel Mohsine Aghzer , 1 , Axel Gerdes , ,2, Nasser Ennih • Departamento de Petrologfa y Geoquimica and Instituto de Geologia Econ6mica, Universidad Comp!utense/Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 28040 Madrid, Spain b Departament Ge% gie. Faculte des Sciences, Universite Chouaib Doukkali, EIJadida. Morocco c InstitutftirGeowissenschaften. Minera/ogie, Goethe-UniversityFrankfurt (GUF),Altenhoferallee 1. D-60438 Frankfurt amMain, Gennany d Department of Earth Sciences, SteIIenbosch University.Private BagXl. Matieland 7602, South Africa ABSTRACT The Lu-Hf isotopic composition of detrital zircons has been used to investigate the crustal evolution of the northern part of the West African (raton (WAC). The zircons were separated from six samples of siliciclastic sedimentary rocks from the main Neoproterozic stratigraphic units of the Anti-Atlas belt, from the SiIWa and Zenaga inliers. The data suggest that the north part of the WAC formed during three cycles of juvenile crust formation with variable amount of reworking of older crust. The younger group of zircons, with a main population clustering around 610 Ma, has a predominant juvenile character and Keyworili: evidences of moderate mixing with Paleoproterozoic and Neoarchean crust, which supports that most Anti-Atlas belt igneous and metamorphic rocks where zircons originally crystallized were formed in an ensialic mag Morocco Hfisotopes matic arc environment. The group of zircons in the age range 1.79-2.3 Ca corresponds to the major crust Detrital zircon forming event in the WAC: the Eburnian orogeny. -

Mesozoic and Cenozoic Thermal History of the Western Reguibat Shield West African Craton)
This is a repository copy of Mesozoic and Cenozoic thermal history of the Western Reguibat Shield West African Craton). White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/124296/ Version: Accepted Version Article: Gouiza, M orcid.org/0000-0001-5438-2698, Bertotti, G and Andriessen, PAM (2018) Mesozoic and Cenozoic thermal history of the Western Reguibat Shield West African Craton). Terra Nova, 30 (2). pp. 135-145. ISSN 0954-4879 https://doi.org/10.1111/ter.12318 © 2017 John Wiley & Sons Ltd. This is the peer reviewed version of the following article: Gouiza M, Bertotti G, Andriessen PAM. Mesozoic and Cenozoic thermal history of the Western Reguibat Shield (West African Craton). Terra Nova. 2018;30:135–145. https://doi.org/10.1111/ter.12318, which has been published in final form at https://doi.org/10.1111/ter.12318. This article may be used for non-commercial purposes in accordance with Wiley Terms and Conditions for Self-Archiving. Uploaded in accordance with the publisher's self-archiving policy. Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. -

Polyphase Tectonic Evolution of Fore-Arc Basin Related to STEP Fault As Revealed by Seismic Reflection Data from the Alboran Sea (W-Mediterranean) E
Polyphase Tectonic Evolution of Fore-Arc Basin Related to STEP Fault as Revealed by Seismic Reflection Data From the Alboran Sea (W-Mediterranean) E. d’Acremont, M. Lafosse, A. Rabaute, G. Teurquety, D. Do Couto, G. Ercilla, C. Juan, B. Mercier Lépinay, S. Lafuerza, J. Galindo-zaldivar, et al. To cite this version: E. d’Acremont, M. Lafosse, A. Rabaute, G. Teurquety, D. Do Couto, et al.. Polyphase Tectonic Evolution of Fore-Arc Basin Related to STEP Fault as Revealed by Seismic Reflection Data From the Alboran Sea (W-Mediterranean). Tectonics, American Geophysical Union (AGU), 2020, 39 (3), 10.1029/2019TC005885. hal-03004274 HAL Id: hal-03004274 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03004274 Submitted on 15 Apr 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. RESEARCH ARTICLE Polyphase Tectonic Evolution of Fore‐Arc Basin Related 10.1029/2019TC005885 to STEP Fault as Revealed by Seismic Reflection Data Key Points: ‐ • The reactivation of the Subduction From the Alboran Sea (W Mediterranean) Tear Edge Propagator fault zone on E. d'Acremont1 , M. Lafosse1 , A. Rabaute1 , G. Teurquety1,2, D. Do Couto1, G. Ercilla3, the southern edge of the Alboran 3 4 1 5,6 3 Domain forms the South Alboran C. -

Ordovician Stratigraphy and Benthic Community Replacements in the Eastern Anti-Atlas, Morocco J
Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco J. Javier Alvaro, Mohammed Benharref, Jacques Destombes, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Aaron Hunter, Bertrand Lefebvre, Peter van Roy, Samuel Zamora To cite this version: J. Javier Alvaro, Mohammed Benharref, Jacques Destombes, Juan Carlos Gutiérrez-Marco, Aaron Hunter, et al.. Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti- Atlas, Morocco. The Great Ordovician Biodiversification Event: Insights from the Tafilalt Biota, Morocco, 485, The Geological Society of London, pp.SP485.20, In press, Geological Society, London, Special Publication, 10.1144/SP485.20. hal-02405970 HAL Id: hal-02405970 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02405970 Submitted on 13 Nov 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. The Geological Society Special Publications Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco --Manuscript Draft-- Manuscript Number: GSLSpecPub2019-17R1 Article Type: Research article Full Title: Ordovician stratigraphy and benthic community replacements in the eastern Anti-Atlas, Morocco Short Title: Ordovician stratigraphy of the Anti-Atlas Corresponding Author: Javier Alvaro Instituto de Geociencias SPAIN Corresponding Author E-Mail: [email protected] Other Authors: MOHAMMED BENHARREF JACQUES DESTOMBES JUAN CARLOS GUTIÉRREZ-MARCO AARON W. -

The Fezouata Shale (Lower Ordovician, Anti-Atlas, Morocco): a Historical Review
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 460 (2016) 7–23 Contents lists available at ScienceDirect Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology journal homepage: www.elsevier.com/locate/palaeo The Fezouata Shale (Lower Ordovician, Anti-Atlas, Morocco): A historical review Bertrand Lefebvre a,⁎, Khadija El Hariri b, Rudy Lerosey-Aubril c,ThomasServaisd,PeterVanRoye,f a UMR CNRS 5276 LGLTPE, Université Lyon 1, bâtiment Géode, 2 rue Raphaël Dubois, 69622 Villeurbanne cedex, France b Département des Sciences de la Terre, Faculté des Sciences et Techniques-Guéliz, Université Cadi Ayyad, avenue Abdelkrim el Khattabi, BP 549, 40000 Marrakesh, Morocco c Division of Earth Sciences, School of Environmental and Rural Sciences, University of New England, Armidale, NSW 2351, Australia d CNRS, Université de Lille - Sciences et Technologies, UMR 8198 Evo-Eco-Paleo, F-59655 Villeneuve d'Ascq, France e Department of Geology and Geophysics, Yale University, P.O. Box 208109, New Haven, CT 06520, USA f Department of Geology and Soil Science, Ghent University, Krijgslaan 281/S8, B-9000 Ghent, Belgium article info abstract Article history: Exceptionally preserved fossils yield crucial information about the evolution of Life on Earth. The Fezouata Biota Received 30 September 2015 from the Lower Ordovician of Morocco is a Konservat-Lagerstätte of major importance, and it is today considered Accepted 29 October 2015 as an ‘Ordovician Burgess Shale.’ This biota was discovered only some 15 years ago, but geological studies of the Available online 10 November 2015 area date back to the beginning of the 20th century. Pioneering geological investigations lead to the discovery of Ordovician strata in the Anti-Atlas (1929) and ultimately resulted in their formal subdivision into four main strat- Keywords: igraphic units (1942). -

Introduction
Downloaded from http://sp.lyellcollection.org/ by guest on October 1, 2021 Introduction DUNCAN S. MACGREGOR BP Exploration Operating Co. Ltd, Kuningan Plaza, S. Tower, P.O. Box 2749, Jakarta 12940, Indonesia This Special Publication of the Geological 'booked' in Algeria in 1994 than in any other Society documents a series of papers collected country in the world. on the petroleum geology of Morocco, Algeria, The importance of the region to the petroleum Tunisia, Libya and the western part of Egypt. industry is, of course, not reflected in the volume This region contains some 4% of the world's of geological literature available on the area, par- remaining oil and gas reserve (Table 1), placing ticularly that in English. This volume represents the area above more traditional producing the first such attempt at a compilation of the pet- regions, including Europe, the USA and SE roleum geology of this region. The main objec- Asia, in its importance as a future petroleum pro- tives of this book are thus to increase the level ducer. In addition to these considerable proven of documentation towards that appropriate for reserves, North Africa is now one of the world's such major petroleum provinces and to facilitate most active exploration areas. This was reflected, the application of analogues between North Afri- for instance, in more new oil reserves being can countries and beyond. Table 1. North African petroleum reserves and their global significance Rank Country Reserves (109 BBO) Oil reserves (remaining) 1 Saudi Arabia 261.2 2 Iraq 100.0 3 United Arab Emirates 98.1 4 Kuwait 96.5 5 Iran 88.2 6 Venezuela 64.5 7 Mexico 49.8 8 Russia* 49.0 9 USA* 29.6 10 Libya 29.5 (2.9% of world total) 11 China 24.0 12 Nigeria 20.8 13 Algeria* 9.2 (0.9% of world total) - Egypt (inc. -

Vertebrate Assemblages from the Early Late Cretaceous of Southeastern Morocco: an Overview
Journal of African Earth Sciences 57 (2010) 391–412 Contents lists available at ScienceDirect Journal of African Earth Sciences journal homepage: www.elsevier.com/locate/jafrearsci Geological Society of Africa Presidential Review No. 16 Vertebrate assemblages from the early Late Cretaceous of southeastern Morocco: An overview L. Cavin a,*, H. Tong b, L. Boudad c, C. Meister a, A. Piuz a, J. Tabouelle d, M. Aarab c, R. Amiot e, E. Buffetaut b, G. Dyke f, S. Hua g, J. Le Loeuff f a Dpt. de Géologie et Paléontologie, Muséum de Genève, CP 6434, 1211 Genève 6, Switzerland b CNRS, UMR 8538, Laboratoire de Géologie de l’Ecole Normale Supérieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05, France c Faculté des Sciences et Techniques, BP, 509, Boutalamine, Errachidia, Morocco d Musée Municipal, 76500 Elbeuf-sur-Seine, France e IVPP, Chinese Academy of Sciences, 142 XiZhiMenWai DaJie, Beijing 100044, China f School of Biology and Environmental Science, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland g Musée des Dinosaures, 11260 Espéraza, France article info abstract Article history: Fossils of vertebrates have been found in great abundance in the continental and marine early Late Cre- Received 16 June 2009 taceous sediments of Southeastern Morocco for more than 50 years. About 80 vertebrate taxa have so far Received in revised form 9 December 2009 been recorded from this region, many of which were recognised and diagnosed for the first time based on Accepted 11 December 2009 specimens recovered from these sediments. In this paper, we use published data together with new field Available online 23 December 2009 data to present an updated overview of Moroccan early Late Cretaceous vertebrate assemblages. -
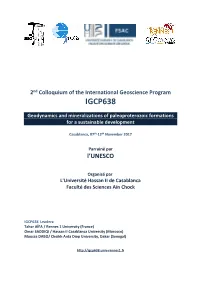
2Nd Colloquium of the International Geoscience Program IGCP638
2nd Colloquium of the International Geoscience Program IGCP638 Geodynamics and mineralizations of paleoproterozoic formations for a sustainable development Casablanca, 07th-12th November 2017 Parrainé par l’UNESCO Organisé par L'Université Hassan II de Casablanca Faculté des Sciences Aïn Chock IGCP638 Leaders: Tahar AÏFA / Rennes 1 University (France) Omar SADDIQI / Hassan II Casablanca University (Morocco) Moussa DABO/ Cheikh Anta Diop University, Dakar (Senegal) http://igcp638.univ-rennes1.fr ORGANIZING COMMITTEE Omar Saddiqi (FSAC UH2C Casablanca): Chairman Lahssen Baidder (FSAC UH2C Casablanca) EL Hassan El Arabi (FSAC UH2C Casablanca) Aboubaker Farah (FSAC UH2C Casablanca) Faouziya Haissen ( FSBM UH2C Casablanca) Atika Hilali (FSAC UH2C Casablanca) Abdelhadi Kaoukaya (FSAC UH2C Casablanca) Mehdi Mansour (FSAC UH2C Casablanca) Mostafa Oukassou (FSBM UH2C Casablanca) Hassan Rhinane (FSAC UH2C Casablanca) SCIENTIFIC COMMITTEE Tahar Aïfa (Univ. Rennes 1, France) Alain Kouamelan (Univ. Abidjan, Ivory Coast) Mohammed Aissa (UMS Meknès, Morocco) Théophile Lasm (Univ. Abidjan, Ivory Coast) Laurent Ameglio (GyroLAG Potchefstroom, South Africa/ Jean-Pierre Lefort (Univ. Rennes 1, France) Perth, Australia) Addi Azza (Conseiller du Ministre de l’Energie, des Mines Ulf Linnemann (Unv. Dresden, Germany) et du Développement Durable, Rabat, Morocco) David Baratoux (IRD/UPS/IFAN, France) Khalidou Lo (Univ. Nouakchott, Mauritania) Lahssen Baidder (UH2C Casablanca, Morocco) Martin Lompo (Univ. Ouagadougou, Burkina Faso) Lenka Baratoux (IRD/IFAN, France) Lhou Maacha (Managem Casablanca, Morocco) Jocelyn Barbarand (UPS Orsay, France) Younes Maamar (Managem Casablanca, Morocco) Fernando Bea (Univ. of Granada, Spain) Henrique Masquelin (Univ. Montevideo, Uruguay) Mouloud Benbrahim (Univ. of Oran, Algeria) Sharad Master (Univ. Johannesburg, South Africa) Mohammed Bouabdellah (UMP Oujda, Morocco) Nacer Merabet (CRAAG Algiers, Algeria) Jean-Louis Boudinier (Univ. -

The Moroccan Massive Sulphide Deposits: Evidence for a Polyphase Mineralization
minerals Article The Moroccan Massive Sulphide Deposits: Evidence for a Polyphase Mineralization Abderrahim Essaifi 1,* , Kathryn Goodenough 2, Fernando Tornos 3 , Abdelhak Outigua 4, Abdelmalek Ouadjou 4 and Lhou Maacha 4 1 Geology Department, Cadi Ayyad University, BP. 2390, Marrakech 40000, Morocco 2 British Geological Survey, The Lyell Centre Research Avenue South, Edinburgh EH14 4AP, UK; [email protected] 3 Instituto de Geociencias (IGEO, CSIC-UCM), Calle Dr Severo Ochoa, 7, 28040 Madrid, Spain; [email protected] 4 Managem Group, BP. 5199, Casablanca 20100, Morocco; [email protected] (A.O.); [email protected] (A.O.); [email protected] (L.M.) * Correspondence: essaifi@uca.ac.ma; Tel.: +212-524-443-449 Received: 28 January 2019; Accepted: 3 March 2019; Published: 6 March 2019 Abstract: This work provides an overview of the geological, geochemical, and metallogenic data available up to date on the Moroccan massive sulphide deposits, including some new results, and then discusses the evidences for the epigenetic and syngenetic hypotheses. All of the ore deposits are located within a crustal block located at the intersection between two major shear zones and are characterized by a sustained and long-lived magmatic activity. The ore deposits are located within second-order shear zones, which played an important role in controlling the geometry of the mineralization. The mineralization lacks the unequivocal textural and structural features that are indicative of a sedimentary or diagenetic origin, and a syntectonic to late-tectonic pyrite-rich assemblage is superimposed on an earlier, pretectonic to syntectonic pyrrhotite-rich mineralization. Each deposit has a distinctive pyrrhotite sulfur isotopic signature, while the sulfur isotopic signature of pyrite is similar in all deposits. -

Abstracts Book Pour CD
2 ORAL SESSIONS 4 GS 33: Geochemistry: new understanding provides Geochemical characterization of Upper Cretaceous source new opportunities rocks in Morocco Chair: N. Cameron, A. Morabet Chakor Alami ONHYM, Rabat, Morocco Hydrocarbon generation modelling in the Atlantic margin basins of Morocco : the effect of water pressure The Upper Cretaceous source rocks in Morocco range in age from Cenomanian to Maastrichtian and they are Andy Carr encountered in most Moroccan sedimentary basins. They Advanced Geochemical Systems Ltd., Loughborough, outcrop in the Rif / Pre-Rif area at the North, in the middle Atlas Leicestershire, UK in the centre and in Tarfaya Basin in the South. Where they Hydrocarbon exploration has largely been controlled by the outcrop they occur as oil shale deposits. They have high TOC necessity to ensure the presence of a mature source rock values, high petroleum potential (S2) and are generally capable of generating either oil or gas. Current geochemical immature. models claim that hydrocarbon generation is controlled Upper Cretaceous source rocks were also encountered in primarily by temperature, and basins with deeply buried source exploration wells in the Tadla Basin in the central region, the rocks are therefore most likely to be gas-prone. However the Boujdour area in the south of Morocco and in the Moroccan evidence from deepwater basins appears to contradict this Atlantic offshore. All the geochemical data (TOC, Rock-Eval, understanding in that deepwater exploration in the Gulf of GC, GC-MS and isotopes) from ONHYM’s data base will be Mexico shows that oils appear to have been generated presented, together with oil-oil correlations and Oil-Source relatively recently even though the Upper Jurassic source rocks Rock correlations.