Le Portrait D'antoine De Sartine
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Year of Le Nôtre
ch VER ât Sail ecouverture conférence de presse version déf.indd 1 aules 18/01/2012 13:01:48 3 CONTENTS Press conference - 26 january 2012 Foreword 4 Versailles on the move 7 The exhibitions in versailles 8 Versailles to arras 12 Events 13 Shows 15 Versailles rediscovered 19 Refurnishing versailles 21 What the rooms were used for 26 Versailles and its research centre 28 Versailles for all 31 2011, Better knowledge of the visitors to versailles 32 A better welcome, more information 34 Winning the loyalty of visitors 40 Versailles under construction 42 The development plan 43 Safeguarding and developing our heritage 48 More on versailles 60 Budget 61 Developing and enhancing the brand 63 Sponsors of versailles 64 Versailles in figures 65 Appendices 67 Background of the palace of versailles 68 Versailles in brief 70 Sponsors of the palace of versailles 72 List of the acquisitions 74 Advice for visitors 78 Contacts 80 4 Foreword This is the first time since I was appointed the effects of the work programme of the first phase President of the Public Establishment of the Palace, of the “Grand Versailles” development plan will be Museum and National Estate of Versailles that I considerable. But the creation of this gallery which have had the pleasure of meeting the press. will present the transformations of the estate since Flanked by the team that marks the continuity Louis XIII built his hunting lodge here marks our and the solidity of this institution, I will review the determination to provide better reception facilities remarkable results of 2011 and, above all, the major for our constantly growing numbers of visitors by projects of the year ahead of us. -

L'hôtel De CASTRIES
L’HÔTEL de CASTRIES 72, rue de Varenne, Paris 7e Monographie historique SOMMAIRE Autour de l’hôtel de Castries 3 Le faubourg Saint-Germain 4 La rue de Varenne 8 Histoire d’une architecture et d’une famille 10 L’intérieur de l’hôtel de Castries 25 Liste des ministres 37 AUTOUR DE L’HÔTEL DE CASTRIES À l’ombre des tours de Saint-Sulpice et du dôme des Invalides, le faubourg Saint-Germain est marqué par l’histoire. Au Moyen Âge, la ri- che abbaye de Saint-Germain-des-Prés dicte sa loi tandis que les étudiants se battent au Pré-aux-Clers. Pendant les guerres de religion, le premier synode national des Protestants se tient rue des Marais. Mais à la fin de la Renaissance, le faubourg Saint-Germain n’est encore que « l’égout et la sentine du royaume tout entier. Impies, libertins, athées, tout ce qu’il y a de plus mauvais semble avoir conspiré à y établir son domicile » (Théophile Lavallée, Histoire de Paris, 1853). 3 Il faut attendre les deux épouses d’Henri IV, Marguerite de Valois et Marie de Médicis, pour assister à la construction des premiers palais. Quant à celui des Tuileries, il va nécessiter un bac sur la Seine pour le charroi des matériaux. Une longue voie qui y mène en prend le nom et devient en 1722 l’artère vitale du quartier. Mais l’austère faubourg précède le noble faubourg, les monastères, les résidences patriciennes. Dans cet endroit dont la salubrité tranche sur le reste de la capitale, la Contre-Réforme place d’innombrables couvents tout au long du règne de Louis XIII. -

Chasse, Souvenirs Historiques, Livres & Manuscrits
SOUVENIRS HISTORIQUES, CHASSE, LIVRES & MANUSCRITS — Mardi 25 juin 2019 – 13h30 — Drouot Salle 14, Paris CHASSE, SOUVENIRS HISTORIQUES, LIVRES & MANUSCRITS Mardi 25 juin 2019 Paris — Drouot Salle 14 13h30 — Lot 1 à 387 — Expositions publiques Lundi 24 juin de 11h à 18h Mardi 25 juin de 11h à 12h — Intégralité des lots sur millon.com Département Experts Sommaire Chasse, Souvenirs Souvenirs historiques Historiques & Livres Maxime CHARRON [email protected] et Manuscrits Chasse/Cheval ............................................. p.6 Commissaire priseur Militaria ........................................................p.22 Mayeul de LA HAMAYDE [email protected] Armes Souvenirs historiques ................................ p.30 01 47 27 95 34 Gaétan BRUNEL Bourbons ....................................................... p.31 Orléans ......................................................... p.44 Contact Napoléon .......................................................p.52 Mariam VARSIMASHVILI [email protected] Familles royales étrangères ............................ p.58 01 47 27 56 55 Livres Elvire Poulain Noblesse ....................................................... p.62 Objets de vitrine ............................................ p.62 Livres et manuscrits ...................................p.74 Alexandre Millon, Président Groupe MILLON, Commissaire-Priseur Les commissaires-priseurs Mayeul de La Hamayde Cécile Dupuis Delphine Cheuvreux-Missoffe Lucas Tavel Nathalie Mangeot Enora Alix Pour tous renseignements, ordres d’achat, rapports -

Collection D'autographes, De Dessins Et De Portraits De Personnages Célèbres, Français Et Étrangers, Du Xvie Au Xixe Siècle, Formée Par Alexandre Bixio
BnF Archives et manuscrits Collection d'autographes, de dessins et de portraits de personnages célèbres, français et étrangers, du XVIe au XIXe siècle, formée par Alexandre Bixio. XVIe-XIXe siècle. Cote : NAF 22734-22741 Collection d'autographes, de dessins et de portraits de personnages célèbres, français et étrangers, du XVIe au XIXe siècle, formée par Alexandre Bixio. XVIe-XIXe siècle. Papier.Huit volumes, montés in-fol.Demi-reliure. Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits Document en français. Présentation du contenu Un inventaire détaillé de cette collection a été publié par Léon Dorez dans le Bulletin d'histoire du Comité des travaux historiques (1916), p. 276 et suiv : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5787089t/f284.image. Informations sur les modalités d’entrée Don de Mmes Rouen-Bixio et Depret-Bixio, 1916 (D 5005) I. A - B Cote : NAF 22734 Réserver I. A - B 250 f. Ce document est conservé sur un site distant. Conditions d'accès Un délai est nécessaire pour la communication de ce document. En savoir plus. Documents de substitution Il existe une version numérisée de ce document. Numérisation effectuée à partir d'un document original : NAF 22734. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100272996 Lettre de Mehmet-Emin Aali-Pacha division : F. 1 Lettre de Mehmet-Emin Aali-Pacha 1856 ? Portrait de Mehmet-Emin Aali-Pacha division : F. 2 Portrait de Mehmet-Emin Aali-Pacha Dessin à la plume et encre brune ; 170 x 113 mm. Présentation du contenu Attribué à Nadar par Léon Dorez. 01/10/2021 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4092h Page 1 / 238 BnF Archives et manuscrits Lettre d'Abd el Kader au général Bugeaud division : F. -
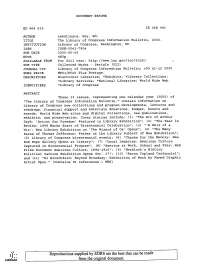
Reproductions Supplied by EDRS Are the Best That Can Be Made from the Original Document
DOCUMENT RESUME ED 464 635 IR 058 441 AUTHOR Lamolinara, Guy, Ed. TITLE The Library of Congress Information Bulletin, 2000. INSTITUTION Library of Congress, Washington, DC. ISSN ISSN-0041-7904 PUB DATE 2000-00-00 NOTE 480p. AVAILABLE FROM For full text: http://www.loc.gov/loc/lcib/. v PUB TYPE Collected Works Serials (022) JOURNAL CIT Library of Congress Information Bulletin; v59 n1-12 2000 EDRS PRICE MF01/PC20 Plus Postage. DESCRIPTORS Electronic Libraries; *Exhibits; *Library Collections; *Library Services; *National Libraries; World Wide Web IDENTIFIERS *Library of Congress ABSTRACT These 12 issues, representing one calendar year (2000) of "The Library of Congress Information Bulletin," contain information on Library of Congress new collections and program developments, lectures and readings, financial support and materials donations, budget, honors and awards, World Wide Web sites and digital collections, new publications, exhibits, and preservation. Cover stories include:(1) "The Art of Arthur Szyk: 'Artist for Freedom' Featured in Library Exhibition";(2) "The Year in Review: 1999 Marks Start of Bicentennial Celebration"; (3) "'A Whiz of a Wiz': New Library Exhibition on 'The Wizard of Oz' Opens"; (4) "The Many Faces of Thomas Jefferson: Father of the Library Subject of New Exhibition"; (5) Library of Congress bicentennial events; (6) "Thanks for the Memory: New Bob Hope Gallery Opens at Library"; (7) "Local Legacies: American Culture Captured in Bicentennial Program"; (8) "America at Work, School and Play: Web Films Document American Culture, 1894-1915"; (9) "Herblock's History Political Cartoon Exhibition Opens Oct. 17";(10) "Aaron Copland Centennial"; and (11)"Al Hirschfeld: Beyond Broadway: Exhibition of Work by Famed Graphic Artist Open." (Contains 91 references.) MES) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. -

The Magnificent Collection of Engraved Portraits Formed by The
^/pf ^-ss^^^t Catalogue No. 761 Part I—Portraits -The- Great Cope Collection of Engravings AMERICAN THEATRICAL and NAPOLEONIANA CATALOGUE COMPILED AND SALE AT THE ART AUCTION ROOMS OF CONDUCTED BY THOS. BIRCH'S SONS, STAN. V. HENKELS 1110 CHESTNUT STREET, PHILA. t- Lot 2jg.—Reduced. An Uniqt/e Portrait. SPECIAL NOTICE. Catalogue of the E. R. Cope Collection, Part II., now preparing, will embrace all ihe Miscellaneous Portraits, including the fine proof folio mezzotints, and those by Drevet, Edelinck, Nanteuil, Schmidt, Desnoyers, Sherwin, Sharpe, and other great engravers, in Line, Stipple and Mezzotint. Part III. will embrace the Miscellaneous Engraved Subjects, including nothing but the choicest examples of the Old and Modern Masters, as well as Sporting Subjects. Catalogue No. 761 Part 1.—Portraits ' , . ,THE MAGNIFICENT COLLECTION OF ENGRAVED PORTRAITS FORMED BY THE LATE ED\A(^ARD R. COPE, ESQ.. OF GERMANTOWN, PHILADELPHIA American Theatrical and Napoleoniana BEING THE MOST IMPORTANT COLLECTION EVER PLACED BEFORE THE AMERICAN PUBLIC ^^^'^^^ONJ^ TO BE SOLD I fJUL 2 8 1989 -^"'^^'^ TUESDAY. MAY 5th. 1896 AND FOLLOWING DAYS COMMENCING IN TITE AFTERNOONS AT 2.30 O'CLOCK, AND EVENINGS AT 8 O'CLOCK X;^ 2S0 Lots will be sold at each sitting CATALOGUE COMPILED AND SALE AT THE ART AUCTION ROOMS OF CONDUCTED BY • THOS. BIRCH'S SONS V. STAN. HENKELS 1 1 10 Chestnut Street, Philadelphia, Pa. (|^° On exhibition in our Art Gallery, May 2d and 4th. 11 -t a For those who cannot attend the sale, we take great pleasure in recommending the following gentlemen, who will accept orders. W. H. -

Jean Paul Marat
Jean Paul Marat Conner T02501 00 pre 1 02/04/2012 08:24 Revolutionary Lives Series Editors: Brian Doherty, Keele University; Sarah Irving, University of Edinburgh; and Professor Paul Le Blanc, La Roche College, Pittsburgh Revolutionary Lives is a book series of short introductory critical biographies of radical political figures. The books are sympathetic but not sycophantic, and the intention is to present a balanced and where necessary critical evaluation of the individual’s place in their political field, putting their actions and achievements in context and exploring issues raised by their lives, such as the use or rejection of violence, nationalism, or gender in political activism. While individuals are the subject of the books, their personal lives are dealt with lightly except in so far as they mesh with political issues. The focus of these books is the contribution their subjects have made to history, an examination of how far they achieved their aims in improving the lives of the oppressed and exploited, and how they can continue to be an inspiration for many today. Published titles: Leila Khaled: Icon of Palestinian Liberation Sarah Irving Jean Paul Marat: Tribune of the French Revolution Clifford D. Conner Gerrard Winstanley: The Digger’s Life and Legacy John Gurney www.revolutionarylives.co.uk Conner T02501 00 pre 2 02/04/2012 08:24 Jean Paul Marat Tribune of the French Revolution Clifford D. Conner Conner T02501 00 pre 3 02/04/2012 08:24 First published 2012 by Pluto Press 345 Archway Road, London N6 5AA www.plutobooks.com Distributed in the United States of America exclusively by Palgrave Macmillan, a division of St. -
Art As Revolutionary Propaganda in David's the Death of Marat
H. SPENCER BEAUMONT Art as Revolutionary Propaganda in David’s The Death of Marat PHYSICIAN, SCIENTIST, POLITICAL PHILOSOPHER, journalist, diseased misanthrope, paranoid, regicide, inciter of mass murder – Jean-Paul Marat shed his skin several times before discovering a talent for fanaticism. By mid-1790, however, anyone whose revolutionary fervor did not burn as ferociously as his was a reactionary who must be eliminated. His newspaper, ironically called L’Ami du Peuple (The Friend of the People), was a fiery pulpit of revolutionary propaganda, his sacred podium for the denunciation of the people’s enemies. While belonging to no political party himself, Marat led the Jacobin assault against the nobility, saying that Louis XVI’s death would be good for the people. He also used his paper to blast the Girodin party, portraying them as foes of republicanism. His greatest contribution to the French Revolution still awaited, however. In the summer heat of 1793, Marat’s assassination set the stage for his ultimate metamorphosis. The catalyst of this transfiguration was a work of revolutionary art, the greatest tableau of one of France’s most celebrated painters, War, Literature & the Arts: an international journal of the humanities / Volume 30 / 2018 Jacques-Louis David. Poignantly, his triumph would also prove his undoing. The masterpiece that caused viewers to swoon at its unveiling eventually precipitated the exile of its creator in 1814. At his death in 1825, only David’s heart was permitted burial in France. His body was laid to rest in Brussels and his infamous painting, The Death of Marat, had been kept in seclusion for 30 years, viewable by appointment only. -
Napoléon À Arras P.50
Bonaparte au pont d’Arcole - Antoine-Jean Gros En partenariat avec: Mécène principal Conception graphique : Catherine Lamaire / Région Hauts-de-France / Région Hauts-de-France Conception graphique : Catherine Lamaire SOMMAIRE Avant-propos p.5 Le château de Versailles à Arras, p.8 un partenariat de décentralisation exemplaire Le château de Versailles, p.9 première collection au monde sur l’Empire Parcours dans l’exposition p.11 Introduction p.12 Un général au service de la Révolution p.13 Terminer la Révolution, le Consulat p.15 Proclamation de l’Empire p.17 Napoléon à Versailles p.20 L’Empire victorieux p.21 La Famille impériale p.24 La Société parisienne p.28 Paris capitale des arts p.27 L’Empire en difficulté p.36 La chute, l’exil et la mort p.38 Les artistes majeurs de l’Empire p.42 Repères chronologiques p.45 Napoléon à Arras p.50 Catalogue de l’exposition p.52 Informations pratiques p.53 Les Hauts-de-France à l’heure de « Napoléon, images de la légende » p.54 Le musée des Beaux-Arts d’Arras p.56 Les partenaires de l’exposition p.58 Les informations presse p.60 AVANT-PROPOS Catherine Pégard, Présidente de l’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles Napoléon à Versailles ? L’écrasante figure de Louis XIV et le souvenir iconique de Marie- Antoinette semblent l’avoir éclipsé. L’Empereur entretient pourtant un lien étroit avec le « château des rois », qui conserve la plus belle collection napoléonienne au monde. S’il renonce à s’installer au château de Versailles, encore marqué par les récents épisodes de la Révolution et dont les aménagements seraient trop dispendieux, il en atteste la grandeur en y recevant le pape un mois après son sacre et s’attache à la préserver, achetant des terres pour reconstituer le domaine, dont il contribue à maintenir l’intégrité. -

Boze, Pierre-Paul Nairac
Neil Jeffares, Pastels & pastellists Boze, Pierre-Paul Nairac NEIL JEFFARES Joseph Boze Zoomify Pierre-Paul NAIRAC (1732–1812) Pastel on paper, 63.5x53 cm, oval Signed, middle right “Boze/1786” Private collection PROVENANCE: Commissioned 1786, 384 livres. [?the sitter’s granddaughter Angélique-Pauline Raymond, Mme Jean-Jacques Luetkens; her son Oscar Luetkens; M. Gergonne, a Bordeaux dealer]; acquired in an antiques shop in Bordeaux, c.1920 by a private collector in Arles; by descent to his son; Monaco, Christie’s, 30 June 1995, Lot 113 EXHIBITED: Joseph Boze (1745–1826): portraitiste de l’Ancien Régime à la Restauration, Martigues, musée Ziem, 18 November 2004 – 20 February 2005, cat. Gérard Fabre, no. 36, reproduced colour LITERATURE: Jeffares 2006, p. 77, reproduced; Dictionary of pastellists online, J.177.28 ICONOGRAPHY: (I) oil on canvas, by Pierre Lacour, 0.71x0.82, Salon de Bordeaux de 1782 (France, private collection). Lit.: Mesuret, reproduced; Le Port des Lumières; (II) anonymous profile, crayon (Bibliothèque national de France, N2); (III) engraving after Edmé Quenedey (Paris, musée Carnavalet, G.20815) GENEALOGY: Nairac HE PORTRAIT SHARES the brilliant handling of Boze’s masterpiece, his self-portrait in the Louvre; in particular, the range of blues and greys are employed on the silk coat, the folds T of which are remarkably similar. Gérard Fabre summarises the artist’s achievement in this work: Le parfait accord entre les tonalités du fond et le vêtment du modèle est un des points saisissants de ce portrait. Ici, cette caractéristique de l’art de Boze atteint un degré particulièrement poussé. La parfaite unité des couleurs est frappante, et malgré la sobriété de tons, le modèle conserve toute sa présence par le traitement même de la matière. -

Par ['Administration Des Subsistances. Paris, B. N., Imprimes. 7 Maximilien Robespierre
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 1 Babeuf. Nach einem zeitgenössischen Stich. Paris, Bibliotheque Na tionale, Cabinet des Estampes. 2 Titelseite des von der Gemeinde Villars-les-Roye in der Picardie an die Nationalversammlung gesandten Exemplars der Petition sur les impots vom April 1790. Paris, B. N., Imprimes. 3 Jean-Paul Marat im April 1793. Nach dem Gemälde von Joseph Boze. Paris, Musee Carnavalet. 4 Das abgeänderte Versteigerungsprotokoll vom 31. Dezember 1792 über den Verkauf der Domäne Fontaine-sous-Montdidier. Aus: Gabriel Deville, Thermidor et Directoire. Paris, s. d. [1904] (T. V der Histoire socialiste (1789 -1900), sous la direction de Jean Jaures). 5 Anaxagoras Chaumette. Stich von Lorieux nach einem Gemälde von Bonneville. Paris, B. N., Estampes. 6 Titelseite der am 18. Juli 1793 veröffentlichten Broschüre Paris sauve par ['administration des subsistances. Paris, B. N., Imprimes. 7 Maximilien Robespierre. Von David im Konvent nach der Natur ge zeichnet. Paris, B. N., Estampes. 8 Titelseite der von Babeuf im Februar 1794 - während seiner Haft in der Abbaye - beendeten Verteidigungsschrift Babeuf, ex-administrateur de la Somme ... Paris, B. N., Imprimes. 9 Billaud-Varenne. Zeichnung und Stich von Bonneville. Paris, B. N., Estampes. I 10 Das Gefängnis Sainte-Pelagie in Paris, rue de la Clef, n° 14. Der dritte Stock, genannt L'Opinion, beherbergte die politischen Gefangenen. Paris, B. N., Estampes. 11 Stanislas Freron. Zeichnung und Stich von Bonneville. Paris, B. N., Estampes. 12 Jean-Lambert Tallien. Zeichnung und Stich von Bonneville. Paris, B. N., Estampes. 13 Joseph Fouche. Nach einem David zugeschriebenen Porträt. Paris, B. N., Estampes. 490 14 Titelseite der im November 1794 erschienenen Broschüre Voyage des Jacobins .. -

The Power of the Portrait: Marie-Antoinette and the Shaping of A
THE POWER OF THE PORTRAIT: MARIE-ANTOINETTE AND THE SHAPING OF A REPUTATION THROUGH ART by LYDIA KATHERINE DUGGINS Bachelor of Arts, 2008 Rhodes College Memphis, TN Submitted to the Faculty Graduate Division College of Fine Arts Texas Christian University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS May 2011 THE POWER OF THE PORTRAIT: MARIE-ANTOINETTE AND THE SHAPING OF A REPUTATION THROUGH ART Thesis approved: Dr. Amy Freund, Major Professor Dr. Babette Bohn Dr. Heather MacDonald Dean H. Joseph Butler Graduate Studies Representative For the College of Fine Arts i Copyright © 2011 by Lydia Katherine Duggins All rights reserved ii TABLE OF CONTENTS List of Illustrations………………………………………………………………………………iv The Power of the Portrait: Marie-Antoinette and the Shaping of a Reputation through Art….....1 Illustrations………………………………………………………………………………………46 Works Cited……………………………………………………………………………………...54 Vita……………………………………………………………………………………………….56 Abstract…………………………………………………………………………………………..57 iii LIST OF ILLUSTRATIONS Image 1. Elisabeth Vigée-Lebrun, La Reine en gaulle, 1783, Private Collection of Hessische Hausstiftung, Krongberg, Germany Image 2. Elisabeth Vigée-Lebrun, Marie-Antoinette “en robe de velours bleu,” 1788, Château de Versailles Image 3. Jean-Marc Nattier, Marie Leszczynska, 1748, Château de Versailles Image 4. Carle van Loo, Portrait of Marie Leczynska, 1747, Palazzo Pitti, Florence Image 5. Carle van Loo, Portrait of Louis XV, 1747 Image 6. Elisabeth Vigée-Lebrun, Portrait of Marie-Antoinette, 1778, Kunsthistorisches Museum, Vienna Image 7. Adolf Wertmüller, La Reine, Monseigneur le Dauphin, et Madame, Fille de Roi se promenans dans le jardin Anglais du Petit Trianon, 1785, National Museum, Stockholm Image 8. Antoine Watteau, La Réveuse, 1712–14, The Art Institute of Chicago Image 9.