Pordic, Plérin, Trémuson (Côtes-D’Armor)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PETITE ENFANCE >2020-2023 SCHÉMA INTERCOMMUNAL D
1 682 HAB. Plage du Petit Havre Plage de Tournemine Plage des Rosaires PORDIC Martin Plage 7 105 HAB. PLÉRIN 14 998 HAB. Plage de Saint-Laurent Plage de Nouelles PORT DU LÉGUÉ TRÉMUSON 2 022 HAB. SAINT-BRIEUC LA MÉAUGON Barrage 47 452 HAB. Gare 1 333 HAB. du Gouët LANGUEUX 7 760 HAB. PLOUFRAGAN 11 947 HAB. TRÉGUEUX 8 341 HAB. SAINT-DONAN L’Urne 1 490 HAB. YFFINIAC SAINT-JULIEN 4 991 HAB. 2 104 HAB. PLÉDRAN PLAINE-HAUTE 6 481 HAB. 1 545 HAB. LE LESLAY 153 HAB. SAINT-GILDAS Le Gouët LE FŒIL 1 534 HAB. PLAINTEL LE VIEUX BOURG QUINTIN 4 346 HAB. 3 028 HAB. SAINT-CARREUC SAINT-BRANDAN 1 524 HAB. SAINT-BIHY 2 432 HAB. 246 HAB. Landes de Lanfains LANFAINS PETITE ENFANCE > 2020-2023 SCHÉMA INTERCOMMUNAL1 100 HAB. D’ORIENTATIONS Forêt de Lorge ROSTRENEN " ÉQUILIBRE ÉQUITE ET ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE EN MATIÈRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE " LA HARMOYE 407 HAB. La terre, la mer, l’avenir en commun saintbrieuc-armor-agglo.fr BINIC-ÉTAB LES-SUR - M ER / / H I L L ION / / LA H A R M O YE // L A MÉAUG ON // L ANF AINS // L ANG U E U X LAN TIC // LE B ODÉO // LE FŒI L / / L E L ESLAY // L E VIEU X -BOU R G / / P LAI N E-H AUTE // P L AINTEL PLÉD R AN // P L ÉRIN // PLŒUC-L'H ERM ITA GE // PLOUFR A G AN // PLOU R H AN / / PORDI C // Q U INTIN SAINT-B I HY / / SAINT-B R A N DAN / / S A I N T-BRIEUC // S AINT-CARR EUC / / SAIN T-DONAN // SAI NT-G ILD AS SAIN T - J U L I EN / / SAIN T-QUAY-POR TRI E U X / / TRÉGU E U X // TRÉMUSON / / TR ÉVEN EUC / / Y FFIN IAC GLOSSAIRE Schéma Intercommunal d’Orientations Petite Enfance ADFAAM 22 : Association Départementale -

Liste Des Zones Géographiques 2021
Annexe 2.A Liste des 18 zones géographiques Zone Circonscription Commune Nature code RNE Code postal Zone N°01 LANNION CAMLEZ Primaire 0221449F 22450 Zone N°01 LANNION CAOUENNEC Primaire 0220775Y 22300 Zone N°01 LANNION COATREVEN Primaire 0220797X 22450 Zone N°01 LANNION KERMARIA SULARD Primaire 0220893B 22450 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220937Z 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220942E 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0220944G 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Elémentaire 0221042N 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221115T 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221560B 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Maternelle 0221581Z 22300 Zone N°01 LANNION LANNION Primaire 0221861D 22300 Zone N°01 LANNION LOUANNEC Primaire 0221089P 22700 Zone N°01 LANNION PERROS GUIREC Primaire 0221443Z 22700 Zone N°01 LANNION PERROS GUIREC Primaire 0221720A 22700 Zone N°01 LANNION PLEUMEUR BODOU Maternelle 0220276F 22560 Zone N°01 LANNION PLEUMEUR BODOU Primaire 0220278H 22560 Zone N°01 LANNION ROSPEZ Primaire 0220661Z 22300 Zone N°01 LANNION ST QUAY PERROS Elémentaire 0220428W 22700 Zone N°01 LANNION ST QUAY PERROS Maternelle 0221636J 22700 Zone N°01 LANNION TREBEURDEN Primaire 0220458D 22560 Zone N°01 LANNION TREGASTEL Primaire 0221096X 22730 Zone N°01 LANNION TRELEVERN Primaire 0221503P 22660 Zone N°01 LANNION TREVOU TREGUIGNEC Primaire 0221424D 22660 Zone N°02 LANNION LANVELLEC Primaire 0221784V 22420 Zone N°02 LANNION PLESTIN LES GREVES Maternelle 0221473G 22310 Zone N°02 LANNION PLESTIN LES GREVES Elémentaire 0221492C 22310 -

Secteur De Recrutement Collèges Et Lycées Par Commune
DIRECTION ACADÉMIQUE DES CÔTES D'ARMOR DIVEL * Modifications RS 2020 SECTEURS DE RECRUTEMENTS DES LYCÉES ET COLLÈGES CORRESPONDANTS PAR COMMUNES COMMUNES COLLÈGE DE RATTACHEMENT LYCÉE DE RATTACHEMENT ALLINEUC PLOEUC - L'HERMITAGE Lycée Rabelais - Saint-Brieuc ANDEL LAMBALLE Lycée H. Avril - Lamballe AUCALEUC DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEAUSSAIS-SUR-MER (Ploubalay - Trégon - Plessix Balisson) PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BEGARD BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BELLE-ISLE-EN-TERRE BELLE-ISLE-EN-TERRE Lycée A. Pavie - Guingamp BERHET BEGARD Lycée A. Pavie - Guingamp BINIC - ETABLES-SUR-MER (Binic-Etables sur Mer) ST-QUAY-PORTRIEUX Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOBITAL DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BODEO (LE) (Pas d'école) QUINTIN Lycée Rabelais - Saint-Brieuc BON REPOS SUR BLAVET (LANISCAT) ST NICOLAS DU PELEM Lycée A. Pavie - Guingamp BON REPOS SUR BLAVET (PERRET) ROSTRENEN Lycée Sérurier de Carhaix (29) BON REPOS SUR BLAVET (ST GELVEN) GUERLEDAN (Mûr de Bretagne) Lycée F. Bienvenue - Loudéac BOQUEHO PLOUAGAT Lycée Freyssinet - Saint-Brieuc BOUILLIE (LA) ERQUY Lycée H. Avril - Lamballe BOURBRIAC BOURBRIAC Lycée A. Pavie - Guingamp BOURSEUL PLANCOET Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BREHAND MONCONTOUR Lycée H. Avril - Lamballe BREHAT PAIMPOL Lycée Kerraoul - Paimpol BRELIDY PONTRIEUX Lycée A. Pavie - Guingamp BRINGOLO PLOUAGAT Lycée A. Pavie - Guingamp BROONS BROONS Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BRUSVILY DINAN - François Broussais Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan BULAT-PESTIVIEN CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALANHEL CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALLAC CALLAC Lycée A. Pavie - Guingamp CALORGUEN DINAN - Roger Vercel Lycée La Fontaine des Eaux - Dinan CAMBOUT (LE) PLEMET Lycée F. -

Guide CLIC Lamballe
Maison du Département Édition mai GUIDE 2020 des acteurs au service des personnes âgées Réseau du CLIC de Lamballe-Penthièvre Direction personnes âgées et personnes handicapées des acteurs au service des personnes âgées Édito La solidarité est une compétence phare du Département qui se traduit par un en- gagement au service des plus fragiles. Dans les Côtes d’Armor, l’intervention de la politique départementale en faveur des personnes âgées occupe une place crois- sante compte tenu des caractéristiques démographiques de la population. Elle est aussi un enjeu de société, celui de la dignité de la personne et du respect de son choix de vie. À ce titre, le Département détient la responsabilité des Centres Locaux d’Informa- tion et de Coordination (CLIC), accueils de proximité dédiés aux personnes âgées et à leur entourage. Attentifs au besoin de la personne âgée, à l’écoute de ses proches, les CLIC proposent des solutions pragmatiques, expliquent les démarches à engager, font le lien avec les professionnels concernés. Ils travaillent en réseau avec les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile. Ils centralisent toutes les informations susceptibles d’intéresser les personnes âgées et les profes- sionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Lorsque le vieillissement s’accompagne d’une perte d’autonomie, de nombreux dispositifs peuvent être sollicités mais répondant chacun à des règles particulières et des conditions spécifi ques. C’est pourquoi, pour chaque Centre Local d’Informa- tion et de Coordination (CLIC), ce guide pratique permet de recenser les ressources gérontologiques en proximité. Disponible en version papier ou numérique, il offre une vision globale des moyens dédiés au maintien à domicile pour les personnes, leur entourage et les professionnels. -

FLYER-PROXITUB.Pdf
MODE D’EMPLOI LES TARIFS Comment lire une fiche horaire Proxitub ? SECTEUR DE TREGUEUX Ticket unité : uniquement auprès des conducteurs. 544 - Ville Brebis / 049 - Gué Renaud / 047 - Grand Tréfois / 048 - Tréfois …. Liste des arrêts sur ce Coupon 10 voyages : Point TUB et dépositaires. 1 secteur* 518 - La Hamonais /064 - La Cerisaie / 096 - Croix Gibat / 247 - Petit Bois ….. Coupon hebdomadaire, abonnements mensuels et annuels : Point TUB ou boutique en ligne www.tubinfo.fr (rechargement Arrêt(s) Relais Trégueux Bleu Pluriel n°060 carte Korrigo). 2 Horaires de DEPART Proxitub vers Trégueux Bleu Pluriel du lundi au samedi Tarifs en vigueur disponibles sur notre site internet. Jours de circulation LMCJV Sco S+Vac TRÉVENEUC Au plus tôt 20 minutes avant SAINT-QUAY- PORTRIEUX l'horaire d'arrivée à l'arrêt relais - Arrêts Proxitub * DEPART Horaire communiqué à la -Q (Selon liste ci-dessus) VOIR réservation (intervalle de 10 BON À SA 3 minutes) PLOURHAN VOTRE NOUVEAU Arrêt relais Trégueux Bleu Pluriel ARRIVEE 7:00 7:25 7:40 50% D’ÉCONOMIE Bénéficiez de 50 % d’économie BINIC-ÉTABLES-SUR-MER En correspondance q q q sur votre abonnement TUB SERVICE DE TRANSPORT Ligne C - Trégueux Bleu Pluriel DEPART 7:05 7:30 7:45 grâce à la prime transport. Pointe de Pordic Plage des 4 ARRIVEE Rosai Clémenceau 7:20 7:46 8:00 ≈ res Présentez la facture de votre abonnement annuel LANTIC SUR RÉSERVATION ou mensuel auprès de votre employeur. Pordic Horaires de RETOUR Proxitub depuis Trégueux Bleu Pluriel du lundi au samedi PORDIC- TRÉMÉLOIR DÈS LE Jours de circulation -

St-Brieuc Paimpol
ST-BRIEUC ST-BRIEUC > PAIMPOL ligne 1 LIGNE 1 PAIMPOL DU 4 JUILLET AU 30 AOÛT 2020 ÉTÉ LMmJV__ LMmJVSD LMmJVSD LMmJVS_ LMmJVS_ D LMmJV__ LMmJVS__ LMmJVSD LMmJVSD LMmJV__ LMmJV__ Service effectué par un car équipé d’un porte-vélos. ST-BRIEUC Gare centre 08:33 09:25 11:30 12:40 13:45 13:45 15:30 16:20 17:30 18:25 18:45 19:30 LIGNE Les Champs 08:35 09:27 11:32 12:42 13:47 13:47 15:32 16:22 17:32 18:27 18:47 19:32 RENSEIGNEMENTS Europe 08:40 09:33 11:37 12:50 13:53 13:53 15:41 16:30 17:40 18:33 18:55 19:37 1 PLERIN La Prunelle 08:43 09:36 11:40 12:53 13:56 13:56 15:44 16:33 17:43 18:36 18:58 19:40 Site internet : www.breizhgo.bzh Eleusis 08:47 09:40 11:44 12:57 14:00 14:00 15:49 16:39 17:48 18:41 19:03 19:44 PORDIC Centre 08:50 09:44 11:48 13:01 14:04 14:04 15:53 16:42 | 18:45 19:06 19:48 BINIC Bd Leclerc 08:54 09:48 11:50 13:04 14:08 14:08 15:57 16:49 17:58 18:49 19:11 19:50 ST-BRIEUC I PAIMPOL Estran 08:56 09:50 11:51 13:06 14:10 14:10 16:00 16:52 18:03 18:53 19:14 19:51 du lundi au samedi de 8h à 20h. -

Maisons Du Département Paimpol Goëlo Maison Du Département 11 Bis Rue Nicolas Armez - BP 239 22504 Paimpol Cedex Tél
Centres locaux d’information et de coordination - 2018 Maisons du Département Paimpol Goëlo Maison du Département 11 bis rue Nicolas Armez - BP 239 22504 Paimpol Cedex Tél. 02 96 20 87 20 Lanmodez Plougrescant Fax 02 96 55 33 09 Pleubian Île-de-Bréhat Penvénan Saint-Brieuc Terres et Mer [email protected] Trégastel Kerbors Trévou- Pleumeur Maison du Département Perros-guirec Tréguignec Plouguiel Ploubazlannec Trélévern Gautier 76 B rue de Quintin - CS 50551 Lamballe-Penthièvre Trédarzec Lézardrieux Pleumeur- Louannec Tréguier 22035 Saint-Brieuc Cedex Camlez Centre Hospitalier de Lamballe Bodou St-Quay Minihy Trébeurden Perros Kermaria 13 rue du Jeu de Paume -Sulard Tréguier Pleudaniel PAIMPOL Tél. 02 96 77 68 68 Coatréven Pouldouran Fax 02 90 03 42 02 CS 10234 Trézény Troguéry 22402 Lamballe Cedex LANNION Langoat Hengoat [email protected] Lanmérin La Roche-Derrien Plourivo Plouézec Lannion Rospez Kerfot Tél. 02 96 50 07 10 Maison du Département Quemperven Pommerit- Ploëzal Fax 02 96 50 92 49 Ploulec'h Mantallot Jaudy Trédrez Yvias Lanloup Pour les briochins : 13 Bd Louis Guilloux - CS 40728 -Locquémeau Caouënnec- [email protected] Lanvézéac Quemper Berhet Pontrieux Lanle Coordination Personnes Agées 22304 Lannion cedex Ploumilliau Runan Guézennec Pléhédel Ploubezre Prat Le Faouët Plouha 6 ter rue Maréchal Foch Tél. 02 96 04 01 61 St-Michel-en-Grève Cavan Plouëc Tréméven Tonquédec Coatascorn St-Clet 22000 Saint-Brieuc Fax 02 96 04 01 76 du-Trieux Pludual Tréveneuc Plévenon Brélidy -

Pléneuf-Val-André / Planguenoual / Saint-Alban
PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ GUIDE PLANGUENOUAL / SAINT-ALBAN 2020 LES SACRÉS NUMÉR°-S UTILES INDISPENSABLES PRATIQUES 3 URGENCES 21 MARCHÉS 4 NUMÉROS ADMINISTRATIFS 22 GARAGES / CARROSSERIES AUTRES SERVICES 24 HORAIRES DES MARÉES 6 SERVICE DE SANTÉ 26 LOISIRS / PATRIMOINE / SPORT 8 BÂTIMENT / ARTISANAT 28 ENSEIGNEMENT / VACANCES SCOLAIRES 12 JARDIN / PISCINE / TERRASSEMENT 30 TRANSPORT / SALLE DE RÉCEPTION 14 COMMERCE / SERVICE MARÉES / TOUT POUR VOTRE COM' 18 COMMERCE ALIMENTAIRE NAUTISME 20 RESTAURANT / BAR / BRASSERIE HÔTEL / CAMPING 1 CHANGEMENT D'HEURE HEURE D'HIVER 25 / 10 / 20 - 1h NUMÉROS HEURE D'ÉTÉ / 28 / 03 / 21 + 1h SACRÉMENT URGENTS • Police / Gendarmerie 17 • Hôpital privé des Côtes d’Armor DÉPANNAGES • Pompiers 18 10 rue François Jacob • SAMU 15 (portable 112) Plérin - 02 57 24 02 00 • EDF Électricité • SOS Médecins 36 24 • Gendarmerie 09 726 750 22 CRÉ ATION - ENTRETIEN DE JARDIN de Pléneuf-Val-André • Pharmacie de garde 32 37 3 rue de la Boulaie • Gaz 02 96 72 22 18 0 810 433 333 • Centre anti poison/ Rennes Plan 2d/3d - Terrassement - Rocaille - Palissades - Pergola - Bassins 17 (urgences) 2 rue Henri-Le-Guilloux, Muret - Dallage - Engazonnement - Plantation - Entretien • Dépannage Auto : 35033 Rennes cedex 9 • Perte ou vol cartes de crédit Voir page 22 02 99 59 22 22 15 rue de la Tourelle - ZA du Poirier - ST-ALBAN - 02 96 32 77 66 - www.yobe-paysage.fr 0 892 705 705 • Perte ou vol chéquiers • Dépannage plomberie : • Appel d’urgence Européen 0 892 683 208 Voir page 8 112 • CROSS Corsen 196 • Urgences Personnes • Télécom Services Clients : Sauvetage en mer sourdes et malentendantes Bouygues : 10 64 (par fax ou sms) 114 • SNSM Station Erquy Orange : 39 00 06 12 57 53 41 SFR : 10 23 • Centre hospitalier Numéro d’urgence : 196 On peut compter sur lui. -
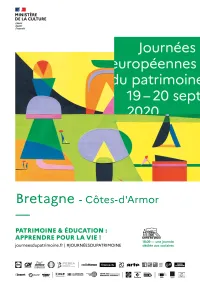
Programmation Côtes-D'armor
Bretagne - Côtes-d'Armor Plougrescant • • Trégastel • Louannec • Pleumeur-Bodou • Ploubazlanec Pleudaniel • • Paimpol • Lannion Ploëzal • • Lanleff Côtes-d'Armor • Plouzélambre • Erquy • Pléneuf-Val-André • Pordic • Plouisy Morieux • Lamballe-Armor • Créhen • • Beaussais-sur-Mer Saint-Péver • Saint-Brieuc • Planguenoual • Bourbriac • Hillion • Pléven • Langrolay-sur-Rance • Plédran • Lamballe Saint-Brandan •• Plaintel • Trégenestre Saint-Connan • Quessoy • • Taden • Quintin Dinan • • Lanvallay • Hénon Plélan-le-Petit • Léhon • Lanrivain • • Saint-Glen • Saint-Nicolas-du-Pélem Tréfumel • Évran • • Le Quiou Uzel • • Plouguenast-Langast Guitté Le Quillio • • Saint-Thélo • Gouarec • • Saint-Gelven • Guerlédan - Mûr-de-Bretagne Saint-Launeuc • • Loudéac JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2020 – BRETAGNE / COTES D’ARMOR* Détails sur le site programme : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ BEAUSSAIS-SUR-MER LANNION PLOUGRESCANT BOURBRIAC LANRIVAIN PLOUGUENAST-LANGAST CREHEN LANVALLAY PLOUISY DINAN LE FAOUËT PLOUZELAMBRE ERQUY LE QUILLIO PORDIC EVRAN LE QUIOU QUESSOY GOUAREC LEHON QUINTIN GUERLEDAN - MUR-DE- LOUANNEC SAINT-BRANDAN BRETAGNE LOUDEAC SAINT-BRIEUC GUITTE PAIMPOL SAINT-CONNAN GURUNHUEL PLAINTEL SAINT-GELVEN HENON PLEDRAN SAINT-GLEN HILLION PLELAN-LE-PETIT SAINT-LAUNEUC LAMBALLE PLENEUF-VAL-ANDRE SAINT-NICOLAS-DU-PELEM LAMBALLE-ARMOR - MORIEUX PLEUDANIEL SAINT-PEVER LAMBALLE-ARMOR - PLEUMEUR-BODOU TADEN PLANGUEMOUAL PLEVEN TREFUMEL LANGROLAY-SUR-RANCE PLOËZAL TREGASTEL LANLEFF PLOUBAZLANEC TREGENESTRE *Liste et informations -

Un Avenir En Commun
n°44 Déc16-Jan-Fév17 ÉCONOMIE p. 6 et 7 TEO p. 10 De nouvelles L’Agglo à l’écoute entreprises des commerçants au Légué Dossier p. 17 à 23 SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION Un avenir en commun Hillion - La Méaugon - Langueux - Plédran - Plérin Ploufragan - Pordic Tréméloir - Saint-Brieuc - Saint-Donan Saint-Julien - Trégueux - Trémuson - Yffiniac 2 Hillion - La Méaugon - Langueux - Plédran - Plérin - Ploufragan - Pordic Tréméloir - Saint-Brieuc - Saint-Donan - Saint-Julien - Trégueux - Trémuson - Yffi niac Construire l'avenir “avec confi ance En cette fi n d'année 2016, L'histoire de cette page qui se tourne une étape de la construction constitue un socle essentiel et un de l'intercommunalité formidable atout pour poursuivre l'action intercommunale” au service s'achève pour faire place d'un territoire élargi, dans ce même en janvier prochain à une esprit qui caractérise la mobilisation nouvelle dynamique engagée de chacun dans l'intérêt de tous. par les territoires qui ont décidé de se réunir dans Grâce à cette coopération, le paysage intercommunal a été fortement mar- l'Agglomération de demain. qué par des réalisations, des équi- pements, des actions construites et conduites en commun ; il a pris place dans l'environnement départemental et régional et a affi rmé son rôle, à l'appui de ses potentialités, de ses spécifi cités et de la diversité de ses atouts, tout en garantissant la di- mension de proximité sans laquelle il n'y a pas de réussite durable. Cet acquis précieux est le meilleur témoignage de cette histoire vécue, et permet d'envisager l'avenir de SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRA- Bruno Joncour Président de Saint-Brieuc TION avec volonté, enthousiasme et Agglomération confi ance. -

PAR6 Avec Annexes
PRÉFET DE LA REGION DE BRETAGNE SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES ARRÊTÉ établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R.211.80 et suivants, Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action de l’Etat dans les régions et départements, Vu le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, Vu l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, Vu l’arrêté n°17.014 du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables listant les communes concernées entièrement ou partiellement, Vu l’arrêté n°17.018 du 2 février 2017 portant délimitation des zones vulnérables listant les sections cadastrales des communes faisant l’objet d’une délimitation -

Saint-Brieuc Terre Et Mer
Maison du Département CLIC de Saint-Brieuc Terres et Mer Centre Local d'Information et de Coordination Un service gratuit pour les personnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage > “Suis-je assez valide pour > “Quelles sont les aides ? rester en sécurité à mon Combien cela coûte-t-il ?” domicile ?” > “Si les ressources sont insuf- > “Qui peut m’aider chez moi ?” fisantes, quelles sont les > “Le logement de papa n’est obligations familiales ?” plus adapté à son handicap. > « Je suis l’aidant principal de Que puis-je faire ?” mon conjoint, je suis épuisé, > “À qui s’adresse-t-on ?” quelles sont les aides pos- ? sibles ? » > “Maman ne peut rester à la maison… Quelles solutions peuvent lui être offertes sur le Un lieu ressource pour secteur ?” les professionnels Le CLIC, qu’est-ce que c’est ? C’est un Centre Local d’Information et de Coordination. Vous pouvez y rencontrer gratuitement un interlocuteur pour : > vous conseiller et vous aider à trouver des solutions > vous présenter l’offre de service existante Les valeurs du CLIC > vous informer sur • les aides? financières confidentialité • les structures d’hébergement neutralité • les services à domicile • l’adaptation du logement... > vous accompagner dans vos démarches administratives, la prise de contact avec les professionnels, la mise en place des services... Le CLIC est également le relais de la Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap (MDPH) pour les + de 55 ans. Le territoire couvert par le CLIC de Saint-Brieuc Terres et Mer Tréveneuc St-Quay-Portrieux Plourhan Binic-Étables -sur-Mer Lantic Coordination personnes âgées CCAS Saint-Brieuc Pordic Tél.