John Maynard Keynes 1 John Maynard Keynes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Economists' Papers 1750-2000
ECONOMISTS’PAPERS 1750 - 2000 A Guide to Archive and other Manuscript Sources for the History of British and Irish Economic Thought. ELECTRONIC EDITION ….the ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the“ world is ruled by little else. “Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economist.’ John Maynard Keynes’s General Theory of Employment, Interest and Money (1936) ECONOMISTS’ PAPERS 1750-2000 THE COMMITTEE OF THE GUIDE TO ARCHIVE SOURCES IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT IN 1975 R.D. COLLISON BLACK Professor of Economics The Queen’s University of Belfast A.W. COATS Professor of Economic and Social History University of Nottingham B.A. CORRY Professor of Economics Queen Mary College, London (now deceased) R.H. ELLIS formerly Secretary of the Royal Commission on Historical Manuscripts LORD ROBBINS formerly Professor of Economics University of London (now deceased) D.N. WINCH Professor of Economics University of Sussex ECONOMISTS' PAPERS 1750-2000 A Guide to Archive and other Manuscript Sources for the History of British and Irish Economic Thought Originally compiled by R. P. STURGES for the Committee of the Guide to Archive Sources in the History of Economic Thought, and now revised and expanded by SUSAN K. HOWSON, DONALD E. MOGGRIDGE, AND DONALD WINCH with the assistance of AZHAR HUSSAIN and the support of the ROYAL ECONOMIC SOCIETY © Royal Economic Society 1975 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission. -
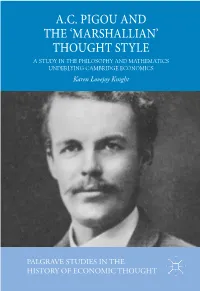
A.C. Pigou and the 'Marshallian' Thought Style
A.C. PIGOU AND THE ‘MARSHALLIAN’ THOUGHT STYLE A STUDY IN THE PHILOSOPHY AND MATHEMATICS UNDERLYING CAMBRIDGE ECONOMICS Karen Lovejoy Knight PALGRAVE STUDIES IN THE HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT Palgrave Studies in the History of Economic Thought Series Editors Avi J. Cohen Department of Economics York University and University of Toronto Toronto, ON, Canada G.C. Harcourt School of Economics University of New South Wales Sydney, NSW, Australia Peter Kriesler School of Economics University of New South Wales Sydney, NSW, Australia Jan Toporowski Economics Department SOAS, University of London London, UK Palgrave Studies in the History of Economic Thought publishes contri- butions by leading scholars, illuminating key events, theories and indi- viduals that have had a lasting impact on the development of modern-day economics. The topics covered include the development of economies, institutions and theories. More information about this series at http://www.palgrave.com/gp/series/14585 Karen Lovejoy Knight A.C. Pigou and the ‘Marshallian’ Thought Style A Study in the Philosophy and Mathematics Underlying Cambridge Economics Karen Lovejoy Knight Independent Scholar Duncraig, WA, Australia Palgrave Studies in the History of Economic Thought ISBN 978-3-030-01017-1 ISBN 978-3-030-01018-8 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-01018-8 Library of Congress Control Number: 2018959362 © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2018 This work is subject to copyright. All rights are solely and exclusively licensed by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and trans- mission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. -

Estudio De La Influencia De La Tasa De Interés Y De Las Variables Macroeconómicas En El Producto Interno Bruto”
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas “ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA TASA DE INTERÉS Y DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO” TRABAJO DE TITULACIÓN Previa la obtención del título de: MAGISTER EN ECONOMÍA Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Presentado por: CRISTHIAN FÁBIAN ARÉVALO AVECILLAS Guayaquil - Ecuador 2015 AGRADECIMIENTO Gracias a Dios, por tener a mi lado personas increíbles y muy amables, que me pongan en el camino correcto. A mis padres, por ayudarme y a mantener siempre la ilusión de lograr este objetivo académico. A mis hermanos, por los consejos y la ayuda brindada. A toda mi familia, por haberme apoyado en todos los momentos de mi vida. Un agradecimiento especial a mí Director de Tesis, el Ph. D. Fabricio Zanzzi, por su apoyo en la elaboración de esta tesis. Gracias. ii DEDICATORIA Este trabajo se lo dedico en especial a mi madre Nelly, quien me ha apoyado cuando más lo he necesitado, por guiarme en el camino correcto y ser mi sustento diario, gracias por ser la persona más especial en mi vida; a mi padre Manuel, por su apoyo incondicional. A mi hermano, Danny, quien siempre impulsó a seguir el camino del estudio, y me extendió su ayuda en los momentos más difíciles y a mi hermano Esteban, quien siempre ha estado ahí cuando lo necesito. Y que este logro alcanzado, sea una guía en mi vida futura. iii TRIBUNAL DE GRADUACIÓN M. Sc. Cristina Yoong Presidente del Tribunal de Trabajo de Titulación Ph.D. Fabricio Zanzzi Director del Proyecto M. -

L'expertise De James Laurence Laughlin Au Service De L'unification Monétaire Et Bancaire Américaine, 1870-1913
digitales archiv ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ZBW – Leibniz Information Centre for Economics Andre-Aigret, Constance Book L'expertise de James Laurence Laughlin au service de l'unification monétaire et bancaire américaine, 1870-1913 Provided in Cooperation with: Open Access Documents This Version is available at: http://hdl.handle.net/11159/3469 Kontakt/Contact ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft/Leibniz Information Centre for Economics Düsternbrooker Weg 120 24105 Kiel (Germany) E-Mail: [email protected] https://www.zbw.eu/econis-archiv/ Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieses Dokument darf zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken This document may be saved and copied for your personal und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. Sie and scholarly purposes. You are not to copy it for public or dürfen dieses Dokument nicht für öffentliche oder kommerzielle commercial purposes, to exhibit the document in public, to Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben perform, distribute or otherwise use the document in public. If oder anderweitig nutzen. Sofern für das Dokument eine Open- the document is made available under a Creative Commons Content-Lizenz verwendet wurde, so gelten abweichend von diesen Licence you may exercise further usage rights as specified in Nutzungsbedingungen die in der Lizenz gewährten Nutzungsrechte. the licence. http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Presentation-de-l-ABES/licence-Etalab-francais Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft zbw Leibniz Information Centre for Economics L’expertise de James Laurence Laughlin au service de l’unification monétaire et bancaire américaine, 1870- 1913. : de la défense de l’étalon-or à la conception du Federal Reserve Act (1913) Constance Andre-Aigret To cite this version: Constance Andre-Aigret. -

THÈSE DE DOCTORAT Soutenue Le Par Théorie Et Pratique De L,Étalon.Or International Chez R.G. Hawtrey, H.D. White Et R. Triffi
7+Ê6('('2&725$7 GHO¶8QLYHUVLWpGHUHFKHUFKH3DULV6FLHQFHVHW/HWWUHVௗ 36/5HVHDUFK8QLYHUVLW\ 3UpSDUpHjO¶8QLYHUVLWp3DULV'DXSKLQH 7KpRULHHWSUDWLTXHGHO¶pWDORQRULQWHUQDWLRQDOFKH]5* +DZWUH\+':KLWHHW57ULIILQXQHILOLDWLRQ QRQULFDUGLHQQH eFROH'RFWRUDOHGH'DXSKLQH²(' 6SpFLDOLWpSciences économiques &20326,7,21'8-85<ௗ 0-pU{PHGH%2<(5GHV52&+(6 8QLYHUVLWp3DULV'DXSKLQH 'LUHFWHXUGHWKqVH 0$ODLQ%e5$8' 8QLYHUVLWpGH&HUJ\3RQWRLVH 5DSSRUWHXU 0PH5HEHFD*Ï0(=%(7$1&2857 8QLYHUVLWp/\RQ 5DSSRUWHXUH 0PH0DUWLQH&$55e7$//21 8QLYHUVLWp3DULV'DXSKLQH 0HPEUHGXMXU\ 14.12.2016 6RXWHQXHOH 0/XGRYLF'(60('7 SDUPierre-Hernan ROJAS 8QLYHUVLWpGH%RXUJRJQH PrésidentGXMXU\ 0,YR0$(6 'LULJpHSDUM. Jérôme de BOYER %DQTXH1DWLRQDOHGH%HOJLTXH des ROCHES 0HPEUHGXMXU\ L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. Remerciements La thèse de doctorat est sans conteste une expérience individuelle. Mais rétrospectivement, je prends conscience à quel point l’aboutissement d’un tel travail est déterminé par la qualité de l’environnement personnel et professionnel. Au moment d’achever mon doctorat, je pense à toutes ces personnes et institutions qui m’ont permis, de près ou de loin, d’accomplir ce travail de longue haleine. Je souhaiterais avant tout remercier mon directeur de thèse, Jérôme de Boyer des Roches, de m’avoir donné le goût pour la recherche et de m’avoir guidé tout au long de ces années. Après ma classe préparatoire, j’ai choisi d’intégrer l’université Paris-Dauphine pour poursuivre ma formation en sciences économiques. En choisissant « par hasard » son cours d’histoire de la pensée économique, j’étais loin d’imaginer qu’il ferait naître chez moi un tel intérêt pour la pensée monétaire, et encore moins que je déciderais de faire mon mémoire de master 2 ainsi que ma thèse sous sa direction. -

Proquest Dissertations
NOTE TO USERS This reproduction is the best copy available. UMI THE EVOLUTION OF MONEY LAWS: A THEORY IAN D. SHEEN A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN LAW YORK UNIVERSITY, TORONTO, ONTARIO MARCH 2010 Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 OttawaONK1A0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-64943-5 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-64943-5 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -

Land Rights, Ethno-Nationality, and Sovereignty in History
1111 2 Land Rights, Ethno-Nationality, 3 4 and Sovereignty in History 5 6 7 8 9 1011 1 2 3111 The complex relationships between ethno-nationality, rights to land, and 4 territorial sovereignty have long fed disputes over territorial control and 5 landed rights between different nations, different ethnicities, and different 6 religions. These disputes raise a number of interesting issues related to the 7 nature of land regimes and to their economic and political implications. 8 The studies drawn together in this volume explore these and related issues 9 for a broad variety of countries and times, and illuminate the diverse causes 20111 of ethno-national land disputes, and the different forms of adjustment and 1 accommodation to the power differences between the contesting groups. 2 This is done within a generalized framework outlined by the editors in their 3 analytical overview, which offers contours for comparative examinations of 4 such disputes, past and present. Some of the issues discussed include: 5 6 • the structure and functioning of land markets in which the participa- 7 tion of “others” (ethno-nationally, religiously, or otherwise identified) 8 has been restricted or barred altogether; 9 • the political and economic underpinning of such constraints; 30111 • the implications of ethno-nationally restricted land markets for the allo- 1 cation and utilization of resources, income distribution, and economic 2 performance in the societies concerned. 3 4 Providing conceptual and factual analyses of a comparative nature and a 5 wealth of empirical material (both historical and contemporary), this book 6 will appeal to economic historians, economists, political scientists, sociolo- 7 gists, anthropologists, and all scholars interested in issues concerning 8 ethno-nationality and land rights in historical perspective. -

The Payment System / Betalningssystemet
The Payment System / Betalningssystemet John-Erik Janson, utgivningsår: 2003 Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729). (1993:1212) (1994:193) Copyright © 2003 by John-Erik Janson All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. ISBN 91-8781227-4 THE PAYMENT SYSTEM AND THE CONCEPTS SUPPLY AND DEMAND (English edition of ´Betalningssystemet och begreppen utbud och efterfrågan´, Nov. 2000). John-Erik Janson 2003 This Acrobat PDF file is a copy of the original printed version, that is available at selected university libraries. The original printed version was printed in Gothenburg, Sweden December 2003 by Intellecta DocuSys. PREFACE. 4 PART 1. THE PAYMENT SYSTEM. CHAPTER 1. THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY, PAYMENT METHODS, AND PAYMENT SYSTEMS. a. The Development of the Economy and 9 Payment Methods. b. Distribution, Payments, Transactions, 10 and Payment Systems. c. Different Types of Payments and 11 Transactions. d. The Actors of the Payment System. 12 CHAPTER 2. MEANS OF PAYMENT, DIFFERENT TYPES. a. Different Types of Payment Systems. 17 b. Payment means, general. 17 c. Banknotes and Coins, Check and Giro 18 Means. d. Savings and Long-Term Deposits. 20 e. Bank Checks, Money Orders and so on. 23 f. Account Cards. 24 g. Cash Cards. 26 h. Automatization of the Payment System 27 CHAPTER 3. -

Historia Do PENSAMENTO
HistOria do PENSAMENTO ECONtIMICO4 Traduo da 6 edi o norte-americana eiblioteca Regional CUR/UF Tti c5p PA. UFWIT / CUR Eblioteca Regional Data:_af.O.J10 Dados Internacionais de Catalogacdo ma Publicacao (CIP) (Camara Brasileira do Livro, SP, Brasil) Brue, Stanley L., 1945- Historia do pensamento econOmico / Stanley L. Brue (traducao Luciana Penteado Miquelino]. --Sao Paulo Thomson Learning, 2006. 1. reimpr. da 1. ed. de 2005. Titulo original: The evolution of economic thought. Bibliografia. ISBN 85-221-0424-7 1. Economia - Hist6ria I. Titulo. 04-2168 CDD-330.09 indice pare catilogo sistematico: Historia do PENSAMENTO ECONOMIC° 6 Traducao da edicao norte-americana Stanley L. Brue Traducao: Luciana Penteado Miquelino Revisao Tecnica: Roberto Antonio Iannone Economista — P U C-S P Mestre em Historia Econornica — US P Doutorando em Historia Economica — US P Professor da FAAP (Graduacao e MBA) Australia Brasil Canada Cingapura Espanha Estados Unidos Mexico Reino Unido THONISC0 N1 Gerente Editorial: Copidesque: Editorgao Eletrqnica: Adilson Pereira Norma Gusukuma Macquete ProduciSes Graficas Editor de Revisao: Desenvolvimento: Cristina Paixao Lopes e Capa: Marcio Coelho Sandra Lia Farah Megaart Design Supervisora de Prodgao Tradgao: Titulo do Original em Editorial: Luciana Penteado Miquelino The Evolution of Economic Patricia La Rosa Thought-Sixth Edition Revisao Ucnica: ISBN: 0-03-025998-3 Produtora Editorial: Roberto Antonio lannone Ligia Cosmo Cantareili COPYRIGHT © 2000 de Harcourt, Todos os direitos reservados. Dados internacionais de Inc. COPYRIGHT © 2005 para Nenhuma parte deste livro podere Cataloggao na Publicgao (CiP) lingua por-tuguesa adquirido por ser reproduzida, sejam quais forem (Camara Brasileira do Livro, SP, Thomson Learning Edic6es Ltda., os meios empregados, sem a Brasil) uma diviseo da Thomson Learning, permisseo, por escrito, da Editora. -

University of Huddersfield Repository
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by University of Huddersfield Repository University of Huddersfield Repository Gaukroger, Alan The Director of Financial Enquiries A Study of the Treasury Career of R. G. Hawtrey, 1919-1939. Original Citation Gaukroger, Alan (2008) The Director of Financial Enquiries A Study of the Treasury Career of R. G. Hawtrey, 1919-1939. Doctoral thesis, University of Huddersfield. This version is available at http://eprints.hud.ac.uk/2980/ The University Repository is a digital collection of the research output of the University, available on Open Access. Copyright and Moral Rights for the items on this site are retained by the individual author and/or other copyright owners. Users may access full items free of charge; copies of full text items generally can be reproduced, displayed or performed and given to third parties in any format or medium for personal research or study, educational or not-for-profit purposes without prior permission or charge, provided: • The authors, title and full bibliographic details is credited in any copy; • A hyperlink and/or URL is included for the original metadata page; and • The content is not changed in any way. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. http://eprints.hud.ac.uk/ The Director of Financial Enquiries A Study of the Treasury Career of R. G. Hawtrey, 1919-1939. Alan Gaukroger B.Sc. (Sheffield), P.G.C.E. (Birmingham), M.A. (Durham) B.A., Dip. Stat. (Open), M.A. (Huddersfield) A thesis presented to the University of Huddersfield as part of the requirement for the award of the degree of Doctor of Philosophy. -

College Council & Attachments
college council agenda & attachments april 25, 2012 complete version 1 JOHN JAY COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE The City University of New York The College Council Agenda April 25, 2012 1:40 p.m. 630T I. Adoption of the Agenda II. Minutes of the March 29, 2012 College Council (attachment A), Pg.3 III. Report from the Undergraduate Curriculum and Academic Standards Committee (attachments B1 – B9) – Anne Lopes, Dean of Undergraduate Studies New Courses: B1. PSY 4XX Clinical Topics in Forensic Psychology, Pg.5 B2. ECO 3XX Sustainability: Preserving the Earth as a Human Habitat, Pg.20 B3. BIO 3XX Human Physiology, Pg.35 B4. MUS 1XX Introduction to Guitar, Pg.44 Course Revisions: B5. SOC 222 Sociology of Mass Communication, Pg.55 B6. ECO 210 American Economic History and Development, Pg.58 B7. PSY/ANT 445 Culture, Psychopathology and Healing, Pg.75 Programs B8. Proposal to Revise the BA Degree in Political Science, Pg.84 B9. Proposal to Revise the Minor in Gender Studies, Pg.92 IV. Report from the Committee on Graduate Studies (attachments C1 – C3) – Jannette Domingo, Dean of Graduate Studies C1. A Resolution for Changes to be made in the Graduate Bulletin for Submission of a Grade Appeal Application, Pg.96 C2. A Proposal to Revise the Curriculum of the MPA: Inspection and Oversight Program, Pg.98 C3. A Proposal to Revise the Curriculum of the MPA: Public Policy and Administration Program, Pg.105 V. Report from The Committee on Honors, Prizes, and Awards (attachment D) – Berenecea Johnson Eanes, Vice President of Student Affairs, Pg.112 2 VI. -

JOHN MAYNARD KEYNES in King's College Library, Cambridge
Pro uesf Start here. This volume is a finding aid to a ProQuest Research Collection in Microform. To learn more visit: www.proquest.com or call (800) 521-0600 About ProQuest: ProQuest connects people with vetted, reliable information. Key to serious research, the company has forged a 70-year reputation as a gateway to the world's knowledge- from dissertations to governmental and cultural archives to news, in all its forms. Its role is essential to libraries and other organizations whose missions depend on the delivery of complete, trustworthy information. 789 E. Eisenhower Parkw~y • P.O Box 1346 • Ann Arbor, M148106-1346 • USA • Tel: 734.461.4700 • Toll-free 800-521-0600 • www.proquest.com A catalogue of the papers of JOHN MAYNARD KEYNES in King's College Library, Cambridge A catalogue of the papers of JOHN MAYNARD KEYNES in KING'S COLLEGE LIBRARY, CAMBRIDGE II.•• CHADWYCK-HEALEY LTD © 1995 Chadwyck-Healey Ltd All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission. Published by: Distributed in North America by: Chadwyck-Healey Ltd Chadwyck-Healey Inc. The Quorum 1101 King Street Barnwell Road Alexandria, VA 22314 Cambridge CBS SSW USA UK A CIP catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 0 85964 233 X Printed by Bookcraft Ltd, Midsomer Norton, UK CONTENTS Introductory notes IX Abbreviations Xl GENERAL SUBJECTS lA India Office Clerk 1906-8 1