Les Risques Naturels
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Règles De Bord Le Mot Tarifs
! nous entre lien le tous, entre lien le Général, Conseil Le Le mot règles de bord Aires de la présidente > Les cars scolaires sont accessibles > Vélo et skis transportés Multimodales aux voyageurs dans la limite gratuitement dans la limite € des places disponibles de la place disponible dans les soutes Déposez votre voiture ou votre vélo pour covoiturer, rejoindre Le Bus à 1 c’est votre réseau ! > Port de la ceinture de sécurité € Le Bus à 1€ fait partie de votre quotidien et obligatoire le réseau de Bus à 1 ou le train ! vous transporte dans tout le département Plan du réseau du Plan en respectant à la fois votre pouvoir d’achat de préparer l’appoint pour l’acquittement du prix Janvier 2014 Janvier Il est conseillé et l’environnement. > de la place Votre Conseil Général Aujourd’hui, le réseau de Bus à 1€ évolue de conserver son ticket pendant le voyage facilite vos déplacements et est accessible à tous. En favorisant > en développant RÉSO66, l’intermodalité grâce au réseau d’Aires un réseau d’aires multimodales Multimodales « Réso66 » où vous pouvez déposer votre vélo ou votre voiture pour situées dans 4 points stratégiques € covoiturer ou rejoindre le réseau de Bus à 1 ou le train, du département : ou encore en développant le Transport à la Demande au plus près des villages du territoire pour en assurer le développement équilibré, le Conseil Général se mobilise pour vous ! Il est interdit d’ouvrir les portes, Grâce à ce plan du réseau, vous visualiserez en un clin d’œil > d’entraver la circulation, > Argelès-sur-Mer toutes les lignes régulières et à la demande qui desservent > de se déplacer dans le véhicule, le territoire des Pyrénées-Orientales. -

561- Formiguere - Perpignan Web
FORMIGUÈRES > MONT-LOUIS ANNÉE 2019-2020 Du 30/11/2019 au 8/03/2020 Pyrénées JOURS SEMAINE Lundi à Samedi Dimanche Ne circule pas les jours fériés Orientales PÉRIODES SCOLAIRES • • • • • • • • PETITES VACANCES • • • • • • • • • • • d Transporteur / numéro de ligne 561 560 561 560 561 560 561 560 (1) Correspondances SNCF non garanties e 261 e n v Horaires i g e Station 12:50 16:30 16:30 i Puyvalador (2) Correspondances pour Bourg-Madame via Saillagouse n l t a l a Village 12:55 16:40 16:40 (3) Corresponadances pour Bourg-Madame via Font-Romeu L 561 Formiguères Place* 07:05 13:10 13:10 16:45 17:00 16:45 17:00 (4) Corresponadances pour Porta via Bourg-Madame AUTOCAR Matemale Foyer 07:10 13:15 17:05 17:05 Les Angles Complexe Sportif 07:20 13:25 17:15 17:15 (5) Corresponadances pour Latour de Carol via Font-Romeu Yaka 07:20 13:25 17:15 17:15 Pla del Mir 07:20 13:25 17:15 17:15 *Navette entre Formiguères " Place " et Puyvalador La Llagonne La Quillane 07:25 13:30 17:20 17:20 Abribus 07:30 13:35 17:20 17:20 Mont-Louis Porte de France 07:35 (3) 07:50 13:40 (2) (3) 13:50 17:25 (4) (5) 17:30 17:25 (4) (5) 17:30 La Cabanasse Gare SNCF 07:40 - - - - Prades Espace Multimodal Docteur Salies 08:50 14:50 18:30 18:30 Perpignan Gare Routière Multimodale (1) (Bld Saint Assiscle) 10:00 15:35 19:15 19:40 Ligne 561 (ex 261) Formiguères > Mont-Louis > Puyvalador (desserte saisonnière) lio.laregion.fr À partir du 1er septembre 2019, les numéros de lignes Calendrier 2019-2020 MONT-LOUIS > FORMIGUÈRES du réseau liO dans les Pyrénées-Orientales évoluent. -

Football Club Cerdagne Font-Romeu Capcir Organigramme
Hiver 2020 Football Club Cerdagne Font-Romeu Capcir https://fc-cerdagne.fr/ Organigramme PRESIDENT M. PUIG Bernard SECRETAIRE M. FERRAS Louis TRESORIER M. ERRE Olivier MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR M. VERGES Jérôme M. ALBERT Jérôme M. BOUVIER Brice M ROMERO André M. MARTIN Olivier M. DARRICAU Camille M. SARRAN Christian BEAUCOUP DE JEUNES Nous avons, pour cette saison sportive 2019/2020, 190 licenciés et 8 équipes engagées dans le niveau Départemental et une équipe (U18) en niveau Régional Occitanie. Sportivement, nos Séniors sont actuellement 5ème de leur championnat. La grosse satisfaction de ce début de saison est les U18 R2 qui occupent le trio de tête à la trêve hivernale et qualifié pour les ½ finales de Coupe du Roussillon. Nous avions engagé une équipe de U15 à 11 en début de saison mais le manque d’effectif nous a contraint modifier notre engagement. Afin qu’un maximums d’enfants puissent jouer tous les week-ends, le Comité directeur à décider d’engager une équipe de U15 à 8 et une équipe de U17. Pour le foot animation (de U7 à U13), nous avons beaucoup d’enfants et les éducateurs essayent de faire jouer un maximum de jeunes aux différents plateaux organisés par le District. Un salarié supplémentaire est venu renforcer l’effectif déjà en place, il s’agit de CHATELIER Corentin, qui actuellement est en contrat apprentissage et doit passer son Brevet d’Etat en Juin. Tous nos éducateurs sont actuellement diplômés FFF. Trois rifles ont été faites à Osseja et Saillagouse et le succès a été au rendez-vous. -

Pyrénées Orientales N Et Tours Du Capcir, Du Carlit Et De Cerdagne N O
GR® La Traversée des Pyrénées e é Pyrénées Orientales n et tours du Capcir, du Carlit et de Cerdagne n o d Plus de 30 jours de randonnée n a R e d n a r G GR 10 GR 36 GR PAYS 8 102 D 6 D A D D 1 D 25 Fanjeaux 3 61 32 D 9 6 9 D 0 2 ® ® 11 ® D 3 G 6 0 D 1 3 6 GR GR GR 3 R 1 7 D 1 D 6 D 8 6 623 11 D R V 6 D ar PAMIERS 2 G Alaigne . 5 GR10 36 PA YS St-Hilaire D G GRP 3 Lagrasse D R Tour du 6 P 78 1 1 Golfe Antique D 6 26 D Mirepoix LIMOUX a Itin 1é1raires décrits : Voie ferrée et gare . 11 9 r 6 G D a N 3 R 139 sur itinéraire 20 V GR 10 D 6 6 E Varilhes H e Durban- Sigean GR 36 r u A 0 s Port-la- Voie express avec sortie e 2 i Corbières 9 É AUDE rb N GRP “Tour du Capcir” 0 D Nouvelle 2 O R 1 B 6 5 Route prin cipale 1 2 7 G D N GRP “Tour du Carlit” 6 8 1 D 1 MouthoumetMouthoumet 6 G GRP “Tour de Cerdagne” Chalabre Limite dépGartementale R RP D Se P G R A FOIX nt mes D Montoulié C ie d'Ol 613 V a r 7 D a t D h a 1 r. s T re 2 de Périllou Autre itinéraire non décrit Frontière e r 6 6 e r 707 m 2 R Lavelanet 3 a 7 Couiza s R r s Montgaillard 0 10 km 8 G a altitude : R D 1 è c G R 1 1 Pech de i (en mètres) 100 G200 D 115070 1000 1500 2000 2500 3000 17 17 D b D 3 R 7B D 1 C o r Tuchan 9 P Bugarach 1230 m E PPlala ddee Château de P s Quillan R e Peyrepertuse lm BBrézrézoouu Montségur GGRPO $ tang de T Tarascon- T G ' D o dd'Olmes D ur R 1 Leucate sur-Ariège d P 1 1 0 u 7 G 2 I d 0 e M D 613 CCaudiès-de-audiès-de- R St-Paul- 1 9 T a 1 ab s 3 6 e si 6 D f 7 FFenenoouillèdesuillèdes de-Fenouillet D D 11 G 7 D Pic de 7 R B R Ag - Belcaire G ly St-Barthélemy -

Le Festival De La Flore Des Pyrénées
Pyrénées-Orientales | Ariège | Andorre | Catalogne Le festival de la flore des Pyrénées 1 Sorties, conférences, ateliers, cirque, théâtre, peinture, expositions,… il y en aura pour tous les goûts. Cet été, la flore pyrénéenne n'aura pas de Festi’Flora secrets pour vous. Alors venez nous rejoindre, L’évènement transfrontalier entrez dans la danse et portant à connaissance du que la fête commence ! public la splendeur de la flore pyrénéenne Cet été, partons ensemble sur les chemins de traverse à la découverte des joyaux de la flore des Pyrénées Les sens en éveil, écoutez le murmure des plantes compagnes, exubérantes parfois le long des sentiers, ou encore secrètes, Pyrénées-Orientales p 4 lovées au coeur des rochers. Tantôt discrètes Animations proposées par la Fédération ou audacieuses en ligne de crête, subtiles des réserves naturelles catalanes p 4 et toujours élégantes ; fleurs aux formes Les animations Animations proposées par le Parc naturel de ce festival sont surprenantes et aux couleurs à en perdre régional des Pyrénées catalanes p 7 la tête, elles vous conteront des histoires gratuites mais de magiciens et de sorcières, de remèdes l’inscription est millénaires et de recettes buissonnières… Ariège p 8 obligatoire ! Animations proposées par le Conservatoire d’espaces naturels d’Ariège p 8 Les personnes en charge Patrimoine d’exception, aux mille et de leur organisation et un secrets ! Flore des Pyrénées, ce leurs contacts vous sont Andorre p 10 mentionnés tout le long festival lui est dédié, oserez-vous Animations coordonnées par -

Le Risque Mouvement De Terrain, Consultez Les Sites Du Ministère De La Transition Écologique Et Solidaire (MTES)
D.D.R.MdesPyrénées-Orientales mouvement de de terrain INFORMATIONSUR LES RISQUES MAJEURS Le risque 79 i h Décembre2017 MOUVEMENT DE TERRAIN MOUVEMENT DE TERRAIN D.D.R.MdesPyrénées-Orientales INFORMATIONSUR LES RISQUES MAJEURS 80 Décembre2017 INFORMATION SUR LES RISQUES MAJEURS GÉNÉRALITES G.1- QU’EST-CE QU’UN MOUVEMENT DE TERRAIN ? Les mouvements de terrain sont les manifestations du déplacement gravitaire de masses de terrain déstabilisées sous l'effet de sollicitations naturelles (fonte des neiges, pluviométrie anormalement forte, séisme, etc.) ou anthropiques (terrassement, vibration, déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères, etc.). Ils recouvrent des formes très diverses qui résultent de la multiplicité des mécanismes initiateurs (érosion, dissolution, déformation et rupture sous charge statique ou dynamique), eux-mêmes liés à la complexité des comportements géotechniques des matériaux sollicités et des conditions de gisement (structure géologique, géométrie des réseaux de fractures, caractéristiques des nappes aquifères, etc.). Les volumes mis en jeu peuvent être compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). N I A R R E T E G.2 - COMMENT SE MANIFESTE-T-IL ? D T N On différencie : E M E • les mouvements lents, pour lesquels la déformation est progressive V et peut être accompagnée de rupture mais en principe d'aucune U accélération brutale : O M - les affaissements -

HORAIRES Lio TER
HORAIRES liO TER APPLICABLES DU 15 DÉCEMBRE 2019 PERPIGNANLE SOLER ST-FELIU-D’AVALLMILLAS ILLE-SUR-TÊTVINÇA MARQUIXANESPRADES MOLITG-LES-BAINSRIA VILLEFRANCHESERDINYA VERNET-LES-BAINSJONCET OLETTE-CANAVEILLES-LES-BAINSNYER THUÈS-LES-BAINSTHUÈS-CARANÇAFONTPÉDROUSESAUTO ST-THOMASPLANÈS MONT-LOUISBOLQUÈRE LA-CABANASSE FONT-ROMEU- EYNE ESTAVAR ODEILLO-VIASAILLAGOUSEERR STE-LÉOCADIEOSSÉJA BOURG MADAMEUR-LES-ESCALDESENVEITG VILLAGELATOUR BÉNA-FANÈS DE CAROL ENVEITG AU 30 AVRIL 2020 PERPIGNAN VILLEFRANCHE-VERNET LES BAINS LATOUR DE CAROL ENVEITG Tous Tous Tous Ven Tous * Ne circule pas les jours fériés les les les Dim et les (sauf exception précisée jours jours jours Sam jours dans le renvoi numéroté) 1 2 3 2 4 5 CAR PerpignanPerpignan Le SolerSoler SSaint-Féliu-d’Avallaint-Féliu-d’Avall En raison de travaux, la circulation ferroviaire est interrompue MillasMillas entre Perpignan et Villefranche-Vernet-les-Bains. Les trains IIlle-sur-Têtlle-sur-Têt sont remplacés par des autocars. Leurs horaires sont VinçaVinça disponibles sur le site ter.sncf.com/occitanie et sur les MarMarquixanesquixanes affi ches apposées en gare. PPrades-Molig-les-Bainsrades-Molig-les-Bains RiRiaa Villefranche-Vernet-les-Bains 9.37 9.37 13.57 15.52 15.52 17.48 Serdinya 9.44 9.45 14.05 15.59 15.59 17.55 Joncet 9.46 9.47 14.07 16.02 16.02 17.57 Olette-Canaveilles-les-Bains 9.50 9.57 14.17 16.14 16.14 18.10 Nyer 10.02 14.22 16.18 16.18 18.14 Thuès-les-Bains 9.57 10.07 14.27 16.23 16.23 18.19 Thuès-Carança 10.12 14.33 16.29 16.29 18.24 Fontpédrouse-St-Thomas-les-Bains 10.04 -

BM8-Les 100 Ciels D'osséja
Bulletin n°8-les 100 ciels 12/09/05 10:33 Page 1 Parution : 3 numéros/an - mai 2004/août 2004 L’essentiel d’OSSÉJA est un bulletin tiré à 1000 exemplaires - Mairie 66340 OSSÉJA Directeur de la Publication Daniel Delestré, Maire Comité de Rédaction Daniel DELESTRÉ, Maire; Denise LLAU, Adjointe au Maire; Bruno GONTIER, Conseiller Municipal; Any JULIA, Conseillère Municipale; Josette MAS, Conseillère Municipale; Michèle CORDIER; Jean-Marc LEWIN; André PRUJA; Marie Carmen SUNÉ; Frédérique Berlic NUMÉRO 8 La reproduction totale ou partielle des photos ou articles publiés est interdite sans accord du ou des auteurs. ( mai 2004/août 2004 Rugby ÉDITORIAL Osséja Matemale Cerdagne Capcir XV e club de rugby plus connu sous le nom de ROM est le club phare de la Cerdagne et du Capcir puisqu’il est le seul à représenter ce sport dans nos cantons. Créé en 1998 et issu de la fusion des deux anciens clubs, il ne cesse d’augmenter en effectif malgré les difficultés rencontrées par C l’équipe première. Bien entendu, pratiquer le rugby sur nos terres cerdano-capcinoises n’est pas chose facile, quand on connaît la rudesse de nos hivers. Pourtant à voir les jeunes pousses sur le terrain le mer- credi, on se rend compte que le rugby arrive à passionner ces enfants et que l’avenir nous réservera peut-être quelques bonnes surprises. Chers amis, Cette année, notre équipe première n’a pas été à la hauteur de ses ambitions et son parcours a été assez catas- trophique ; mais malgré cela, elle a loupé d’un point la qualification en Championnat de France, preuve que le La saison estivale approche. -

Les Angles Sur Facebook
LesSTATION DE SKIAngles CATALANE 1600-2400M GUIDE ÉTÉ 2014 OFFICE du TOURISME Tél : 04.68.04.32.76 S OMMAIRE Mail : [email protected] Les Animations p.3 www.lesangles.com Les Activités p.4/7 Horaires d’ouverture : Le Parc Animalier p.8 Tous les jours de 9h à 12h30 Le Bike Park p.9 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h du 12 juillet au 22 août. Le VTT p.10 La Randonnée p.11/13 Le Lac de Matemale p.14 Le Lac de Balcère p.15 La Pêche p.16 Les Services p.17 Visites et Découvertes p.18/21 Les Hébergements p.22/28 Marchés et Produits Fermiers p.29 Les Restaurants p.30/31 Commerçants/Artisans p.32/33 Numéros Utiles p.34 Les + de l’hiver p.35 Carte de situation p.36 Ce picto signifie que la prestation est réservable en ligne sur lE SHOP : lesangles.com ANIMATIONS ETE Retrouvez durant tout l’été des manifestations qui vous emmèneront du plateau de Bigorre au lac de Balcère en passant par le lac de Matemale, et bien d’autres endroits à découvrir. Programme complet des animations disponible à l’Office du Tourisme et sur notre site internet : www.lesangles.com 3 LES ACTIVITES ESPACE DE LOISIRS DU LAC DE MATEMALE . Dans un écrin de verdure, découvrez une multitude d’activités. Possibilité d’y accéder en navettes gratuites. Angles Aventures - Tél : 06.81.41.16.30 – angles-aventures.fr Un parc aventure accessible dès l’âge de 2 ans... 140 jeux en 15 parcours dont 1 tyrolienne de 215m, vous permettent d’évoluer à votre guise. -
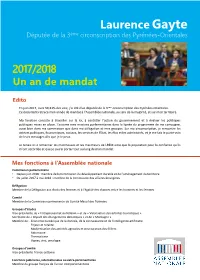
2017/2018 Un an De Mandat
Laurence Gayte Députée de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales 2017/2018 Un an de mandat Edito En juin 2017, avec 59,31% des voix, j’ai été élue députée de la 3ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Ce document retrace mon année de mandat à l’Assemblée nationale, au sein de la majorité, et sur mon territoire. Ma fonction consiste à travailler sur la loi, à contrôler l’action du gouvernement et à évaluer les politiques publiques mises en place. J’assume mes missions parlementaires dans la lignée du programme de ma campagne, aussi bien dans ma commission que dans ma délégation et mes groupes. Sur ma circonscription, je rencontre les acteurs politiques, économiques, sociaux, les services de l’Etat, les élus et les administrés, et je me fais le porte-voix de leurs messages dès que je le peux. Je tenais ici à remercier les marcheuses et les marcheurs de LREM ainsi que la population pour la confiance qu’ils m’ont accordée et que je saurai porter tout au long de mon mandat. Mes fonctions à l’Assemblée nationale Commission parlementaire • Depuis juin 2018 : membre de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire • De juillet 2017 à mai 2018 : membre de la Commission des affaires étrangères Délégation Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes Comité Membre de la Commission permanente du Comité Massif des Pyrénées Groupes d’études Vice-présidente de « Entrepreneuriat au féminin » et de « Valorisation des activités touristiques » Secrétaire -

ANNEXE 2 Aide Exceptionnelle Aux Travaux De Nettoyage Des Parcelles
ANNEXE 2 Aide exceptionnelle aux travaux de nettoyage des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 CONDITIONS PARTICULIERES REGIONALES APPLICABLES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON Carte des zones montagne éligibles au nettoyage « lourd » (cf,article 4) Nettoyage - Aides exceptionnelle de l’Etat en Languedoc-Roussillon – Tempête Klaus 2009 ANNEXE 2 (suite) Aide exceptionnelle aux travaux de nettoyage des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 CONDITIONS PARTICULIERES REGIONALES APPLICABLES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON Liste des communes en zones montagne éligibles au nettoyage « lourd » (cf.article 4) NOM_COMM INSEE_COMM NOM_DEPT INSEE_DEPT HANDICAP ALAIGNE 11004 AUDE 11 Montagne ALBIERES 11007 AUDE 11 Montagne ALET-LES-BAINS 11008 AUDE 11 Montagne ARQUES 11015 AUDE 11 Montagne ARTIGUES 11017 AUDE 11 Montagne AUNAT 11019 AUDE 11 Montagne AURIAC 11020 AUDE 11 Montagne AXAT 11021 AUDE 11 Montagne BELCAIRE 11028 AUDE 11 Haute-montagne BELCASTEL-ET-BUC 11029 AUDE 11 Montagne BELFORT-SUR-REBENTY 11031 AUDE 11 Montagne BELVIANES-ET-CAVIRAC 11035 AUDE 11 Montagne BELVIS 11036 AUDE 11 Montagne BESSEDE-DE-SAULT 11038 AUDE 11 Montagne LA BEZOLE 11039 AUDE 11 Montagne BOUISSE 11044 AUDE 11 Montagne BOURIEGE 11045 AUDE 11 Montagne BOURIGEOLE 11046 AUDE 11 Montagne LE BOUSQUET 11047 AUDE 11 Haute-montagne BRENAC 11050 AUDE 11 Montagne BROUSSES-ET-VILLARET 11052 AUDE 11 Montagne LES BRUNELS 11054 AUDE 11 Montagne BUGARACH 11055 AUDE 11 Montagne CABRESPINE 11056 AUDE 11 Montagne CAILLA 11060 AUDE 11 Montagne CAMPAGNA-DE-SAULT -

Département Des Pyrénées-Orientales Opoul-Perillos Étang De Salses Le Château Découpage Administratif Vingrau
Département des Pyrénées-Orientales Opoul-Perillos Étang de Salses le Château Découpage administratif Vingrau Salses le Chateau Prugnanes Caudies de F. St Paul de Fenouillet Maury Tautavel Le Barcares Espira de l'Agly Lesquerde Cases de Pene St Hippolyte St Martin Fenouillet Fosse St Laurent de S. Planezes Rivesaltes St Arnac Rasigueres Vira Lansac Latour de Fr. Le Vivier FellunsAnsignan Estagel Claira Toreilles Calce Peyrestortes Pia Prats de S. Cassagnes Montner Baixas Pezilla de C.TrillaCaramany Rabouillet I Bompas Ste Marie Belesta Villelongue de S. Sournia Corneilla la RVilleneuve la Riv.St Esteve Trevillach IX Pezilla la R. Baho VII Campoussy Montalba le C. Millas II Canet en Roussillon Nefiach VIII PERPIGNAN VI Tarerach St Feliu Amont CabestanyIII le Soler Mosset Ille sur Tet V Étang de Canet en Roussillon Arboussols St Feliu d'Avall Toulouges IV St Nazaire Molitg les B. Corbere les C. Eus Rodes Canohes Saleilles Puyvalador Corbere St Michel de Ll. Fontrabiouse Real Urbanya Campome Vinça Camelas Villeneuve deTheza la R. Alenya Catllar Marquixanes Bouleternere Thuir Ponteilla Pollestres Rigarda Llupia Formigueres Nohedes Castelnou Corneilla del V St Cyprien Sansa Conat Los MasosEspira de C. Casefabre Montescot PRADES Joch Ste Colombe Ria Sirach Finestret Trouillas Bages Latour Bas E. Codalet Caixas Terrats Elne Olette Villefranche de C. Glorianes Villemolaque Railleu Jujols St Jean LasseilleOrtaffa Les Angles Clara Boule d'Amont Fourques Matemale Oreilla Serdinya Corneilla de C. Montauriol Brouilla Estoher Fuilla Baillestavy Passa Palau del V. Caudies de C. Fillols Prunet et Belpuig Torderes Banyuls A Porte Puymorens Ayguatebia-Talau Taurinya Tresserre St Andre Souanyas Calmeilles Llauro St Genis des F.