Saint-Lamain
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1. Zone D'assainissement Collectif
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT MISE A JOUR Passenans (39) 2017 Avril 166 ‐ 16 Ce dossier a été réalisé par : Sciences Environnement Agence de Besançon Pour le compte de : Commune de Passenans Personnel ayant participé à l'étude : Romuald TAUVERON Chargé d'études : Romuald TAUVERON SOMMAIRE Zonage d’assainissement .................................................................................................................................................. 5 1. Zone d’assainissement collectif ................................................................................................................................ 7 2. Zone d’assainissement non collectif ......................................................................................................................... 7 3. Contexte local ........................................................................................................................................................... 8 3.1. Généralités ......................................................................................................................................................... 8 3.2. Analyse de l’existant .......................................................................................................................................... 9 3.2.1. Population ................................................................................................................................................... 9 3.2.2. Logements .................................................................................................................................................. -

N° 7-2 Juillet 2009
N° 7-2 PREFECTURE DU JURA JUILLET 2009 I.S.S.N. 0753 - 4787 Papier écologique 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 566 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE .........................................................................................................................................................................................................................567 Arrêté n° 09-123 du 13 juillet 2009 portant subdélégation de signature ................................................................................................567 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE .....................................................................569 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée dégâts de gibier - Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2009 .....................................................................................................................................................................................569 Arrêté préfectoral n° 2009/472 du 29 juin 2009 portant création d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de l’ACCA de VILLERS ROBERT ................................................................................................................................................................570 Arrêté préfectoral n° 2009/473 du 29 juin 2009 portant création d’une -
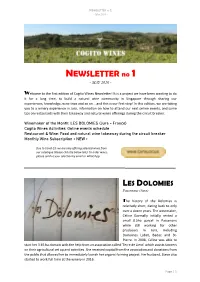
NEWSLETTER No 1 - May 2020
NEWSLETTER no 1 - May 2020 - NEWSLETTER no 1 - MAY 2020 - Welcome to the first edition of Cogito Wines Newsletter! It is a project we have been wanting to do it for a long time, to build a natural wine community in Singapore through sharing our experiences, knowledge, wine trips and so on... and this is our first step! In this edition, we are taking you to a winery experience in Jura, information on how to attend our next online events, and some tips on restaurants with their takeaway and natural wines offerings during the circuit breaker. Winemaker of the Month: LES DOLOMIES (Jura - France) Cogito Wines Activities: Online events schedule Restaurant & Wine: Food and natural wine takeaway during the circuit breaker Monthly Wine Subscription < NEW > Due to Covid-19, we are only offering selected wines from our catalogue (Please click the below link). To order wines, please send us your selection by email or WhatsApp. LES DOLOMIES Passenans (Jura) The history of the Dolomies is relatively short, dating back to only over a dozen years. The winemaker, Céline Gormally initially rented a small 0.5ha parcel in Passenans while still working for other producers in Jura, including Domaines Labet, Badoz and St- Pierre. In 2008, Céline was able to start her 3.65 ha domain with the help from an association called ‘Terre de Liens’ which assists farmers on their agricultural set up and activities. She received capital from the association and donations from the public that allowed her to immediately launch her organic farming project. Her husband, Steve also started to work full time at the winery in 2016. -

Le Réseau MOBIGO Dans Le Jura
Le réseau MOBIGO dans le Jura conditions de circulation Dernière mise à jour : 4/4/19 8:40 P = circuit Primaire, retard ou Ne circule Ligne transporteur Origine / destination normale Observations Type de circuit S = circuit Secondaire, perturbée pas (P / S / LR) LR = ligne structurante TOTAUX 286 1 7 100 TRANSDEV / ARBOIS TOURISME Navettes DOLE 1 160 TRANSDEV TAXENNE - GENDREY 1 161 TRANSDEV La BARRE-La BRETENIERE-ORCHAMPS Primaire 1 162 TRANSDEV RPI SERMANGE - GENDREY 1 163 TRANSDEV Ecole Concordia RANCHOT 1 164 TRANSDEV RPI PAGNEY - OUGNEY - VITREUX primaires 1 165 TRANSDEV BRANS - THERVAY - Gpe Sco DAMMARTIN 1 166 TRANSDEV CHAMPAGNEY - RPI Scolaire Dammartin 1 167 TRANSDEV RPI MONTMIREY-OFFLANGES - MOISSEY 1 168 TRANSDEV RPI PEINTRE MONTMIREY 1 169 TRANSDEV RPI PLUMONT - ETREPRIGNEY 1 170 TRANSDEV Pt MERCEY-DAMPIERRE-FRAISANS Prim/Collèg 1 172 TRANSDEV ORCHAMPS - FRAISANS Collège 1 173 TRANSDEV LA BARRE - FRAISANS Collège 1 174 TRANSDEV DAMPIERRE-FRAISANS Prim et collège 1 175 TRANSDEV MONTEPLAIN - ORCHAMPS 1 176 TRANSDEV OFFLANGES - PESMES Collège 1 177 TRANSDEV PAGNEY - PESMES Collège 1 178 TRANSDEV DAMMARTIN Champagnolot - PESMES Collège 1 179 TRANSDEV OUR - FRAISANS Collège 1 180 TRANSDEV RANS - ORCHAMPS 1 210 KMJ FROIDEVILLE - LONS LE SAUNIER 1 211 KMJ MOLAY - TAVAUX Collège 1 212 KMJ ST GERMAIN LES ARLAY - BLETTERANS Collèg 1 213 KMJ CHAPELLE-VOLAND - BLETTERANS Collège 1 214 KMJ FONTAINEBRUX-BLETTERANS Collège 1 215 KMJ BOIS DE GAND - BLETTERANS 1 216 KMJ COSGES - BLETTERANS 1 217 ARBOIS TOURISME BALIASEAUX - CHAUSSIN Collège -

Liste Des Communes Par Bureau De L'enregistrement
Archives départementales du Jura Liste des communes comprises dans le ressort de chaque bureau de l’Enregistrement dans le département du Jura de 1790 à 1955 Arbois Abergement-le-Grand, Arbois, Les Arsures, Certemery, Chamblay, Champagne-sur-Loue, La Chatelaine, Cramans, Ecleux, La Ferté, Grange-de-Vaivre, Mathenay, Mesnay, Molamboz, Montigny-lès-Arsures, Montmalin, Mouchard, Ounans, Pagnoz, Les Planches-près-Abois, Port-Lesney, Pupillin, Saint-Cyr-Montmalin, Vadans, Villeneuve-d’Aval, Villers-Farlay, Villette-lès-Arbois. Arinthod (rattaché au bureau de Lons-le-Saunier en 1934) Arinthod, Aromas, La Boissière, Céffia, Cernon, Cézia, Charnod, Chatonnay, Chemilla, Chisséria, Coisia, Condes, Cornod, Dramelay, Fetigny, Genod, Legna, Marigna-sur-Valouse, Saint-Hymetière, Savigna, Thoirette, Valfin-sur-Valouse, Vescles, Viremont, Vosbles. Beaufort 1819 – 1942 (avant 1819 voir Cousance ; rattaché àau bureau de Lons-le-Saunier en 1942) Arthenas, Augea, Augisey, Beaufort, Bonnaud, Cesancey, Cousance, Gizia, Grusse, Mallerey, Maynal, Orbagna, Rosay, Rotalier, Saint-Laurent-La-Roche, Sainte-Agnès, Vercia, Vincelles. Bletterans Arlay, Bletterans, Bois-de-Gand (avant 1945 voir Sellières), Brery (avant 1945 voir Sellières), Chapelle-Voland, La Charme (avant 1945 voir Sellières), La Chassagne (avant 1945 voir Sellières), Chaumergy (avant 1945 voir Sellières), Chêne-Sec (avant 1945 voir Sellières), Commenailles (avant 1945 voir Sellières), Cosges, Darbonnay (avant 1945 voir Sellières), Desnes, Les Deux-Fays (avant 1945 voir Sellières), Fontainebrux, Foulenay -

20140307 Bilan Depot Candida
Lons-le-Saunier, le 07 mars 2014 Bilan du dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales 2014 PRÉFET DU JURA Le dépôt des candidatures pour le premier tour des élections municipales est clos depuis le jeudi 6 mars à 18h. C À cette date, le nombre de candidatures enregistrées est le suivant : O • 6 596 candidats pour les communes de moins de 1 000 habitants, répartis sur 499 communes M • 1 685 candidats pour les communes de 1 000 habitants et plus, correspondant M à 79 listes réparties sur les 42 communes concernées. U Les candidatures enregistrées seront définitivement validées quatre jours après le dernier jour de dépôt possible, à savoir le 10 mars au plus tôt, et seront mises en N ligne le 11 mars dans la rubrique « élections » du site du Ministère de l’Intérieur. I Vous trouverez en annexe de ce communiqué les listes (pour les communes de 1000 habitants et plus) et candidatures déposées (pour les communes de moins Q de 1000 habitants). U Attention : ces listes et candidatures sont provisoires. Elles sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’examen des dossiers par la préfecture et par le É tribunal administratif. D E P R E S S PRÉFECTURE DU JURA - 8, rue de la préfecture - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - E : 03 84 86 84 00 - :[email protected] Horaires d’ouverture au public : consultez notre site internet www.jura.gouv.fr, rubrique « horaires » ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Page 1 Elections municipales 1er tour du 23 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 39 - JURA Candidat au conseil communautaire 39 JURA 013 - Arbois 01 POUR ARBOIS, UNE AUTRE VOIE (VOIX) 1 M. -

Bubbles NV Crémant Du France
Bubbles NV Crémant du France "Blanc du Noir" Beaufort 450 NV Crémant du Jura "Zéro Dosage" Tissot 600 2007 Le Petit Beaufort Domaine Alice Beaufort 550 2018 "Betty Bulles" Blanc Octavin 550 NV Nieva York Microbio Wines 500 NV La Resistencia Activa Contra el Marquél Microbio Wines 550 NV Alumbro "Clarete" Isabel Rodriguez Moran 400 Champagne NV "Brut" Elegance Vincent Couche 800 NV "Brut" Rèserve R. Pouillon 800 NV "Brut" Blanc de Blancs R. Pouillon 900 NV "Extra Brut" Cuvée n° 740 Jacquesson 1000 NV "Extra Brut" Cuvée n° 741 Jacquesson 1000 Cider NV Cidre Bio, Cornouaille, France Melenig 300 NV Sidre "Brut Tendre", France Eric Bordelet 300 White Germany & Austria 2018 Riesling 'Rheinschieffer' Peter Jakob Kühn 450 2017 Little Bastard Staffelter-hof 450 2016 MADCAP MAGNUS Staffelter-hof 600 2016 Müller-Thurgau "Le Blanc Nu" Max sein Wein 450 2018 Pinot Blanc Weingut Brand 450 2018 Roter Traminer "Hautnah" Nico Espenshied 550 2018 Handcrafted Riesling Martin & Anna Arndorfer 450 2017 Tauchgang, Chardonnay Michael Wenzel 500 2018 Grüner Veltliner "Theodora" 75/150cl Gutogau 550/1100 2018 Himmel auf Erden Christian Tschida 750 2018 Himmel auf Erden II Maische Vergoren Christian Tschida 750 2015 Graf Morillon Sepp Muster 750 France Alsace 2015 Sylvaner Grand Cru 'Zotzenberg' Rieffel 550 2015 Riesling/Pinot gris 'Val d'Eleon' Marc Kreydenweiss 650 2018 Muscat Ottonel 'Murmure' Domaine Rietsch 600 2016 Quand j'étais Petit, j'étais pas Grand Anders Frederik Steen 850 Loire 2017 Sauvignon Blanc, Menetou-Salon Domaine Phillippe Gilbert 450 2016 -

Retrouvez Tous Les Parcours Sur
Retrouvez tous les parcours sur : www.velo-messia-39.com MARS départ Samedi 14 heures Openrunner 7002090 4 Mars 70 Km Messia – Lons par la voie verte – Louhans- Dijon D678 – ZI Branges Dénivelé 340 m D413 Vincelles Saint Usuges D178 Putacrots Vers le Fay - Le Fay - Saillenard Bletterans - Rue des Bornes - Fontainebrux Larnaud - Granges Bedey – Courlaoux – Frebuans – Chilly - Messia Variante 60 km En arrivant à Louhans prendre rue de la Griffonière Rue de Bonlieu (vers laiterie) - D23 Montagny - Chemin des Vessières - Putacrots - puis reprendre le parcours Openrunner 6805171 11 Mars 71 km Messia – Chilly – Le camp d’aviation – La Grange Bedey - Le gravier – Dénivelé 456m Bard – Le pontot – Juhans –Arlay –Lombard - - Vers sous Sellieres - . Recanoz - Froideville –Commenailles – Chapelle Voland – Les Piotelats – Petit Nance – Nance – Saillenard – Beaurepaire – La Levanchée – Nilly – Courlaoux – Frébuans – Chilly - Messia Variante 60 Km Froideville – Vincent – Desnes – Bletterans – Nance – Puis reprendre le parcours Openrunner 6970420 18 Mars 72 Km Messia – Chilly – Frébuans – Trenal - . Mallerey – Bonnaud - Moulin du Dénivelé 379m Croz - - Savigny - Chantemerle – Véria – Sagy – Saint Martin du Mont - Louhans – St usuge - D178 Montcony - Le Tronchet – Frangy en Bresse – Charnay – Fontainebrux – Larnaud – La Grange Bedey – Courlaoux – La voie verte- Messia Variante 60 Km Saint Martin du Mont - .-Ratte - .D 678- - Putacrot – Montcony – le tronchet - -Saillenard – Beaurepaire - . D 678 – La Levanchée -- Nilly – Courlaoux – voie -

Menu Découverte Original « Les 7 Notes Gourmandes » 80 €
Menu découverte original « Les 7 Notes Gourmandes » 80 € Présentation commentée de 7 spécialités culinaires de Franche-Comté en accord avec 7 grands vins du Jura Originalité et Convivialité Menu découverte Les 7 Notes Gourmandes » avec les vins compris Inclus en formule séjour, renseignez-vous… Sur Réservation RESTAURANT Domaine du Revermont Hôtel-Restaurant 600, Route Revermont, 39230 Passenans JURA - FRANCE +33 384 44 61 02 / +33 384 44 64 83 [email protected] - www.domaine-du-revermont.fr Formule déjeuner semaine … 17 € Servi uniquement le midi du lundi au vendredi hors jours fériés 1 Mise en bouche + 1 plat + 1 dessert à choisir dans le menu Premières Saveurs ci-dessous : Découverte 26 € Mise en bouche ********** Rouleaux de printemps “volaille, morbier, salade et légumes”, sauce Texane Ou Eclair de saumon fumé et sa crème acidulée combava et herbes ********** Poisson du jour Ou Poitrine de pintade, polenta au curry et crème de comté ********** Lingot de crème brûlée au fruit de la passion et son sorbet citron Ou Pressé de poires et pommes aux épices, caramel et beurre salé Ce menu vous est proposé avec un assortiment de 3 Comté aux accords surprenants 30 € RESTAURANT Domaine du Revermont Hôtel-Restaurant 600, Route Revermont, 39230 Passenans JURA - FRANCE +33 384 44 61 02 / +33 384 44 64 83 [email protected] - www.domaine-du-revermont.fr Invitation aux Sens 38€ Mise en bouche ********** Terrine de Foie Gras de Canard, chutney d’abricots, caramel de dattes, brioche toastée Ou Raviole ouverte de truite de -

Règlement Régional Des Transports Scolaires Du
RÈGLEMENT RÉGIONAL DES TRANSPORTS SCOLAIRES DU JURA SOMMAIRE I - CHAMP D'APPLICATION ............................................................................................................................... 3 II - CRITÈRES DE PRISE EN CHARGE .............................................................................................................. 3 ER 2.1. ELEVES DU 1 DEGRE..................................................................................................................................... 3 ND 2.2. ELEVES DU 2 DEGRE : .................................................................................................................................. 4 2.3. SECONDE DEMANDE ........................................................................................................................................ 6 2.4. RESIDENCE ALTERNEE .................................................................................................................................... 6 III - FORME DES AIDES ACCORDÉES .............................................................................................................. 6 3.1. SUR LES SERVICES ROUTIERS REGIONAUX ...................................................................................................... 6 3.2. SUR LES SERVICES FERROVIAIRES (SNCF) .................................................................................................... 7 3.3. SUR LES SERVICES ROUTIERS DU GRAND DOLE............................................................................................. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured
15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

N° Du Versement
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU JURA Remembrement agricole Procès-verbaux de remembrement foncier agricole des communes du Jura 1957-2009 Versement de la Direction départementale des territoires (DDT) (documents de l’ancienne Direction départementale de l’Agriculture et de la forêt) (2559W) Bordereau de versement rédigé par Eric Boully, responsable de la gestion des archives de la Direction départementale des Territoires (DDT), modifié par Isabelle Bluet, attachée de conservation du patrimoine, sous la direction de Patricia Guyard, directrice des Archives départementales du Jura Montmorot, 2017 Versement 2559W BREVE PRESENTATION DU FONDS Contexte institutionnel D’abord gérées par l’ancienne administration du Génie rural dans le cadre de l’application de la loi du 9 mars 1941 sur le remembrement, les opérations de remembrement foncier agricole sont confiées à la Direction départementale de l’Agriculture (DDA) en 1964- 1965 en application du décret n°65-224 du 26 mars 1965 (organisation et attributions des DDA). Après une transformation en 1984 de la DDA qui devient la Direction départementale de l’Agriculture et de la forêt (DDAF), cette administration fusionne avec la Direction départementale de l’Equipement (DDT) au 1er juillet 2009. Dénommée provisoirement Direction départementale de l’Equipement et de l’agriculture (DREA), elle devient au 1er janvier 2010 la Direction départementale des Territoires (DDT). Transfert des documents aux Archives du Jura Ces documents font partie d’un versement d’archives réalisé en octobre 2016 par la Direction départementale des Territoires (DDT) afin de résorber un arriéré de versement de la Direction départementale de l’Agriculture et de la forêt (DDAF). Le versement est constitué de 359 registres couvrant toutes les communes jurassiennes remembrées de 1957 à 2009.