Paradise Now
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Factsheet the Netherlands and the European Audiovisual Sector
25 years of MEDIA Factsheet The Netherlands and the European audiovisual sector MEDIA budget invested in The Netherlands (2007-2015): €42.4 million Since 1991, MEDIA has provided support to strengthen Europe’s audiovisual sector, including the film, TV and videogames industries, so that it can creatively convey the breadth of Europe’s rich cultural diversity to audiences around the world. Over €2.4 billion has been invested in enhancing the careers of audiovisual professionals and in giving new audiences access to Europe’s wealth of creative and cultural achievements in cinemas, on TV and on digital platforms. EXAMPLES of success stories Many Dutch projects have benefited from the help of the MEDIA programme: CineMart - International Film Festival Rotterdam (2007-2015: €1,950,000) – Market Access IDFA Bertha Fund-Europe - St. Jan Vrijman Fonds (2014-2015: €620,000) – International Coproduction Funds DocsOnline (2007-2015: €1,085,000) – Online Distributie … Paradise Now! (2005) Kauwboy (2012) Fish Tank (2009) Best Foreign Language Film Best First Feature at the Berlinale Jury Prize Award at Cannes Festival at Golden Globe awards European Discovery - Prix Fipresci Alexander Korda Award for Best British Nominated for the Academy Award at European Film Awards Film at BAFTA awards for Best Foreign Language Film Cinekid is supported through the calls for Festivals, Market Access, Audience Development and Training and this enables them to support the whole audiovisual chain: from script development, co-production, distribution/acquisition to knowledge exchange. This is of vital importance in a rapidly changing media landscape. Thanks to the MEDIA support, Cinekid can focus on cultural diversity and artistic quality. -
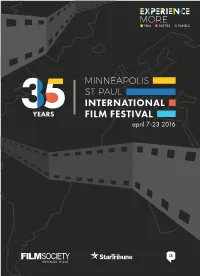
Deepa Mehta (See More on Page 53)
table of contents TABLE OF CONTENTS Introduction Experimental Cinema: Welcome to the Festival 3 Celluloid 166 The Film Society 14 Pixels 167 Meet the Programmers 44 Beyond the Frame 167 Membership 19 Annual Fund 21 Letters 23 Short Films Ticket and Box Offce Info 26 Childish Shorts 165 Sponsors 29 Shorts Programs 168 Community Partners 32 Music Videos 175 Consulate and Community Support 32 Shorts Before Features 177 MSPFilm Education Credits About 34 Staff 179 Youth Events 35 Advisory Groups and Volunteers 180 Youth Juries 36 Acknowledgements 181 Panel Discussions 38 Film Society Members 182 Off-Screen Indexes Galas, Parties & Events 40 Schedule Grid 5 Ticket Stub Deals 43 Title Index 186 Origin Index 188 Special Programs Voices Index 190 Spotlight on the World: inFLUX 47 Shorts Index 193 Women and Film 49 Venue Maps 194 LGBTQ Currents 51 Tribute 53 Emerging Filmmaker Competition 55 Documentary Competition 57 Minnesota Made Competition 61 Shorts Competition 59 facebook.com/mspflmsociety Film Programs Special Presentations 63 @mspflmsociety Asian Frontiers 72 #MSPIFF Cine Latino 80 Images of Africa 88 Midnight Sun 92 youtube.com/mspflmfestival Documentaries 98 World Cinema 126 New American Visions 152 Dark Out 156 Childish Films 160 2 welcome FILM SOCIETY EXECUTIVE DIRECTOR’S WELCOME Dear Festival-goers… This year, the Minneapolis St. Paul International Film Festival celebrates its 35th anniversary, making it one of the longest-running festivals in the country. On this occasion, we are particularly proud to be able to say that because of your growing interest and support, our Festival, one of this community’s most anticipated annual events and outstanding treasures, continues to gain momentum, develop, expand and thrive… Over 35 years, while retaining a unique flavor and core mission to bring you the best in international independent cinema, our Festival has evolved from a Eurocentric to a global perspective, presenting an ever-broadening spectrum of new and notable film that would not otherwise be seen in the region. -

Course Offerings & Graduation Requirements Booklet
Course Offerings & Graduation Requirements Booklet Tricia Bush Marcy Tyler “I am convinced that knowledge is power - to overcome the past, to change our own situations, to fight new obstacles, to make better decisions. ~ Ben Carson Updated 2/19 Dear Students and Parents/Guardians: We are pleased to offer this booklet including information on New York State high school graduation requirements, diploma options, college planning, course offerings at GHS, and more! The high school educational program offers options for students who plan to continue their formal education beyond high school and for those who plan to enter the workforce or military following graduation. We hope you find this information helpful. This booklet allows students and parents to become familiar with the variety of curriculum choices offered at GHS and specific graduation requirements. We strongly encourage students to not only seek to satisfy graduation requirements, but to challenge themselves with classes that will better prepare them for college. Taking advantage of elective opportunities allows students to explore interests and make decisions about future plans. Please be aware, however, that most elective courses are tentative as they depend on enrollment. In Grade 8, students and parents have an opportunity to learn about the high school curriculum and graduation requirements prior to making course selections for grade 9. In grade 9, a more formalized plan will be made according to each student’s goals. Each year after that, we work with students and parents in choosing courses and making adjustments to the plan as interests/needs change. Course offerings can vary slightly from year to year as well. -

Paradise Now
FILMHANDLEDNING Paradise Now Konflikten i Mellanöstern fyller dagstidningarnas i Israel, i Tel Aviv. Det är hans vän Jamal som förmedlar budska- spalter var och varannan dag. Israel som ocku- pet. Said förklarar för sin mamma att han fått ett arbetstillstånd i pant med en militär förtryckarapparat, palestini- Israel. Said har svårt att sova den natten, han går över till Suha erna som hänsynslösa självmordsbombare. Para- med hennes bilnycklar klockan fyra på natten och de dricker thé dise Now handlar just om två självmordsbom- och pratar om bio och livet under israelisk överhöghet. Det är bare. Vad driver dem? Vilka krafter ligger bakom? ockupationsmakten som definierar motståndet, menar Said, där- för allt våld. Nej, motståndet kan ta sig många uttryck, svarar Suha som är emot våld i alla dess former. Världen förändras och Rekommenderad från gymnasiet vi med den, säger Saids mamma som är orolig för sonen, vid ett senare tillfälle. en filmhandledning av Dagen därpå går Jamal och Said till en hemlig lokal där sen andreas hoffsten den mytomspunne ledaren Abu Karem och andra berättar och ger instruktioner om hur det hela kommer att gå till. De får också framför en videokamera ge sin syn på varför de ställer upp Handling som martyrer. Dessa inspelningar kommer senare att säljas som Vägspärrarna styr mycket av det dagliga livet på Västbanken och ”martyrfilmer” på video. Även bilder tas till kommande affischer i Gaza. Suha får sitt bagage genomsökt vid en israelisk vägspärr. över ”hjältemartyrerna”. Det är nästan som en välorganiserad En daglig förnedring där det gäller för henne att åtminstone liten industri. -

The Reel World: Contemporary Issues on Screen
The Reel World: Contemporary Issues on Screen Films • “Before the Rain” (Macedonia 1994) or “L’America” (Italy/Albania 1994) • “Earth” (India 1998) • “Xiu-Xiu the Sent Down Girl” (China 1999) • (OPTIONAL): “Indochine” (France/Vietnam 1992) • “Zinat” (Iran 1994) • “Paradise Now” (Palestine 2005) • “Hotel Rwanda” (Rwanda 2004) • (OPTIONAL): “Lumumba” (Zaire 2002) • “A Dry White Season” (South Africa 1989) • “Missing” (US/Chile 1982) • “Official Story” (Argentina 1985) • “Men With Guns” (Central America 1997) Books • We Wish to Inform You That Tomorrow We Will be Killed With Our Families: Stories from Rwanda by Philip Gourevitch • (OPTIONAL/RECOMMENDED): A Dry White Season by André Brink Course Goals There are several specific goals to achieve for the course: Students will learn to view films historically as one of a number of sources offering an interpretation of the past Students will acquire a knowledge of the key terms, facts, and events in contemporary world history and thereby gain an informed historical perspective Students will take from the class the skills to critically appraise varying historical arguments based on film and to clearly express their own interpretations Students will develop the ability to synthesize and integrate information and ideas as well as to distinguish between fact and opinion Students will be encouraged to develop an openness to new ideas and, most importantly, the capacity to think critically Course Activities and Procedures This course is taught in conjunction with “The Contemporary World,” although that course is not a prerequisite. We will use material from that course as background and context for the films we see. Students who have already taken “The Contemporary World” can review the material to refresh their memories before watching the relevant titles if they feel the need to do so. -

Medea of Gaza Julian Gordon Connecticut College, [email protected]
Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Theater Honors Papers Theater Department 2014 Medea of Gaza Julian Gordon Connecticut College, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.conncoll.edu/theathp Part of the Theatre and Performance Studies Commons Recommended Citation Gordon, Julian, "Medea of Gaza" (2014). Theater Honors Papers. 3. http://digitalcommons.conncoll.edu/theathp/3 This Honors Paper is brought to you for free and open access by the Theater Department at Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Theater Honors Papers by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. GORDON !1 ! ! Medea of Gaza ! Julian Blake Gordon Spring 2014 MEDEA OF GAZA GORDON !1 GORDON !2 Research Summary A snapshot of Medea of Gaza as of March 7, 2014 ! Since the Summer of 2013, I’ve been working on a currently untitled play inspired by the Diane Arnson Svarlien translation of Euripides’ Medea. The origin of the idea was my Theater and Culture class with Nancy Hoffman, taken in the Spring of 2013. For our midterm, we were assigned to pick a play we had read and set it in a new location. It was the morning of my 21st birthday, a Friday, and the day I was heading home for Spring Break. My birthday falls on a Saturday this year, but tomorrow marks the anniversary, I’d say. I had to catch a train around 7:30am. The only midterm I hadn’t completed was the aforementioned Theater and Culture assignment. -

International Film Festival
2007 International Film Festival FRIDAY 3 AUG France – La doublure Så som i himmelen Das Leben der Anderen Shijie 7pm (ends 8.25pm) Paradise Now A New Day in Old Sana’a L’enfant SÅ SOM I HIMMELEN (AS IT IS IN HEAVEN) L’enfANT (THE CHILD) Spain – Volver Sweden 2004 directed by Kay Pollak, 132 mins, rated M Belgium/France 2005 Directed by: Jean-Pierre & Luc Dardenne, 100 mins, rated M 9.15pm (ends 11.15pm) A successful international conductor returns to his childhood village in the far north of The Dardenne brothers focus on downbeat characters from the working classes of Sweden to recover from a heart attack. He gets involved with the local church choir and an industrialised Belgium in their trilogy ‘The Promise’, ‘The Son’ and ‘The Child’, all of extraordinary musical creation ensues. The score by Stefan Nilsson will leave you inspired which are emotionally powerful films. ‘The Child’ recounts the tale of a young thief who SATURDAY 4 AUG and appreciative of the beauty and power of music. A must-see for all lovers of fine music. actually sells his newborn baby and then gradually realises the enormity of his action. This Sweden – Nominated for an Oscar 2005. is a stunning cinematic experience, using understated techniques of naturalism which these Så som i himmelen directors favour. Won Golden Palm at Cannes Film Festival 2005 and numerous other awards 9.30am (ends 11.40am) Das LEBEN DER ANDEREN (THE LIVES OF OTHERS) and nominations. Germany 2006 directed by F Henckel von Donnersmarck, 137 mins, rated MA+restricted Germany – This multi-award-winning film, including winner of the Oscar 2007 for Best Foreign Film, SHIJIE (THE WORLD) China 2004 directed by Jia Zhangke, 140 mins, rated PG transports us into East Germany in the late 1980s, before the fall of the Berlin Wall. -

Face to Face and One Face Reflected in Many Mirrors
Irina Kolbutova Moscow [email protected] FACE TO FACE AND ONE FACE REFLECTED IN MANY MIRRORS In this article I would like to demonstrate how a very ancient theo- logical concept emerged unexpectedly through the mediation of the Platonic tradition almost simultaneously in the twelfth-century Latin West and in a remote oriental context, and how these two later devel- opments of the same set of ideas can clarify each other and their com- mon roots. At the outset it is worth making some observations concerning the use of the early Christian writings in this study, which scholars of the previous generations almost indiscriminately called “gnostic” thus us- ing the term by which, as was noted by A. DeConick, they att empted to reconstruct “an umbrella religion called ‘Gnosticism,’ a religion which in fact did not exist.”1 Furthermore, as R. G. Hall indicated, “the terms ‘Jewish,’ ‘Christian,’ and ‘gnostic’ are notoriously slippery when ap- plied to texts from early in the second century. The Odes of Solomon, with their close relationship to the Hodayot from Qumran, on the one hand, and to later gnostic literature, on the other, would belong equal- ly in studies of ancient Jewish hymnody, early Christian prophecy, and the origin of gnosticism. The Gospel of John belongs as clearly in a study of Gnostic origins as in a study of Christian origins and is Jew- ish to such an extent that one of the biggest issues it faces is being put out of the synagogue.”2 Finally, A. Golitz in highlighted the problem noting the “re-evaluation of apocalyptic literature, Christian origins, and the analysis of Gnosticism” for which scholars “had begun to look to more proximate (as opposed to distant Iranian), Jewish sources.” As this scholar observed, “we can fi nd a striking instance of this shift in the respective — and stunningly diff erent — analyses of the Acts of (1) A. -

A Cinematic Intifada Palestinian Cinema and the Challenge to the Dominant Zionist Narrative by Mounir Khoury, B.A. a Thesis Subm
A Cinematic Intifada Palestinian Cinema and the Challenge to the Dominant Zionist Narrative By Mounir Khoury, B.A. A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment Of the requirements for the degree of Master of Arts In Film Studies Carleton University Ottawa, Ontario September 17, 2007 Copyright, Mounir Khoury, 2007 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Library and Bibliotheque et Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-33744-8 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-33744-8 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant a la Bibliotheque et Archives and Archives Canada to reproduce,Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve,sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet,distribuer et vendre des theses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, a des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, electronique commercial purposes, in microform,et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protege cette these. this thesis. Neither the thesis Ni la these ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent etre imprimes ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Media Screen Roundup - July 2013
Media Screen Roundup - July 2013 A monthly digest of film and television publications compiled by Simon Baker, Institute of Historical Research, and published by the British Universities Film & Video Council at http://bufvc.ac.uk/2013/08/19/media-screen-roundup-july-2013 Allen, Steven, and Laura Hubner. 2012. Framing Film: Cinema and the Visual Arts. Bristol; Intellect. Includes, Intertextual relays of art and design. Crafting worlds : the changing role of the production designer / Ian Christie ; Adapting 'Watchmen' / Ian Hague ; Poster graphic design and French films in Poland after World War 2 / Dorota Ostrowska ; Here's Johnny! Re-framing 'The shining' / Laura Hubner - Movement and stasis. Narrativising pastness : the photographs of Donald Thomson and 'Ten canoes' / Steven Allen ; The still life : DVD stills galleries and the digital uncanny / Tina Kendall ; Leafing through cinema / Matilde Nardelli - Paintings, artists and films. 'Michael' and 'Gertrude' : art and the artist in the films of Carl Theodor Dreyer / David Heinemann ; Resonances of nineteenth-century realism in Steve McQueen's 'Hunger' / Toni Ross ; 'You a graffiti artist?' : the representation of artists and the visual arts in the film-making of Martin Scorsese -- Evocative frames. Framing loneliness in painting and film / David Morrison ; Grievability and precariousness in Alain Resnais's 'Hiroshima, mon amour', Ari Folman's 'Waltz with Bashir' and Alexander Sokurov's 'Alexandra' / Dennis Rothermel ; 'un cinéma impur' : framing film in the early film industry / Judith Buchanan. Ames, Eric. 2012. Ferocious Reality: Documentary According to Werner Herzog. Minneapolis; University of Minnesota Press Bartig, Kevin. 2013. Composing for the Red Screen: Prokofiev and Soviet Film. Oxford; Oxford University Press Baxter, Meredith. -

Foreign Film Collection 4-08.Indd
Foreign Film Collection JM 4/08 Rolling Meadows Library 3110 Martin Lane Rolling Meadows, IL 60008 847-259-6050 www.rolling-meadows.lib.il.us Rolling Meadows Library Foreign Film Collection SWEDISH These films are available on either DVD or Cries and Whispers Video. Please see the Readers’ Advisory Elvira Madigan Desk for information regarding these titles. Fanny and Alexander June Night AFGHANI My Life as a Dog Osama Scenes from a Marriage Seventh Seal ARABIC Silence Halfaouine Child of the Terraces Through a Glass Darkly Sabah Under the Sun Virgin Spring ARGENTINIAN Wild Strawberries Common Ground Winter Light Official Story Suddenly TAIWANESE Three Times BELGIAN Yi Yi Private Property BRAZILIAN TURKISH Black Orpheus Distant City of God Four Days in September VIETNAMESE House of Sand Scent of Green Papaya CHINESE YUGOSLAVIAN Crouching Tiger, Hidden Dragon When Father Was Away on Business Curse of the Golden Flower Eat Drink Man Woman Eye Farewell My Concubine Fearless Hero In the Mood for Love Iron Monkey Millenium Mambo Mongolian Ping Pong Raise the Red Lantern Riding Alone for Thousands of Miles Shaolin Soccer Shower Springtime in a Small Town Stolen Life Story of Qiu Ju Three Times To Live Wedding Banquet Wooden Man’s Bride Yi Yi Zhou Yu’s Train 8 1 Ivan’s Childhood CZECHOSLOVAKIAN Late Marriage Autumn Spring Moscow Does Not Believe in Tears Closely Watched Trains Prisoner of the Mountains Divided We Fall Russian Ark Fifth Horseman is Fear Siberiada Firemen’s Ball Kolya RWANDAN Shop on Main Street Sometimes in April DANISH SAAMI Antonia’s -

Video/Dvd Finder
1 VIDEO/DVD FINDER This is an ALPHABETICAL listing of all of the videos and DVDs in the Learning Support Services collection. If a translation was available, both the original and translated titles are listed. If a title belongs to a multi-part series, each title is listed separately as well as being listed under the series title (e.g. “The Rise of Nationalism” from the series “Africa: A Voyage of Discovery” is listed under both “Rise of Nationalism, The” and “Africa: A Voyage of Discovery : The Rise of Nationalism.” Ignore initial articles such as a, der, des, el, l’, la las, le, les, los, the, un, una, etc. (e.g . look under “B” for “La belle et la bete.”) 2 Guide to Call Numbers AF=African MS=Medieval Studies AN=Anthropology MT=Meteorology AR=Arabic MU=Music AS=South Asian NO=Norwegian BL=Bulgarian PE=Persian BO=Biology PG=Portuguese BU=Burmese PH=Physics CH=Chinese PL=Polish CM=Chemistry PO=Psychology CZ=Czech PS=Political Science DA=Danish RU=Russian DU=Dutch SB=Serbo-Croatian EC=Economics SC=Scandinavian Studies ED=Education SD=Swedish EN=English SG=Sociology EW=Ewe SH=Swahili FL=Folklore SP=Spanish FN=Finish TA=Tagalog FR=French TH=Thai GG=Geography TK=Turkish GL=Geology TM=Tamil GR=German UB=Urban Studies HA=Hausa WS=Women’s Studies HE=Hebrew YO=Yoruba HI=Hindi HS=History ID=Interdepartmental IN=Indonesian IS=Islam IT=Italian JA=Japanese JO=Journalism KE=Korea KR=Krio LI=Linguistics MA=Math MG=Mongolian 3 September 5, 2019 $10 HORSE AND A $40 SADDLE, A FL1.020 10 To 11 (DVD) TK2.063 100% Arabica (DVD) FR2.059.211 100 Jahre deutscher