CONGO, Leopoldvlle, Bolobo , Equateur Par Ch
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Wr:X3,Clti: Lilelir)
ti:_Lilelir) 1^ (Dr\ wr:x3,cL KONINKLIJK MUSEUM MUSEE ROYAL DE VOOR MIDDEN-AFRIKA L'AFRIQUE CENTRALE TERVUREN, BELGIË TERVUREN, BELGIQUE INVENTARIS VAN INVENTAIRE DES HET HISTORISCH ARCHIEF VOL. 8 ARCHIVES HISTORIQUES LA MÉMOIRE DES BELGES EN AFRIQUE CENTRALE INVENTAIRE DES ARCHIVES HISTORIQUES PRIVÉES DU MUSÉE ROYAL DE L'AFRIQUE CENTRALE DE 1858 À NOS JOURS par Patricia VAN SCHUYLENBERGH Sous la direction de Philippe MARECHAL 1997 Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du programme "Centres de services et réseaux de recherche" pour le compte de l'Etat belge, Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles (Services du Premier Ministre) ISBN 2-87398-006-0 D/1997/0254/07 Photos de couverture: Recto: Maurice CALMEYN, au 2ème campement en . face de Bima, du 28 juin au 12 juillet 1907. Verso: extrait de son journal de notes, 12 juin 1908. M.R.A.C., Hist., 62.31.1. © AFRICA-MUSEUM (Tervuren, Belgium) INTRODUCTION La réalisation d'un inventaire des papiers de l'Etat ou de la colonie, missionnaires, privés de la section Histoire de la Présence ingénieurs, botanistes, géologues, artistes, belge Outre-Mer s'inscrit dans touristes, etc. - de leur famille ou de leurs l'aboutissement du projet "Centres de descendants et qui illustrent de manière services et réseaux de recherche", financé par extrêmement variée, l'histoire de la présence les Services fédéraux des affaires belge - et européenne- en Afrique centrale. scientifiques, techniques et culturelles, visant Quelques autres centres de documentation à rassembler sur une banque de données comme les Archives Générales du Royaume, informatisée, des témoignages écrits sur la le Musée royal de l'Armée et d'Histoire présence belge dans le monde et a fortiori, en militaire, les congrégations religieuses ou, à Afrique centrale, destination privilégiée de la une moindre échelle, les Archives Africaines plupart des Belges qui partaient à l'étranger. -

My African Travels
CAMBRIDGE LIBRARY COLLECTION Books of enduring scholarly value History The books reissued in this series include accounts of historical events and movements by eye- witnesses and contemporaries, as well as landmark studies that assembled significant source materials or developed new historiographical methods. The series includes work in social, political and military history on a wide range of periods and regions, giving modern scholars ready access to influential publications of the past. My African Travels Published in 1886, My African Travels is a succinct record of British American explorer Henry Morton Stanley’s adventurous African expeditions during 1871-1884 and the results of his travels. Stanley, was commissioned by New York Herald to undertake a secret mission to find and rescue the Scottish missionary DavidLivingstone, who was lost in the midst of the African jungle. Stanley describes his journey through the forests and rivers of Africa and his encounters with the African wildlife, tribespeople, and Arab settlers and traders amidst the variegated beauty of places such as Unyamwezi, Usagara, Ukawendi, and Tanganika districts. Ranging over such events such as Stanley’s historic rescue of Livingstone to Livingstone’s death and Stanley’s further expeditions in Africa and his exploration and development of the Congo state, My African Travels is the saga of a passionate explorer with graphic descriptions of the vicissitudes of an African journey. Cambridge University Press has long been a pioneer in the reissuing of out-of-print titles from its own backlist, producing digital reprints of books that are still sought after by scholars and students but could not be reprinted economically using traditional technology. -

PEACE and GOODWILL George Grenfell on the Congo - I
139 PEACE AND GOODWILL George Grenfell on the Congo - I Some thirteen years ago in Gateshead, I was shown a small rectangular piece of iron a few inches square. The owner, Miss Peggy McKercher, proudly told me it was a fragment of the BMS ship, Peace. My interest caught, I have since pursued the largely forgotten story ofdetennination and dedication to Christ. Modern Zaire is very different from the land and peoples that the first BMS missionaries encountered so I have kept to the old name of Congo to describe situations and events of the past. Beginnings Written European history of the Congo begins in 1485-6, when the Portuguese navigator, Diego Cam, reached the mouth of the Congo river (also called the Nzadi, from which the name Zaire derives). He sailed to Matadi, the highest navigable point from the Atlantic, and proceeded overland to the capital of the King of Congo, now the Angolan town ofMbanza Kongo (under Portuguese rule, San Salvador). In 1491 another Portuguese expedition came to the area and the King and Queen of Congo were baptized, taking the Christian names of John and Leonora. In the reign of the next king, Alphonso (1492-1525), Portuguese dominance was established, and with it a veneer of Roman Catholic Christianity. There is a reasonable history of Congo up to 1670 by the Catholic missionary, Father Cavazzi. This suggests a somewhat chaotic relationship: the Portuguese priests and monks sent to Congo were not of high calibre. King Diogo (1532-1540) was so disillusioned with them that he ordered all immoral and unruly clerics and monks to be tied up and shipped back to Silo Tome. -
Versions of Kituba's Origin
DOI 10.1515/jall-2013-0004 JALL 2013; 34(1): 111 – 181 William J. Samarin Versions of Kituba’s origin: Historiography and theory1 Abstract: Casual explanations and thoughtful ones have been given for the emer- gence of Kituba, one of the African-based lingua francas of West Central Africa, but there is still no scholarly work that is based on political, historical, anthropo- logical, and linguistic research to account for the language’s origin and develop- ment. The present contribution is, frst, an overview of various attempts at ex- plaining its origin and development. Second, argued and arguable explanations are examined from diferent perspectives and with data not available before recent research. Finally, the author adds Kituba to his list of African vehicular languages that emerged in the late 19th century, when a signifcant number of auxiliaries – Africans in the majority, foreign and indigenous ones – solved their communication needs by contriving make-shif idioms that quickly gelled as lan- guages. Still far from the work that will hopefully be accomplished by others, this modest study suggests the kind of historiography and linguistic analysis that will helpfully characterize it. Keywords: Bantu grammar, Catholic schools, Congolese jargon, language and colonization, pidgin historiography, porterage, Scheut missionaries William J. Samarin (imeritus): Department of Anthropology, University of Toronto, Canada E-mail: [email protected] 1 An earlier version of this paper profted greatly from a careful reading by Armin Schwegler, Joseph Salomon, John A. Goldsmith (on tone), and two anonymous readers, to whom I am grateful. Too numerous to list are the individuals and organizations who helped me since the beginning of my study of language and colonization in West Central Africa in 1971, but the most important donor was the Social Sciences and Humanites Research Council of Canada. -
The Congolese Elite and the Fragmented City : the Struggle for the Emergence of a Dominant Class in Kinshasa
Working Paper no. 54 THE CONGOLESE ELITE AND THE FRAGMENTED CITY : THE STRUGGLE FOR THE EMERGENCE OF A DOMINANT CLASS IN KINSHASA William Freund University of KwaZulu-Natal August 2009 Crisis States Working Papers Series No.2 ISSN 1749-1797 (print) ISSN 1749-1800 (online) Copyright © W. Freund, 2009 24 Crisis States Research Paper The Congolese Elite and the Fragmented City: The struggle for the emergence of a dominant class in Kinshasa William Freund University of KwaZulu-Natal Prelude: The Belgian Congo This paper is about the present in the city of Kinshasa, the situation of the Congolese elite in the city and its relationship to the Congolese state. However, to arrive at a reasonable assessment, we need first to look at what kind of country the Democratic Republic of the Congo is, how its class structure has formed and then at the network of Congolese cities and their relation to the political economy of the country. We start with a few paragraphs on colonial history. Eventually, after trying to sum up some of the main features writers have captured about Kinshasa, we shall consider to what extent it is a city being made or taken over by an indigenous elite. At least amongst those interested in Africa, the black legend associated with the misrule of King Leopold II of the Belgians and his Congo Free State has continued to live in literature and retain its horror film aura thanks to the continued best-selling writing of such captivating authors as Adam Hochschild, Vidia Naipaul and Michaela Wrong. (Hochschild, 1998, Naipaul, 1980, Wrong, 2000). -

Henry Shelton Sanford and the American Recognition of the International Association of the Congo
University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 1989 Commerce, race, and diplomacy| Henry Shelton Sanford and the American recognition of the International Association of the Congo Sarah Elizabeth Wiley The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Wiley, Sarah Elizabeth, "Commerce, race, and diplomacy| Henry Shelton Sanford and the American recognition of the International Association of the Congo" (1989). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 1830. https://scholarworks.umt.edu/etd/1830 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. COPYRIGHT ACT OF 1976 THIS IS AN UNPUBLISHED MANUSCRIPT IN WHICH COPYRIGHT SUBSISTS. ANY FURTHER REPRINTING OF ITS CONTENTS MUST BE APPROVED BY THE AUTHOR. MANSFIELD LIBRARY UNIVERSITY OF MONTANA DATE : 1 9 FT 3 COMMERCE, RACE. AND DIPLOMACY: HENRY SHELTON SANFORD AND THE AMERICAN RECOGNITION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE CONGO By iarah Elizabeth Colenbrander B.A., University of Alabama, 1985 Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts UNIVERSITY OF MONTANA 1989 Chairman, Board of Examiner: }&L , '•M Date UMI Number: EP36179 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. -

Etude D'impact Environnemental Et Social
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO MINISTERE DES FINANCES ___________ Cellule d’Exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles « La CFEF » ___________ PROJET DE DEVELOPPEMENT DU POLE DE CROISSANCE OUEST Don IDA H-8600 Composante 1 TRAVAUX DE REHABILITATION DES PISTES RURALES PAR LA METHODE HIMO ET LA CONSTRUCTION DES OUVRAGES D’ART SUR DIX NEUF AXES ROUTIERS DE LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL1 ___________ ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (Version approuvée par l’IDA le 10 juin 2016) Avril 2016 1 Cette version révisée par le Cabinet Agrer a été relue et enrichie par Messieurs Mbaye Faye Mbengue (Consultant international), Bruno Bolekimo et Moussana Assani (tous Consultants Okapi Conseils) et Félix Boko (Consultant Land Ressources). TABLE DES MATIERES LISTE DES ABREVIATIONS ................................................................................................................................. 4 LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................ 5 LISTE DES CARTES ............................................................................................................................................. 6 LUKUFI LU TSADULU ......................................................................................................................................... 7 EXECUTIVE SUMMARY ..................................................................................................................................... 9 RESUME -

Democratic Republic of Congo): New Perspectives in Central Africa
Journal of African Earth Sciences 137 (2018) 261e277 Contents lists available at ScienceDirect Journal of African Earth Sciences journal homepage: www.elsevier.com/locate/jafrearsci Evolution and estimated age of the C5 Lukala carbonate-evaporite ramp complex in the Lower Congo region (Democratic Republic of Congo): New perspectives in Central Africa * F. Delpomdor a, , N. Van Vliet b, X. Devleeschouwer c, L. Tack d,A.Preat b a Illinois State Geological Survey, University of Illinois, Champaign, IL 61820, United States b Biogeochemistry and Modeling of the Earth System, Universite libre de Bruxelles, Brussels, 1050, Belgium c Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Geological Survey of Belgium, Brussels 1000, Belgium d Royal Museum for Central Africa, Tervuren, 3080, Belgium article info abstract Article history: New detailed lithological, sedimentological, chemostratigraphic data were obtained from exploration Received 14 April 2017 drilling samples on the C5 carbonate-dominated formation of the Neoproterozoic Lukala Subgroup Received in revised form (former Schisto-Calcaire Subgroup) from the West Congo Belt (WCB) in the Democratic Republic of 23 October 2017 Congo. This formation records the last post-Marinoan sea-level events that occurred in the whole basin, Accepted 24 October 2017 followed by the development of the Araçuaï-West Congo Orogen between 630 and 560 Ma. The C5 Available online 27 October 2017 Formation consists of back-reef lagoonal and peritidal/sabkha cycles of ~2.0 m in thickness, that record a short-time marine regression, rapidly flooded by a marine transgression with deposition of organic-rich Keywords: Ediacaran argillaceous carbonates or shales under dysoxia and anoxia conditions. -

Vie Matérielle, Échanges Et Capitalisme Sur La Rive Méridionale Du Pool Du Fleuve Congo (1815-1930)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by HAL-Paris1 Vie mat´erielle,´echanges et capitalisme sur la rive m´eridionaledu Pool du fleuve Congo (1815-1930) Sylvie Ayimpam To cite this version: Sylvie Ayimpam. Vie mat´erielle,´echanges et capitalisme sur la rive m´eridionaledu Pool du fleuve Congo (1815-1930). Clio en @frique. Recherche en Anthropologie et Histoire de l'Afrique, CEMAf, 2006, http://www.cemaf.cnrs.fr/IMG/pdf/18-clio.pdf. <halshs-00723326> HAL Id: halshs-00723326 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00723326 Submitted on 10 Aug 2012 HAL is a multi-disciplinary open access L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destin´eeau d´ep^otet `ala diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publi´esou non, lished or not. The documents may come from ´emanant des ´etablissements d'enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche fran¸caisou ´etrangers,des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou priv´es. RRAAHHIIAA Recherches en anthropologie & en histoire de l’Afrique Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale du Pool du fleuve Congo (1815-1930) Sylvie Ayimpam Collection « Clio en @frique » n° 18 – été 2006 Centre d’Étude des Mondes Africains (CEMAf) MMSH – Aix-en-Provence Sylvie Ayimpam Vie matérielle, échanges et capitalisme sur la rive méridionale du Pool du fleuve Congo 1815-1930 Introduction I Les structures du quotidien et les jeux de l’échange sur la rive méridionale du Pool Malebo (1815-1881) ................................................................................................................................... -

The Workers of Aifrican Trade
Volume 11 SAGE SERIES ON AFRICAN MODERNIZATION AND DEVELOPMENT Catherine Coquery-VRJrovitch Paul E. Lovejoy Editors The Workers of Aifrican Trade fj SAGE PUBLICATIONS Beverly Hills London New Delhi Copyright © 1985 by Sage Publications, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. For information address: SAGE Publications, Inc. 275 South Beverly Drive Beverly Hills, California 90212 SAGE Publications India Pvt. Ltd. SAGE Publications Ltd M-32 Market 28 Banner Street Greater Kailash I London EC1Y 8QE New Delhi 110 048 India England Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging in Publication Data Main entry under title: The workers of African trade. (Sage series on African modernization and development ; v. .11) "The chapters in this volume were originally presented at a conference held at York University, Toronto, in September 1983"—Acknowledgments. Includes bibliographies and index. 1. Transport workers—Africa, Sub-Saharan—History— Congresses. 2. Africa, Sub-Saharan—Commerce—History— Congresses. I. Coquery-Vidrovitch, Catherine II. Lovejoy, Paul E. III. Series. HD8039.T72A3575 1985 380.T0967 85-2259 ISBN 0-8039-2472-0 FIRST PRINTING 12 THE STATE'S BAKONGO BURDEN BEARERS WILLIAM J. SAMARIN In taking possession of the heart of Africa in the last quarter of the nineteenth century, Belgians used Bangalas to carry their guns and Bakongos to bear their burdens. These were the first and most important Congolese—as opposed to expatriate—soldiers and porters of the initial period of colonization. -
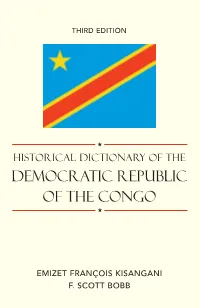
Historical Dictionary of the Democratic Republic of the Congo, Third Edition
HDCongoPODLITH.qxd 9/28/09 2:27 PM Page 1 KISANGANI & AFRICA HISTORY BOBB HISTORICAL DICTIONARIES OF AFRICA, NO. 112 THIRD EDITION One of Africa’s largest, most populated, and generously endowed countries, the Democratic Republic of the Congo has both dominated the surrounding region and been greatly republic democratic affected by it. The Democratic Republic of the Congo has under- of the dictionary historical gone a long period of war, and the outlook for political renewal and economic recovery is bleak. Human security is likely to of the congo of the congo remain a distant dream for many years because of the prevalence of rape and sexual violence, which is considered the worst in the world. This third edition of Historical Dictionary of the Democratic Republic of the Congo reviews the nearly 48 years of independ- ence, more than a century of colonial rule, and earlier kingdoms and groups that shared the territory. It contains a chronology, an introductory essay, a bibliography, and more than 800 cross- referenced entries on civil wars, mutinies, notable people, historical dictionary of the places, events, and cultural practices. democratic republic Emizet François Kisangani is professor in the Department of Political Science at Kansas State University in Manhattan. of the congo F. Scott Bobb is a journalist who has been reporting on and writing about the Democratic Republic of the Congo since the mid-1970s. He is serving as a Voice of America correspondent in Southern Africa. THIRD EDITION For orders and information please contact the publisher SCARECROW PRESS, INC. A wholly owned subsidiary of EMIZET FRANCOIS¸ KISANGANI The Rowman & Littlefield Publishing Group, Inc. -

Holman Bentley D.D
W. HOLMAN BENTLEY D.D. UNIVERSITY OF GLASGOW THB LIFE AND LABOURS OF A CONGO PIONEER BY HIS WIDOW H.. M. BENTLEY WITH A PHOTOGRAVURE PORTRAIT, MAP, A.ND SIXTBEN OTHER ILLUSTRATIONS. LONDON THE CAREY PRESS 19, FURNIVAL STRBET, B,C, 4. PREFACE T was with no little hesitancy that I complied I with the request to write an account of my dear husband's life. There were so many reasons that made it almost impossible for me to describe with any fairness the character and work of such a man as he was, that I shrank from the task. But when, finally, more than one friend urged it upon me, I felt in a way constrained to do it, if but to show how much may be achieved by any one man, if only he be willing to place himself unreservedly in the hands of God, to be used by Him and for His glory. One great difficulty that confronted me at the onset was that I had never met my husband until the year of our marriage. Happily I found two diaries of the years 1878 and 1879, which have helped me very much in my account of those years; and these, with his mother's recollections and the letters of friends, have enabled me to give an account of the way in which he was trained by God for his great life-work. Another vii viii Preface inconvenience was that his private correspondence had mostly been left behind in Congo, in the expectation of returning there after a reasonable absence on furlough.