Rapport De Presentation Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Plan Urbain S I R T1 Cauchoise O V U U 67 Préfecture E Rue De Tanger a T2 E Théâtre LE HOULME D'arc B Bd De La Marne E Septembre 2011 Av
ulin Le Haut-Bourg . Mo ille Rue J ntv Rouen Centre Hameau de Frévaux 16 Mo 29 vers Montville, Clères R École e u Rue Verte Ricarville d Rue Louis Bouilhet NeufchâtelRoute de l e Route de Montville r e e Centre Médical t 5 Ru 4 M 8 11 7 r 20 R e o R e i a ih Les Tilleuls Deschamps v ue la B Cimetière C e Rue Bouquet d r MONTVILLE h r a er Église Monumental Notre-Dame des Champs Stade Carrefour de Clères s C i e Cimetière PISSY- Vos transports en commun dans l’agglomération rouennaise s Rue du Champ e d Rte de e St-Romain R. d'Ernemont Jouvenet liè Pisc. Rue Stanislas Girardinvre J.B. de la Salle e Rue Leroy u PÔVILLE Église d R u R 6 Beauvoisine u Campulley Lesouef Mie des Oiseaux Mairie de Malaunay e e Rue L Coulon Boulingrin esou Re S u ef n t Bd de a - R Rue r G d l'Yser 5 D 121 e T1 40 67 t53 Collège r Gare-Rue Verte v Jules Rue Revel a Beauvoisine 22 Bd de l'Yser Collège Jean Zay is e Marie Viaduc n Av. G. Métayer Revel 13 i Réservoir Bérat 40 MALAUNAY Plan Urbain s i R T1 Cauchoise o v u u 67 Préfecture e Rue de Tanger a T2 e Théâtre LE HOULME d'Arc B Bd de la Marne e Septembre 2011 Av. Flaubert T3 Préfecture 13 5 u B Rue Beaux- R Lycée o Gare du Houlme u Le Bois F le du Puits d v r u Rue Jean Arts Lycée a e 5 22 rd s Belges d t53 11 13 20 Corneille Rue du Bizet q La Vallée D 90 Fac. -

Étude L 111-1-4 Plaine De La Ronce
ISNEAUVILLE - PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE DE LA RONCE – ETUDE L. 111-1-4 – Plan Local d’Urbanisme 1 ISNEAUVILLE - PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE DE LA RONCE – ETUDE L. 111-1-4 – Plan Local d’Urbanisme 2 SOMMAIRE 1.1.1. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE p.5 2.2.2. PRISE EN COMPTE DE L’ARTICLE L.111.1.4 DU CODE DE L’URBANISME p.7 3.3.3. OBJET DE L’OPÉRATION p.9 4.4.4. DISPOSITIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES p.13 5.5.5. LA PLAINE DE LA RONCE p.19 6.6.6. TIRER PARTI DES ELEMENTS FORTS DU PAYSAGE p.21 7.7.7. PRENDRE EN COMPTE LES PRINCIPALES LIGNES DE FORCE p.23 8.8.8. CONSTRUIRE UN PAYSAGE DYNAMIQUE p.25 9.9.9. UNE PALETTE VEGETALE p.27 10. RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS DE PROGRAMME SUR LE TERRITOIRE DE LA ZAC p.29 11. PRINCIPES D’OCCUPATION DES TERRAINS p.31 12. TRADUCTION RÈGLEMENTAIRE DU PROJET p.33 13. CONCLUSION p.37 ISNEAUVILLE - PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE DE LA RONCE – ETUDE L. 111-1-4 – Plan Local d’Urbanisme 3 ISNEAUVILLE - PARC D’ACTIVITES DE LA PLAINE DE LA RONCE – ETUDE L. 111-1-4 – Plan Local d’Urbanisme 4 111-1--- RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ÉTUDE L’article L.111.1.4 du Code de l’urbanisme, stipule qu’en dehors des zones urbanisées, les constructions et installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes classées à grande circulation. -

C'est Le Printemps !
IsneauvilleInformations C’est le printemps ! Avril 2015 - N°76 ISNEAUVILLE à 5 mn de Rouen par A28 02 35 6060 1818 0033 wwwww.pasquiermeubles.com [email protected] Magasin ouve rt le lundi de 14h à 19h, du mardi au vend redi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h sans interruption Sommaire Éditorial la vie isneauvillaise La Métropole Rouen-Normandie est maintenant installée …………………………………4 Notre journal « Isneauville Informations » change, La Métropole Rouen-Normandie…………………………………………………………………………………………………………………4 nous avons fait le choix du respect de l’environnement Le Conseil Municipal des Jeunes ………………………………………………………………………………………………………………5 en l’imprimant sur du papier recyclé. Environnement, ruissellement, biodiversité…………………………………………………………………………………6 Nos haies !! …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 Développement durable et Agenda 21 ………………………………………………………………………………………………7 L’aspect change, il se veut dynamique et le reflet de la Cérémonie des vœux ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………8 vie active de notre commune et des associations qui Concours maisons fleuries …………………………………………………………………………………………………………………………………9 font « le bien vivre ensemble ». Urbanisme ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 A la rencontre des isneauvillais ………………………………………………………………………………………………………………10 Les collectivités doivent prendre des initiatives dans Le CCAS et ses missions ……………………………………………………………………………………………………………………………………11 ce sens, mais chacun doit avoir le souci -

Infos Belbeuf N° 4 - 2013
INFOS BELBEUF N° 4 - 2013 INFORMATIONS MUNICIPALES Bienvenue 2014 Nous sommes au terme d’une année où « Ensemble pour Belbeuf » nous avons enfin pu voir, la réalisation de nos deux projets phares : l’ouverture de la crèche, la mise en service des nouveaux ateliers municipaux, et l’arrivée de nouveaux belbeuviens aux Génétais. La concrétisation de ces projets nous prouve qu’il ne faut jamais baisser les bras et que même si l’environnement est difficile et compliqué, tout est possible. Nous avons eu plaisir à vous rencontrer lors des deux portes ouvertes qui vous ont permis de découvrir ces réalisations, et nous espérons vous retrouver nombreux pour le concert du Big Band Christian Garros, à la salle Jacques Anquetil (halle de sports), le dimanche 12 janvier 2014, à 17h00, et dans cette même salle, pour la cérémonie des vœux, le vendredi 10 janvier 2014, à 18h30. Dans l’attente de ces moments de convivialité, nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Le maire, Jean-Guy Lecouteux RENDEZ-VOUS ET MANIFESTATIONS DE JANVIER 2014 Vendredi 10 Janvier 2014 à la Salle Jacques Anquetil à 18h30 Monsieur le Maire présentera ses vœux aux Belbeuviens Vous êtes toutes et tous cordialement invités *********************** Dimanche 12 Janvier 2014 à la Salle Jacques Anquetil à 17h00 Concert de Jazz BIG BAND Christian GARROS Réservation en mairie Tarif 10€ et – de 12 ans 5€ ************************ Samedi 18 Janvier 2014 à la Salle des Fêtes à partir de 20h00 Galette dansante organisée par le Foyer Rural *********************** -

Réf Dossier : 1960 N° Ordre De Passage : 7 N° Annuel : C2017 0516
Envoyé en préfecture le 14/11/2017 Reçu en préfecture le 14/11/2017 Affiché le ID : 076-200023414-20171114-C2017_0516-DE Réf dossier : 1960 N° ordre de passage : 7 N° annuel : C2017_0516 DÉLIBÉRATION RÉUNION DU CONSEIL DU 6 NOVEMBRE 2017 Urbanisme et habitat - Urbanisme - Commune d'Isneauville - Modification simplifiée n° 3 du Plan Local d'Urbanisme - Bilan de la mise à disposition du public : approbation Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune d'Isneauville a été approuvé par délibération du Conseil municipal du 8 décembre 2008, révisé-simplifié le 16 avril 2012, modifié-simplifié le 21 janvier 2013, modifié le 11 mars 2013, modifié-simplifié le 9 septembre 2013 et modifié le 12 décembre 2016. Par courrier du 16 juin 2017, la commune d'Isneauville a sollicité la Métropole Rouen Normandie afin d'engager une 3ème modification simplifiée de son PLU, afin de rectifier une erreur matérielle. Par arrêtés des 29 juin et 12 juillet 2017, le Président de la Métropole Rouen Normandie a prescrit la modification-simplifiée n° 3. Les modalités de la mise à disposition du public ont été définies par délibération du Conseil métropolitain en date du 23 mars 2016. Deux avis annonçant la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 3 ont été insérés dans les éditions du Paris Normandie des 3 et 24 juillet 2017, mis en ligne sur les sites internet de la commune d'Isneauville et de la Métropole Rouen Normandie et affiché aux sièges respectifs. La mise à disposition du public du projet de modification n° 3 du PLU de la commune d'Isneauville s'est déroulée du lundi 21 août au mercredi 20 septembre 2017 inclus, en mairie d'Isneauville ainsi qu'au siège de la Métropole Rouen Normandie où des registres ont été mis à disposition du public afin qu'il puisse y consigner ses observations. -

Incendie Lubrizol
Service régional et départemental de la communication interministérielle Rouen, le 27 septembre 2019 INCENDIE LUBRIZOL - ROUEN communiqué - 16h00 Hier, jeudi 26 septembre, un incendie s'est déclaré aux alentours de 02h40 au sein de l'entreprise Lubrizol, quai de France à Rouen. Cette entreprise est classée SEVESO seuil haut. Elle produit notamment des additifs pour lubrifiants. L’incendie est maintenant totalement maîtrisé. Le panache de fumée visible hier est dissipé. 120 sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur site afin de surveiller et éteindre les derniers foyers résiduels, refroidir les points chauds et procéder à des analyses en temps réel. Des analyses des fumées dégagées par l’incendie et des retombées de suie ont eu lieu très rapidement après le départ de l’incendie et certaines sont encore en cours. Se référer aux annexes jointes : Cartographie des différents points de mesures, tableau des mesures du 26 septembre 2019 (cellule mobile d’intervention chimique du SDIS 76). Des odeurs incommodantes, conséquence directe de l’extinction de l’incendie, peuvent être perçues. L’action des sapeurs-pompiers vise à limiter ces odeurs. L’usine ne stocke pas de produits radioactifs à des fins de production. Quelques instruments de mesure, sous scellés, comportaient des éléments radioactifs et n’ont pas été exposés au feu ni dégradés. Ils ont été vérifiés ensuite. Des barrages anti-pollution ont été mis en place sur la Seine. Quelques irisations résiduelles en aval peuvent subsister. Les écoles des 13 communes suivantes restent fermées ce jour, pour permettre le nettoyage des extérieurs des établissements : Rouen, Mont-Saint-Aignan, Bois- Guillaume, Bihorel, Isneauville, Quincampoix, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint- André-sous-Cailly, La Rue-Saint-Pierre, Saint-Germain-sous-Cailly, Cailly, Bosc- Guérard-Saint-Adrien, Canteleu, ainsi que celles des autres communes ayant fait ce choix. -
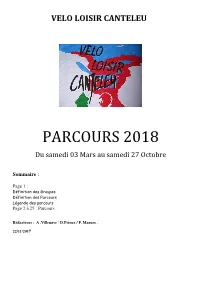
2018-Parcours.Pdf
VELO LOISIR CANTELEU PARCOURS 2018 Du samedi 03 Mars au samedi 27 Octobre Sommaire : Page 1 : Définition des Groupes Définition des Parcours Légende des parcours Page 2 à 25 : Parcours Rédacteurs : A .Villenave / D.Prieux / F. Mazure . 22/11/2017 Définition des Groupes : G1 : cyclosport (24 à 28 km/h) G2 : cyclorando (21 à 25 km/h ) G3 : cyclotourisme (18 à 22 km/h) Pour un groupe homogéne bien mesurer sa capacité à évoluer dans le groupe choisi . Définition des Parcours : Samedi et Dimanche : 3 parcours au choix P1/P2/P3 P1 : 30 à 50 kms P2 : 50 à 80 kms P3 : 60 à 100 kms Mercredi :Parcours unique adaptable en plus ou moins de kms selon envie des groupes . Légende des parcours Exemple : P1/ La Vaupaliére – St Martin – Sahurs n° SO 5 inv Km : 40 1 côte : 1 : 0 : 0 BAC : 0 n° SO 5inv Fichier GPX P1/P2/P3 : ordre de difficulté des parcours / principales localités traversées , SO 5 : désigne approximativement la direction du parcours suivie du numéro dans le fichier , 6 fichiers de directions avec : NE (Nord-Est) , N0 (Nord-Ouest ) , N (Nord), S(Sud) , S0( Sud-Ouest) , E (Est ) . inv signale que le parcours est le même que S05 mais avec le sens inversé . côte facile ( 3 à 4% ) côte moyenne ( 5 à 6 % ) côte difficile ( 7 % et plus) . BAC : signale le nombre de passage du bac sur le parcours . tourne à gauche, tourne à droite , X croisement . ( Barneville ) signale une direction sans passage dans la localité . Fichier GPX : Pour certains parcours des Fichiers Gpx de route ou de trace peuvent être fournis sur demande . -

Orival – Bourg-Achard
Samedi 02 mai 2020 P1/ Jumiéges-Yainville N° NO 23 48 2 ì : ìì : ììì : BAC : Km : côtes 2 0 0 0 Canteleu + St Martin de Boscherville + Duclair + Mesnil sous Jumiéges + Jumiéges + Yainville + St Paul + Du- clair + St Martin de Boscherville + Canteleu P2/ Quevillon –– St Paer –– Fréville n° NO 33 Km : 4 : : BAC : 64 côtes 3 1 : 0 0 Déniv : 640 m Canteleu + Quevillon + St Martin de Boscherville + Hénouville + La Fontaine + Duclair +D5 D63 + St Paer + Fréville + Blacqueville + D88 Villers-Ecalles + Villers + Le Paulu + St Pierre de Varengeville + Rou- mare + Montigny + Canteleu Samedi 02 mai 2020 P3 /Duclair - St Wandrille – Croix-Mare N° NO 7 70 5 ì : ìì :ììì BAC : Km : côtes 3 1 : 1 0 Canteleu + Montigny + La Vaupalière + St Pierre de Varengeville + Duclair + ìì Les Monts + ì Ronceray + Ste Marguerite + St Wandrille + ì Betteville + ( La Folletière + ; D5 puis : (aussi- tôt) + ììì Mont-de-l’If + Croix-Mare + Fréville + Blacqueville + Barentin + ì Côte rue Ambroise Paré + Les Campeaux + Roumare + La Vaupalière + Montigny + Canteleu Mercredi 06 mai 2020 Fontaine sous Préaux – Le Mont-Pereux n° E 34 Km : 3 : : BAC :N° E 56 côtes 2 1 : 0 0 34 Canteleu + Maromme ì + Les Long Vallons + Isneauville + Fontaine sous Préaux + vers St Martin du Vivier + ìì Le Mont Péreux + Isneauville + La Muette + D47 +Bosc- Guérard + Montville +ì Eslettes + St Jean-du-Cardonnay + La Vaupalière + Montigny + Canteleu. Samedi 09 mai 2020 P1/ Yville-Anneville n° S 25 Km : 2 : : BAC :N°S 50 côtes 2 0 : 0 2 25 Canteleu + Sahurs + La Bouille + La Ronce ì Yville + Route du Marais + Duclair + Le Paulu ì St Pierre de Va- rengeville + La Vaupaliére + Montigny + Canteleu P2/ La Bouille – La Bergerie - Bosgouet n° S 13 4 : : : N° S 13 BAC : 2 Km : 66côtes 3 1 0 Canteleu + Sahurs + La Bouille + Château Ro- bert Le Diable + Orival + Elbeuf entrée D913 puis suivre La Londe côte (La Bergerie.) La Londe vers N138 + RF de La Louveterie + Bos- gouet + sur N175 puis aussitôt + après pont sur autoroute + au croisement + Mare Foulon + Mauny + La Bouille + Sahurs + La Martel + Canteleu. -

Les Groupements De Communes De L'académie De Rouen
Les groupements de communes de l’académie de Rouen L’ordre des communes au sein du groupement de communes est important. Si vous demandez un groupement de communes, l’algorithme étudiera les possibilités d’affectation en fonction du barème bien sûr, mais aussi de l’ordonnancement des communes. Par exemple, si vous demandez Rouen et environs, le programme tentera de vous affecter d’abord à Rouen, puis à Bois-Guillaume, puis Bihorel… L’ordonnancement des communes est référencé dans le tableau ci-dessous. EURE Code du Dénomination du groupe de Composition du groupe de communes groupe de communes communes Pont-Audemer, Manneville-sur-Risle, Beuzeville (12 km), Monfort-sur-Risle (14 km), PONT-AUDEMER 027955 Cormeilles (17 km), Routot (17 km), Bourg-Achard (23 km), Grand-Bourgtheroulde et environs (31 km) BERNAY Bernay, Broglie (11 km), Thiberville (14 km), Beaumont-le-Roger (17 km), Brionne 027953 et environs (15 km), Le Mesnil-en-Ouche (18 km) Verneuil d’Avre et d’Iton, Breteuil-sur-Iton (11 km), Rugles (20 km), Mesnil sur Iton VERNEUIL et environs 027956 (19 km), Nonancourt (21 km) ÉVREUX Évreux, Gravigny, St-André-de-l’Eure (16 km), Conches-en-Ouche (18 km), Bueil 027951 et environs (22 km), Ezy-sur-Eure (31 km) VERNON Vernon, St-Marcel, Gasny, Pacy-sur-Eure (13 km), Gaillon (14 km), Le Val d’Azay 027952 et environs (ex Aubevoye) GISORS et environs 027957 Gisors, Etrépagny (13 km), Les Andelys (31 km) LOUVIERS Louviers, Le Vaudreuil, Val-de-Reuil, Pont-de-l’Arche, La Saussaye (14 km), 027954 et environs Romilly-sur-Andelle (18 km), Le Neubourg (22 km), Fleury-sur-Andelle (25 km) SEINE MARITIME Code du Dénomination du groupe de Composition du groupe de communes groupe de communes communes Rouen, Bois-Guillaume, Bihorel, Mont-Saint-Aignan, Bonsecours, Sotteville-lès- ROUEN Rouen, Darnétal, Le Petit-Quevilly, Déville-lès-Rouen, le Mesnil-Esnard, Canteleu, 076951 et environs Isneauville, Saint-Etienne-du-Rouvray, Maromme, Le Grand-Quevilly, Franqueville- Saint-Pierre, Petit-Couronne, Boos, Le Houlme, Grand-Couronne. -

Carte 2-55 : Préaux (Nord) Et La Vieux-Rue (Nord)
ZONES D’ÉROSION ET AXES DE RUISSELLEMENT · Carte 2-55 : Préaux (nord) et La Vieux-Rue (nord) 8 92 D le point du jour D monts mélins 1 D 2 8 1 2 5 A la loge aux pauvres le genetay morgny-la-pommeraye les haquets la cazerie bois de la houssaye la vieille vente 15 les tilleuls D terre neuve le vieux château les quesnots 8 2 A la houssaye bellevue D 5 la gruchette 3 bélévent ferme de la bellevue la tuilerie la vieux-rue 0 0 0 butte du moulin 5 1 / 1 A 1 e 6 l D l e forêt de préaux h la rue aux juifs 5 D1 la vieux-rue c E bois de la houssaye les monts - les vieilles terres 3 1 les quatorze hectares 0 2 le bout de la ville e r D61 préaux b m la folletière e v o N - terres de l'essart c l'épine à cailloux e b o R - 0 0.5 1 Kilomètre e t la mare aux boeufs le bosc t la mare au saule e b u A - y l bosc au moine l le trou de la haisette i la mare à quinze fosses a C E 0 0.5 1 Kilomètre G A S ZONES D’ÉROSION ET AXES DE RUISSELLEMENT · Carte 2-56 : Préaux (sud) terres de l'essart l'épine à cailloux la mare aux boeufs le bosc la mare au saule le trou de la haisette la mare à quinze fosses le quesnay le mont ménin herbage du piège le trou de rouen plaine de l'épine ferme des communes le parquet ferme de l'essart la laie D62 les communaux château guillerville bois breton saint-saire les communes D 5 le bois breton 3 D les coutumes 9 1 puits de l'aire le patibulaire 0 0 le carrouget 0 7 D 5 1 / 1 e petite ferme du puits de l'aire l l château bimare roncherolles-sur-le-vivier e h c E - 3 1 0 2 la chauvelle e r le village b D 91 D m D15 5 e 3 v o quévreville -

Seine-Maritime Et Intercommunalités
Eu Le Tréport Étalondes Ponts-et-Marais Flocques CC Villes Sœurs Criel-sur-Mer Saint-Rémy-Boscrocourt Saint-Pierre-en-Val Incheville Touffreville-sur-Eu Monchy-sur-Eu Baromesnil Canehan Millebosc Longroy Le Mesnil-Réaume Saint-Martin-le-Gaillard Guerville Petit-Caux Cuverville-sur-Yères Melleville Bazinval Seine-Maritime et intercommunalités Sept-Meules Monchaux-Soreng Villy-sur-Yères CC Falaises du Talou Rieux Grèges Dieppe Sauchay Avesnes-en-Val Blangy-sur-Bresle Varengeville-sur-Mer Grandcourt Hautot-sur-Mer Martin-Église Ancourt Bailly-en-Rivière Sainte-Marguerite-sur-Mer Bellengreville Quiberville Rouxmesnil-Bouteilles Saint-Ouen-sous-Bailly Dancourt Nesle-Normandeuse Envermeu Saint-Aubin-sur-Mer Fresnoy-Folny Longueil CA Région Dieppoise Les Ifs Saint-Riquier-en-Rivière Pierrecourt Arques-la-Bataille Sotteville-sur-Mer Le Bourg-Dun Ouville-la-Rivière Saint-Aubin-sur-Scie Puisenval Veules-les-Roses Saint-Aubin-le-Cauf Douvrend Preuseville Saint-Valery-en-Caux Offranville Saint-Nicolas-d'Aliermont CC Interrégionale Saint-Denis-d'Aclon Wanchy-Capval Manneville-ès-Plains La Chapelle-sur-Dun Paluel Martigny Ingouville Ambrumesnil Tourville-sur-Arques Blosseville Dampierre-Saint-Nicolas Aumale-Blangy-sur-Bresle Avremesnil Sauqueville Fallencourt Hodeng-au-Bosc Veulettes-sur-Mer Colmesnil-Manneville Saint-Sylvain Cailleville Saint-Pierre-le-Vieux Aubermesnil-Beaumais Réalcamp Malleville-les-Grès Gueures Saint-Jacques-d'Aliermont CC Londinières Gueutteville-les-Grès Foucarmont Campneuseville Auberville-la-Manuel La Gaillarde Thil-Manneville -

Ligne 71 Neufchatel En Bray Rouen
71 NEUFCHATEL-EN-BRAY ROUEN HORAIRES VALABLES DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2021 INCLUS Lu au Ve Lu au Ve Lu au Sa Lu au Ve Lu au Ve Sa Lu au Sa Lu au Ve Lu au Ve Lu au Ve Lu au Ve Sa Lu au Sa Lu au Sa Période de fonctionnement PS-VS TA TA PS-VS TA TA TA TA TA TA TA TA TA PS-VS NEUFCHATEL-EN-BRAY / Place de la Libération 06:25 07:05 08:10 ESCLAVELLES / Beau Séjour 06:31 | 08:15 ESCLAVELLES / Les Hayons 06:32 | 08:18 MAUCOMBLE / Centre | 06:29 | 08:21 ST-SAENS / Centre | 06:35 07:12 | 08:25 ST-MARTIN-OSMONVILLE / Église | 06:42 07:22 | 08:30 ROCQUEMONT / Le Fresneau | | | | 08:35 BUCHY / Collège | 06:26 | 06:50 | | 07:30 | BUCHY / Église 06:47 06:27 | 06:51 | 07:31 07:31 | 08:30 STE-CROIX-SUR-BUCHY / École | 06:30 | 06:53 | 07:33 07:34 | 08:33 ST-GERMAIN-DES-ESSOURTS / Centre | 06:38 | 07:02 | 07:42 07:42 | 08:42 LONGUERUE / École | 06:43 | 07:06 | 07:46 07:45 | 08:46 LE VIEUX-MANOIR / Saint-Aubin | 06:44 | 07:07 | 07:47 07:46 | | LA RUE-ST-PIERRE / Le Bout Rogne | 06:46 | 07:09 | 07:49 07:49 | 08:49 LA RUE-ST-PIERRE / Mairie | | 06:46 06:46 | | | | | | 08:50 BOSC-BERENGER / Mairie École | | | | 06:50 | 07:31 | | | | CRITOT / Calvaire | | | | 06:53 | 07:34 | | | | CRITOT / Carrefour | | | | 06:55 (B) | 07:37 | | | | ROCQUEMONT / Centre | | | | 06:58 | | | | | | ROCQUEMONT / Le Fresneau | | | | 07:00 | | | | | | CAILLY / Le Floquet | | | | | | 07:38 | | | | CAILLY / Centre | | 06:51 06:51 | | 07:15 07:40 | | | 08:55 ST-ANDRÉ-SUR-CAILLY / Centre | | 06:56 06:56 | | 07:21 07:46 | | | 09:00 ST-ANDRÉ-SUR-CAILLY / Vert Galant | 06:50 06:57