Le Cas D'ai Weiwei Par Catherine Déry Département D'histoi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Eventos De La Vida De Ai Weiwei E Historia China Contemporánea
Eventos de la vida de Ai Weiwei e historia china contemporánea Alcatraz 2013 2013 Ai Weiwei presenta S.A.C.R.E.D. en un evento colateral El 30 de noviembre de 2013, Ai Weiwei coloca un ramo de la 55ª Bienal de Venecia en la Iglesia de de flores frescas en la cesta de la bicicleta fuera de la Sant’Antonin en Castello, el 29 de mayo. Seis grandes entrada de su estudio. Jura continuar este acto hasta dioramas reproducen escenas de su vida diaria que su pasaporte y su derecho a viajar libremente sean mientras estuvo detenidos en 2011. Ai no puede asistir restaurados. a numerosas exposiciones durante el periodo de cinco Mao Zedong años en que tiene prohibido viajar al extranjero. Juegos Olímpicos Ai Weiwei 2011 2014 1966-1976 Mao Zedong pone en marcha la Gran Revolución Cultural Proletaria en mayo de 1966. El movimiento dura diez años, con el objetivo declarado de imponer el comunismo al eliminar los elementos capitalistas, tradicionales y culturales de la sociedad china. Durante la fase más radical (1966-1969), millones de 1956-1957 personas son acusadas posteriormente de participar Entre 1956 y 1957, el Partido Comunista de China en actividades “burguesas”, sufren humillaciones 2010 2010-2011 2014 alienta a sus ciudadanos a expresar sus opiniones y públicas, encarcelamientos, torturas, incautaciones Ai Weiwei presenta Sunflower Seeds, una instalación a El gobierno de Shanghái informa a Ai Weiwei en El 26 de abril de 2014, se inaugura la exposición “15 criticar abiertamente las políticas nacionales. Este de bienes y diversas formas de hostigamiento. -

The Italian Approach to Libya
Études de l’Ifri "PLAYING WITH MOLECULES" The Italian Approach to Libya Aldo LIGA April 2018 Turkey/Middle East Program The Institut français des relations internationales (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non-governmental, non-profit organization. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Taking an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. ISBN: 978-2-36567-861-2 © All rights reserved, Ifri, 2018 Cover: “A scratched map of Libya hanging on the walls inside a reception centre for unaccompanied and separated migrant and refugee minors in Western Sicily”. © Aldo Liga. How to quote this document: Aldo Liga, “‘Playing with Molecules’: The Italian Approach to Libya”, Études de l’Ifri, Ifri, April 2018. Ifri 27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE Tel.: +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax: +33 (0)1 40 61 60 60 Email: [email protected] Website: Ifri.org Author Aldo Liga is a freelance analyst on Middle East and North Africa issues and energy. He works for a Swiss-NGO which implements assessment, monitoring & evaluation and organisational capacity-building programmes. He holds a MA in International Security from Sciences Po Paris and a BA in Political Science from the “Cesare Alfieri” School of Political Sciences of Florence. -

Beijing Spring Documents a Forgotten Struggle for Freedom in China
FOR IMMEDIATE RELEASE Beijing Spring Documents a Forgotten Struggle for Freedom in China Never-Before-Seen Footage Sheds Light on a Generation of Artists and Activists Who Set the Stage for Tiananmen Square First protest since the revolution. Photo courtesy Wang Rui (1979) (NEW YORK, NY – September 18, 2017) – AC Films is finalizing post-production on a new feature-length documentary, Beijing Spring. In 1978, two years after Mao Zedong’s death, a remarkable shift began in China. The new government under Deng Xiaoping, retreating from the violence of the Cultural Revolution, promised reform, and loosened restrictions on political and artistic speech. Deng experimented with free speech by allowing liberal ideas and avant-garde art to be posted along a wall in central Beijing, a space that became known as the Democracy Wall. In this moment of newfound freedom, artists and activists (including Wei Jingsheng and a young Ai Weiwei) dared to voice their ideas, until the government cracked down again, shutting the door on this brief moment of reform known as the Beijing Spring. Now, forty years later, Beijing Spring tells the story of the Democracy Wall, and the artists and activists who created it, as has never been possible before: with reams of never-before-seen 16mm footage, hidden from the Chinese authorities for decades. Beijing Spring marks the directorial debut of Andy Cohen, Executive Producer of artist Ai Weiwei’s Human Flow, which debuted at both the Venice Film Festival and Telluride this September (to be released by Amazon), and the Oscar short-listed films Hooligan Sparrow and Never Sorry. -

That's My Life Jacket!
Critical Arts South-North Cultural and Media Studies ISSN: 0256-0046 (Print) 1992-6049 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/rcrc20 “That’s My Life Jacket!” Speculative Documentary as a Counter Strategy to Documentary Taxidermy Thomas Bellinck & An van Dienderen To cite this article: Thomas Bellinck & An van Dienderen (2019): “That’s My Life Jacket!” Speculative Documentary as a Counter Strategy to Documentary Taxidermy, Critical Arts, DOI: 10.1080/02560046.2019.1627474 To link to this article: https://doi.org/10.1080/02560046.2019.1627474 Published online: 01 Aug 2019. Submit your article to this journal Article views: 185 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rcrc20 CRITICAL ARTS https://doi.org/10.1080/02560046.2019.1627474 “That’s My Life Jacket!” Speculative Documentary as a Counter Strategy to Documentary Taxidermy Thomas Bellinck and An van Dienderen School of Arts, KASK & Conservatorium, Ghent, Belgium ABSTRACT KEYWORDS Despite the socially committed attitude many documentary artists Speculative documentary; take, documentaries often end up underpinning a large-scale practice-based research; Ai epistemological enterprise linked to global capitalism and Western Weiwei; documentary colonialism (H. Steyerl, “Documentary Uncertainty,” Re-visiones pioneers; cross-disciplinary research; taxidermic (2011) www.re-visiones.net). Ai Weiwei’s Human Flow (2017), an “ ” documentary; documentary award-winning documentary about the refugee crisis , provides theatre; documentary film; an insightful case study. The film’s well-intended activism visual economy becomes a mere trope that does not prompt any change. The formal strategies deployed do not address the power differentials between the filmmakers and their subjects, so that neither subjects nor viewers are left with any form of agency. -

Universidade Federal Da Bahia Crítica.Ba
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA FACULDADE DE COMUNICAÇÃO MARINA MONTENEGRO LOPES MACHADO CRÍTICA.BA: AGREGADOR DE CRÍTICAS BAIANAS DE CINEMA Salvador 2018 MARINA MONTENEGRO LOPES MACHADO CRÍTICA.BA: AGREGADOR DE CRÍTICAS BAIANAS DE CINEMA Memorial descritivo apresentado como requisito parcial para obtenção de grau de bacharel do curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia. Orientador: Prof. Dr. Guilherme Maia Salvador 2018 2 RESUMO Crítica.Ba (www.critica-ba.com) é um agregador de críticas cinematográficas baianas. Livre e gratuita, a plataforma online visa reunir críticas de filmes escritas por críticos baianos, funcionando como um espaço que guia o público para os trabalhos desses profissionais. No site, o público pode encontrar também perfis dos críticos que atuam no cenário baiano, além de notícias sobre as realizações desses profissionais. O objetivo do projeto é valorizar e fortalecer a crítica produzida na Bahia, além de divulgar o trabalho dos críticos baianos e possibilitar um espaço de discussão entre críticos e público. Palavras-chave: crítica cinematográfica, cinema, crítico, jornalismo cultural, plataforma, agregador, site, Bahia. 3 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO 5 1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 8 1.1 A Crítica Cinematográfica na Web 8 1.1.1 Cibercinefilia 11 1.1.2 A relação do público com a crítica na internet 15 1.1.3 Agregadores de críticas 19 2. O PROJETO 33 2.1 Mapeamento e Critérios 35 2.2 Características da Plataforma 38 3. O PERCURSO 42 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 47 5. REFERÊNCIAS 49 6. APÊNDICES 52 4 APRESENTAÇÃO O presente trabalho apresenta a memória do desenvolvimento da plataforma digital Crítica.Ba (www.critica-ba.com) – um agregador de críticas cinematográficas produzidas por críticos baianos. -

Artist Statement Wednesday 19.02.2020 Thursday 20.02.2020 Friday 21.02.2020 Saturday 22.02.2020 Sunday 23.02.2020 Monday 24.02.2
WEDNESDAY 19.02.2020 FRIDAY 21.02.2020 SUNDAY 23.02.2020 MONDAY 24.02.2020 Saal 1 Saal 1 Saal 1 Saal 1 14:00 D Fairytale [2007, 166min] 12:00 D The Rest [2019, 78min] 14:15 D Little Girl’s Cheeks [2008, 78min] 16:30 D Calico Cat [2010, 68min] 17:15 D Disturbing the Peace [2009, 77min] 13:45 D Little Girl’s Cheeks [2008, 78min] 16:00 D Human Flow [2017, 140min] 18:00 D Little Girl’s Cheeks [2008, 78min] 18:45 D So Sorry [2011, 54min] 15:30 D Disturbing the Peace [2009, 77min] 18:45 D One Recluse [2010, 184min] 19:45 D Disturbing the Peace [2009, 77min] 20:00 D The Rest [2019, Berlin Premiere, 78min] 17:15 D Stay Home [2013, 77min] 22:15 D Disturbing the Peace [2009, 77min] 21:30 D Peaceful Land [2011, 102min] 21:45 D One Recluse [2010, 184min] S Ximei Getting Married [2015, 26 min] 19:15 D Fairytale [2007, 166min] Saal 2 Saal 2 Saal 2 22:30 D Human Flow [2017, 140min] 14:30 D Calico Cat [2010, 68min] 13:15 D Human Flow [2017, 140min] 14:00 D Ordos 100 [2011, 60min] 18:30 D Play of the Play [2014, 60min] 16:00 D The Mala Desert [2012, 61min] 15:15 D Peaceful Land [2011, 102min] Saal 2 19:45 D Peaceful Land [2011, 102min] 17:15 D You Know What I Mean [2014, 75min] 17:15 D Ai Weiwei’s Appeal ¥15,220,910.50 11:00 D The Mala Desert [2012, 61min] 21:45 O Ai Weiwei: Yours Truly [2019, 76min] 18:45 D The Rest [2019, 78min] [2014, 127min] 12:15 D Play of the Play [2014, 60min] 20:30 D Ordos 100 [2011, 60min] 19:45 D Stay Home [2013, 77min] 13:30 D You Know What I Mean [2014, 75min] Saal 3 21:45 D Ai Weiwei’s Appeal ¥15,220,910.50 S Ximei Getting -

The Art of Dissent Ai Weiwei, Rebel with a Cause1
Chapter 12 The art of dissent Ai Weiwei, rebel with a cause1 Sandra Ponzanesi The artist as intellectual In December 2018, the prominent Chinese artist Ai Weiwei unveiled a flag to mark 70 years of the Universal Declaration of Human Rights. The light-blue flag has a footprint made up of white dots at its center. The design was inspired by Ai’s time spent visiting Rohingya refugees in Bangladesh, who were forced to flee attacks inMyanmar . While he was in the refugee camp, he noticed that nearly everyone was barefoot. He was inspired to see the bare footprint as a symbol for displaced people but also as a symbol of our common humanity. He took 100 muddy footprints of people, young and old, in various locations, and combined them in his design. Ai hopes his design will act as a visual reminder for people to educate them- selves on the meaning of human rights, to offer hope and to encourage further debate on the importance of human rights. “It’s about human identity,” says Ai in a video released to accompany the launch. “Human rights is not a given property, but rather something we can only gain from our own defense and fight [. .] Not many ideas can relate to this very broad, but also very special, topic.”2 Elsewhere he explains, “As humans, as long as we can stand up or can make a move, we have our footprint.”3 The flag was flown for seven days in June 2019 to mark the 70th anniversary, as part of the human rights grassroots’ awareness campaign called Fly the Flag.4 Ai Weiwei commented: “I am honored to have the opportunity to design a flag for the 70th anniversary for the Universal Declaration of Human Rights.” He added, “as we all come to learn, human rights are the precious result from generation after generation’s understanding of the human struggle. -

B E Y O N D T H E B O U N D S O F S T a T U S
B E Y O N D T H E B O U N D S O F S T A T U S T H E H B S W A Y CHARINA MOLINA MICHELLE NWUFO BROOKLYN ROBERTSON JOCELYN SILVA ALLY ZWEIGLE • T H E I N T E R G E N E R A T I O N A L T R A N S M I S S I O N O F L E G I S L A T I O N , B I O L O G Y , A N D I D E N T I T Y B E T W E E N R E F U G E E W O M E N A N D C H I L D R E N F R O M W A R - T O R N N A T I O N S • Cover image sourced from (International Rescue Committee, 2018, p. 1) EDITORS' NOTE AS STUDENTS OF THE SOCIETY AND GENETICS DEPARTMENT AT UCLA, WE UNDERSTAND THE CRITICAL NECESSITY OF ADDRESSING SOCIAL INEQUALITIES, AS THEY OFTEN TRANSLATE INTO OUR BODIES AND ENVIRONMENTS. WE HAVE TAKEN COURSES ON THE TRANSACTIONAL RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND CHRONIC HEALTH OUTCOMES. WE HAVE EXPLORED MEDICAL AND HEALTH-RELATED ISSUES FROM A BIOSOCIAL FRAMEWORK. WE HAVE CHALLENGED OURSELVES TO LOOK BEYOND A WESTERN, EUROCENTRIC, PATRIARCHAL, AND ABLEIST POINT OF VIEW. THIS PROJECT IS A CULMINATION OF OUR DEDICATION TO LEARNING MORE ABOUT THE WORLD AROUND US, WHILE SIMULTANEOUSLY ATTEMPTING TO SPREAD AWARENESS ON SILENCED ISSUES. -
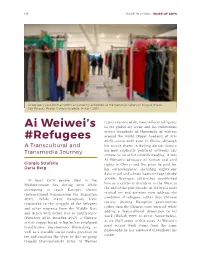
Article36.Pdf
196 MADE IN CHINA - WORK OF ARTS Ai Weiwei’s Laundromat (2016) as currently exhibited at the National Gallery in Prague (Trade Fair Palace). Photo: Giorgio Strafella, 14 April 2017. represents one of the most influential figures Ai Weiwei’s in the global art scene and his exhibitions attract hundreds of thousands of visitors around the world (Royal Academy of Arts #Refugees 2015)—since 2015 even in China, although A Transcultural and his recent shows in Beijing do not feature Transmedia Journey his most explicitly ‘political’ artworks. His stature as an artist notwithstanding, it was Ai Weiwei’s advocacy of human and civil Giorgio Strafella rights in China—and the price he paid for Daria Berg his outspokenness, including eighty-one days in jail and a brain haemorrhage (Grube 2009b; Branigan 2011)—that established At least 5,079 people died in the him as a celebrity dissident in the West at Mediterranean Sea during 2016 while the end of the past decade. Ai Weiwei’s most attempting to reach Europe’s shores critical art and activism now address the (International Organisation for Migration condition of refugees, rather than Chinese 2017). While many Europeans have society, putting European governments responded to the struggle of the refugees rather than the Chinese state ‘on trial’ while and other migrants from the Middle East adding a ‘transcultural’ dimension to his and Africa with either fear or indifference work (Welsch 1999; Ai 2013). Nevertheless, (Poushter 2016; Dearden 2017), a Chinese as we shall argue in this essay, Ai Weiwei’s artiste engagé based in Berlin has employed most recent work stems from the same installations, documentary filmmaking, as philosophy he has espoused throughout his well as a sizeable social media presence to career. -

Ai Weiwei “Refutation”
Tang Contemporary Art presents: Ai Weiwei “Refutation” Artist: Ai Weiwei Curator: Cui Cancan Exhibition Dates: March 26 – April 30, 2018 Location: 10/F, H Queen’s, 80 Queen’s Road Central, Central, Hong Kong Opening Reception: Monday, March 26, 6 – 8 pm FOR IMMEDIATE RELEASE (HONG KONG – March 8, 2018): Tang Contemporary Art is proud to announce “Refutation,” Ai Weiwei’s second solo exhibition from March 26 to April 30, 2018 at the gallery’s new space in H Queen’s. Curated by Cui Cancan, this exhibition will be Ai’s third collaboration with Tang Contemporary Art after "Ai Weiwei” in Beijing (2015) and “Wooden Ball” in Hong Kong (2015). In July 2015, after receiving his passport back from Chinese authorities, Ai relocated to Berlin, Germany. In December 2015, Ai traveled with his son and girlfriend to the Greek island of Lesbos where he first encountered refugees face-to-face. He watched as boats carrying refugees began arriving on shore. He recorded video with his phone as the refugees, including the very young and the very old, climbed out of the simple inflatable boat. This event sparked his later actions, which are a direct response to the largest refugee crisis in human history. Since then, his team has shot nearly 1,000 hours of footage in 40 refugee camps across 23 countries. In 2017, Ai Weiwei presented the installation Law of the Journey, a black inflatable boat 60 meters long and 3 meters wide carrying 258 humanoid figures, at the National Gallery in Prague. Law of the Journey (Prototype A), 1640 x 580 x 350 cm, reinforced PVC, 2016 ⾏之道 (模型 A),1640 x 580 x 350, 強化 PVC, 2016 From a cellar in Xinjiang to an underground studio on New York’s 7th Street to his present underground studio in Berlin, Ai Weiwei has been a refugee who has not stopped moving. -
H a I N E S G a L L E
H A I N E S G A L L E R Y AI WEIWEI Chinese, b. 1957 Lives and works in Berlin, Germany EDUCATION Enrolled in Beijing Film Academy, 1978 Lived in NYC, NY, 1981-1993 Parsons School of Design, 1983 Returned to China, 1993 Founded China Art Archives and Warehouse, Beijing, China, 1994 SELECTED SOLO EXHIBITIONS 2020 (upcoming) Ai Weiwei, Royal Museum of Fine Arts of Belgium, Brussels, Belgium 2019 Ai Weiwei: Zodiac (2018) LEGO, The John & Mabel Ringling Museum of Art, Sarasota, FL Ai Weiwei: Roots, Lisson Gallery, London, UK Ai Weiwei: Bare Life, Kemper Art Museum at Washington University, St. Louis, MO Ai Weiwei: New York Photographs 1983-1993, Asia Society Museum, New York, NY Ai Weiwei, K20/K21, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Dusseldorf, Germany Resurrecting Memories, Museo Universitario Arte Contemporáneo, Mexico City, Mexico Ai Weiwei: Unbroken, Gardiner Museum, Toronto, Canada Raiz, Belo Horizonte, Brazil 2018 Raiz, OCA, Sao Paulo, Brazil UTA Artist Space, Los Angeles, CA Jeffrey Deitch Projects, Los Angeles, CA Ai Weiwei: Life Cycle, Marciano Art Foundation, Los Angeles, CA Ai Weiwei: Grapes, Wadsworth Atheneum, Hartford, CT Ai Weiwei: Rebar and Case, Hudson D. Walker Gallery, Fine Arts Work Center, Provincetown, MA Ai Weiwei Fan-Tan, MuCEM – Museum of European and Mediterranean Civilizations, Marseille, France Trace, site-specific installation organized by Hirshhorn Museum and Sculpture Garden and Alphawood Exhibitions, Chicago, IL Ai Weiwei: Circle of Animals/Zodiac Heads: Gold, Farnsworth Art Museum, Rockland, ME Refutation, Tang Contemporary Art, Hong Kong, China Laundromat, Fire Station at Garage Gallery, organized by Qatar Museum, Doha, Qatar 2017 Ai Weiwei “Inoculation”, Galleria Continua, Buenos Aires, Argentina Ai Weiwei: Mirror, FOMU FotoMuseum Antwerp, Belgium Good Fences Make Good Neighbors, Public Art Fund, New York, NY Ai Weiwei: It’s Always The Others, Cantonal Fine Arts Museum, Lausanne, Switzerland Ai Weiwei: On Porcelain, Sakıp Sabancı Museum, Istanbul, Turkey Ai Weiwei: Soleil Levant. -

International Refugee Law and Policy Spring 2021 Thursdays 3:30 – 6:20 PM PST Remote Via Canvas Zoom
INTL 190: International Refugee Law and Policy Spring 2021 Thursdays 3:30 – 6:20 PM PST Remote via Canvas Zoom Instructor: Krista Kshatriya Email: [email protected] Office Hours: Thursdays, 8-9 pm PST (Zoom) or by appointment Overview The coronavirus pandemic has changed our lives in ways we never imagined. Still, people around the world continue to flee their homes because of fear of persecution and in search of safety. International refugee policy determines the fate of more than 30 million displaced people and how the global community treats some of our most vulnerable members. In this course, we research the historical context, legal issues, and current policies impacting refugees around the world. In so doing, students will gain in-depth and interdisciplinary knowledge of: (1) refugee and asylum law, (2) the interaction of domestic and international institutions, and (3) the interplay between federal law, policy, and administration. This course also provides a foundation of legal studies through court case analysis and argument. This course highlights a significant global topic at the intersection of political and historical issues, armed conflict, immigration policy, human rights law, state sovereignty, and national security. Students will explore current international refugee situations and analyze policy questions in the context of binding international obligations regarding protection and national political concerns. To understand the legal framework that has developed in response to forced migration, students will examine legal terms derived from international agreements, statutes, administrative decisions, and interpretations by federal courts. The course will lay out the international origins of refugee law, including the history and development of the United Nations 1951 Refugee Convention, the 1967 Protocol, and the U.S.