Philippe Rahm
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Implementation of a Random Forest Classifier to Examine Wildfire Predictive Modeling in Greece Using Diachronically Collected Fire Occurrence and Fire Mapping Data
Implementation of a Random Forest classifier to examine wildfire predictive modeling in Greece using diachronically collected fire occurrence and fire mapping data Authors: Alex Apostolakis, Stella Girtsou, Charalampos Kontoes, Ioannis Papoutsis, Michalis Tsoutsos e-mails: {alex.apostolakis, sgirtsou, kontoes, ipapoutsis, mtsoutsos}@noa.gr Beyond center of excelence, IAASARS, National Observatory of Athens, Greece Presenter: Alex Apostolakis Recent Forest fire disasters 2019 Bush fires in New South Wales of Australia burned about 1.65 million hectares 2019 Brazilian Space Agency has reported an 83% increase in fire occurrences compared to the same period of the previous year. 2018 Attica wildfires spread up to a speed of 124 km/h resulting to more than a hundred casualties. Climate change impact The problem of the wildfires becomes considerably important if we account for the climate change scenarios which suggest substantial warming and increase of heat waves, drought and dry spell events across the entire Mediterranean in the future years. Model categories for fire risk prediction Theoretical (or physics-based) : Theoretical models are entirely based on equations that describe the physics of the related to the fire ignition physical phenomena like fluid mechanics, combustion and heat transfer Data-driven models : Data-driven models (also known as empirical models before the data science developments) are purely based on the correlations between data extracted from historical fire records and their related parameters. Machine learning models belong to this category. Why Machine Learning models Machine Learning algorithms are designed to automatically formulate the complex mathematical relations between the input parameters. In Physical-based models the mathematics of those relations should be known in advance. -

Disaster Preparedness, Resilience, and Response Forum Report
Columbia World Projects: Disaster Preparedness, Resilience, and Response Forum Report August 15, 2019 Foreword Dear Reader, On behalf of Columbia World Projects (CWP), we are pleased to present the following report on our Forum on Disaster Preparedness, Resilience, and Response, one of an ongoing series of meetings dedicated to bringing together academia with partners from government, non- governmental and intergovernmental organizations, the media, and the private sector to identify projects designed to tackle fundamental challenges facing humanity. Natural disasters and public health emergencies impact tens of millions of people each year. At the individual level, the impact is often felt physically, mentally, and emotionally, and can destroy homes and businesses, wipe out financial resources, uproot families, and cause lasting injuries and even deaths. At the community and regional level, the impact can be equally devastating, inflicting enormous environmental and structural damage; stalling or even reversing a society’s economic growth and development; and producing and exacerbating poverty and instability. While natural disasters and public health emergencies have been a consistent feature of human existence, the frequency and intensity of such incidents have increased over the last few decades, in significant part as a result of climate change and growing mobility. All of this has made managing disasters more urgent, more expensive, and more complex. On June 10, 2019, CWP invited approximately 35 experts from a range of fields and disciplines to take part in a Forum with the aim not only of deepening our understanding of natural disasters and public health emergencies, but also of proposing concrete ways to improve the lives of people affected by these events. -
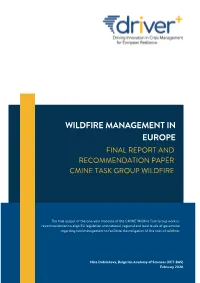
Wildfire Management in Europe Final Report and Recommendation Paper Cmine Task Group Wildfire
WILDFIRE MANAGEMENT IN EUROPE FINAL REPORT AND RECOMMENDATION PAPER CMINE TASK GROUP WILDFIRE The final output of the one-year mandate of the CMINE Wildfire Task Group work is a recommendation to align EU legislation and national, regional and local levels of governance regarding land management to facilitate the mitigation of the risks of wildfires.. Nina Dobrinkova, Bulgarian Academy of Sciences (IICT-BAS) February 2020 TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................................................. 3 ACKNOWLEDGEMENTS .............................................................................................................................. 4 INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 7 CONTEXT OF THE TASK GROUP ........................................................................................................................... 7 GOAL OF THE TASK GROUP .................................................................................................................................. 7 EUROPEAN FIRES 'STATE OF THE ART' .............................................................................................................. 8 GENERAL INFORMATION ON WILDFIRES ........................................................................................................ 9 WILDFIRE CHARACTERISATION ........................................................................................................................ -

Sorli Fil1l1ivffisfifiy ...I
\;11 ttl I / ~ sorlI fil1l1IVffiSfifiY ...i ......._---------------- -- - United States Department of Fire Agriculture Forest Service Management S An international quarterly periodical Volume 50, NO.1 Notes devoted to forest fire management 1989 Contents 2 Fire Management: Strength Through Diversity 53 Forest Fire Simulation Video and Graphic System Harry Croft L.F. Southard 6 Major Transitions in Firefighting: 1950 to 1990 56 Smoke Management Modeling in the Bureau of Jack F. Wilson Land Management Allen R. Riebau and Michael L. Sestak 9 A Look at the Next 50 Years John R. Warren 59 Smoke From Smoldering Fires-a Road Hazard Leonidas G. Lavdas 13 Warm Springs Hotshots Holly M. Gill 63 Author Index-Volume 49 16 Wildfire Law Enforcement-Virginia Style 65 Subject Index-Volume 49 John N. Graff 19 Fire Management in the Berkeley Hills Short Features Carol L. Rice, 1 Thank you, Fire Management Notes 21 Light-Hand Suppression Tactics-a Fire Allan J West Management Challenge Francis Mohr 5 Workforce Diversity-What We Can Do! L.A. Amicare//a 31 Lightning Fires in Saskatchewan Forests c.i Oglivie 8 The Fire Equipment Working Team William Shenk 37 GSA-a Partner in Wildfire Protection 11 Smokejumper Reunion-June 1989 Larry Camp Janice Eberhardt 38 Predicting Fire Potential 15 NWCG's Publication Management System: Thomas J. Rios A Progress Report Mike Munkres 42 Wildfire 1988-a Year To Remember Arnold F. Hartigan 55 Identifying Federal Excess Personal Property Francis R. Russ 45 Documenting Wildfire Behavior: The 1988 Brereton Lake Fire, Manitoba Kelvin G. Hirsch Special Features 49 Fire Observation Exercises-a Valuable Part of 24 The Way Wc Were Fire Behavior Training Patricia L. -

First Main Title Line First Line Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2014
First Main Title Line First Line Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2014 Joint report of JRC and Directorate-General Environment 2015 Report EUR 27400 EN European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability Contact information San-Miguel- Ayanz Jesús Address: Joint Research Centre, Via Enrico Fermi 2749, TP 261, 21027 Ispra (VA), Italy E-mail: [email protected] Tel.: +39 0332 78 6138 JRC Science Hub https://ec.europa.eu/jrc Legal Notice This publication is a Technical Report by the Joint Research Centre, the European Commission’s in-house science service. It aims to provide evidence-based scientific support to the European policy-making process. The scientific output expressed does not imply a policy position of the European Commission. Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use which might be made of this publication. All images © European Union 2015 JRC97214 EUR 27400 EN ISBN 978-92-79-50447-1 (PDF) ISBN 978-92-79-50446-4 (print) ISSN 1831-9424 (online) ISSN 1018-5593 (print) doi:10.2788/224527 Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 © European Union, 2015 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Abstract This is the 15th issue of the EFFIS annual report on forest fires for the year 2014. This report is consolidated as highly appreciated documentation of the previous year's forest fires in Europe, Middle East and North Africa. In its different sections, the report includes information on the evolution of fire danger in the European and Mediterranean regions, the damage caused by fires and detailed description of the fire conditions during the 2014 fire campaign in the majority of countries in the EFFIS network The chapter on national reporting gives an overview of the efforts undertaken at national and regional levels, and provides inspiration for countries exposed to forest fire risk. -

Environment International Mapping Combined Wildfire and Heat Stress
Environment International 127 (2019) 21–34 Contents lists available at ScienceDirect Environment International journal homepage: www.elsevier.com/locate/envint Mapping combined wildfire and heat stress hazards to improve evidence- based decision making T ⁎ Claudia Vitoloa, , Claudia Di Napolia,b, Francesca Di Giuseppea, Hannah L. Clokeb,c,d,e, Florian Pappenbergera a European Centre for Medium-range Weather Forecasts, Reading RG2 9AX, UK b Department of Geography and Environmental Science, University of Reading, Reading, UK c Department of Meteorology, University of Reading, Reading, UK d Department of Earth Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden e Centre of Natural Hazards and Disaster Science, CNDS, Uppsala, Sweden ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: Heat stress and forest fires are often considered highly correlated hazards as extreme temperatures play a key Wildfire role in both occurrences. This commonality can influence how civil protection and local responders deploy Multi hazard resources on the ground and could lead to an underestimation of potential impacts, as people could be less Geospatial analysis resilient when exposed to multiple hazards. In this work, we provide a simple methodology to identify areas Decision making prone to concurrent hazards, exemplified with, but not limited to, heat stress and fire danger. We use the Fire weather index (FWI) combined heat and forest fire event that affected Europe in June 2017 to demonstrate that the methodology can Universal thermal climate index (UTCI) be used for analysing past events as well as making predictions, by using reanalysis and medium-range weather forecasts, respectively. We present new spatial layers that map the combined danger and make suggestions on how these could be used in the context of a Multi-Hazard Early Warning System. -
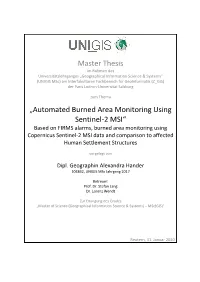
Master Thesis „Automated Burned Area Monitoring Using Sentinel-2
Master Thesis im Rahmen des Universitätslehrganges „Geographical Information Science & Systems“ (UNIGIS MSc) am Interfakultären Fachbereich für GeoInformatik (Z_GIS) der Paris Lodron-Universität Salzburg zum Thema „Automated Burned Area Monitoring Using Sentinel-2 MSI“ Based on FIRMS alarms, burned area monitoring using Copernicus Sentinel-2 MSI data and comparison to affected Human Settlement Structures vorgelegt von Dipl. Geographin Alexandra Hander 104842, UNIGIS MSc Jahrgang 2017 Betreuer: Prof. Dr. Stefan Lang Dr. Lorenz Wendt Zur Erlangung des Grades „Master of Science (Geographical Information Science & Systems) – MSc(GIS)” Reutern, 31. Januar 2020 BURNED AREA MONITORING USING COPERNICUS SENTINEL-2 Affidavit I hereby assure that the present Master Thesis will be completed without external help and without other than the sources cited, and that the work has not yet been submitted to any other examination office in the same or similar form. All statements of the Work that has been taken over literally or analogously is marked accordingly with the authorship. Alexandra Hander ALEXANDRA HANDER 104842 1 BURNED AREA MONITORING USING COPERNICUS SENTINEL-2 Acknowledgment I would like to take this opportunity to thank everyone who helped me during my studies and this master thesis. Above all, I would like to thank my two supervisors Prof. Dr. Stefan Lang and Dr. Lorenz Wendt. You have given me the opportunity to write my master's thesis on such an exciting and certainly future-oriented topic. Especially Dr. Lorenz Wendt supported and motivated me with a lot of patience and always with helpful feedback and suggestions. Many thanks also to the whole UNIGIS team for the competent support of my part-time studies. -
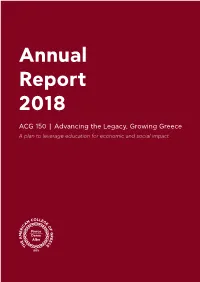
2018 Annual Report
Annual Report 2018 ACG 150 | Advancing the Legacy, Growing Greece A plan to leverage education for economic and social impact Table of Contents Board Chair’s Message ........................................................................................................................................................ 2 President’s Message .............................................................................................................................................................. 2 In Memoriam: Dr. John S. Bailey ..................................................................................................................................... 3 ACG 150 | Advancing the Legacy, Growing Greece ........................................................................................... 4 Strategic Developments: 2008-2018 ............................................................................................................................ 4 GOAL ONE Achieve high standards of performance across all educational programs and make a material difference in Greece’s economy and public health ..................................................................... 5 Pierce .............................................................................................................................................................................................. 6 Deree ............................................................................................................................................................................................. -

Collective Intelligence in Emergency Management 1
Collective Intelligence in Emergency Management 1 Running head: COLLECTIVE INTELLIGENCE IN EMERGENCY MANAGEMENT: SOCIAL MEDIA’S ROLE IN THE EMERGENCY OPERATIONS CENTER Collective Intelligence in Emergency Management: Social Media's Emerging Role in the Emergency Operations Center Eric D. Nickel Novato Fire District Novato, California Collective Intelligence in Emergency Management 2 CERTIFICATION STATEMENT I hereby certify that this paper constitutes my own product, that where the language of others is set forth, quotation marks so indicate, and that appropriate credit is given where I have used the language, ideas, expressions, or writings of another. Signed: __________________________________ Collective Intelligence in Emergency Management 3 ABSTRACT The problem was that the Novato Fire District did not utilize social media technology to gather or share intelligence during Emergency Operations Center activations. The purpose of this applied research project was to recommend a social media usage program for the Novato Fire District’s Emergency Operations Center. Descriptive methodology, literature review, two personal communications and a statistical sampling of fire agencies utilizing facebook supported the research questions. The research questions included what were collective intelligence and social media; how was social media used by individuals and organizations during events and disasters; how many fire agencies maintained a facebook page and used them to distribute emergency information; and which emergency management social media programs should be recommended for the Novato Fire District’s Emergency Operations Center. The procedures included two data collection experiments, one a statistical sampling of United States fire agencies using facebook, to support the literature review and research questions. This research is one of the first Executive Fire Officer Applied Research Projects that addressed this emerging subject. -

Aviation's Global Promise
16–20 JUNE 2014 ATLANTA, GA AVIATION’S GLOBAL PROMISE – CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FINAL PROGRAM www.aiaa-aviation.org #aiaaAviation Premier Sponsor 14-315 © 2014 Lockheed Martin Corporation Lockheed 2014 © BUILDING THE FOUNDATION FOR INNOVATION At Lockheed Martin, we know that innovation and creativity are critical to solving complex business problems. We are proud to support this year’s AVIATION 2014 Forum and salute its mission to bring industry together to address the challenges of today and tomorrow. www.lockheedmartin.com Executive Steering Committee AIAA AVIATION 2014 Welcome Welcome to Atlanta and to AVIATION 2014; we’re excited to share this year’s program with you as we explore aviation’s global promise! An essential driver of economic growth and stability, the aviation enterprise is in a phase of evolving business models, increased efficiency demands, emerging manufacturing methods, and constantly evolving technology integration. These trends offer unprecedented Juan Alonso opportunities and challenges for new capabilities that could transform the way we Stanford University utilize this critical asset. This year’s forum will build on the foundation of AVIATION 2013 to stimulate thought-provoking conversations among industry leaders and the engineering and technical professionals that develop and operate aviation systems. A full program of detailed technical discussions will underpin the high-level plenary and panel conversations to provide a wide-ranging overview of the state of the art in our industry. Jennifer Byrne In addition to cutting-edge technical research presentations, industry executives Lockheed Martin Aeronautics and thought-leaders will discuss challenges and opportunities associated with international aviation integration and operations, global supply chain and risk management, NextGen and SESAR implementation, and technology development and implementation. -

The General Elections in Greece 2019 by Anna Kyriazi
2019-3 MIDEM-Report THE GENERAL ELECTIONS IN GREECE 2019 BY ANNA KYRIAZI MIDEM is a research center of Technische Universität Dresden in cooperation with the University of Duisburg-Essen, funded by Stiftung Mercator. It is under the direction of Prof. Dr. Hans Vorländer, TU Dresden. Citation: Kyriazi, Anna 2019: The general elections in Greece 2019, MIDEM-Report 2019-3, Dresden. CONTENTS SUMMARY 4 1. THE GREEK PARTY-SYSTEM 4 2. THE IMMIGRATION ISSUE IN GREECE 8 3. ELECTORAL RESULTS 12 4. OUTLOOK 13 BIBLIOGRAPHY 14 AUTHOR 16 IMPRINT 14 SUMMARY • Following a large defeat by the conservative New Democracy in the May 2019 European Parliament elections the leftist Syriza government called for snap general elections in July. The result was seen as predetermined and the question was the margin of loss of the incumbent. • As expected, New Democracy won the 2019 general elections with just under 40% of the vote, securing 158 seats in parliament. This was the first time since the onset of the economic crisis that an outright majority was achieved. New Democracy’s electoral pledges included measures to stimulate growth, tax cuts, and strength- ening public safety and security. • The election confirmed the trend towards the re-concentration and the simplification of the party-system that was profoundly upset by the economic crisis. Despite its consecutive losses, Syriza managed to consolidate itself as the main left-wing pole of a two-party system, while New Democracy recovered on the right. Four more parties managed to enter parliament, but smaller challengers that emerged across the political spectrum during the crisis disappeared. -

Information Bulletin No.1
INFORMATION BULLETIN Europe | Wildfires 5 August 2021 Date of Disaster: Fires in multiple locations, since late July Glide №: WF-2021-000104-HUN N° of National Societies engaged in response operations (as of 5 August, based information available at the time): Bulgarian Red Cross, Hellenic Red Cross, Italian Red Cross, Red Cross of North Macedonia, Russian Red Cross, Spanish Red Cross, Turkish Red Crescent1 A Turkish Red Crescent volunteer gives water to a woman whose house has been destroyed by the wildfire. Photo: Turkish Red Crescent This bulletin is being issued for information only and reflects the current situation and details available at this time. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) is processing a DREF request from the Italian Red Cross, but at this point is not seeking funding or other assistance from donors for this operation. National Societies might, however, accept direct assistance to provide support to the affected population. In case you wish to offer any kind of support, please consult IFRC Regional Office for Europe Partnerships and Resource Development Team. 1The list of countries and National Societies mentioned in this report is not exhaustive, there may be other National Societies responding, this report is based on the information available as of 5 August 2021. Future updates may include information on additional National Societies responing to the fires in their respective countries. Public P a g e | 2 The situation – overview High temperatures, longer period of droughts, lower precipitation and strong wind bursts lead to the onset of fires across many parts of Europe in the months of July and August.