20P44.Pdf (3.469Mo)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Medicinal Plants of Guinea-Bissau: Therapeutic Applications, Ethnic Diversity and Knowledge Transfer
Journal of Ethnopharmacology 183 (2016) 71–94 Contents lists available at ScienceDirect Journal of Ethnopharmacology journal homepage: www.elsevier.com/locate/jep Medicinal plants of Guinea-Bissau: Therapeutic applications, ethnic diversity and knowledge transfer Luís Catarino a, Philip J. Havik b,n, Maria M. Romeiras a,c,nn a University of Lisbon, Faculty of Sciences, Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes (Ce3C), Lisbon, Portugal b Universidade NOVA de Lisboa, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Global Health and Tropical Medicine, Rua da Junqueira no. 100, 1349-008 Lisbon, Portugal c University of Lisbon, Faculty of Sciences, Biosystems and Integrative Sciences Institute (BioISI), Lisbon, Portugal article info abstract Article history: Ethnopharmacological relevance: The rich flora of Guinea-Bissau, and the widespread use of medicinal Received 10 September 2015 plants for the treatment of various diseases, constitutes an important local healthcare resource with Received in revised form significant potential for research and development of phytomedicines. The goal of this study is to prepare 21 February 2016 a comprehensive documentation of Guinea-Bissau’s medicinal plants, including their distribution, local Accepted 22 February 2016 vernacular names and their therapeutic and other applications, based upon local notions of disease and Available online 23 February 2016 illness. Keywords: Materials and methods: Ethnobotanical data was collected by means of field research in Guinea-Bissau, Ethnobotany study of herbarium specimens, and a comprehensive review of published works. Relevant data were Indigenous medicine included from open interviews conducted with healers and from observations in the field during the last Phytotherapy two decades. Knowledge transfer Results: A total of 218 medicinal plants were documented, belonging to 63 families, of which 195 are West Africa Guinea-Bissau native. -

Assessment of Threatened Medicinal Plants in Selected Locations in South-Western Nigeria *1Lawal I
Journal of Forestry Research and Management. Vol. 16(3).12-26; 2019, ISSN 0189-8418 www.jfrm.org.ng Assessment of Threatened Medicinal Plants in Selected Locations in South-Western Nigeria *1Lawal I. O., 1Rafiu B. O 2Falana A.R,. and 1Adam, A. A. 1Biomedicinal Research Centre, Forestry Research Institute of Nigeria, P.M.B. 5054, Ibadan. 2Federal College of Forestry, Ibadan, Nigeria. *Corresponding author: [email protected]; Tel: +2348035059095 ABSTRACT Plant as a biotic factor plays a significant role in the well-being of man. The relationship between man and plants has been very cordial since time immemorial. The burgeoning world population and the concomitant increase in anthropogenic activities led to the rapid erosion of natural ecosystems. This study was designed to assess the categories and the ethno-medicinal information of endangered medicinal plant species in Igbo-Nla, Odeda Local Government Area of Ogun state and International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Akinyele Local Government Area of Oyo state, Nigeria for proper referencing. The land area of 5 acres were marked out from the locations and divided into 4 compartments of 1.25 acres. The plant species found were identified, enumerated and recorded accordingly. Ethno-botanical information such as the local names, parts used and ailments which they can be used to treat were captured. Frequency of occurrence, species abundance/richness and others were used to analyze the information obtained. It was revealed that 33 species belonging to 12 angiosperm families were recorded in IITA while 40 species belonging to 25 plant families were recorded in Igbo-Nla with species in Fabaceae family having the highest frequency of occurrence at both study areas. -

Evaluation of Silvicultural Requirements of Dialium Guineense (Willd), a Neglected Indigenous Fruit in Nigeria by Oni, P.I
International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) ISSN: 2278-0181 Vol. 2 Issue 4, April - 2013 Evaluation Of Silvicultural Requirements Of Dialium Guineense (Willd), A Neglected Indigenous Fruit In Nigeria By Oni, P.I. Bells University of Technology Department of Biological Sciences, P.M.B 1015, Ota. Nigeria ABSTRACT Evaluation of silvicultural requirements of Dialium guineense to different potting media and pot sizes were investigated towards efforts in increased domestication and ex-situ conservation. Initial seeds viability test was carried out in the laboratory and subsequently 100 seeds were sown in a high humidity propagator and germination monitored for one month. Thereafter, thirty six fairly uniform vigorous seedlings were selected and potted into different pot sizes containing different potting media and growth performance monitored. Findings indicated that highest total plant height (9.54cm) was observed in the small pot size containing topsoil (M1P1) and least (8.16cm) in medium pot size with sawdust (M2P2. Highest plant diameter (15mm) was attained in the large pot size containing topsoil (M1P3) and least (13.00mm) in the medium pot size containing saw dust (M2P1). Interactions between potting media and all the growth parameters were significant (p<0.05) while interactionIJERT betweenIJERT pot sizes and growth parameters were not significant. Interactions between pot sizes and potting media were also not significant. Pot size effect was not particularly stable for most growth variables investigated, rather the type of potting medium used. The present study indicates that topsoil as potting medium was superior irrespective of pot sizes. Although pot size effects was not consistent, however raising the species in small to medium pot size with top soil as potting medium was most preferred. -

Antioxidant and Antimicrobial Activities of Dialium Guineense (Willd) Leaf Extract
Pharmacy and Pharmacology Research Vol. 1(1), pp. 1-7, May 2013 Full Length Research Paper Antioxidant and antimicrobial activities of Dialium guineense (Willd) leaf extract Gideon Ikechukwu Ogu1*, Joachim Ezeadila2 and John Meomikem Ehiobu1 1Department of Biological Sciences, Novena University, Ogume, Delta State, Nigeria. 2Department of Applied Microbiology and Brewing, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria. Accepted 14 May, 2013 ABSTRACT The in vitro antioxidant and antimicrobial activities of methanolic leaf extract of Dialium guineense were studied in order to provide a pharmacological basis for their ethomedicinal applications. Antioxidant activity was measured using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenging activity and reducing power assay. In addition, the total phenolic content was also analyzed. Antimicrobial activity was tested against clinical isolates of Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Candida albicans, Microsporium gypseum, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum using agar well diffusion method. The results of the DPPH scavenging activity of the extract showed a concentration dependent antioxidant activity with maximum scavenging activity (85.35%) observed at 250 µg/ml concentration and comparable to those of ascorbic (95.75%) and gallic acids (93.67%). The reducing potential of the extract (0.069 ± 0.003 nm) was also comparable to that of gallic acid (0.078 ± 0.022 nm), while the total phenolic content was 69.45 ± 0.002 mg/g gallic acid equivalent. The antimicrobial inhibition zone and minimum inhibitory concentration values of the extract ranged between 10.2 to 25.9 mm and 7.81 to 62.5 µg/ml respectively, with the Gram positive bacteria generally being most sensitive, followed by the fungi and the Gram negative bacteria. -

Annals of the History and Philosophy of Biology
he name DGGTB (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Deutsche Gesellschaft für Theorie der Biologie; German Society for the History and Philosophy of BioT logy) refl ects recent history as well as German tradition. Geschichte und Theorie der Biologie The Society is a relatively late addition to a series of German societies of science and medicine that began with the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften”, Annals of the History founded in 1910 by Leipzig University‘s Karl Sudhoff (1853-1938), who wrote: “We want to establish a ‘German’ society in order to gather Ger- and Philosophy of Biology man-speaking historians together in our special disciplines so that they form the core of an international society…”. Yet Sudhoff, at this Volume 17 (2012) time of burgeoning academic internationalism, was “quite willing” to accommodate the wishes of a number of founding members and formerly Jahrbuch für “drop the word German in the title of the Society and have it merge Geschichte und Theorie der Biologie with an international society”. The founding and naming of the Society at that time derived from a specifi c set of histori- cal circumstances, and the same was true some 80 years lat- er when in 1991, in the wake of German reunifi cation, the “Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie” was founded. From the start, the Society has been committed to bringing stud- ies in the history and philosophy of biology to a wide audience, us- ing for this purpose its Jahrbuch für Geschichte und Theorie der Biologie. Parallel to the Jahrbuch, the Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie has become the by now traditional medi- Annals of the History and Philosophy Biology, Vol. -
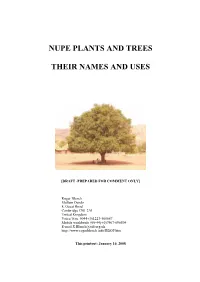
Nupe Plants and Trees Their Names And
NUPE PLANTS AND TREES THEIR NAMES AND USES [DRAFT -PREPARED FOR COMMENT ONLY] Roger Blench Mallam Dendo 8, Guest Road Cambridge CB1 2AL United Kingdom Voice/ Fax. 0044-(0)1223-560687 Mobile worldwide (00-44)-(0)7967-696804 E-mail [email protected] http://www.rogerblench.info/RBOP.htm This printout: January 10, 2008 Roger Blench Nupe plant names – Nupe-Latin Circulation version TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS................................................................................................................................ 1 TABLES........................................................................................................................................................... 1 1. INTRODUCTION....................................................................................................................................... 1 2. THE NUPE PEOPLE AND THEIR ENVIRONMENT .......................................................................... 2 2.1 Nupe society ........................................................................................................................................... 2 2.2 The environment of Nupeland ............................................................................................................. 3 3. THE NUPE LANGUAGE .......................................................................................................................... 4 3.1 General .................................................................................................................................................. -

Enquête Ethnobotanique De Six Plantes
Enquête ethnobotanique de six plantes médicinales maliennes : extraction, identification d?alcaloïdes - caractérisation, quantification de polyphénols : étude de leur activité antioxydante Donatien Koné To cite this version: Donatien Koné. Enquête ethnobotanique de six plantes médicinales maliennes : extraction, identifica- tion d?alcaloïdes - caractérisation, quantification de polyphénols : étude de leur activité antioxydante. Biologie végétale. Université Paul Verlaine - Metz, 2009. Français. NNT : 2009METZ014S. tel- 01752627 HAL Id: tel-01752627 https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01752627 Submitted on 29 Mar 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt -

Republique De Guinee
1 REPUBLIQUE DE GUINEE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION NATIONALE DE ET DE L’ENVIRONNEMENT L’ENVIRONNEMENT MONOGRAPHIE NATIONALE SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE GF / 6105 - 92 - 74 PNUE / GUINEE CONAKRY Novembre 1997 2 REPUBLIQUE DE GUINEE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’ENVIRONNEMENT DIRECTION NATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT MONOGRAPHIE NATIONALE SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE UNITE NATIONALE POUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE COMITE DE SYNTHESE ET DE REDACTION • Mr MAADJOU BAH: Direction Nationale de l’Environnement / Coordonnateur • Dr Ahmed THIAM: Université de Conakry • Dr Ansoumane KEITA: CERESCOR • Mr Sékou SYLLA: ONG / GUINEE - ECOLOGIE • Mr Mamadou Hady BARRY DNPE / Ministère de l’Economie, du Plan et des Finances • Mr Jean LAURIAULT: Musée Canadien de la Nature 3 PRÉFACE Notre Planète abrite un ensemble impressionnant d’organismes vivants dont les espèces, la diversité génétique et les écosystèmes qu’ils constituent représentent la diversité biologique, capital biologique naturel de la terre. Cette diversité biologique présente d’importantes opportunités pour toutes les nations du monde. Elle fournit des biens et des services essentiels pour la vie et les aspirations humaines, tout en permettant aux sociétés de s’adapter aux besoins et circonstances variables. La protection de ces acquis naturels et leur exploration continue à travers la science et la technologie offrirait les moyens par lesquels les nations pourraient parvenir à un développement durable. Les valeurs économiques, éthiques, esthétiques, spirituelles, culturelles et religieuses des sociétés humaines sont une partie intégrante de cette complexe équation de protection et de conservation des acquis. Or les effets adverses des activités humaines sur la diversité biologique sont de nos jours dramatiques. -

An Annotated Checklist of the Vascular Flora of Guinea-Bissau (West Africa)
BLUMEA 53: 1– 222 Published on 29 May 2008 http://dx.doi.org/10.3767/000651908X608179 AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE VASCULAR FLORA OF GUINEA-BISSAU (WEST AFRICA) L. CATARINO, E.S. MARTINS, M.F. PINTO BASTO & M.A. DINIZ IICT – Instituto de Investigação Científica Tropical, Trav. Conde da Ribeira 9, 1300-142 Lisboa, Portugal; e-mail: [email protected] CONTENTS Summary . 1 Résumé . 1 Resumo . 2 Introduction – The country’s main features . 2 Vegetation . 5 Botanic collections in Guinea-Bissau . 9 Material and Methods . 13 Checklist of the vascular flora of Guinea-Bissau . 19 Pteridophyta . 19 Magnoliophyta (Angiospermae) . 21 Magnoliopsida (Dicotyledones) . 21 Liliopsida (Monocotyledones) . 119 References . 151 Taxonomic Index . 191 SUMMARY A Checklist of Guinea-Bissau’s vascular flora is presented, based on the inventory of herbarium material and on recent collections. In addition to the name, we cite for each taxon the basionym and synonyms, the life form and habitat, as well as the chorology, Raunkiaer’s biological type, phenology and vernacular names if known. 1507 specific and infra-specific taxa were recorded, of which 1459 are autochthonous, belonging to 696 genera. This shows a higher diversity than the 1000 species estimated so far. In the autoch- thonous flora there are 22 species of Pteridophyta from 14 families; 1041 taxa of Dicotyledons from 107 families, and 396 taxa of Monocotyledons belonging to 33 families. Three taxa are probably endemic to the country. Key words: flora, phytogeography, ecology, chorology, vernacular names, Guinea-Bissau. RÉSUMÉ Ayant pour base l’inventaire des matériaux d’herbier et les récoltes récentes, une Checklist est présenté sur la flore vasculaire de la Guinée-Bissau. -

Germination Response of Velvet Tamarind (Dialium Guineense Willd.) Seeds Treated with Pre-Sowing Soaking in Water at Varying Temperatures and Durations
GSC Biological and Pharmaceutical Sciences, 2017, 01(02), 007-012 Available online at GSC Online Press Directory GSC Biological and Pharmaceutical Sciences e-ISSN: 2581-3250, CODEN (USA): GBPSC2 Journal homepage: https://www.gsconlinepress.com/journals/gscbps (RESEARCH ARTICLE) Germination response of velvet tamarind (Dialium guineense Willd.) seeds treated with pre-sowing soaking in water at varying temperatures and durations Ogbu Justin U. 1* and Otah Okocha I. 2 1Department of Horticulture and Landscape Technology, Federal College of Agriculture (FCA), Ishiagu 491105 Ebonyi State Nigeria 2Department of Horticulture technology, AkanuIbiam Federal Polytechnic, Unwana Afikpo Ebonyi State Nigeria Publication history: Received on 07 September 2017; revised on 06 October 2017; accepted on 07 November 2017 https://doi.org/10.30574/gscbps.2017.1.2.0014 Abstract The study evaluated Dialium guineense Willd. seeds response to pre–soaking in water for varying durations and temperature regimes, as a way of addressing the species seed dormancy challenge. Experimental laid out used was 2 x 4 factorial experiment in completely randomized design (r=4). Daily germination counts were taken for ten weeks after sowing. Data were analyzed by use of descriptive statistics and ANOVA at p<0.05. Results showed that germination started within the first seven days after sowing (DAS) for most of the treatments, but was erratic and neither uniform nor massive without effective pre-sowing treatment practice. Only seeds soaked in 75 C water for 6 hours reached highest 52.5% cumulative germination at 70 DAS, which was followed by seeds soaked in warm water at 45 °C for 6 hours that had 40% cumulative germination. -

Fermentation of the Fruit Pulp of Dialium Guineense (Velvet Tamarind) for Citric Acid Production Using Naturally Occurring Fungi
Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2015) 4(7): 432-440 ISSN: 2319-7706 Volume 4 Number 7 (2015) pp. 432-440 http://www.ijcmas.com Original Research Article Fermentation of the fruit pulp of Dialium guineense (Velvet tamarind) for Citric Acid Production Using Naturally Occurring Fungi Ajiboye, Adeyinka E.1* and Sani, Alhassan2 1Microbiology Unit, Department of Biosciences and Biotechnology, College of Pure and Applied Sciences. Kwara State University, Malete, Nigeria 2Department of Microbiology, Faculty of Life Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria *Corresponding author A B S T R A C T The aim of this research was to produce citric acid from the fruit pulp of Dialium guineense using naturally occurring fungi in a solid state fermentation. The fruit pulp was de-capped from the seed and dried at 60oC in an oven. Natural fermentation was carried out for seven days at 280C ± 2. The fungi were isolated and identified as Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum, K e y w o r d s Penicillium citrinum, Mucor hiemalis, Mucor racemosus, Rhizopus stolonifer, Citric acid, Alternaria tenuis Syncephalastrum racemosus, Saccharomyces cerevisiae and Solid state Schizosaccharomyces pombe. They were screened for citric acid production using fermentation, standard methods. Yellow coloration confirmed citric acid production after five Fruit pulp, days of incubation. Organisms that were strongly positive for citric acid production Czapek-dox include Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Penicillium chrysogenum, agar, Penicillium citrinum, Mucor racemosus, and Alternaria tenuris. They were used to ferment the fruit pulp of D. guineense in a solid state fermentation by inoculating Substrate 2ml spore suspension of 2x105 spores/ml of each of the isolates on separate Erlenmeyer flasks of 250ml for seven days at 28 ± 2 oC. -

65 Evaluation of the Effects of Anthonotha Macrophylla (Hardwood)
Evaluation Of The Effects Of Anthonotha macrophylla (Hardwood), Dialium guineense (Softwood) And Gas, Oven On The Nutrient Composition And The Organoleptic Properties Of Smoked Dried Clarias gariepinus. Okeke, P. A.1, Adibe, A. C.1, Ezenwenyi, J.U.2, Ogbonnaya, H.F.1, And Moghalu, K.1 1 Department of Fisheries and Aquaculture Management, Faculty of Agriculture, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria 2 Department of Forestry and Wildlife Management, Faculty of Agriculture, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Anambra State, Nigeria. Corresponding Author: [email protected] Abstract: A comparative evaluation of the effect of using Anthonotha macrophylla (Hardwood), Dialium guineense (Softwood) and gas oven on the nutrient composition and organoleptic properties of smoked dried Clarias gariepinus. Thirty (30) table size C. gariepinus species with mean weight of 500gm were procured, killed, eviscerated, rinsed with clean water and cut into steaks. They were shared into three batches as treatments A, B and C respectively. Each treatment was immersed in 10% brine solution for 30 minutes. Treatments A and B were smoked with charcoal of Anthonotha macophylla (Hardwood) and Dialium guineense (Softwood) for 24 hours, and treatment C with gas oven for 12 hours. They were allowed to cool at ambient temperature. There was no significant difference (p > 0.05) in the proximate nutrient composition of the fish samples from the three treatments as determined by A.O.A.C. (2000) method. There was no significant difference (p > 0.05) among the sensory parameters (texture, taste, aroma and flavour), using the 9 – point hedonic scale, except for the flavour. Treatments A and B had higher score of ash than those smoked with treatment C.