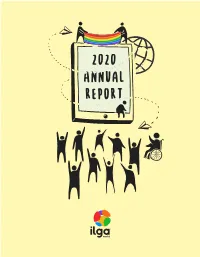Mise en œuvre de la Convention d‘Istanbul en Suisse
Rapport alternatif de la société civile
Ed. Réseau Convention Istanbul Juin 2021
Netzwerk Istanbul Konvention Réseau Convention Istanbul Rete Convenzione di Istanbul
1
Impressum
Editrice : Réseau Convention Istanbul www.conventionistanbul.ch / juin 2021 Coordination & rédaction : Simone Eggler (Brava, anciennement TERRE DES FEMMES Suisse) & Anna-Béatrice Schmaltz (cfd – l’ONG féministe pour la paix)
Auteurs des rapports thématiques approfondis : Voir les rapports approfondis
Traduction : weiss traductions genossenschaft (www.weiss-traductions.ch), Mirjam Werlen (Inter- Action Suisse), Izabel Barros (cfd – l’ONG féministe pour la paix)
Layout: Nora Ryser www.noraryser.ch
Table des matières
677
77888
Annex Remerciements Introduction
Le Réseau Convention d’Istanbul Rapport du réseau Structure du rapport Les limites dues aux ressources lors de l’élaboration du rapport Processus de monitorage CI : une autre façon de procéder pour les militant.e.x.s et le groupe de base
99
9
Lien avec les autres obligations internationales Langage inclusif
Définitions
10 Femmes 10 Genre 11 Intersexuation / intersexe / variations des caractéristiques sexuelles (VCS) 11 Personnes trans 11 LGBTIQA+ 11 Handicaps 12 Intersectionnalité 12 Inclusion 12 Violence à l’égard des femmes 12 Violence basée sur le genre 12 Violence « au domicile » 14 Violence numérique 14 Violence structurelle 14 Violence institutionnelle 15 Violence sexuée 15 Victime, personne concernée, survivant.e.x
15 Situation en Suisse
16 Situation des différents groupes de personnes concernées
17 Chapitre I – Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales
18 Art. 1 Buts de la Convention & Art. 2 Champ d’application de la Convention
20 Art. 3 Définitions
22 Art. 4 Droits fondamentaux, égalité et non-discrimination 25 Art. 5 Obligations de l’Etat et diligence voulue 27 Art. 6 Politiques sensibles au genre
29 Chapitre II – Politiques intégrées et collecte de données
30 Art. 7 Politiques globales et coordonnées 32 Mesures suprarégionales
33 Art. 8 Ressources financières
3
33 Art. 9 Organisations non gouvernementales et société civile 36 Art. 10 Organe de coordination 38 Art. 11 Collecte des données et recherche
- 42
- Chapitre III – Prévention
43 Art. 12 Obligations générales 47 Art. 13 Sensibilisation 47 Art. 14 Education 51 Art. 15 Formation des professionnel.le.x.s. 55 Art. 16 Programmes préventifs d’intervention et de traitement 57 Art. 17 Participation du secteur privé et des médias
62 Chapitre IV – Protection et soutien
63 Art. 18 Obligations générales 64 Art. 19 Informations 65 Art. 20 Services de soutien généraux & Art. 22 Services de soutien spécialisés 66 Art. 23 Refuges 68 Art. 24 Permanence téléphonique 69 Art. 25 Soutien aux victimes de violence sexuelle 70 Art. 26 Protection et soutien des enfants témoins 71 Art. 27 Signalement & art. 28 Signalement par les professionnels
73 Chapitre V – Droit matériel
75 Art. 29 Procédures civiles et voies de droit 76 Art. 30 Indemnisation 76 Art. 31 Garde, droit de visite et sécurité 77 Art. 32 Conséquences civiles des mariages forcés 78 Art. 33 Violence psychologique
78 Art. 34 Harcèlement
78 Art. 35 Violence physique 79 Art. 36 Violence sexuelle, y compris le viol 80 Art. 37 Mariages forcés 80 Art. 38 Mutilations génitales féminines 81 Art. 39 Avortement et stérilisation forcés
82 Art. 40 Harcèlement sexuel 82 Art. 42 Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom
du prétendu « honneur »
82 Art. 43 Application des infractions pénales 83 Art. 45 Sanctions et mesures 83 Art. 46 Circonstances aggravantes
83 Art. 48 Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations
obligatoires
4
84 Chapitre VI – Procédure pénale
85 Art. 49 Obligations générales 86 Art. 50 Réponse immédiate, prévention et protection 87 Art. 51 Appréciation et gestion des risques 87 Art. 52 Ordonnances d’urgence d’interdiction 88 Art. 53 Ordonnances d’injonction ou de protection 89 Art. 54 Enquêtes et preuves
90 Art. 55 Procédures ex parte et ex official
91 Art. 56 Mesures de protection 91 Art. 57 Aide juridique 92 Art. 58 Prescription
93 Chapitre VII – Migration et asile
94 Art. 59 Statut de résident 96 Art. 60 Demandes d’asile fondées sur le genre 101 Art. 61 Non-refoulement
105 Annex
106 Annex
5
Annex
Rapport approfondi : Les violences vécues par les femmes lesbiennes et les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes Rapport approfondi : Intersex Rapport approfondi : Enfants et violence domestique Rapport approfondi : Violence dans la vieillesse - violence contre les femmes âgées
Rapport approfondi : La protection des filles et des femmes handicapées et ayant besoin de soutien
et de soins Rapport approfondi : Enfants, adolescents et jeunes adultes dans le contexte de la violence domestique Rapport approfondi : Handicap Rapport approfondi : Les femmes réfugiées concernées par la violence
Rapport approfondi : Les violences conjugales à l’égard des femmes étrangères ayant un statut
précaire en Suisse
Rapport approfondi : Accès au soutien spécialisé pour les femmes ayant subi des actes de violence
à l’étranger Rapport approfondi : Convention d’Istanbul et intersectionnalité Rapport approfondi : Violence numérique à l‘égard des femmes Rapport approfondi : Violence pendant l‘accouchement Rapport approfondi : FGM/C Rapport approfondi : Les mariages forcés et les mariages de mineur-e-s Rapport approfondi : Exploitation du travail des femmes migrantes en Suisse Rapport approfondi : La violence sexualisée Rapport approfondi : La violence sexualisée dans le monde du travail Rapport approfondi : Violence contre les femmes dans le travail du sexe Rapport approfondi : Plan d’action féministe contre la violence envers les femmes Rapport approfondi : Le travail avec les personnes auteures de violence Rapport approfondi : Refuges Art. 23 Rapport approfondi : Médias Rapport approfondi : Collecte de données et recherche
6
Remerciements
Nous remercions toutes les personnes membres du Réseau Convention Istanbul ainsi que toutes les autres personnes impliquées et l’équipe de weiss traductions genossenschaft pour leur engagement et leur ténacité !
Introduction
La Convention d’Istanbul (CI) constitue un instrument précieux contre la violence, au service de la justice et de l’égalité. Elle permet en Suisse de s’attaquer à toutes les formes de violences basées sur le genre, de violences à l’égard des femmes et de violences dans l’entourage social. Les prémices de l’inclusion et de l’intersectionnalité jouent ainsi un rôle clé dans la lutte contre la violence de même
que dans le soutien et la protection des personnes concernées : car ce n’est qu’en reconnaissant dès le début et dans toutes les mesures les réalités de vie spécifiques et les besoins de toutes les person-
nes concernées que l’on pourra entrevoir un monde sans violence, juste et équitable. Nous voulons y contribuer en écrivant ce rapport.
Le Réseau Convention d’Istanbul
En Suisse, la CI a renforcé au sein de la société civile le travail en réseau et la collaboration des organisations non gouvernementales (ONG) et services spécialisés. Le Réseau Convention d’Istanbul
regroupe actuellement près de 100 services spécialisés et ONG œuvrant dans les domaines de la vio-
lence, de l’égalité des genres, LGBTIQA+, du handicap, de la vieillesse, des enfants, de la migration/ de l’asile et des droits humains. Ces acteur.rice.x.s travaillent main dans la main pour une application de la CI en Suisse qui soit inclusive et sans discrimination. Leur solide expertise leur permet d’établir une perspective intersectionnelle. Grâce à cette nouvelle mise en réseau et collaboration, les ONG et services spécialisés partagent leur savoir spécialisé et participent à la promotion et à l’application de
la CI dans la sphère non gouvernementale.
Rapport du réseau
Ce rapport alternatif est œuvre collective des membres du Réseau Convention d’Istanbul. L’ap-
plication intersectionnelle et sans discrimination de la CI constitue l’objectif principal de notre rése-
au. Une telle mise en œuvre réclame l’ancrage d’une perspective intersectionnelle aussi bien dans
l’analyse que dans la pratique. Le présent rapport fournit les principes fondamentaux pour atteindre
cet objectif, en intégrant de manière transversale les réalités mais aussi les éclairages des différents
groupes de personnes concernées ainsi que des différentes formes de violences. Nous souhaitons ainsi contrer la marginalisation de chacun des groupes de personnes concernées. L’intégration transversale sous-entend la possibilité d’intégrer un maximum d’éclairages sur chaque point ou question abordée dans les articles de la CI. Des approfondissements supplémentaires sont mis à disposition lorsque cela nous semblait nécessaire.
7
Structure du rapport
Le rapport se divise en deux parties : une première partie générale commune tenant lieu de catalogue de revendications suivie d’une annexe détaillée en deuxième partie. La partie principale propose une vue d’ensemble commune ainsi qu’un catalogue de revendications au fil des articles de la CI, qui ne peut toutefois pas aller dans les détails en raison de sa taille limitée. Afin de partager les connais-
sances et expériences tirées de la pratique de chacun.e.x des acteur.rice.x.s, l’annexe comprend les rapports spécialisés et thématiques d‘agences spécialisées et d‘ONG sur divers sujets.
Les limites dues aux ressources lors de l’élaboration du rapport
Nous désirons souligner ici que ce rapport n’a bénéficié du support financier que des ONG et
services spécialisés impliqués. Malheureusement, beaucoup d’entre nous n’ont ni le temps ni les
ressources financières pour un tel travail de base, c’est pourquoi chacun.e.x d’entre nous n’a pu consacrer qu’un temps limité à ce monitorage. En outre, nous avons dû nous définir un catalogue de revendications sans pouvoir aborder plus en détail chaque thème. Les rapports détaillés permettent
justement d’approfondir, même si les ONG n’ont pas toutes pu établir un rapport d’approfondisse-
ment faute de moyens suffisants et même si certaines auraient aimé avoir plus de temps pour cela, ce qui n’était pas possible faute de finances. Preuve en est donc que beaucoup d’ONG ne disposent que de fonds très limités ou uniquement privés pour leurs travaux de documentation, politiques et socié-
taux. C’est donc aussi pour cette raison que nous ne pouvons assurer l’exhaustivité de ce rapport et qu’il représente la situation à un moment donné, avec les ressources disponibles.
Actuellement, l’Etat suisse n’estime pas nécessaire de soutenir notre travail de monitorage de la CI
à l’aide des fonds publics. Afin que les connaissances et les expériences acquises puissent servir de façon effective aux objectifs de la CI, il y a toutefois besoin de ressources financières pour que la soci-
été civile puisse participer au processus démocratique. On peut citer à titre d’exemple la participation à l’établissement de rapports destinés aux organismes multilatéraux, tels que le présent rapport, ou à des procédures de consultation de politique intérieure. Ces travaux ne sont toujours pas soutenus
suffisamment par les pouvoirs publics mais sont pris en charge par les ONG, donc financés par des
fonds privés et en partie par du bénévolat.
Nous revendiquons donc l’attribution de fonds publics aux ONG qui participent au processus dé- mocratique dans le contexte de l’application de la CI.
Processus de monitorage CI : une autre façon de procé- der pour les militant.e.x.s et le groupe de base
Les militant.e.x.s bénévoles et les collectifs rencontrent de sérieux obstacles pour pouvoir parti-
ciper au processus de reporting sur la mise en œuvre de la CI à l’attention de GREVIO. En effet, le questionnaire s’adresse manifestement aux spécialistes (œuvrant pour le compte de l’Etat) qui tra-
vaillent dans divers domaines de la violence et disposent ainsi d’un savoir précis sur la pratique ainsi
que de données concrètes. Répondre aux questions demande de ce fait beaucoup de temps et les acteur.rice.x.s bénévoles n’en disposent que de peu. Nous le regrettons et en profitons pour propo-
8
ser un questionnaire plus ouvert avec une approche permettant aux acteur.rice.x.s important.e.x.s du domaine de la violence de participer avec force de proposition et de rapports sur leurs activités. Il donnerait l’occasion d’intégrer autrement le point de vue des expert.e.x.s par expérience, à savoir les
personnes concernées et en danger ; ce qui est très important.
Lien avec les autres obligations internationales
Il est important de considérer la CI et les obligations qui en découlent en lien et en interaction avec les autres conventions et engagements multilatéraux auxquels la Suisse a adhéré. Bien que la CI reste l’instrument le plus complet et concret contre ces formes de violence, ces obligations sont parfois présentes dans plusieurs autres conventions ou se trouvent précisées et complétées dans d’autres traités. Nous faisons notamment référence aux textes suivants : Convention de l’ONU sur les droits des femmes (CEDAW), Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant (CIDE), Convention de Lanzarote (appelée aussi Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels), Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques pré- judiciables (CEDAW/C/GC/31 - CRC/C/GC/18).
Les obligations issues des autres conventions doivent impérativement être respectées dans le ca-
dre de la mise en œuvre de la CI. Une procédure coordonnée permet aussi de créer des synergies et d’en profiter pour une mise en œuvre efficace. Dans le cas contraire, le risque est de voir se disperser
les ressources limitées, ou pire encore de les opposer les unes aux autres. Au niveau régional, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) doit également constituer une ligne directrice im-
pérative. Avant tout, nous encourageons le GREVIO à ne pas se laisser influencer par une conception
réactionnaire-traditionnelle de la cohésion sociale ou par la dénonciation de la Convention d’Istanbul par la Turquie. Tant le Conseil de l’Europe que l’Union européenne (UE) ont clairement pris position contre une attitude contraire à l’esprit de la présente Convention.1
Langage inclusif
Dans ce rapport, nous avons choisi d’employer la solution suivante afin d’inclure tous les genres :
acteur.rice.x.s
Définitions
La terminologie employée fait partie intégrante du discours et ne cesse d’évoluer, au gré des ex-
périences et des connaissances issues de la pratique et de la théorie. La langue modèle la réalité et
traduit les rapports de force. Ce constat est d’autant plus marqué dans la réalité sociétale et dans
nos représentations en ce qui concerne le genre mais aussi le thème de la violence. Le choix de la terminologie en matière de genre ne relève pas seulement d’une volonté de précision dans le conte-
nu mais exprime aussi la volonté de respecter ou au contraire de dominer des individus ou groupes d’individus. La façon dont on nomme la violence et dont on parle de la violence ne traduit pas simple-
- 1
- Voir « Opening remarks by Vice-President Jourová at the European Parliament Plenary debate on “Government at-
tempts to silence free media in Poland, Hungary and Slovenia », 10 mars 2021, « The EU Strategy on the Rights of the Child and the European Child Guarantee », mars 2021.
9
ment le degré de sensibilisation ou le niveau de connaissances de la société mais elle impacte aussi
très concrètement les mesures prises dans leurs applications concrètes. Pour toutes ces raisons, le
niveau discursif nous paraît important dans notre lutte contre la violence, ce qui requiert une utilisation consciente ainsi qu’un développement constant de la terminologie. C’est pourquoi nous nous
permettons de vous indiquer ici nos définitions (telles que valables actuellement !) et arguments sur le thème de la violence :
► les revendications en matière de terminologie : voir art. 3
Femmes
Nous employons le terme de femmes (sauf en cas de limitation explicite) pour toutes les personnes
qui s’identifient partiellement ou entièrement en tant que femmes, qui sont complètement ou en
partie perçues comme femmes par la société, ou qui sont/ont été socialisées en tant que femmes/
filles. Cette définition inclut les femmes et personnes trans et intersexuées, les personnes se trouvant
en dehors des concepts de genre, tout comme les femmes cisgenres.
Genre
Le genre est un concept pouvant être déterminé pour soi ou de l’extérieur, selon divers facteurs. Il s’oriente ainsi à des normes sociales stéréotypées : les caractéristiques sexuelles physiques, l’iden-
tité de genre et l’expression du genre. Pour les définitions, nous nous en référons aux Principes de
Jogyakarta plus 10.2 Par conséquent, les caractéristiques sexuelles comprennent les caractéristiques physiques individuelles attribuées au sexe, les chromosomes, les hormones ainsi que les caracté- ristiques sexuelles secondaires développées pendant la puberté. L’identité de genre est comprise comme faisant référence à la conscience individuelle d’appartenir à un genre qui peut, mais ne doit pas, correspondre au sexe assigné la naissance. On entend par expression de genre la représentation personnelle que l’on se fait du genre au travers de l’apparence extérieure, à savoir l’habillement, la coiffure, les accessoires, le maquillage mais aussi la façon de se comporter, de parler, ou encore les
prénoms ou pronoms utilisés. Le ressenti du genre peut également fluctuer, c’est-à-dire changer régulièrement ; on parle alors de genre fluide. Pour l’individu, ce qui est déterminant est son identité
de genre, qui ne dépend de considérations ni médicales, ni sociales, ni légales. Entre ces différents facteurs de genre, il n’existe aucun lien de causalité, ils restent tous indépendants les uns des autres dans leur forme. Ni les caractéristiques sexuelles physiques, ni l’identité de genre, ni même l’expression de genre ne sont limitées par la construction binaire homme-femme ; bien au contraire il existe une grande diversité. Toutefois, l’assignation du genre se fait la plupart du temps en Suisse
d’après la représentation binaire qu’il n’existe que des femmes et des hommes. Les rôles sociaux et les attributions définies par le temps et le lieu influencent fortement le genre socialement viable.
Dans notre société marquée par la binarité femme-homme, les enfants se voient attribuer leur genre
dès la naissance en fonction de leurs organes génitaux et de leurs caractéristiques sexuelles, iels se
retrouvent « normalisé.e.x.s » par un procédé chirurgico-hormonal. Puis leur socialisation se fait avec les stéréotypes de rôle correspondants. Notre travail se doit de reposer sur la diversité des genres et sur la connaissance de l’existence d’individus qui se situent en dehors des concepts de genre. Les mesures prises ne doivent donc pas se conformer aux représentations de genre binaires.
Quoi qu’il en soit, force est de constater que des personnes subissent des violences ou sont à ris-
que parce qu’elles sont perçues comme femme ou fille, se définissent entièrement ou partiellement comme femme ou fille, ou sont/ont été socialisées en tant que femme ou fille. Les valeurs sociales,
10
les représentations liées au genre et toutes les hiérarchisations connexes rendent légitimes les actes de violence aux yeux de leurs auteur.e.x.s
Intersexuation / intersexe / variations des caractéristiques sexuelles (VCS)
Intersexe/intersexuation est un terme pour décrire toutes les VCS. Les enfants intersexué.e.x.s naissent avec des caractéristiques sexuelles (anatomie sexuelle, organes reproducteurs, fonctionne-
ment ou niveaux hormonaux ou variations chromosomiques) qui ne correspondent pas à la défini-
tion des corps « mâle » / « femelle ». La grande majorité des personnes intersexuées/intersexes ont une identité de genre d’homme ou de femme.
Personnes trans
Trans signifie que l’identité de genre (voir définition de genre) d’une personne ne correspond pas ou pas complètement au genre qui lui a été assigné à la naissance. Les personnes trans peuvent s’identifier de façon binaire, à savoir exclusivement comme femme ou exclusivement en tant
qu’homme. Leur identité de genre peut toutefois se soustraire à cette dichotomie en tant qu’identité non-binaire. Les personnes qui ne sont pas trans sont considérées comme cis.
Lorsque nous employons le terme « femmes » dans ce rapport, sans le limiter explicitement aux femmes cis, nous incluons également les personnes trans.
LGBTIQA+
LGBTIQA+ est un terme générique regroupant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersexes, queer, agenre, asexuelles ou aromantiques ainsi que toutes les personnes qui ne s’iden-